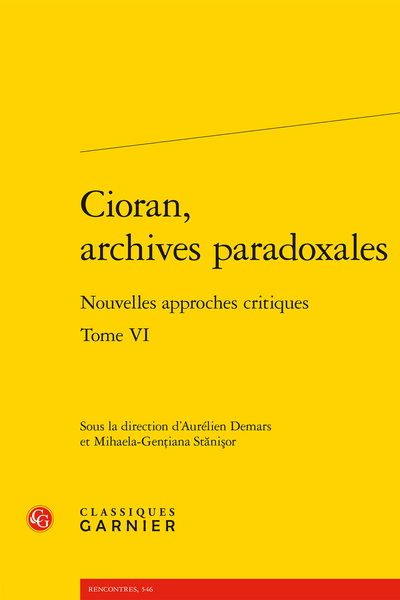
La promenade solitaire comme mode de vie et de regard
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Cioran, archives paradoxales. Tome VI. Nouvelles approches critiques
- Author: Stănişor (Mihaela-Genţiana)
- Abstract: Le dialogisme, toujours plus poussé sous la forme d’un monologue intérieur, cette caractéristique essentielle du style de Cioran, n’a pas échappé à l’œil fin de Philippe Reytier, l’auteur du livre de bandes dessinées On ne peut vivre qu’à Paris (Paris, 2021), ayant comme protagoniste Cioran. Celui-ci est croqué par le dessinateur dans un Paris désert, silencieux et atemporel, mais d’autant plus ouvert et favorable à la recherche de soi.
- Pages: 257 to 260
- Collection: Encounters, n° 546
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406130321
- ISBN: 978-2-406-13032-1
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13032-1.p.0257
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-03-2022
- Language: French
- Keyword: Comics, aphorism, dialogism, Paris, loneliness
LA PROMENADE SOLITAIRE
COMME MODE DE VIE ET DE REGARD1
Dans le peu d’entretiens qu’il a donnés, Cioran a eu tendance à faire de lui un personnage. Il racontait sa vie avec enthousiasme et humour, tout en insistant sur quelques aspects aventuriers (au sens donquichottesque), sur des épisodes héroïques qu’il avait réussi à surmonter (et dont il pouvait finalement rire) : l’insomnie (et ses promenades nocturnes), le suicide (et les effets thérapeutiques de l’écriture), l’amour (et ses déceptions), la mort (et la passion pour les cimetières ainsi que sa pratique du football avec des crânes dans son village natal). Dans toutes ces expériences, Cioran est seul, face à face avec celui qu’il aurait voulu être.
Le dialogisme, toujours plus poussé sous la forme d’un monologue intérieur, cette caractéristique essentielle du style de Cioran, n’a pas échappé à l’œil fin de Philippe Reytier, l’auteur d’un livre de bandes dessinées ayant comme protagoniste Cioran. Celui-ci est croqué par le dessinateur dans un Paris désert, silencieux et atemporel, mais d’autant plus ouvert et favorable à la recherche de soi. Cioran, devenu héros de papier, déroule son aventure ontologique dans le seul topos qui accepte de l’accueillir pleinement (ou de le laisser se perdre totalement) : Paris. « On ne peut vivre qu’à Paris », cette affirmation que Cioran aimait prononcer, dépasse, dans l’album de Reytier, toute touche ironique, pour aboutir à une tonalité tragique en sourdine. Notre œil est fasciné par les nuances pâles, ternes, bien choisies pour refléter le gris perpétuel d’une existence sous le signe de ce « rien de funèbre2 ». Un promeneur solitaire, pour lequel le peu de rouge est toujours ailleurs, dans les objets qu’il regarde (livres, bicyclette, ombre de femme, oiseau, fleur, feuille morte, 258bateau au loin…), a pu « abolir » « l’horreur3 » de la vie pour ne plus se courber sur ses malheurs : un Cioran tout droit, marchant les mains dans les poches, ou assis sur un banc, le regard lointain, réfléchissant en toute sérénité ou en expert4 à propos du destin de l’être.
Au moyen de cette surprenante forme d’expression qu’est la bande dessinée, Patrice Reytier a choisi d’illustrer sa propre vision de Cioran5, à partir de plusieurs aphorismes6, certains inédits. Cette représentation artistique nous rend le philosophe plus familier, plus proche de nous, plus accessible en quelque sorte puisqu’on peut associer texte et image. Le dessinateur reprend graphiquement les grands thèmes de Cioran (« l’histoire », « la sainteté », « le suicide », « le temps », « la fin », « la musique », « le rien », « le désespoir », « le néant », « la solitude », « l’être », etc.) et les troublantes répliques du penseur, tout en organisant ses dessins en triptyques7 qui portent un titre révélateur, sous forme d’un substantif, le plus souvent sans article, plutôt au singulier, plus rarement au pluriel (d’habitude sans article), par exemple « Lubies », « Ancêtres », « Terreurs », « Gifles », « Philosophes », « Fleurs »). Quelques noms sont accompagnés de l’article défini : « Les Résolutions », « Les Nuages », « Les Odieux », « Les Sentiments », « Les Illusions ». L’article joue ici le rôle de Charon, en assurant le passage du concept à l’affect, du connu à l’inconnu, de la notion singulière aux significations plurielles (de la trajectoire existentielle dessinée). Pour que l’effet descriptif des noms avance et s’approfondisse, Reytier introduit des aphorismes dont le titre se présente sous la forme d’un verbe à l’infinitif. Il y en a quatre : « Renoncer », « Rire », « Redouter », « Abolir ». L’effet définitionnel est projeté dans les quatre attitudes à prendre devant la vie, l’autre et la mort : le renoncement et l’abolition comme pratiques quotidiennes ; rire de tout et tout redouter comme attitudes scripturales.
259Ce qui trouble dans ces dessins et prouve un crayonnage raffiné et réaliste, c’est un imaginaire riche, c’est l’ouverture topique et la neutralité finale de l’espace ; l’image s’intériorise dans les dessins tout comme il arrive dans l’aphorisme cioranien : « Sentiment de solitude poussé jusqu’au ridicule. // Se sentir extérieur au monde, // à tous les coins du monde8. » L’aphorisme cioranien, selon la juste remarque de Reytier, jongle avec la ponctuation, avec les signes graphiques pour démarquer souvent son contenu : « Sa ponctuation martelait ses phrases comme s’il les découpait en moments successifs, en cases juxtaposées9. » C’est ce « successif » qui est mis en valeur par les bandes, sous l’effet des réflexions de longue durée du héros promeneur. Et cette durée est assurée par le passage visuel d’un triptyque à un autre.
Quant à l’appartenance de la bande dessinée au genre littéraire, les avis divergent. « Neuvième art » ou non, il est certain que, « dans un monde de plus en plus tourné vers le visuel, l’imaginaire de jeunes et moins jeunes est autant nourri de Superman que de Don Quichotte, de Tintin que de David Copperfield, de Betty Boop que de Mme Bovary10. » La bande dessinée est capable de traiter tous les sujets et même d’adapter une pensée aphoristique à une image visuelle en évolution. « Elle excelle, dans un rapport familier avec son lecteur, à susciter le rire, l’émerveillement, le rêve11. »
Il est vrai que cette intimité auteur-dessinateur, auteur-dessinateur-lecteur les transfigure tous les trois. Car il s’agit, non d’un texte émietté, mais d’une réunion de perspectives sous la dominance visuelle du décor. On y est projeté en tant que spectateur. Style littéraire, style graphique et style perceptif, voici les facettes de ces dessins ; finalement, mots et dessins ne font que porter le lecteur dans un espace atemporel et aspatial, devant « La Fin12 », devant ces chaises vides ionesciennes.
Dans les dessins de Patrice Reytier, la promenade cioranienne devient la forme tutélaire d’une initiation au regret13. C’est le regret qui devient 260le filon narratif, l’axe central qui unifie les images, les cadres, les endroits, le moi et ses doubles. Ce livre représente le regret en soi dans lequel Cioran réussissait à vivre.
Mihaela-Genţiana Stănişor
Université « Lucian Blaga » de Sibiu
1 Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, dessins P. Reytier, couleurs C. Piot, préf. S. Jaudeau, Paris, Payot & Rivages, 2021, 95 p.
2 Ibid., p. 20. L’aphorisme est scindé en trois vignettes : « Est nécessairement vulgaire // tout ce qui est exempt // d’un rien de funèbre. »
3 Ce verbe et ce nom figurent comme titres de deux séries de bandes.
4 Ibid., p. 76 : « Expert // en horreur de la vie. »
5 Ibid., p. 13 : « Cet autre regard sur l’œuvre de Cioran », comme il l’avoue dans la « Note du dessinateur ».
6 Il nous précise que les quinze premiers aphorismes lui « ont été confiés par Pierre Alechinsky » et qu’il a eu accès aux archives de Cioran et à « un recueil sans titre et sans date, contenant 61 aphorismes manuscrits considérés comme inédits ». « Note du dessinateur », p. 12-13.
7 Au sens que donne le Dictionnaire Larousse : « Œuvre littéraire ou artistique composée de trois parties offrant une certaine symétrie. » https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/triptyque/79793 (consulté le 15 novembre 2021).
8 Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, « Solitude », op. cit., p. 61.
9 Ibid., « Note du dessinateur », p. 12.
10 Cf. Encyclopédie Larousse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bande_dessin%C3%A9e/185578 (consulté le 15 novembre 2021).
11 Ibid.
12 Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, « La Fin », op. cit., p. 31 : « Quand tout le monde me donnera raison, // La Fin sera en vue. »
13 Ibid., p. 84 : « Regret » : « Vivre non pas // dans tel ou tel regret // mais dans le regret en soi. »