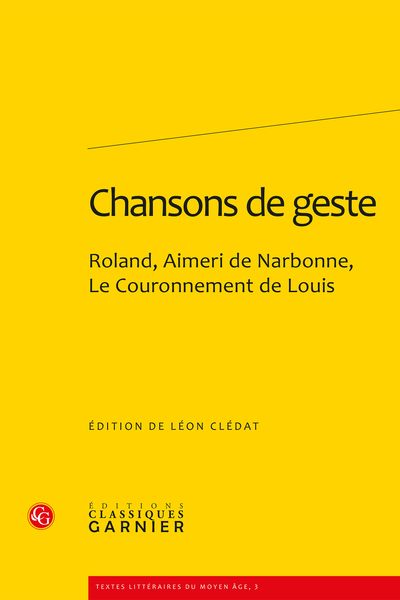
Explication des archaïsmes
- Publication type: Book chapter
- Book: Chansons de geste. Roland, Aimeri de Narbonne et Le Couronnement de Louis
- Pages: 9 to 16
- Collection: Literary Texts of the Middle Ages, n° 3
- CLIL theme: 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN: 9782812442520
- ISBN: 978-2-8124-4252-0
- ISSN: 2261-0804
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-4252-0.p.0009
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-09-2010
- Language: French
EXPLICATION DES ARCHAÏSMES
Il est nécessaire de donner au lecteur quelques explications préalables sur les mots archaïques, les vieus gallicismes et le rythme employés dans notre traduction.
MOTS
Parmi les mots dont nous allons donner la liste alphabétique, les uns existent encore, mais ont perdu une partie de leur signification, d’autres figurent dans nos dictionnaires à titre d’archaïsmes1, d’autres enfin ont complètement disparu de la langue.
Adouber : Armer, revêtir de l’armure, et non pas seulement « armer chevalier ».
Ahan : Grande fatigue, grande peine. On dit encore « suer d’ahan ».
Amiral : Émir, grand chef des Sarrasins.
Appeler (en) : Interpeller.
Armes : Ce mot ne désigne pas seulement les armes offensives, mais aussi – c’est le sens ordinaire – les armes défensives, l’ensemble des pièces de l’armure.
Aumaçour : Nos trouvères font de ce mot (qui est l’arabe almansor = le victorieus) le nom d’une dignité chez les Sarrasins.
Baillie (avoir en) : Avoir sous sa puissance, gouverner.
Baron : Ce mot n’a pas de signification plus précise que celle de grand seigneur. Il s’applique aussi bien à l’empereur, au pape, aus rois, qu’aus comtes, aus ducs, etc. Il s’emploie adjectivement avec le sens de plein de vaillance.
Beau frère : Terme d’affection : mon ami.
Bliaud : Espèce de tunique, que l’on gardait sous le haubert.
Boucle, bouclier : Voyez écu.
Brant : Épée, et spécialement lame de l’épée.
10Brogne : Est le plus souvent synonyme de haubert (Voyez ce mot). A l’origine, la brogne est un haubert sans mailles, constitué par une tunique de cuir sur laquelle sont appliquées des plaques d’acier.
Carreau : Trait que lance l’arbalète.
Chef : Ce mot est constamment employé avec le sens de tête, qui est le sens primitif.
Chenu : Blanc.
Coiffe : Voyez haubert.
Com : Forme abrégée de comme.
Conquêter : Conquérir.
Courant : Rapide. Épithète de nature, appliquée au cheval.
Dame-Dieu : Seigneur Dieu. A l’origine, le mot dame est des deus genres et signifie à la fois « seigneur » et « dame ».
Démener : Voyez mener.
Dérompre : Composé et synonyme de rompre.
Dessur, dessus : Sur.
Devers : Deus sens : En se dirigeant vers, en partant de.
Dextre : Adj. : droit, droite. Subst. : main droite. – Dans la locution « mener en destre », nous avons conservé à ce mot sa forme populaire, à laquelle se rattache le dérivé « destrier ».
Doublé : Adjectif qui s’applique au haubert. Le haubert doublé parait être un haubert à doubles mailles.
Droit, droite : Cet adjectif a souvent le sens de légitime.
Droiturier : Légitime, juste.
Dromon : Grand navire.
Écu : L’écu portait au centre une boucle, d’où le nom de bouclier (= garni d’une boucle). Il était en bois, recouvert de cuir. On le décorait de peintures (fleurs, animaus) et parfois de dorures.
Enseigne : Drapeau, et aussi cri de guerre. L’enseigne-drapeau était fixée par des clous au-dessous du fer de la lance.
Épié : Espèce de lance. Ce mot n’a rien de commun avec épieu.
Escient (à mon), ou sans préposition, mon escient, ou encore mien escient : A ma connaissance, comme je le sais, autant que je puis savoir. Cette locution s’emploie, bien entendu, avec les autres adjectifs possessifs.
Férir : Frapper. Nous n’employons plus guère ce verbe que dans la locution « sans coup férir ».
Fleuri : Blanc (comme les arbres fruitiers en fleurs).
Frère : Au vocatif : ami.
Gemmé : Garni de pierres précieuses. Gemmé d’or : orné d’or et de pierres.
1. Gent, gente : Adj. : beau, noble, gracieus.
2. Gent : Subst. : race, peuple, armée, troupe, gens.
Geste : Substantif féminin : histoire.
Glouton : Terme d’injure, sans signification précise.
Gonfanon : Enseigne, fixée par des clous au-dessous du fer de la lance.
Haubert : Tunique en mailles de fer. La partie du haubert qui protégeait le menton s’appelait la ventaille, et celle qui couvrait la nuque, les oreilles et la tête s’appelait la coiffe. Le heaume était posé sur la coiffe.
Heaume : Casque d’acier, de forme conique, se laçant par dessus la coiffe du haubert, et muni d’un avancement sur le nez, qu’on appelait nasal ou nasel. Le heaume pouvait être garni d’or et de pierreries.
Hoir : Héritier.
Jaseran : Proprement d’Alger (arabe Djezaïr).
Leur (le) : Pour leur. Voyez mien.
Lignage : Descendance, race, parenté.
Loyaument : Forme archaïque de loyalement.
Manon : Mahomet.
Maître : Principal, – e, dans les locutions telles que « maître-tour, maître-port, etc. ».
11Marche : Province frontière, et, par extension, province, pays, seigneurie.
Mener : Ce verbe et son composé démener s’emploient constamment dans des locutions telles que « mener ou démener joie, deuil, douleur, fierté, etc. », qui signifient : manifester de la joie, de la douleur, etc.
Mercier : Verbe ; sens actuel du composé remercier.
Merveiller (se) : S’émerveiller.
Mie (ne) : Locut. adv. : ne point.
Mien (le) : Forme aujourd’hui pronominale, employée au lieu de la forme adjective mon. On a de même le tien pour ton, le sien pour son, etc. On trouve aussi mien (sans le) pour mon. Voyez escient.
Mil : Pour mille. A l’origine, mille était le pluriel de mil, mais les deus mots se sont employés de bonne heure l’un pour l’autre.
Monjoie : Cri de guerre des Français, et nom de l’enseigne de Charlemagne. Mot d’origine très incertaine.
Montant : Valeur, dans les locutions telles que « n’en pas donner le montant d’un bouton ».
Moult : Beaucoup, très, beaucoup de. – Nous avons conservé à ce mot la forme sous laquelle il est connu ; mais la forme correcte serait mout.
Moutier : Église ; monastère.
Mul : Masculin de mule. Nous n’avons aujourd’hui que le diminutif mulet.
Nasal : Partie du heaume (Voyez ce mot), qui protège le nez.
Nôtre (le) : Pour notre. Voyez mien.
Olifant : Éléphant, ivoire, cor d’ivoire.
Onques : Jamais.
Ost : Armée, camp.
Parage : Comme lignage. Voyez ce mot.
Parmi : Peut s’employer en parlant du milieu d’un objet.
Puy : Montagne.
Rière-garde : On a substitué dans ce mot le composé « arrière » au simple « rière » = latin retro.
Senestre : Gauche.
Sien (le) : Pour son. Voyez mien.
Sire : S’emploie pour seigneur, même au vocatif. Un roi s’adressant à un vassal l’appèlera sire.
Sommier : Cheval destiné à porter les fardeaus, bête de somme.
Targe : Espèce de bouclier (rond ?).
Tien (le) : pour ton. Voyez mien.
Vaincre une bataille : La gagner.
Val : Vallée. Le pluriel archaïque est vaus, conservé dans la locution « par monts et par vaus ». En dehors de cette locution, nous employons le pluriel « vals ».
Vassal : S’emploie souvent, par extension, pour seigneur, baron (Voyez ce mot), vaillant chevalier. Adjectivement, il équivaut à vaillant.
Ventaille : Voyez haubert.
Vêprée : Soir.
Vôtre (le) : Pour votre. Voyez mien.
12FORMES, SYNTAXE, TOURNURES, LOCUTIONS
Les adjectifs se rattachant à la déclinaison latine en is, et les participes présents, même employés comme adjectifs, ne prenaient pas d’e au féminin. On disait « grand et fort bataille », comme on dit encore « à grand peine, grand rue, grand-mère ». Nous avons maintenu cette particularité toutes les fois que la conservation du rythme y était intéressée. Les adjectifs de cette catégorie qui se rencontrent le plus souvent sont : grand, fort, tel, mortel, royal, loyal, et les participes présents.
–L’article peut être omis devant les titres suivis du nom de personne : comte Aimeri, roi Marsile, au lieu de « le comte Aimeri, le roi Marsile ».
–Le pronom sujet est très souvent omis, comme en latin :
Pleure des yeus, tire sa barbe blanche
(Roland, laisse 164)
pour « il pleure, etc. »
–Un pronom peut correspondre à un nom qui ne se trouve pas dans la proposition précédente. Ainsi, dans la chanson de Roland (laisse 58), on lit : « S’il était vif, je vous l’eusse amené », et le pronom il représente le calife, qui n’est nommé dans aucune des sis propositions exprimées dans les cinq vers qui précèdent.
–Le participe passé peut s’accorder avec le complément direct qui suit et ne pas s’accorder avec celui qui précède. La liberté de l’accord est complète.
–Il arrive constamment que le verbe est précédé par son complément direct et suivi par son sujet. Mais, en général, à défaut des cas disparus de l’ancienne déclinaison, le contexte éclaire le sens.
13Exemple :
L’âme de lui emporte Satanas.
(Roland, laisse 102.)
Il est clair que ce n’est pas l’âme qui emporte.
Il faut seulement prendre garde à ne pas confondre une phrase affirmative avec une phrase interrogative, quand c’est un pronom sujet qui suit le verbe.
–Nous avons dû conserver quelquefois l’ellipse du de possessif : « La mort Roland ; fils Capuel ; le fils Sainte-Marie », pour « La mort de Roland ; fils de Capuel ; le fils de Sainte-Marie. »
–L’ellipse de la conjonction que et du pronom qui est fréquente :
Bien vous savez contre païens j’ai droit ;
(Roland, laisse 276)
c’est-à-dire : vous savez que…
Ellipse de qui :
S’il a parent m’en veuille démentir.
(Roland, laisse 307.)
–La conjonction que peut équivaloir à si bien que ou à car :
Dieu le sauva, qu’au corps ne l’a touché.
(Roland, laisse 109.)
–L’i du pronom relatif qui et la voyelle de la conjonction si (se en vieus français) s’élident fréquemment :
Hors Saragosse qu’est en une montagne.
(Roland, laisse 1.)
S’en rière-garde il peut trouver Roland,
Le combattra avec toute sa gent.
(Roland, laisse 51.)
En revanche, on peut n’avoir pas d’élision devant il :
Et, si il peut, Roland y périra.
(Roland, même laisse.)
14–Pour exprimer cette idée que pas une des personnes dont on parle ne s’abstient d’agir de telle ou telle façon, on emploie constamment la tournure : « N’y a celui qui ne », avec ou sans ellipse du pronom relatif :
N’y a marin, de lui ne se réclame.
(Roland, laisse 133.)
N’y a celui ne pleure et se lamente.
(Roland, laisse 162.)
–Les invocations à Dieu et aus saints, sous diverses formes, étaient devenues « de style » pour appuyer une affirmation. Ce serait faire un contresens que de leur attribuer leur pleine valeur ; leur signification est presque aussi atténuée que celle du « Diable m’emporte » dans ces vers de Musset :
On dit triste comme la porte
D’une prison,
Et je crois, le Diable m’emporte,
Qu’on a raison.
Il faut en dire autant des locutions telles que : « Je ne le veus celer, en pure vérité, etc. », et aussi des comparaisons employées pour exprimer le peu de valeur ou d’utilité d’une chose : « Cela ne lui vaut un denier, un bouton, etc. »
Notons encore les locutions : « peu s’en faut qu’il ne perde le sens, qu’il n’enrage, que son cœur n’éclate », pour exprimer un sentiment très vif de colère, de douleur, etc.
VERSIFICATION
On nomme « laisses » les couplets épiques ; les laisses contiennent un nombre indéterminé de vers. Tous les vers d’une même laisse ont la même assonance ou la même rime. L’« assonance » diffère de la 15rime en ce qu’elle porte uniquement sur la voyelle. Les plus anciennes chansons de gestes sont assonancées et non rimées.
Nous avons conservé l’assonance ou la rime toutes les fois qu’elle se présentait naturellement ou qu’on pouvait la rétablir sans trop modifier le vers et sans altérer le sens. Les assonances sont souvent difficiles à maintenir, par exemple l’assonance en a : les mots cheval, chaud (chalt), courant (prononcé coura-n’t) assonaient entre eus ; il faudrait aujourd’hui remplacer chaud et courant par des mots de même sens ayant un a oral tonique, et on n’en trouve pas.
Dans un certain nombre de chansons de gestes (Aimeri de Narbonne est du nombre), chaque laisse se termine par un petit vers, à chute féminine, qui n’assone pas avec les autres.
–Le vers ordinaire des chansons de geste est le décasyllabe, avec césure à la quatrième syllabe. Après la césure, comme aujourd’hui encore à la fin du vers, on admet une syllabe féminine qui ne compte pas, même lorsqu’elle n’est pas élidée.
Exemple :
Le roi Marsile la tient, qui Dieu point n’aime.
(Roland, laisse 1.)
Ce vers n’a dis syllabes qu’à la condition de traiter la syllabe féminine de Marsile, à la césure, comme la syllabe féminine de aime à la fin du vers.
–Il y a des mots qui ne comptent pas aujourd’hui pour le même nombre de syllabes qu’en vieus français. Ainsi chrétien, diable, avaient trois syllabes ; destrier, étrier, lévrier, n’en avaient que deus. Nous avons dû le plus souvent maintenir le compte ancien.
En outre l’e après une voyelle (par exemple dans épée) n’était pas encore muet et comptait pour une syllabe :
16Devant Roland s’enfuiënt les païens.
(Roland, laisse 167.)
Enfin l’e final pouvait ne pas s’élider devant la voyelle initiale du mot suivant (c’est ou ce est), et l’hiatus était autorisé sans aucune réserve.
1 Tel douber, ahan, férir, etc. – Nous n’avons pas fait figurer, dans ce petit glossaire, des mots tels que empenné, autour (substantif), besant, ire, qui, bien que peu employés aujourd’hui, n’exigent pas d’autres explications que celles qui se trouvent dans les dictionnaires courants.