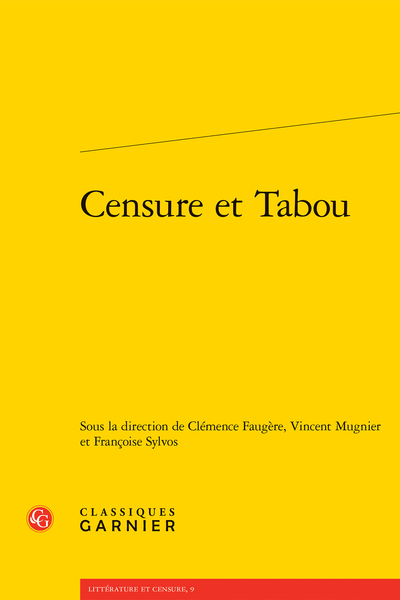
Introduction
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Censure et Tabou
- Auteur : Sylvos (Françoise)
- Pages : 135 à 137
- Collection : Littérature et censure, n° 9
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406150121
- ISBN : 978-2-406-15012-1
- ISSN : 2492-301X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15012-1.p.0135
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/10/2023
- Langue : Français
Introduction
Depuis que l’anthropologie, la psychanalyse, la sociologie et la linguistique s’y intéressent, plusieurs typologies des tabous ont été proposées. Certaines d’entre elles sont établies d’après une échelle graduée d’acceptabilité : on part de ce qui est admis pour aller vers ce qui est toléré ; le troisième degré des tabous, le plus sensible, est l’interdit1. D’autres typologies sont fondées sur des critères qualitatifs permettant d’opposer tabou comportemental et tabou conversationnel2 ; tabou sacré et tabou profane, tabou général et particulier, tabou primaire – qui se réfère aux objets et aux personnes – et tabou secondaire, qui a trait aux conséquences, pensées ou émotions.
La troisième partie de cet ouvrage collectif, « Dire l’indicible, Braver les tabous conversationnels en politique », passe d’un sens primaire du mot tabou, qui concerne l’inconscient collectif et son inscription dans la trame des œuvres, à un sens que l’on pourrait considérer à tort comme moins profond, et nous verrons pourquoi un peu plus loin. Le tabou politique apparaît comme tributaire des circonstances historiques et des opinions, du contexte politico-religieux ; il est l’apanage d’une autorité. Sa transgression est présentée par la société comme un danger pour une communauté. Or, en période de dictature, la transgression menace surtout l’ordre établi qui l’édicte. Le tabou en politique vise précisément à la conservation d’un régime autoritaire. Autrement dit, il est tout aussi arbitraire que les tabous fondamentaux de l’inceste et de l’anthropophagie. Mais, à la différence de ces derniers, l’interdit d’ordre sociopolitique ne peut pas faire l’unanimité et n’est pas nécessairement intégré par les individus dans la mesure où son existence ne trouve souvent d’autre justification que le maintien d’un ordre figé entre les mains d’une poignée de dirigeants et d’idéologues. Implicite ou inter-dit social, le tabou politique voit sa transgression condamnée par la loi. Des dispositifs institutionnels tels que la censure, l’index ou la PVDE 136sous Salazar sont mis en place pour contrôler discours et images. Tout un arsenal de sanctions – amendes, suspension3, retrait4, destruction5 des œuvres, incarcération, torture, exécution des rebelles6 – est prévu. Établie officiellement ou mise en place par la pratique, la répression est étouffante ou violente. Elle instaure la terreur par l’exemple. Mais le tabou politique suscite très souvent des stratégies de contournement.
Bien que n’étant pas intériorisés au même degré que les tabous fondamentaux de l’inceste et de l’anthropophagie, les tabous politiques ont des racines profondes. Cette facette de la question trouve un éclairage grâce à la réflexion de Freud sur le personnage de Moïse. L’homme Moïse et le monothéisme conclut à la superposition des pouvoirs paternel, religieux et politique7. Les tabous politiques renvoient à un scénario familial symbolique. Qu’il soit monarchique, industriel, colonial ou dictatorial, le régime autoritaire qui les édicte s’inspire d’un schéma familial patriarcal. Ses représentants endossent le rôle dramatique du père censé inspirer une obéissance aveugle à un peuple enfant. Nombreux sont les documents concernant Salazar – personnage qui est au cœur de cette série d’articles –, à souligner le paternalisme de son régime8. Ainsi, la solution de continuité entre la troisième partie de cet ouvrage collectif et celles qui précèdent n’est qu’apparente.
Dans cet ensemble consacré aux tabous conversationnels d’ordre politique, on analyse les stratégies scripturales qui tendent à déjouer les 137interdits pour en rendre compte et pour dénoncer de manière subtile la censure, elle-même tabou. Les détours du discours destinés à contester sourdement la politique dictatoriale de Salazar (1889-1970) sont à l’étude. À travers les trois articles d’Armando Nascimento Rosa, de Maria da Graça Gomes de Pina et de Guia M. Boni, une période de régression des libertés est étudiée ici, la censure qui avait disparu au Portugal depuis 1820 ayant été réintroduite en 1933 en tant que régime ordinaire de l’Estado novo (1933-1974). Ce groupement d’articles offre une pluralité de points de vue sur ce régime qui réprimait durement ses opposants et n’hésitait pas à recourir à la torture. Ce volet de l’ouvrage apporte une contribution bienvenue à la connaissance des méthodes usitées par Fernando Pessoa (1888-1935), José Cardoso Pires (1925-1998) et Dinis Machado (1930-2008) pour continuer d’affirmer leur esprit critique et leur liberté dans un contexte dictatorial. Cette série d’articles est donc d’un apport précieux pour envisager les rapports entre histoire et poétique, mais aussi pour établir une typologie des stratégies littéraires de contournement des tabous politiques. L’humour, le style sibyllin et les images négatives cultivées par Pessoa introduisent, dans le genre traditionnellement protestataire du fado, une fresque sociale des temps de la censure sous le régime de Salazar. José Cardoso Pires use quant à lui de la fable et de l’allégorie, des discours alambiqués et de propos de vérité générale. C’est à nouveau la poétique des genres littéraires qui intervient dans le combat à fleurets mouchetés de Dinis Machado contre la dictature, dans son jeu de matador avec la censure. Plusieurs stratégies sont adoptées dans sa trilogie : le choix d’un genre populaire, le roman policier, suffisamment prolifique pour donner du grain à moudre à la censure ; la déstabilisation du lecteur face au caviardage du récit policier par les passages philosophiques, existentialistes ou anarchisants, le décentrement géographique et les jeux de miroir entre le Portugal et les fascismes voisins, espagnol et italien – situer l’intrigue criminelle au Portugal étant frappé d’interdit par la censure.
Françoise Sylvos
Université de La Réunion,
Centre de recherches DIRE
1 Ouidade Sabri-Zaaraoui, op. cit., p. 7.
2 Tony Walter, « Modern Death : taboo or not taboo ? », Sociology, 25, 2, 1991, p. 293-310.
3 Voir l’amendement Riancey sous le Second Empire.
4 On peut prendre pour exemples les affiches de cinéma censurées pour des raisons de morale (voir les affiches de Larry Flint, de Milos Forman, en 1997 ; de The Girl with the dragon Tatoo, de David Fincher en 2011 ; Sin City 2, de Franck Miller, en 2014), ou pour des raisons politiques comme le film sur Guantanamo du Britannique Michael Winterbottom, en 2006.
5 En 1810, l’édition originale de De l’Allemagne, par Madame de Staël, est mise au pilon et brûlée.
6 On peut se référer au cas tristement célèbre de Federico Garcia Lorca, fusillé en août 1836, à la condamnation au goulag de Vladimir Chalamov, auteur des nouvelles Récits de la kolyma (1907-1982), ou à l’exemple du poète saoudien Ashraf Fayad qui, fouetté, a été condamné à mort pour apologie de l’athéisme – la peine a été commuée en un emprisonnement de huit ans.
7 L’ensemble de l’ouvrage met l’accent sur la dimension paternelle des religions monothéistes, en relation avec le meurtre originel et la dévoration du père par la horde primitive. Quant au chapitre « Le progrès dans la vie de l’esprit », il fait un parallèle entre le statut des dieux et celui des rois dans certaines cultures (Sigmund Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1988, p. 210).
8 Graça dos Santos, Le Spectacle dénaturé, le théâtre portugais sous le règne de Salazar[1933-1968], Paris, CNRS Éditions, 2002, p. 34.