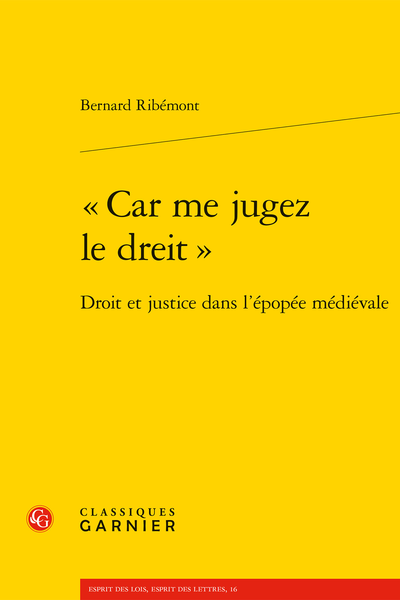
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : « Car me jugez le dreit ». Droit et justice dans l’épopée médiévale
- Pages : 7 à 15
- Collection : Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n° 16
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406150374
- ISBN : 978-2-406-15037-4
- ISSN : 2264-4148
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15037-4.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/08/2023
- Langue : Français
Préface
Rechercher le droit dans les chansons de geste tenait de la gageure … ou de la provocation ! Une attitude intellectuelle qui, piquant la curiosité du chercheur, ne pouvait pas déplaire à Bernard Ribémont, connaisseur infatigable de la centaine de textes qu’il cite et compare. Il avait raison. Les exemples convoqués montrent que l’épopée n’est pas étrangère au droit et qu’elle crée même un droit que l’auteur appelle fort justement « le droit épique ». Il y est partout question de « faire droit », pour réparer les torts faits à la victime, pour affirmer la puissance du roi ou du seigneur détenteurs de la justice, pour établir la vérité. Autrement dit, au cœur de la violence particulièrement exacerbée que met en scène la chanson de geste, surgit le droit. Quelles en sont les caractéristiques ? Au service de quelle justice se place-t-il ? Quelles valeurs véhicule-t-il lors de sa création au xiie siècle, puis aux siècles suivants, quand la littérature médiévale continue à le colporter ?
Si nous considérons les chansons de geste comme un produit fini sans nous interroger sur la véracité de leurs origines plus ou moins légendaires, si nous étudions leur existence brute que livre l’écriture, nous devons nous reporter au tournant du xiie siècle quand, à partir de la Chanson de Roland et jusque vers 1250, ces textes se multiplient, avant de se prolonger aux deux derniers siècles du Moyen âge par leur mise en prose, leur réécriture ou la création de quelques chansons tardives. Leur apparition et l’engouement pour le genre épique peuvent être facilement mis en rapport avec les changements sociaux et politiques qui affectent alors l’Occident, les croisades et la lutte contre les Infidèles, et pour le royaume de France, la force de l’aristocratie en même temps que l’ascension des Capétiens. Les historiens n’ont pas manqué de montrer comment la littérature portée par les jongleurs de château en château avait pu nourrir la culture chevaleresque1. Pourtant, quand il s’agit des chansons de geste, 8ce fut avec une certaine réticence : le genre épique a moins séduit que la fin’amor des troubadours, peut-être en raison de la violence excessive qui paraît y régner et qui aurait conforté l’image d’un Moyen Âge barbare. L’un des grands historiens spécialistes actuels de la période, Dominique Barthélemy, se méfie de leur usage : « cette littérature […] ne peut pas être prise comme le “reflet” direct d’une réalité historique », écrit-il2. Or il démontre par ailleurs, en s’appuyant sur d’autres textes littéraires comme les romans de chevalerie, voire des textes hagiographiques, que la violence des nobles n’est pas illimitée, mais codifiée par des rituels et par des normes non écrites. Dans la mesure où elles secrètent un droit épique qui de surcroît a l’avantage d’être écrit, les chansons de geste auraient donc pu être davantage convoquées3. Il fallait pour cela les réhabiliter dans la description/création d’un droit qui leur est propre.
La comparaison avec le déroulement des faits historiques n’est pas le but de ce livre, même si l’auteur n’ignore pas que des parallèles sont possibles avec les événements contemporains, par exemple dans Le Couronnement de Louis, lorsque Charlemagne veut associer son fils au trône de son vivant, comme l’a fait Hugues Capet pour Robert le Pieux4. C’est tant mieux. En revanche, il met l’accent sur deux phénomènes majeurs et concomitants, à savoir la diffusion générale du droit et la mise par écrit. La perspective est nouvelle. Il s’agit de montrer que les chansons de geste véhiculent un droit au même titre que ceux qui se répandent alors en Occident. L’irruption d’œuvres juridiques anciennes ou nouvellement écrites au xiie siècle est un phénomène majeur, désormais bien étudié, qu’il s’agisse de la diffusion du droit romain, du droit canonique, du droit féodal puis des coutumiers, eux-mêmes mâtinés de droit savant5. On pourrait penser que le fait de vouloir divertir est un 9obstacle à la diffusion de ces normes. Or les auteurs ont pris soin de divertir en normant. Faire la joie du public est leur raison d’être comme l’écrit Bernard Guenée à propos de ce jongleur de la fin du xiie siècle, Ambroise, qui avait à son répertoire « de vieilles chançons de geste / Dont jugleur font si grant feste6 ». Il s’agit également d’enseigner et de conseiller comme se proposent de le faire les rédacteurs des coutumiers. Pierre de Fontaines, qui engrange les coutumes de Vermandois vers 1250-1260, pourrait aussi bien préluder aux cycles des chansons de geste quand il entend répondre à la requête d’un ami pour conseiller son fils afin qu’il « sache droit fere à ses sougiez, et retenir sa terre selonc les lois et les coutumes du païs, et ses amis conseiller quant mestier lor sera7 ».
Il existe entre ces différents droits une évidente contamination, du fait de la multiplicité de leurs usages et de la capillarité des savoirs. Le personnage de Naimes, modèle de sagesse qui contribue largement à créer le droit épique, focalise toutes les influences du Digeste, du droit canonique et de la Coutume. Les chefs d’accusation traitent, au civil, des problèmes de succession et d’héritage ou du mariage, et au criminel de meurtres et de trahison. Dans tous les cas, il peut être fait une référence implicite aux principes de droits savants voisins qui sont justement en train d’être codifiés. Les auteurs en avaient-ils conscience ? Ils sont restés anonymes et on ignore leur formation. Étaient-ils clercs ou laïcs ? On ne peut que se tourner vers leur public, exclusivement aristocratique. Quel droit ont-ils voulu lui conseiller ? Quand il s’agit du mariage par exemple, si important puisque l’échange des femmes implique celui des biens, la tension est perceptible entre le respect du consentement qui est déjà au cœur du Livre des Sentences de Pierre Lombard avant d’être traité par les conciles, et la réalité des faits où le père et la parenté imposent le conjoint. Il n’en reste pas moins que, malgré ses réticences, le public aristocratique écoute les règles de droit que véhiculent les chansons.
Comme les autres sommes juridiques, ce droit est désormais écrit ; il acquiert davantage de rigidité et il peut servir de référence d’une 10chanson à l’autre. Les études récentes, dans la lignée des travaux de Michael Clanchy sur le Lingusitic turn dans l’Angleterre médiévale8, montrent comment l’écriture, à cette époque, a révolutionné la pensée et la pratique d’un point de vue quantitatif et qualitatif9. Autrement dit, de simples phrases comme « fere droit » impliquent une norme de comportement impérative qui oblige à l’obéissance, et deviennent un guide auquel on se réfère. Le poids de cette écriture est d’autant plus fort qu’elle transporte fictivement lecteurs et auditeurs loin dans le temps, celui des ancêtres carolingiens. On a beaucoup glosé sur les apports de l’histoire carolingienne à ces chansons. Le problème est insoluble et pour notre sujet inopérant. Il ne s’agit pas de ressusciter un droit carolingien, mais de fonder le droit épique dans un passé carolingien. Cette opération lui donne sa légitimité et ses lettres de noblesse. De même que, comme l’a montré Georges Duby, le lignage noble du xiie siècle, se targuant d’un et surtout d’une ancêtre carolingienne, surplombe les autres10, de même l’exercice du droit, dans ce milieu aristocratique, se justifie par une ascendance carolingienne. La parole d’un juge venu du fond de ces âges, surtout quand il s’agit de Charlemagne, n’en a que plus de poids. En écoutant ces chansons qui le transportait dans un passé prestigieux, le public, du simple chevalier au comte et au roi, n’acquérait-il pas un surcroît d’honneur ? Ainsi s’est construit un droit quasiment autonome qui puisait sa légitimité dans un passé mythique et se trouvait destiné, exclusivement, à une société de haut vol, l’aristocratie laïque. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il correspond à la réalité de la société du xiie siècle, mais comment elle l’a inscrit dans son imaginaire. Quel en a été l’usage ?
Ce droit épique s’applique essentiellement à la justice : il s’agit de juger selon le droit. La procédure suivie ne s’encombre guère du témoignage et de l’enquête que l’usage des droits romain et canonique est 11en train de rendre indispensable pour mener un procès légal11. Mais ne nous y trompons pas. Dans la pratique, ces nouveaux procédés se sont imposés lentement et ils ont davantage affecté les causes civiles que criminelles12. Les conflits violents jugés par les tribunaux continuent d’user des rites, gestes et paroles, du serment purgatoire, des ordalies, du duel, de tout ce qu’on peut appeler les miracles judiciaires, et cela pendant longtemps comme en témoignent les procès du parlement criminel aux xive et xve siècles. Les chansons de geste en donnent de beaux exemples. Elles montrent à l’historien et au juriste comment ces rituels s’inscrivent dans la procédure, non comme une preuve comme on le croit trop souvent, mais comme un moyen d’arrêter le conflit quand aucune autre solution n’a pu être trouvée. Le recours au sacré fait alors taire la violence. Dans cette société chrétienne, c’est à Dieu de trancher.
Le désir des nobles est peut-être d’en découdre, mais pas à n’importe quel prix et pas n’importe comment. Le combat suit des règles que l’adversaire doit connaître et qui se déroulent publiquement. La paix est à ce prix. Rares sont ceux qui, comme Raoul de Cambrai, parjure et incendiaire d’un lieu saint, l’abbaye d’Origny, se livrent à des actes extrêmes et, comme tels, deviennent les héros du refus du règlement des conflits. On voit poindre ce qui, dans la procédure, deviendra la fama facti13. En ce sens, le droit épique accompagne l’acte de juger. On ne peut qu’être impressionné par l’importance que prennent les tribunaux dans les récits de chansons de geste. Ces plaids se calquent-ils sur le mallum publicum carolingien ? La question méritait d’être posée, mais elle est moins importante à mes yeux que l’imaginaire de leur fonctionnement. Nous ne savons guère comment se déroulaient les plaids seigneuriaux du xiie siècle : ici, sans préjuger, encore une fois, de leur 12rapport avec la réalité, les assemblées sont peuplées de conseillers qui donnent leur avis. La négociation y est constante, qu’il s’agisse du droit des fiefs ou d’un chef d’accusation criminel. La gangue du recrutement de ces conseillers est incontestablement féodale, issue du devoir d’aide et conseil du vassal, et également de l’importance du lignage. La décision finale fait l’objet d’échanges entre les participants jusqu’à l’obtention d’un accord unanime, en particulier quand il s’agit d’une décision grave comme la peine de mort ou le bannissement. Cette description idéale est typique de ce que nous savons des décisions monastiques au même moment14, et de ce que nous connaissons deux siècles plus tard des cours criminelles comme le Châtelet, cette fois par les archives15 : « tous furent d’opinion, » lit-on, car cette unanimité conquise par la délibération des conseillers dit la voix de Dieu.
Remarquons que les conseillers ne jugent pas. Ils entourent l’empereur ou le roi et à leur nécessaire avis s’ajoute leur qualité sociale qui rend cet avis encore plus précieux. Cet avis porte la vérité, comme il est dit dans La Chanson d’Aspremont : « chacun de vous la vérité me dise16 ». Cette pratique, qui se poursuit jusqu’à la fin du Moyen Âge17, y compris dans un procès d’inquisition comme le fut celui de Jeanne d’Arc, ne dévalorise en rien l’acte de juger. C’est le détenteur officiel de la justice qui émet la sentence, donc qui tranche, en ayant Dieu devant les yeux, le seigneur dans Renaut de Montauban, l’empereur dans la Chanson de Roland lors du procès de Ganelon. Se pose alors le problème du roi mal conseillé, qui de ce fait, voit sa justice dépérir, du roi qui fait trop confiance aux femmes, et qui pourrait de ce fait se laisser fléchir par leurs pleurs, ou encore du roi qui n’écoute pas les conseils de son tribunal et se comporte comme un tyran… autant de thèmes qui alimentent les Miroirs aux princes et que la littérature politique vulgarise aux derniers siècles du Moyen Âge18. Rendre la justice selon le droit épique relève donc d’un équilibre fragile qui valorise le roi tout en cadrant son action face à l’aristocratie. Il doit juger grâce à elle et, 13d’une certaine façon, elle lui donne le pouvoir suprême d’être « fontaine de justice ». C’est dire que le pouvoir du roi est naturellement limité par ce contrôle aristocratique qui peut même aller jusqu’à remettre en cause sa justice, c’est-à-dire l’essence même de sa supériorité.
Le roi ne partage pas seulement la justice avec ses nobles. Les uns et les autres louent les valeurs d’honneur et les réservent à leur société chevaleresque. Point de vilains dans ces textes, sauf pour évoquer leur mort honteuse en cas de vol, la pendaison. Alors, et alors seulement, le noble leur est comparé s’il est soumis au même supplice et c’est pour lui une humiliation supplémentaire. Dans les chansons de geste, l’honneur a clairement un fondement matériel, le fief, la terre. Sa dévolution s’accompagne de rituels de saisine dont la signification anthropologique a été bien éclairée par les travaux de Jacques Le Goff19. Ces gestes et objets disent l’honneur, si bien que dévolution, saisine, rupture ou restitution et ressaisine sont l’objet de cérémonies publiques qui tracent le devenir de cet honneur aux yeux de tous. Le droit épique ne manque pas de rappeler ces rituels, mais n’imaginons pas qu’ils ont totalement disparu à la fin du Moyen Âge. On enterre sans doute trop vite la force gestuelle de la féodalité en la jugeant déclinante. La conservation de l’honneur au sens quasiment matériel passe également par les femmes ou plus exactement par le maintien de leur vertu une fois mariées. L’adultère donne lieu à quelques scènes où le jugement ordalique finit pas dire la vérité, même si la reine peut avoir procédé à quelques ruses… Mais l’honneur se conjugue surtout au masculin. Comme dans la société roturière des siècles suivants, les hommes sont chargés de défendre l’honneur de leur lignée, surtout si celui des femmes a été attaqué.
La vengeance est bien au cœur des chansons de geste, même si le mot « faide » n’est guère employé. Les violences sont individuelles ou collectives. Pour ces dernières, on préfèrera l’expression « guerres seigneuriales » plutôt que « guerres privées » qui fait allusion à un hypothétique État qui aurait acquis le monopole de la violence légitime, or ce n’est guère le cas dans les textes étudiés comme dans la société du xiie siècle et jusqu’à la fin du Moyen Âge20. Cette vengeance est saisie ici selon une palette large, de l’émotion qui provoque la colère au geste meurtrier 14qui s’acharne sur le corps de l’adversaire, en le frappant de préférence au visage, là où se concentrent les signes visibles de son honneur. Le signe déclencheur en est, comme très couramment, l’insulte. Dans le contexte des chansons de geste où tout est grossi, ces paroles injurieuses peuvent même se transformer en invectives. Mais à la différence de ce qui se passe dans le monde roturier des siècles postérieurs, l’insulte peut porter directement sur les biens, fiefs ou héritages, et on retrouve là le sens matériel de l’honneur aristocratique : Raoul de Cambrai réclame son fief et c’est la raison de sa vengeance. Certes, des atteintes aux biens peuvent être à l’origine des homicides commis pour réparer un honneur blessé aux xive et xve siècles, mais elles ne sont pas à l’origine immédiate du crime de sang. Elles ont provoqué une haine recuite, parfois transmise de génération en génération, qui explose à l’occasion d’un geste ou d’une parole, et ce sont ce geste et cette parole qui provoquent l’altercation et la vengeance finale21. Enfin et surtout, chez les nobles des chansons de geste, la vengeance s’insère dans un rituel de défis plus sophistiqué que celui qui peut se rencontrer chez les non-nobles. Le « Tu as menti par ta sanglante gorge » des populations ordinaires fait pâle figure à côté de celui que Ganelon lance à l’ensemble des barons.
La traîtrise ajoute à cette dimension propre au monde aristocratique. Non que les roturiers n’en connaissent pas l’enjeu comme le montre l’emploi du mot dans certaines injures ainsi que leur adhésion aux supplices que subissent les traîtres quand ils sont décapités sur ordre du roi aux Halles ou sur la place de Grève. La traîtrise des chansons qui vise le roi est encore loin de pouvoir être qualifiée de lèse-majesté, mais elle est un crime capital que sanctionne le plus souvent la justice divine.
Pour faire face à cette violence exacerbée, les chansons de geste font découvrir un droit épique qui tente de la réguler. Ce n’est pas si facile ! Le temps n’est pas encore au pardon qui commence seulement à poindre en cas d’adultère. Il faut plutôt louer cette violence tout en la limitant. Ces personnages, y compris le roi ou l’empereur, approuvent et pratiquent la vengeance si elle se déroule comme un « beau fait » et ils la considèrent alors comme licite22. Autre source de difficulté, la justice 15et le droit aident à réguler le conflit, mais la stature sociale des nobles reste rétive devant le jugement. Leur fama personae les place au-dessus de la torture pour arriver à l’aveu et les fait échapper aux châtiments corporels : leur renommée est nécessairement, par l’appartenance à leur lignée, une bona fama. Ganelon en a argué. Il a pourtant fini par être sévèrement puni et c’est justement ce qui paraît extraordinaire. La nature de son crime l’a emporté ; il en a été de même pour l’incendie sacrilège commis par Raoul de Cambrai. Pourtant, le statut social de ces grands nobles ne les place pas en dehors des tribunaux, à ceci près qu’ils peuvent inventer une assemblée à leur mesure, celle des pairs. C’est devant elle qu’Enguerrand de Coucy réclame d’être jugé et Saint Louis a été obligé de céder23. Cette exception judiciaire est en net recul au xve siècle, lorsque se succèdent les procès politiques. Entre temps, le Parlement où, au criminel, plus d’un tiers des causes est consacré aux nobles, a banalisé l’acte de les juger, même si, comme dans les récits épiques, la peine de mort reste à leur égard tout à fait exceptionnelle.
Pendant que s’opèrent ces transformations, l’aristocratie continue d’écouter les chansons de geste. Elles sont en bonne place dans leurs bibliothèques. Pourtant, le temps des vengeances collectives est en grande partie révolu24. Les guerres seigneuriales sont devenues résiduelles. Pour compensation, la noblesse a acquis des privilèges judiciaires, mais, dans la réalité, la renommée ne suffit plus à sauver le noble des rets de la justice. Si, jusqu’à la fin du Moyen Âge, le chant des jongleurs reste puissant dans l’imaginaire, il est devenu celui des illusions perdues.
Claude Gauvard
1 Voir par exemple l’ascension de Guillaume le Maréchal étudié par Georges Duby, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, Fayard, 1984.
2 D. Barthélemy, La chevalerie. De la Germanie antique à la France du xiie siècle, Paris, Fayard, 2007, p. 118.
3 À titre de remarquable exception, Stephen D. White, « Un imaginaire faidal. La représentation de la guerre dans quelques chansons de geste », La Vengeance, 400-1200, éd. Dominique Barthélemy, François Bougard et Régine Le Jan, Rome, École française de Rome, (Collection de l’École française de Rome-357), 2006, p. 175-198. L’auteur convoque cinq chansons de geste Raoul de Cambrai, Girart de Roussillon, Renaut de Montauban, Garin le Loherenc et Gerbert de Metz et analyse en particulier comment la guerre « pouvait être conceptualisée dans des termes juridiques », (p. 193), ce qui interdit de considérer la violence comme illimitée.
4 Le Couronnement de Louis, vers 72 et suiv., cité par Bernard Ribémont, infra, p. 41.
5 Voir en particulier les recherches d’André Gouron, La Science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, Variorum reprints, 1984 et Droit et coutume en France aux xiieet xiiie siècles, Londres, Variorum reprints, 1993. Synthèse par Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998, p. 137-185.
6 Ambroise, L’Estoire de la guerre sainte. Histoire en vers de la troisième croisade (1190-1192), éd. Gaston Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1897, cité par B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1980, rééd. Flammarion, 2011, p. 58.
7 Le Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l ’ ancienne jurisprudence française, nlle édition par M.A. J. Marnier, Paris, Durand et Joubert, 1846, p. 3.
8 Michael Clanchy, From Memory to Written Record : England 1066-1307, 3e éd., Londres, Wiley-Blackwell Publishers, 2012.
9 Joseph Morsel, « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge. Observations sur l’étude de la scripturalité médiévale, », Memini. Travaux et documents, 4, 2000, p. 3-43. Sur la valeur sociale de l’écrit, Étienne Anheim et Pierre Chastang, « Les pratiques de l’écriture médiévale (vie-xiiie siècle) », Médiévales, 56, 2009, p. 5-10 ; Paul Bertrand, « À propos de la révolution de l’écrit, xe-xiiie siècle. Considérations inactuelles », ibid., p. 75-92.
10 Georges Duby, Hommes et structures du Moyen Âge. Recueil d’articles, t. 1, La Société chevaleresque, Paris, Flammarion (« Champs »), 1999 [1re éd. 1973], en particulier articles xv, xvi et xvii.
11 Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), Milan éd. Giuffré, 2006 ; L’enquête au Moyen Âge, éd. Cl. Gauvard, Rome, École française de Rome, (Collection de l’École française de Rome-399), 2008 ; Marie Dejoux, Les Enquêtes de Saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, PUF (Le nœud gordien), 2014.
12 Robert Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014, p. 191.
13 Je me permets de renvoyer à Condamner à mort au Moyen Âge, Pratiques de la peine capitale en France, xiiie-xve siècle, Paris, PUF, 2018, p. 238 et suiv. et « Fama explicite et fama implicite. Les difficultés de l’historien face à l’honneur des petites gens aux derniers siècles du Moyen Âge », La Légitimité implicite,t. 2, éd. Jean-Philippe Genet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 39-55.
14 Élisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (xiie-xve siècle), Turnhout, Brepols, 2017.
15 Claude Gauvard, Condamner à mort, op. cit., p. 140-143.
16 La Chanson d ’ Aspremont, vers 5612, cité par Bernard Ribémont, infra p. 445.
17 Conseiller, délibérer, décider : donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, vii e - xvi e siècle), éd. Martine Charageat, Corinne Leveleux-Texeira, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2020.
18 Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1993, p. 167 et suiv.
19 J. Le Goff, « Le rituel de la vassalité », Pour un autre Moyen Âge. Temps travail et culture en Occident : 18 essais, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1977, p. 349-420.
20 Jean-Philippe Juchs, « Des guerres que aucuns nobles font entre eulx ». La faide à la fin du Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, 2021.
21 Cl. Gauvard, « De grace especial », Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. 2, chapitre 16 et 17.
22 Même chose en Angleterre, voir Edward Powell, Kingship, Law and Society. Criminal Justice in rhe Reign of Henri V, New York, Clarendon Press, 1989 ; Philippa C. Maddern, Violence and Social Order : East Anglia, 1422-1442, Oxford, Clarendon Press of Oxford, 1992.
23 D. Barthélemy, « L’affaire Hugues de Coucy », Affaires et grandes causes. De Socrate à Pinochet, éd. Luc Boltanski, Élisabeth Claverie, Nicolas Offenstadt, Stéphane Van Damm, Paris, Stock (Les essais), 2007, p. 59-77.
24 La Vengeance en Europe, xii e - xviii e siècle, éd. Claude Gauvard et Andrea Zorzi, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 : voir en particulier la conclusion rédigée par Aude Musin et Xavier Rousseaux, p. 319-339.