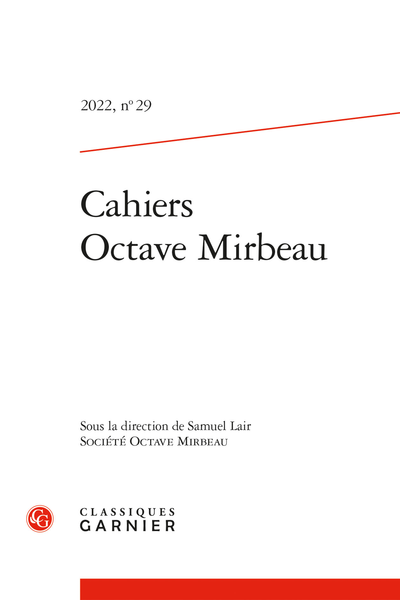
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Octave Mirbeau
2022, n° 29. varia - Auteurs : Lemarié (Yannick), Lair (Samuel), Jordan (Tristan), Mourlevat (Thérèse), Cocandeau (Estelle), Brethenoux (Michel), Margat (Claire)
- Pages : 431 à 477
- Revue : Cahiers Octave Mirbeau
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406146513
- ISBN : 978-2-406-14651-3
- ISSN : 2726-0518
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14651-3.p.0431
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/03/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
COMPTES RENDUS
Octave Mirbeau, Correspondance générale, Tome quatrième, présentée et annotée par Pierre Michel, Le Petit Pavé, 2022, suivi de 3 ajouts à la Correspondance générale.
De ce quatrième et dernier tome de la Correspondance générale que pouvons-nous dire ? Commençons par quelques commentaires sur le livre lui-même. On comprend que le nouvel éditeur, le Petit Pavé, ait voulu reprendre, grosso modo, les caractéristiques des trois premiers tomes parus aux éditions de l’Âge d’Homme : le format 12 x 19, la présentation de couverture, la disposition des lettres et des notes, les polices de caractères, etc. Mais, faute de moyens, le résultat n’est pas aussi probant. Là où les éditions de l’Âge d’Homme proposaient des ouvrages élégants dotés d’un signet et d’une épaisseur raisonnable, le Petit Pavé se satisfait d’un volume sans ruban marque-page et grossi presque démesurément, notamment à cause d’un grammage de papier supérieur. La couverture et son lettrage subissent une déperdition identique : d’un côté, une couleur cerise et des lettres d’or du plus bel effet, de l’autre un ton chocolat et un lettrage blanc beaucoup plus banals.
On regrettera également un travail de relecture souvent pris en défaut. Dès « L’avertissement », le manque de vigilance éclate. Comment en effet laisser passer une telle phrase : « dans ces conditions, ajoutait-elle, il n’était plus possible à 0 € destinés à l’éditeur […] » (sic ! p. 8) ? Comprenne qui pourra. De même on est surpris de constater que, dès « L’introduction biographique » un titre se retrouve tronqué de son initiale : « Ne longue déchéance » pour « Une longue déchéance ». Et nous pourrions multiplier les exemples de ce manque de vigilance : « dont le héros n’est aitre que son propre chien » (p. 25) ; « son ami et son médecin à qui il accore une confiance aveugle » (p. 31) ; « en matiner » (p. 117) ; « Les affaires sot les affaires » (p. 309) ; « sans remords bi rancune » (p. 313 432note 6) ; « expliques-moi » (p. 375) ; « mais par prudece » (p. 545, note 4) ; « face à la triste humaité » (p. 547, note 9), etc. Ici ce sont des points ou des apostrophes qui sont en trop ou disparaissent (au hasard : p. 131, 450, 577, note 3, 603, 676, 805, 812…) ; là, des accents qui manquent (« les trois exemplaires que vous m’avez adresses » p. 93 ; « a garde sa voix à son vieil ami Céard », p. 544, note 2), ou s’ajoutent inutilement (« à la prière dès neveux », p. 210). Le A majuscule est tantôt accentué, tantôt sans accent, à moins qu’il ne se retrouve orné d’un tilde énigmatique (« Ã Sacha Guitry », p. 487, 489, 611, 696 …). Les noms propres mêmes n’échappent pas aux erreurs : Veneux-Nadon devient ainsi « Veneux-Nadson » (p. 54, note 1) ; Eugène Séménoff, « Eugène Séméïiof » (p. 111), Charlotte Lysès, « Charlotte Lysés » (p. 609, 617), Claretie, « CJaretie » (p. 623, note 2), Coutevroult, « Cooutrevoult » (p. 704) ; dans l’index, Jules Verne se voit affublé d’un accent pour se transformer en « Jules Vérne ». Signalons enfin des sic dont la présence ou l’absence nous surprennent. Pourquoi en avoir mis un après « le contraste est saisissant » (p. 524) et pourquoi ne pas en mettre après « Mon chère parain » (p. 320) ou « Frantz-Jourdain » (p. 1076) ? Mystère.
Au-delà de ces fautes de frappe – surprenantes pour un éditeur dont on nous vantait les qualités « mirbeaubolantes », mais pardonnables, il faut le reconnaître, dans un ensemble aussi massif –, il y a surtout le contenu des textes qui précèdent la correspondance qui nous chagrine. Passons sur le fait que, devenu son propre thuriféraire, Pierre Michel ravale Jean-François Nivet au rang de simple « collaborateur technique et logistique » (p. 12), et qu’il biffe, sans vergogne, le nom de l’initiateur, du concepteur et du co-directeur du Dictionnaire Mirbeau (moi, en l’occurrence) car il y a pire. Malgré un rappel à la loi et une action en correctionnelle qui court à ce jour, Pierre Michel continue de diffamer gravement la Société Octave Mirbeau et de répéter les mêmes lunes. Une correspondance générale est-elle le lieu pour cela ? Ne doit-elle pas s’extraire de son temps pour viser une sorte d’éternité ? Celui qui revendique, par ailleurs, son titre de « président honoraire de la Société Octave Mirbeau » (p. 34), peut-il faire fi de la loi pour continuer à propager (qui plus est dans un ouvrage universitaire et sa version papier) des calomnies déjà condamnées ? Nous pensons au contraire qu’il est préférable de taire ses rancœurs personnelles quand on se place dans une perspective scientifique et au service d’un auteur qu’on entend défendre.
433Mais ne nous attardons pas sur cet aspect car c’est le travail sur Mirbeau qui nous requiert en priorité. Nous ne reviendrons pas sur les questions déjà soulevées lors de la publication des précédents tomes concernant la présence de lettres ouvertes, d’articles ou d’interviews dans une correspondance. Nous pensons, entre autres, au long texte sur l’alliance franco-russe éditée dans la Neue Freie Press du 14 juillet 1907 ou à celui du Berliner Tageblatt de décembre de la même année, qui ne relèvent pas d’un véritable échange épistolaire et, par conséquent, auxquels Pierre Michel est obligé d’attribuer des destinataires hypothétiques. Nous nous interrogerons également, sans avoir de réponse définitive, sur le recours aux adresses internet dont la longueur défie l’attention et rend la reproduction périlleuse pour quiconque tente de vérifier le document. Leur caractère provisoire n’assure pas, de surcroît, le suivi du référencement. Plus gênant, elles viennent de sites de vente parfois peu regardants sur l’origine des documents, leur véracité ou sur la précision de l’information. Il y a là certainement une réflexion à mener du côté des chercheurs.
Ces réserves et remarques faites, il faut maintenant aller à l’essentiel : la correspondance. Et là, nous ne pouvons que louer le travail titanesque de Pierre Michel puisque, non seulement, il établit la correspondance de 1903 à 1917 avec un appareil critique toujours aussi remarquable, mais il propose un complément de quelque cinq cents lettres nouvelles, également appareillées ! Les notes, d’une richesse exemplaire, comblent notre curiosité et permettent de parfaire notre connaissance de l’écrivain et de son environnement. Grâce aux informations données, nous entrons plus sûrement encore non seulement dans le quotidien de Mirbeau, mais également dans son œuvre journalistique, romanesque ou théâtrale. L’époque dont Pierre Michel semble tout savoir retrouve sa couleur et sa chair. Sans doute la tenue de l’ensemble ne constitue-t-elle pas une surprise pour nous, mais elle participe derechef au plaisir du lecteur et à l’admiration du mirbellien.
Ce qui occupe Mirbeau au début de ce xxe siècle, ce sont d’abord ses pièces de théâtre. Alors que 1903 a vu Lesaffaires sont les affaires triompher dans une grande partie de l’Europe et se multiplier dans le monde par le biais des traductions, les années suivantes sont accaparées par LeFoyer et les bisbilles avec Claretie. On connait l’origine du conflit : le directeur de la Comédie Française refuse la pièce après 434l’avoir acceptée. Il prétexte que les modifications qu’il avait demandées n’avaient pas été faites quand Mirbeau répète à l’envi qu’il a respecté scrupuleusement sa parole. Alors que les répétitions sont interrompues, un procès s’ensuit. Mirbeau est d’autant plus amer qu’il a assuré avec Les Affaires sont les affaires un succès phénoménal à la maison de Molière, et donné un texte auquel les pensionnaires, en particulier Féraudy, ont rendu constamment hommage. La tension entre Mirbeau et Claretie est donc à son comble… On peut quasiment en suivre les évolutions et les inflexions dans l’écriture même des lettres. De chaleureuses en effet, elles deviennent parfois plus froides au fur et à mesure que les négociations patinent. « Cher ami », « vives amitiés » laissent place à « Cher Claretie », « À vous ». Les formules sont encore moins amènes devant les autres destinataires ; il ne manque pas alors de fustiger la lâcheté de son dorénavant ennemi : « Claretie est affolé. […] Il m’a dit, tout vert de peur […] » (lettre à André Gide, 9 février 1908) ; « Je n’ai jamais vu un homme si pâle, si tremblant que Claretie. [Sa physionomie] semblait éclairée intérieurement par une lueur verdâtre » (lettre à Julia Bartet, 8 mars 1908).
La 628 E8 constitue une autre aventure. Conçu à la manière d’un compte rendu de voyage, le récit donne à Mirbeau l’occasion de briser à nouveau tous les carcans : celui du roman, celui du genre littéraire, celui du regard, celui de la phrase…
Cette activité artistique n’empêche pas Mirbeau de poursuivre les combats auxquels il croit. C’est ainsi qu’il use de son influence pour garantir des revenus financiers à la veuve de Pissarro. Il soutient Maillol, encourage Monet (belle lettre du 19 mai 1908), ferraille au sein de l’Académie Goncourt pour placer, avec plus ou moins de succès, ses poulains : Charles-Louis Philippe, Jules Huret, et, surtout, Marguerite Audoux. Il menace même de démissionner lorsqu’il sent que Jules Renard risque de ne pas être élu à la place de feu Huysmans au profit de l’antidreyfusard Céard.
Politiquement, Mirbeau reste un anarchiste de cœur. Même s’il ne mène pas la vie d’un militant par détestation « des démonstrations publiques » (lettre à Francis Jourdain, vers le 20 février 1910), il s’indigne du rétablissement de la peine de mort (p. 674), s’offusque des atteintes à la création (cf. les notes éclairantes à propos de Victor Méric, p. 628-629) et fustige la dureté du gouvernement quand il s’agit de réprimer les 435mouvements sociaux, et sa mollesse quand il s’agit de lutter contre les puissants. À l’extérieur, il s’engage contre la répression russe, l’exploitation du Congo par le roi des Belges ou les exécutions de Francisco Ferrer, en Espagne (octobre 1909) ou de Benjiro Kotoku au Japon (décembre 1910). L’épuisement qu’il ressent ne l’empêche nullement de défendre la liberté d’opinion avec une conviction intacte comme le montre la lettre à Victor Basch du 21 février 1912 : « Jamais, écrit-il, occasion ne fut meilleure pour réclamer la liberté d’opinion. Les ministres de la République et les magistrats ne nous laissent libres d’agir et penser qu’à la condition que notre pensée, notre action, ne portent nul dommage au système bourgeois ». Propos étonnamment modernes !
Essentielle en ce qu’elle précise le portrait de l’artiste et du penseur, la Correspondance générale permet aussi d’affiner le portrait de l’homme. Notons pour commencer l’amour qu’il porte à sa femme, Alice. De nombreuses lettres prouvent combien il est soucieux de son bien-être et de sa santé. Il craint pour elle quand elle est forcée de s’aliter à cause d’une grippe particulièrement virulente, tout en se réjouissant chaque fois qu’elle se rétablit. D’ailleurs, dans une lettre à Edmond Sée (4 août 1909), il insiste sur « [son] amour et [son] respect », pour elle. Autre information qui transparaît à travers les lettres : la capacité de Mirbeau à discuter ferme quand ses intérêts sont engagés. C’est ainsi que, sans craindre parfois de réduire au silence ses griefs anciens, il fait appel à tous ceux qui peuvent le soutenir dès que commence la lutte pour LeFoyer. Il écrit aux acteurs et actrices, aux politiques, aux journalistes. Aux uns, il met en avant son combat pour les idées, aux autres, l’intérêt de se débarrasser d’un Jules Claretie trop soucieux de son élection à l’Académie française. L’argent même n’est pas tabou au point que Mirbeau donne l’impression d’être un homme d’affaires. Il ne cesse, par exemple, de tancer l’acteur Féraudy pour que Les affaires sont les affaires soient représentées le plus souvent possible. Il suit avec attention les traductions (anglo-américaine, espagnole, …) qui sont lancées sur le marché, les tournées organisées par Hertz ou par Baret. Il suffit qu’un éditeur viennois, Fritz Freund, l’interroge sur les conditions de traduction pour La628-E8 pour qu’il propose 6000 francs, somme énorme à l’époque (lettre 19 janvier 1908). Dans tous les cas, on retrouve le caractère mirbellien, un mélange détonnant de force, de colère et de sentimentalisme que les mots traduisent avec un style inimitable. Parfois, on voit poindre chez 436lui une mauvaise foi, preuve supplémentaire que l’homme est toujours plus riche que l’image à laquelle on cherche à le réduire.
Au fur et à mesure que les années passent, la mort se profile. Dès 1905-1907, Mirbeau évoque son dégoût et son écœurement. Les deux mots reviennent sans cesse pour mieux souligner la fatigue à la fois physique et morale d’un individu qui, avec le temps, supporte de moins en moins le travail harassant de la création et les déceptions de la vie. Il en veut aux critiques (des « ratés »), au milieu théâtral « où le succès ne va qu’aux saletés et aux sottises » (lettre à Geffroy, 7 janvier 1908) et auquel il doit livrer une « guerre effroyable, sourde, fourbe, […] une guerre de trappeur » (lettre à Pissarro, 1908) ; il en veut aux gouvernements qui ne cherchent qu’à durer sans se soucier du bien-être de leurs concitoyens ; il en veut à ceux qui l’abandonnent ou ceux qui, tel Hervieu, préfèrent dorénavant les honneurs à sa compagnie. Il ne trouve de consolations qu’auprès de quelques amis, certains déjà anciens (Jules Huret, Gustave Geffroy), d’autres nouveaux (Francis Jourdain, Léon Werth, Albert Adès…). La lassitude éclate dans des lettres qui sont d’autant plus émouvantes qu’elles semblent des cris du cœur : « Nous rentrons le 20 juillet, glacés, mouillés, éventés, embêtés par toutes ces gueules sinistres de gens qui ont trop bu, trop mangé, trop… » (lettre à Vandérem, 15 juillet 1909) ; « Et rien ne se passe dans cette sacrée vie. Les salauds triomphent toujours d’être des salauds » (lettre à Francis Jourdain, 23 décembre 1909). On peut comprendre dans ces conditions que, sans pour autant se défaire de son statut d’auteur unique, il ait parfois besoin de l’aide de collaborateurs (Thadée Natanson pour LeFoyer voire pour La628-E8 ou Werth pour Dingo) afin de mettre au propre ses idées. Derniers feux d’une correspondance et d’un talent qui s’éteindront définitivement en février 1917.
Alors que l’ouvrage s’achève, Pierre Michel reconnaît lui-même que le travail n’est pas achevé ; il reste en effet des lettres cachées dans des collections publiques ou privées, des textes à compléter et des informations à préciser. Pour autant et en dépit de nos réticences initiales, nous ne pouvons que féliciter l’architecte d’un tel monument.
Complétons notre propos et celui de Pierre Michel en apportant notre modeste quote-part au travail de la Correspondance. Pour cela nous donnons trois brèves informations supplémentaires.
437Pierre Michel indique ne pas avoir retrouvé trace de la lettre 2814 (4 février 1909, p. 671-672) consacrée aux manifestations contre LeFoyer et, pour cette raison, préfère la destiner à un rédacteur en chef, sans plus de précision. Nous signalons qu’il s’agit du texte publié dans Comœdia, le 5 février 1909, et repris dans le Phare de la Loire du 7 février 1909. Elle n’était donc pas spécialement écrite pour « un journal républicain […] de province », comme il est suggéré d’une manière erronée.
Autre point : dans la « Correspondance générale IV-Supplément », lettre 58 (p. 891), Mirbeau remercie un journaliste pour « sa fine analyse » de son « pauvre livre ». Là encore, Pierre Michel n’a pas indiqué de destinataire, malgré une datation située entre l’hiver 1886 et 1887. Or si on suit sur les remarques de la note 1 – qui nous semblent justes – et le commentaire de Mirbeau lui-même, il est vraisemblable que le romancier écrive à son collègue Marcel Fouquier. Fils de Henry Fouquier, ce jeune homme (1866-1961) est un critique littéraire qui, durant l’époque qui nous intéresse, défend, lors de conférences ou d’articles, les premières œuvres de Paul Bourget ; celles d’Édouard Rod ou de Maupassant, et surtout, Crime et Châtiment de Dostoïevski (« Le Crime et le Châtiment », La France, 2 avril 1885). Non seulement, il considère le roman russe comme un « chef d’œuvre » dont la lecture procure « une joie profonde, exquise […] troublante », mais, à l’instar de Mirbeau, il voit son auteur comme « un visionnaire incomparable » et « un admirable observateur ». De surcroît, Fouquier a participé aux dîners des Bons Cosaques, en compagnie de Rodin, Raffaëlli… Ceci explique donc, déjà, à la fois le « Mon cher ami » qui ouvre la lettre et les allusions aux déplacements de Mirbeau à Giverny. Enfin – et ce n’est pas le point le moins important évidemment – Marcel Fouquier livre une analyse effectivement dithyrambique du Calvaire, dans la France du 14 janvier 1887. « Les lecteurs de la France, note-t-il, connaissent assez le talent de M. O. Mirbeau comme chroniqueur pour que je ne m’arrête point à le définir. Je ne veux aujourd’hui parler que du Calvaire, l’éclatant début de M. O. Mirbeau dans le roman. Œuvre sincère et vibrante, écrite sur un sujet qui n’est point banal par un écrivain d’une originalité fière, LeCalvaire échappe aux classifications d’école ». Début enthousiaste qui ne départ pas du reste : « L’étude de ce cas psychologique si fréquent fera à coup sûr un chapitre de l’histoire de l’âme moderne, lorsqu’elle aura trouvé son historien. Cette étude hardiment tentée, et dans le détail si hardie, suffirait à mettre hors de 438page le talent de M. Mirbeau comme romancier. […] Le type de femme que M. O. Mirbeau a peint dans Juliette a aussi la grâce suprême de la vie, l’attrait puissant et subtil, toute la poésie de la vérité ». Même si le chroniqueur regrette la noirceur du chapitre sur la guerre, il souligne la qualité de l’ensemble et « les phrases […] d’une observation profonde et exquise, d’une émotion vraie et rare ». Fouquier qui se laisse aller à faire des comparaisons avec « le Flaubert de Madame Bovary » et qui esquisse, peut-être sans y penser, un rapprochement avec Dostoïevski – excusez du peu ! – annonce même la suite du Calvaire, Rédemption, preuve qu’il suit le travail de Mirbeau. À la lecture de la chronique, on comprend la réaction de Mirbeau et ses remerciements empressés, envoyés dès le samedi soir quand l’article a paru le vendredi. L’Abbé Jules ne suscitera pas chez Marcel Fouquier la même exaltation puisqu’il ne verra dans ce second roman ni « un livre » ni « une œuvre ».
Finissons par un dernier ajout. Il concerne, cette fois-ci, la lettre adressée à Alfred Athis (22 août 1906, p. 1181, « Correspondance générale IV-Supplément »), où un paragraphe a été inexplicablement omis. Nous le donnons : « Ne prêtez pas attention à ce gribouillage… L’auto a je ne sais pas quoi, j’y travaille… et n’y fais rien de bon… d’ailleurs… Et mon mécanicien se prend la tête, à deux mains noires d’huile grasse […] ».
Yannick Lemarié
*
* *
Bernard-Marie Garreau, Les Dimanches de Carnetin, Histoire d’une famille littéraire, éditions complicités, 2021, 191 pages, 19 €.
Il en est des injustices littéraires comme des injustices sociales : les situations d’infortune sont souvent longues à corriger, et les vaincus de 439l’existence doivent parfois se contenter d’une reconnaissance posthume ; encore est-elle souvent exprimée du bout des lèvres. Le présent ouvrage fait œuvre pie en palliant plusieurs manques.
Bernard-Marie Garreau, spécialiste de Marguerite Audoux (1863-1937) dont il a retracé et restauré la juste place au sein du champ littéraire des premières décennies du xxe siècle, s’efforce ici avec succès de poser un éclairage sur ces laissés pour compte de l’histoire littéraire. Conjugué à la maîtrise parfaite de sa matière, c’est tout l’art de conviction de l’auteur que de mettre au premier plan certaines vérités qui ont la force de l’évidence et qui pourtant reposent sur de profonds paradoxes. Limitons-nous à deux d’entre eux : ce groupe de Carnetin dont l’essayiste nous persuade bien qu’il s’agit d’un rassemblement à part entière, avec ses membres, au nombre de dix, ses gloires (Léon-Paul Fargue, Charles-Louis Philippe, Marguerite Audoux, Francis Jourdain, Léon Werth), ses excommuniés (André Gide), ses recrues à titre exceptionnel (Valery Larbaud), ses amis (George Besson, Élie Faure, Octave Mirbeau, Eugène Fasquelle) ses satellites intermittents (Alain-Fournier) et surtout ses visages restés dans l’ombre (Michel Yell, Charles Chanvin, Marcel Ray, Régis Gignoux à qui l’on doit un éloge funèbre de Mirbeau dans Le Figaro le 17 février 1917) ; ce rassemblement, disions-nous, n’est rien moins qu’un cercle soudé, tant les destins individuels sont déterminants, les individualités marquées et solitaires, les volontés d’accomplissement littéraire solides. Et pourtant, il fait bien groupe, à la fois uni par une communauté d’intérêts et une solidarité spontanée, au sens presque moléculaire du terme : « [l]a diversité des affinités entre certains membres du groupe ne fait que souligner les forces contraires qui se joignent harmonieusement pour l’animer ». Le second paradoxe touche à l’emploi du terme « famille » : la thématique de l’abandon et son contrecoup, l’invention d’une famille de substitution, confinent à l’obsession chez plusieurs de ces écrivains, au premier chef desquels Marguerite Audoux ; sur un autre registre, la reconnaissance tardive de l’enfant naturel Léon-Paul Fargue participe elle aussi de cette difficile relation à la famille originelle. Orpheline, isolée, cette famille de Carnetin l’est à plus d’un titre, ne serait-ce qu’à l’aune du peu de reconnaissance critique et universitaire de la place qu’elle occupe dans l’histoire littéraire.
Famille de compensation, donc, le groupe de Carnetin, du nom d’un village de la banlieue est de Paris, naît en 1904 ; en 1907, les dernières 440réunions y ont encore lieu, mais la structuration se défait. Le groupe se délite encore un peu plus avec la mort de Charles-Louis Philippe en 1909, puis celle d’Alain-Fournier en 1914. Les carrières littéraires se déroulent avec plus ou moins de réussite et de cohérence : œuvres avortées de Michel Yell, essais velléitaires de Léon-Paul Fargue, candidature malheureuse de Léon Werth au Goncourt en 1913, bifurcation vers les parcours universitaire, politique ou dramatique pour Marcel Ray, Charles Chanvin ou Régis Gignoux ; mais aussi prix Femina 1910 pour Marguerite Audoux, activité artistique protéiforme de Francis Jourdain, mécénat efficace de Valery Larbaud, à quoi il convient d’ajouter l’intense activité journalistique d’un nombre significatif de membres. L’essentiel est-il là ? L’exercice au jour le jour d’une amitié intelligente et sensible, dont se nourriront à la fois les œuvres littéraires et les parcours personnels, touche plus juste. Elle perdurera entre certains fidèles égarés par-delà les épreuves et le temps, mais choisissant pour centre de ralliement évident la personne et l’œuvre de Marguerite Audoux.
À la lecture passionnante de cet ouvrage, le sentiment dominant le lecteur pourrait être le désarroi, face à cette somme d’épreuves et de tristesse vécus à titre individuel : abandon familial, rupture affective difficile, contacts rugueux avec la société et avec l’Histoire, échecs de toutes sortes, justifient par ailleurs le pessimisme que partagent ces écrivains. Mais l’on rit aussi parfois aux moments où il messied pourtant de s’esclaffer : apprendre que Léon-Paul Fargue ne peut faire mieux que de parvenir quelques minutes après la fin de la cérémonie des obsèques de Charles-Louis Philippe à cause de la lenteur d’une « guimbarde qui tenait à la fois de la limule et du menhir » procède d’un humour noir qui n’est pas incompatible avec cette philosophie résignée qu’affichent plusieurs membres du groupe.
Le chapitre inaugural, « Marguerite et Michel », figure légitimement la pierre d’angle du livre ; la série des autres pièces poursuit l’alternance entre duos et monographies : « Charles-Louis Philippe », « Valery Larbaud et Marcel Ray », « Léon-Paul Fargue », « Jourdain et Werth », « Chanvin et Gignoux », selon une logique de bigarrure des titres qui tantôt fait disparaître le prénom ou le nom, tantôt maintient prénom et patronyme. Ce miroitement des identités civiles tiraillées entre binôme et singletons reflète une autre forme de variation, sans cesse rappelé par l’essayiste : le petit groupe « dont la disparate n’a d’égal que la secrète harmonie » 441étonne par sa cohésion, « mélange de singularités et de similitudes affectant dix destins uniques qui se conjuguent dans une même ferveur ».
À titre indicatif, le chercheur pourrait s’étonner que le nom de Gustave Geffroy n’apparaisse pas dans la nébuleuse de noms favorables au groupe ; peut-être faut-il voir dans cette absence l’un des signes de la dissension entre l’académie Goncourt et le jury du prix Femina. Ami du père de Francis Jourdain, attentif au parcours d’Émile Guillaumin, écrivain paysan, Geffroy fut par ailleurs animé d’une durable sensibilité envers le sort fait aux femmes. En 1919, il revoit l’édition de son roman L’Apprentie (1904), dont l’une des six parties est intitulée « L’atelier et la rue » ; son héroïne, la jeune Cécile Pommier, apprentie dans un atelier de couture, partage nombre de points communs avec les filles mises en scène par Marguerite Audoux dans L’Atelier de Marie-Claire, en 1920. Une même parole favorable au prolétariat des villes, malmené par le patronat, par les conditions de travail misérables et les tentations de l’argent facile de la prostitution s’entend dans les romans de Geffroy et de l’ancienne bergère solognote. Les ateliers de couture figurent l’un de ces espaces professionnels où ouvrières et apprenties endurent avec un courage résigné une adversité sociale fortement intériorisée. De nombreuses analogies se tissent, d’un récit à l’autre, révélatrices d’une commune sensibilité à la solitude et au mal : les chants populaires comme élément de gaîté et de résistance à l’ennui et à l’exploitation des plus humbles, le va-et-vient entre ressouvenir de la province dont sont issues les filles et l’univers parisien, la rencontre de patronnes dont la bonté contrevient au stéréotype manichéen, la vivacité des surnoms populaires (Yeux de loutre, dans L’Apprentie, Yeux couleur de la mer, dans L’Atelier de Marie-Claire) balisent de leurs similitudes un humanisme aigu.
On se doit de saluer la rigueur scientifique de l’entreprise éditoriale1 ; servi par un fort complet appareil de notes, l’essai montre son auteur circuler dans le réseau serré des correspondances croisées, les extraits de journaux intimes, les méandres de l’intertextualité et les dédales biographiques. Cette somme sur le groupe de Carnetin contient d’éclairantes mises au point sur des questions aussi diverses que les groupements littéraires, la littérature prolétarienne, les spécificités de la revue L’Enclos, 442la possible existence d’un style de Carnetin ou le phénomène de procrastination littéraire.
Par le passé, Bernard-Marie Garreau nous a définitivement convaincus que des écrivains comme Marguerite Audoux et Charles-Louis Philippe méritaient amplement l’intérêt que son travail critique mettait en avant. Faisons-lui crédit de cette même lucidité quand il nous dit que « [l]e groupe de Carnetin continue ainsi de vivre ». Il nous livre ici une œuvre sensible, silhouettant des âmes autant que des personnages qu’il paraît voir de l’intérieur. Ouvrant le beau cahier iconographique, on se surprend à comparer ces visages décolorés aux portraits patiemment élaborés par l’auteur, s’étonnant de voir qu’ils ont vécu de leur propre vie.
Samuel Lair
*
* *
Bulletin des amis d ’ Octave Mirbeau, études et actualités, édition du Petit Pavé, Angers, 2020, no 1.
Mis à part l’intérêt légitime que le chercheur prendra à consulter le corpus de lettres de Paul Hervieu, le lecteur curieux de ce qui touche à Mirbeau conviendra aisément qu’une certaine forme d’esprit de chapelle règne hélas ! sur le volume, et que nul n’aurait été plus agacé par la coterie que notre auteur. La revue a la prétention de célébrer, à grands renforts de termes-talisman, l’actualité de Mirbeau ; certes, l’intention est belle, à condition de respecter une démarche historique guidée par le minimum d’exigences épistémologiques. Suffit-il en effet de prononcer ad libitum les mots magiques de « intellectuel éthique », « chantre attitré » « écologiste avant la lettre » pour faire œuvre d’analyste, de commentateur ou d’historien, on est en droit d’en douter. D’autant 443que, comme à l’accoutumée, l’ouvrage ne paraît que très peu l’œuvre d’une équipe éditoriale appelée à travailler librement. Bien plutôt, il sert à compiler certains états d’âme de son rédacteur, jérémiades, accès d’humeur éternellement ressassés, déplorations, etc. mille fois exprimés sur d’autres canaux ; on est en effet bien loin de la série d’études fermes et rigoureuses que le titre pouvait laisser attendre. De même, au plan critique, ne convainquent guère certains rapprochements esquissés à toute force entre Mirbeau et d’autres artistes ; c’est au forceps que l’on assiste à l’accouchement de plusieurs parallèles entre notre auteur et tel écrivain contemporain. Obscur, étranger, et immédiatement contemporain, sont des qualificatifs érigés ici en titres de gloire pour qui veut risquer une confrontation à Mirbeau. Ils ne suffisent malheureusement pas à nous apprendre grand-chose sur l’auteur du Jardin des supplices ; à peine née, la nouvelle revue peine à (re)trouver un souffle, et l’on voit hélas ! mal comment elle assurera sa survie au-delà de redites et d’un ton ressassé jusqu’à l’épuisement.
Samuel Lair
*
* *
Marcel Proust, Les soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inédits, édition établie par Nathalie Mauriac Dyer, Gallimard, mars 2021, 380 pages.
Il y a deux façons de lire ces soixante-quinze feuillets contenus sur quatre-vingt-quatre pages imprimées, écrits en 1908 et retrouvés en 2018 dans les archives de feu Bernard de Fallois. D’abord celle des érudits et des chercheurs. Leur réapparition, déclare l’éditeur, est « un coup de tonnerre… ils donnent accès à la crypte proustienne primitive ». Pour Antoine Compagnon, ils permettent de mieux comprendre la genèse de 444l’œuvre proustienne. Les personnages sont désignés ici sous leur vrai nom. Dans sa préface Jean-Yves Tadié note « qu’au moment où les éditeurs de la Pléiade et les chercheurs de l’ITEM-CNRS s’efforçaient de mettre en place l’histoire du texte proustien à travers ses strates matérielles, ses traces successives, il leur manquait cette première étape. Comme les archéologues recherchent une petite église mérovingienne ou romane sous la cathédrale gothique ». Les deux-cent soixante pages de notes et notices qui complètent ces feuillets sont un faible aperçu des joies qui attendent une nouvelle génération de chercheurs. Il est possible aussi de lire ces pages comme on lit des extraits biographiques ou un recueil de quelques courtes nouvelles. C’est une aubaine pour tous ceux dont le seul nom de Proust sert de prétexte pour ne pas ouvrir un livre, pour tous ceux qui ont été tenté de regarder du côté de Swann et n’ont pas eu la curiosité de poursuivre de l’autre côté. C’est une aubaine pour découvrir un Marcel Proust drôle, spirituel, capable même d’écrire des phrases courtes : « Un champ plein de coquelicots me fait penser que la poésie est une réalité et que le bonheur et la bénédiction peuvent descendre sur la terre. » Il ne faut pas rater cette occasion qui ne se renouvellera pas de sitôt.
Tristan Jordan
*
* *
Claude Pérez, Paul Claudel « Je suis le contradictoire », Biographie, Paris, éditions du Cerf, 2021, 568 pages.
La biographie de Claudel, qui a fait autorité jusqu’à présent, a pour titre Paul Claudel ou l’Enfer du génie. Elle est l’œuvre de Gérald Antoine. Elle a paru en 1988 chez Robert Laffont, rééditée et augmentée en 4452013. La connaissance de la vie de Claudel n’avait pu se faire que peu à peu, au fil des années, à mesure que l’œuvre avançait et que l’auteur se laissait rencontrer. Ainsi, à l’issue du Salon de 1894, quand Octave Mirbeau loue le talent de Camille, en particulier dans ses articles de La Revue de Paris et de la Bibliothèque universelle, en 1895 et déjà en 1893, Mirbeau qui avait reçu un exemplaire de Tête d’or, publié sans nom d’auteur, brise l’anonymat de celui « en qui nous avons mis l’espoir de grandes œuvres » (Revue de Paris, février 1895). G. Antoine indique de son côté que Claudel voyait Mirbeau à l’égal des plus grands écrivains de son temps, Maupassant, Zola. C’est un article de Romain Rolland, enthousiasmé d’avoir assisté à l’une des trois représentations par Lugné-Poe de L’Annonce faite à Marie en 1913, qui livre un souvenir de leur jeunesse, quand ils étaient tous deux élèves à Louis-le-Grand. Il fait allusion à leurs interminables conversations sur leur chemin au retour du lycée (chronique dans la Bibliothèque Universelle, 1913). En 1919, Georges Duhamel publie au Mercure de France un ouvrage, le premier ouvrage véritablement diffusé, intitulé Paul Claudel, qui présente les œuvres dramatiques dont Jacques Madaule se fera le véritable initiateur en 1933 avec Le Génie de Paul Claudel, et, en 1940 avec Le Drame de Paul Claudel, chez Desclée de Brouwer. La parution des correspondances constituera un apport inestimable en ce qui concerne les événements de la vie de Paul Claudel, lettres échangées avec André Gide, en 1949, avec Gabriel Frizeau et Francis Jammes, en 1952, avec André Suarès, en 1969, éditées par Gallimard, qui livrent de précieux renseignements sur la vie de Claudel. Les Mémoires improvisés, série de quarante et un entretiens dans lesquels Jean Amrouche laisse Claudel s’exprimer librement sur lui-même, à la fin de sa vie, et faire un retour en arrière, constituent une sorte de bilan. Toutefois, ne nous y trompons pas ; Claudel ne raconte que ce qu’il veut bien dire, renvoyant l’auditeur curieux vers l’œuvre, s’abritant derrière ce paravent, ceci étant particulièrement vrai pour tout un pan de sa vie, sa liaison avec Rosalie et sa passion insurmontable pour elle. On n’entend guère de révélations ; et pas de confidences. Peu à peu, grâce très souvent à la société Paul Claudel fondée après la mort de l’écrivain par sa fille Renée Nantet-Claudel, de nombreuses correspondances verront le jour. Mais comme est difficile la tâche du biographe, l’examen de la disproportion qui existe entre l’homme et l’œuvre ! Pensons à Bernanos qui admire, certes, en Claudel « le très grand poète », mais qui apprécie 446moins « la belle carrure de ce garde champêtre champenois », en 1930, quand il va jusqu’à faire de Claudel un roublard uniquement préoccupé d’argent. Ainsi le rapporte François Angelier dans sa biographie Georges Bernanos, La colère et la grâce, parue au Seuil en 2021 (page 218). Pour mieux approcher l’écrivain au quotidien, nous avons les lettres qu’il a adressées à deux de ses enfants, Henri et Reine, publiées à L’Âge d’Homme en 1990 et 1991, et les correspondances avec Jean-Louis Barrault, Françoise de Marcilly, Louis Massignon, avec les ecclésiastiques de son temps (présentées par D. Millet-Gérard en 2012 chez Champion). En 2017 ont été éditées chez Gallimard les Lettres à Ysé dont le texte a été établi par Gérald Antoine. Il s’agit de deux cents lettres adressées à Rosalie Vetch. Il manque encore les lettres envoyées à leur fille Louise, née en 1905, pour pouvoir approcher le plus intime de la vie de Paul Claudel. Aujourd’hui Claude Pérez a donné à sa biographie un titre brutal : « Je suis le contradictoire ». G. Antoine, lui, désigne Claudel par la formule de Saint Augustin : « Ecce homo duplex » pour dire la dualité dans une telle personnalité. En 1925, à Rome, Claudel parlait à Paul Petit de « cette dualité de l’esprit humain », et pour lui-même de « ce dédoublement sauvage de l’espérance » dont il était conscient, paroles rapportées par G. Antoine. La formule homo duplex n’aurait pas été pour surprendre l’auteur ainsi désigné. Il avait déjà clos son livre Accompagnements par ces mots en 1921. Aux prises avec une documentation aussi abondante, C. Pérez mène la rédaction de son livre avec une grande prudence et fait part de ses hésitations même lorsqu’il s’agit de faits connus et considérés comme certains. Ce n’est pas le cas pour la rencontre avec Rosalie et la vie à Fuzhou qui échappent à ses interrogations. Est-ce une manière de minimiser les événements ? de les relativiser ? ou est-ce lié à l’accès à une documentation plus sûre ? La connaissance de la vie de Paul Claudel n’a pu se faire qu’au fil des années, parallèlement à celle de l’œuvre. On sera frappé par le soin que prend C. Pérez à ne dire sans réserve que ce dont il est absolument sûr, même s’il peut lui échapper parfois une petite erreur à propos d’un détail secondaire, comme par exemple la certitude absolue que la future épouse de Paul ait su sa longue liaison amoureuse, même si l’éventualité en peut paraître évidente. Or une lettre de madame Claudel à Rosalie Vetch, inédite à ce jour, écrite en juillet 1937, rappelle la promesse de son futur mari en 1905 d’une rupture définitive avec la femme qu’il avait tant aimée. Tout le récit de la vie diplomatique du 447consul, puis de l’ambassadeur Paul Claudel, comporte un déroulement précis des événements, des travaux et des rencontres du diplomate. Le 21 février 1911, Claudel avait accédé au grade de consul général, ce qui l’obligeait à quitter le poste de consul à Prague pour prendre un poste correspondant à son nouveau grade. Sydney lui est proposé qu’il refuse, dit C. Pérez (p. 257). C’est la première fois qu’il refuse un poste. Or en 1902, Claudel avait refusé une mutation considérée comme une promotion pour Hong-Kong. Les recherches minutieuses de C. Pérez aboutissent à des exposés complets sur la vie de Claudel qui a toujours revendiqué son devoir d’état comme sa priorité, même s’il a pu donner à l’écriture de son œuvre et aux représentations de ses drames tout le temps qu’il jugeait nécessaire. De tels comptes-rendus austères oublient souvent de paraître fastidieux, l’auteur sachant de temps à autre dire les choses sur un mode souriant comme lorsqu’il évoque Eugène Meyer achetant le Washington Post, comme s’il faisait ses emplettes (p. 366). Lecteurs de Claudel, nous avions besoin de nous y retrouver dans le déroulement d’une carrière aussi complexe et aussi riche que la sienne.
Thérèse Mourlevat
*
* *
Yannick Lemarié, Arsène Crié (1853-1895), journaliste, anarchiste et boulangiste, L’Harmattan, 2022, 26 €.
Le xixe siècle et la IIIe République française ont été marqués par de fortes tensions entre légitimistes, orléanistes et républicains, eux-mêmes fracturés entre différentes tendances. Dans ce contexte, la formation d’un mouvement anarchiste a constitué un événement historique de première importance, d’une part parce que ses inspirateurs ont mis à 448l’épreuve la solidité de la République (re)naissante, d’autre part parce qu’ils ont investi fortement le champ des idées obligeant ainsi les partis de gauche à s’assurer de leurs convictions respectives.
Dans cette histoire particulière, on peut distinguer, pour le dire très grossièrement, deux temps forts : un premier entre 1875-1885, encore trop peu documenté et mal défini, pendant lequel les anarchistes tendent de structurer leur mouvement voire d’en poser les principes tout en s’adonnant à une agitation sporadique ; un second entre 1890-1895, mieux connu, au cours duquel la multiplication des attentats et des morts conduise les adeptes de la révolution sociale à se poser la question de la violence dans leur pratique d’activistes.
La naissance puis l’expansion de l’anarchie politique dans sa version française s’organise autour de quelques figures emblématiques. À côté des « bombinards » ou « bombineux » qui prônent la propagande par le fait – Ravachol Vaillant, Henry… – on trouve des penseurs qui se partagent entre publicistes (autre nom pour les journalistes à cette époque) et littérateurs parmi lesquels on compte Élisée Reclus, Kropotkine, Bernard Lazare, Sébastien Faure, Jean Grave, Octave Mirbeau, etc. Deux autres noms ont marqué les esprits durant la période 1875-1885 : Émile Gautier, parce qu’il a été considéré par les journaux comme le père de l’anarchisme en France, et Arsène Crié parce qu’il était son fidèle bras droit. C’est le second, lavallois d’origine, qui intéresse Yannick Lemarié.
Parler d’Arsène Crié présente des difficultés car sa vie reste lacunaire et les traces sont si peu nombreuses que le chercheur doit s’en remettre aux différents registres administratifs, aux rapports de police, dont on connaît les biais, ou aux journaux, à supposer que les bibliothèques en aient conservé les numéros. Pourtant, si on en croit Yannick Lemarié, à travers l’homme c’est un pan de l’histoire qui se révèle. Le natif de Laval éclaire ce premier épisode anarchiste trop souvent oublié par les livres alors même qu’il constitue les prémices d’un mouvement de fond qui fera trembler la République sur ses bases. Loin d’entretenir la légende des poseurs de bombe, il aide à préciser les contours d’une pensée révolutionnaire qui, inspirée par les travaux de Proudhon, d’Élisée Reclus, de Kropoktine tente de changer une constitution faite par et pour les bourgeois. Avec Crié, c’est également un double parcours qui se dessine : celui d’un provincial qui, totalement inconnu, monte à Paris, va à Bruxelles où il fonde Le Journal du peuple, puis revient dans 449la capitale française pour s’engager pleinement. Il le fait notamment au sein du Citoyen et la Bataille où, à côté de Lissagaray, il prend ardemment la défense des travailleurs et à travers des manifestations auxquels il participe volontiers en compagnie de Louise Michel. Son action le mène parfois en prison d’où il ressort toujours plus acharné. C’est sans doute sa détestation de la République bourgeoise et l’impasse qu’il pressent qui le jette dans les bras de Boulanger. Erreur funeste et épisode peu reluisant qui plonge Arsène Crié dans la solitude et l’alcoolisme qui le tuera.
S’appuyant encore et toujours sur les archives (belges, nationales, départementales) voire les quotidiens régionaux, Yannick Lemarié ne manque pas de compléter le portrait politique de Crié par un portrait privé. Pour cela, il nous promène de Laval (son lieu de naissance) à Rennes, en passant par Paris et Brest – où il rencontrera sa femme.
Finissons en signalant qu’Arsène Crié journaliste, anarchiste et boulangiste donne l’occasion de découvrir quelques textes (certains d’une actualité mordante) du militant.
Estelle Cocandeau
*
* *
Emmanuel Kessler, Bergson, notre contemporain, L’Observatoire, avril 2022, 269 pages, 22 €.
Peu nombreux sont ceux qui peuvent aujourd’hui citer un titre de Bergson. Comme son contemporain Paul Valéry, Henri Bergson a connu la gloire, tous les honneurs, avant de tomber dans l’oubli. La foule accourait au Collège de France pour assister à ses cours. La grande salle est trop petite, il faut ouvrir les fenêtres pour permettre aux retardataires 450d’écouter de l’extérieur. Les femmes du monde éprises de métaphysique envoient leur domestique pour retenir une place. En entrant dans la salle pour donner son dernier cours, il aperçoit sur l’estrade un parterre de fleurs. Interloqué, il proteste : « Je ne suis pas une danseuse. » Sa notoriété traverse les frontières, il est le Français le plus connu dans le monde. Une conférence donnée à New York est à l’origine d’un embouteillage jamais vu à Broadway. Selon Charles Péguy « Il parlait pendant toute la conférence, parfaitement, sûrement, infatigablement, avec une exactitude inlassable et menue, avec une apparence de faiblesse incessamment démentie, avec une ténuité audacieuse, neuve et profonde, qui lui est demeurée propre ». Lui-même écrira : « En ce qui concerne la philosophie, on nous sait gré d’avoir recommencé à parler une langue accessible au commun des mortels… En réalité, il n’y a pas d’idée philosophique, si profonde ou si subtile soit-elle, qui ne puisse s’exprimer dans la langue de tout le monde. » Bergson est un enfant surdoué accumulant les prix en latin, en grec, en anglais, en composition française, en histoire, en rhétorique. Au concours général il obtient le premier prix en philosophie et aussi en mathématique. Sportif, il pratique l’escrime et l’équitation. Encouragé par son professeur à présenter Normale-sciences il choisit Normale-lettres où il est reçu troisième. Le premier s’appelle Jean Jaurès. Il sera reçu deuxième à l’agrégation de philosophe. Postulant pour une chaire à la Sorbonne sa candidature est refusée par un jury « dominé par les dogmes kantiens et l’influence du positivisme d’Auguste Comte ». Cela ne l’empêchera pas d’enseigner rue d’Ulm. On ne s’étonnera pas de le retrouver au Collège de France, à l’Académie des sciences morales et politiques dont il assure la présidence, à l’Académie française et de le voir recevoir le prix Nobel. Infatigable, « L’avenir est à ceux qui se surmènent » confie-t-il, il accepte des fonctions politiques ou diplomatiques. Au début de l’année 1917, Aristide Briand, ministre des affaires étrangères et président du Conseil lui confie une mission auprès de Woodrow Wilson résolument hostile à une intervention en Europe. Au terme d’une habile négociation il réussit à convaincre le Président américain de faire voter par le Congrès l’entrée en guerre contre l’Allemagne. En 1922, au côté de Marie Curie et d’Albert Einstein, il est élu Président de la Commission internationale de coopération intellectuelle (CICI) dont le but est « de favoriser la collaboration entre scientifiques, universitaires et intellectuels ».
451Impossible de résumer en quelques lignes l’œuvre de Bergson. Emmanuel Kessler affirme que si dans notre vie nous ne devons lire que quinze pages de Bergson il faut lire le texte de la conférence intitulée « La prévision et la nouveauté » publiée dans La Pensée et le Mouvant : Le possible, ce qui n’est pas encore advenu, ne précède pas le réel. Il le suit. En d’autres termes chaque événement est toujours porteur d’un acte imprévisible qui change tout. Rien ne se passe comme prévu. L’avenir ne ressemble jamais à ce que nous avons imaginé. Autre thème développé : Intelligence et intuition. À rebours de ses prédécesseurs du xixe siècle qui ont porté la science au sommet de tout, Bergson affirme qu’il y a deux moyens de connaissance, l’intelligence et l’intuition qui n’est pas la fantaisie ou l’arbitraire. Si nous avons besoin de l’intelligence elle n’est pas le seul ressort de la bonne décision. L’intuition qui porte un regard désintéressé sur les choses la complète et parfois la supplante. C’est ce que Pascal avait perçu lorsqu’il distinguait l’« esprit de géométrie » de l’« esprit de finesse ». Prenant l’exemple de Galilée et de Newton Bergson constate : « Tant que l’on ne fait que raisonner, on ne peut ni découvrir ni inventer. Ainsi l’intuition est à l’œuvre dans toute découverte vraiment productive ». Le général de Gaulle lui-même confessera « Bergson m’a appris que l’action provient de la combinaison de l’intelligence et de l’intuition fonctionnant ensemble, sur un sujet capital qui, un siècle plus tard, occupe une actualité brûlante ». Bergson se montre visionnaire. Il assiste à l’aube d’un progrès technique sans précédent et s’en réjouit. « Ce fut une chance unique, la plus grande réussite matérielle de l’homme sur la planète ». Les machines ont la vertu, outre d’améliorer la vie quotidienne, de libérer le temps de travail de l’ouvrier. Mais il se désole que chaque satisfaction nouvelle entraine de nouveaux besoins, course sans fin vers le superflu générateur d’inégalité et condamne « le bien-être exagéré et le luxe pour un certain nombre plutôt que la libération pour tous ». Il n’est pourtant pas question de revenir au passé et d’arrêter le progrès, mais de l’orienter. Ce sursaut est d’ordre spirituel, Bergson lui donne le nom de supplément d’âme. « Le supplément d’âme est requis pour que l’humain prenne soin tant de son prochain que du milieu dans lequel il habite ». On retrouve dans cette démarche l’idée de « l’évolution créatrice » titre de son œuvre majeure publiée en 1907. Bergson meurt le 6 janvier 1941. L’époque ne s’y prêtait pas mais quelques années plus tard, à l’instar 452de Paul Valéry, nul doute que le général de Gaulle au pouvoir aurait décrété des funérailles nationales.
Tristan Jordan
*
* *
Louis-Ferdinand Céline, Guerre, édition établie par Pascal Fouché, Gallimard, avril 2022, 185 pages, 19 €.
La littérature est pleine de surprises. Après les Soixante-quinze feuillets retrouvés de Marcel Proust voici édité un manuscrit de Céline que l’on croyait définitivement perdu. Il est désormais permis d’espérer voir réapparaître un jour prochain le manuscrit du Journal de Jules Renard déclaré brûlé par sa veuve et, pourquoi pas, de voir apparaître un nouveau testament d’Octave Mirbeau authentifiant l’ancien publié par Alice. Tout a été dit sur Guerre, l’un des manuscrits volés en 1944 dans l’appartement de Céline après sa fuite vers le Danemark, retrouvés dans les mains d’un journaliste après une disparition de près de quatre-vingts ans. En plusieurs occasions Céline avait fait état de l’existence et du vol de ces documents mais beaucoup croyaient à une affabulation. Il s’agit ici d’une autobiographie de plus en plus romancée au fil des pages écrites en 1934 deux ans après la parution du Voyage au bout de la nuit auréolé du prix Renaudot après avoir manqué le Goncourt à deux voix près. Comme l’indique l’éditeur, c’est le récit d’un traumatisme moral et physique subi pendant la Grande Guerre, résumé en une phrase : « J’ai attrapé la guerre dans ma tête », phrase qui va devenir aussi célèbre que les incipits « Ça a débuté comme ça » et « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Blessé au bras et à la tête le 27 octobre 1914 il est décoré un mois plus tard de la médaille militaire avec cette citation : 453« En liaison avec un régiment d’infanterie et sa brigade, s’est offert spontanément pour porter sous un feu violent un ordre que les agents de liaison de l’infanterie hésitaient à transmettre. A porté cet ordre et a été grièvement blessé au cours de cette mission. » Les premières pages de Guerre relatent les circonstances de ses blessures, le choc qu’il a reçu à la tête occasionnant des bourdonnements intenses dont il souffrira toute sa vie. La suite raconte son arrivée sur un lit d’hôpital à Peurdu-sur-la-Lys alias Hazebrouck dans les bras, pour ne pas dire dans les doigts, d’une infirmière lubrique. Là commence une narration relevant d’un délire littéraire que l’on pourrait qualifier de pessimisme joyeux. Céline s’en donne à cœur joie. Le déjeuner chez le couple Harnache est un morceau d’anthologie. Pour celui qui n’a jamais lu Céline ce court texte de cent trente-six pages est une bonne occasion pour entrer dans l’univers célinien au risque de ne plus en sortir. Il nous faut attendre maintenant la publication des autres manuscrits retrouvés, à savoir Londres, descompléments à Casse-pipe et La volonté du roi Krogold. Comme le suggère le titre de l’article de la Lettre de la Pléiade de février/mai 2022, il y a des « cauchemars en réserve ».
Tristan Jordan
*
* *
Antoine Compagnon, Un été avec Colette, Équateurs/Parallèles, mai 2022, 249 pages, 14 €.
« Que veux-tu que je te dise ? Rien n’est banal dans ton existence » lui écrivait sa mère qui ajoutait : « Quel dommage, quand on a un talent d’écrivain comme le tien, d’aller danser au théâtre. ». Pantomime, danseuse, actrice, écrivain, journaliste, Colette déclarait qu’elle avait tout 454aimé du music-hall qui avait pris six ans de son existence, la littérature n’étant qu’un moyen de gagner sa vie. Précisons que la carrière théâtrale de la poyaudine Sidonie Gabrielle Colette roulant les r fut la plus brève tant le public parisien était déconcerté par son accent bourguignon. C’est Mendès qui le premier, devant le succès des Claudine, releva le talent littéraire de la « secrétaire-nègre » de Willy : « Vous ne mesurerez que plus tard la force du type littéraire que vous avez créé. » Pourtant la passion de l’auteur du Blé en herbe et de Gigi c’est le journalisme. Selon Jean Paulhan elle fut une grande journaliste égarée dans le roman. Dès 1895 elle collabore à La Cocarde puis au Mercure de France, à La Vie parisienne et au Mercure musical. C’est en 1910 que commence sa longue collaboration avec Le Matin. Ses premiers articles portent sur les bêtes et le music-hall mais traitent rapidement de tous les sujets d’actualité. Lorsqu’en 1914, bravant les interdictions elle rejoint son mari à Verdun elle devient en quelque sorte correspondante de guerre pour son journal. Elle collaborera plus tard au Figaro, au Journal, à Paris-soir et dirigera Marie-Claire en 1939 et 1940. En cinquante ans de carrière journalistique on lui doit plus de mille articles.Colette s’implique aussi très tôt dans le cinéma de son temps. Ses premiers articles sur le cinéma sont publiés par Le Matin dès 1914 et par deux revues de cinéma, Le Film et Filma dès 1917. Des scénarios sont tirés de ses romans, elle participe elle-même au tournage à Rome de La Vagabonde. En 1918, elle publie dans Excelsior un « Petit manuel de l’aspirant scénariste », modèle de férocité envers les films recherchant plus le sensationnel que la qualité artistique. En 1933, Marc Allégret lui demande d’écrire les dialogues du Lac aux Dames et un an plus tard Max Ophüls lui commande le scénario de Divine.
Qui ignore la vie privée de Colette ? ses trois mariages, ses années de concubinage avec la marquise de Belbeuf, Missy, ses aventures galantes avec Lucie Delarue-Mardrus, Polaire, Nathalie Barney dite l’amazone et bien d’autres, avec Bertrand de Jouvenel, le fils ainé de son deuxième mari âgé de seize ans alors qu’elle en a quarante-sept et qui sera le sujet du Blé en herbe. Mais la sulfureuse Colette, qui dans sa jeunesse dansait nue sous une peau de panthère, est devenue avec l’âge « la bonne dame du Palais-Royal » comme la désigne Antoine Compagnon. Jean Cocteau résume lapidairement : « Vie de Colette. Scandale sur scandale. Puis tout bascule et elle passe au rang d’idole. » Dans sa dernière 455demeure du premier étage de l’appartement donnant sur les jardins du Palais-Royal elle est depuis 1935 la sage épouse de son troisième mari, Maurice Goudeket, qui trois ans plus tôt l’a aidée à créer un institut de beauté rue de Miromesnil dans lequel elle fait elle-même la maquilleuse. Dernière aventure qui ne dure qu’un an. Malgré son nom la concurrence est trop rude. Peu importe, la littérature conserve ses droits. Désormais « Madame Colette » est considérée comme un maître par ses pairs, Francis Carco, Georges Duhamel, Marcel Proust, André Gide qui, à propos de Bella-Vista s’exclame : « Une langue savoureuse presque à l’excès… ah ! combien me plait la façon d’écrire de Colette ! Quelle sûreté dans le choix des mots ! Quel délicat sentiment de la nuance ! » L’heure de la reconnaissance et des honneurs est venue. En 1933, elle succède à Anna de Noailles à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et reçoit une lettre de félicitations de la reine des belges Élisabeth qui devient son amie. En 1945, celle qui au cours de sa vie d’écrivain avait créé « trois ou quatre mythes durables, selon Antoine Compagnon, Claudine, Sido, Colette elle-même et Gigi » est élue à l’unanimité à l’Académie Goncourt dont elle devient présidente en 1949. Ultime consécration, à l’âge de quatre-vingt ans elle est élevée au grade de Grand-Officier de la Légion d’honneur. Décédée le 3 août 1954, l’église lui refuse un enterrement religieux. Peut-être avait-elle eu le tort d’affirmer : « Et pi d’abord Nouel compte pas, c’est le premier de l’an qu’est pour de bon. »Qu’à cela ne tienne, elle sera la première femme à qui la nation accorde des funérailles nationales. Tel fut le destin de celle qui toute sa vie proclamait qu’elle n’était pas un écrivain, qu’elle n’aimait pas la littérature, qu’elle n’écrivait que pour gagner sa vie, mais qui un an avant de mourir, écrivait dans le Figaro littéraire : « Avec humilité, je vais écrire encore, il n’y a pas d’autre sort pour moi. »
Tristan Jordan
456Appendice : Rififi à la Chancellerie
L’élévation de Colette à la « dignité » de Grand-Officier à la fin de sa vie a fait l’objet de réactions qui méritent d’être rapportées comme en témoignent les trois lettres que nous transcrivons ci-dessous : la réponse du général Dassault, Grand Chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur, au Président de la République ; une lettre du général Audibert, membre du Conseil de l’Ordre, une autre d’un probable érudit du nom de Joe Mac Evans. Le contexte : en juillet 1952, le Conseil des Ministres, par la voix du Ministre de l’Éducation Nationale, André Marie, soumet au Conseil de l’Ordre un projet de décret élevant Colette au rang de Grand-Officier. Le Conseil de l’Ordre répond le 5 août par un refus. André Marie fait part de son indignation au Président de la République, Vincent Auriol, qui demande des éclaircissements au général Dassault.
Monsieur le Président de la République,
Vous m ’ avez fait l ’ honneur de me demander certaines précisions sur les conditions dans lesquelles le Conseil de l ’ Ordre de la Légion d ’ Honneur a été amené à émettre un avis défavorable à l ’ élévation de madame Colette à la dignité de Grand-Officier et sur les conséquences résultant de cet avis.
Je m ’ empresse donc de vous fournir les renseignements ci-après.
Il doit tout d ’ abord être bien entendu que la très haute valeur de l ’ œuvre littéraire de Madame COLETTE est au-dessus de toute contestation. Malheureusement, l ’ immoralité et le manque total de dignité de la vie de l ’ intéressée sont de notoriété publique. Dans ces conditions, la faire accéder aux plus hautes dignités de notre Ordre National, alors surtout qu ’ elle serait la première Française à être ainsi proposée en exemple serait une mesure bien déconcertante.
D ’ ailleurs, certains journaux et revues ayant malencontreusement publié la nouvelle de la promotion, je ne cesse de recevoir la visite d ’ hommes éminents, civils, militaires et anciens combattants, appartenant aux milieux les plus sains du pays, venant m ’ exprimer leur inquiétude et leur indignation. Je reçois également de nombreuses protestations et coupures de journaux. Je me permets de vous adresser, en m ’ excusant, l ’ une d ’ elles, reçue à l ’ instant même, non pas qu ’ elle présente un intérêt particulier, mais que l ’ inscription à l ’ encre rouge qu ’ elle comporte synthétise toutes les autres.
En ce qui concerne le Conseil de l ’ Ordre, il a émis, il y a deux ans, un avis unanimement défavorable. Depuis, la question COLETTE a été souvent évoquée 457 dans ses séances et le Conseil n ’ a jamais varié dans sa position, en particulier le 5 août dernier, à l ’ unanimité des sept membres présents.
[…]
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de mon profond et très respectueux dévouement.
Général Dassault, 3 septembre 1952
Monsieur le Grand Chancelier et très cher ami,
Je ne serai pas à la prochaine réunion du Conseil, où se discutera, une fois de plus, la candidature de Colette à la Dignité de Grand-Officier. Je tiens à vous donner mon opinion formelle à ce sujet, me remettant à vous du soin de l ’ appuyer devant le Conseil.
Je ne crois pas que le Conseil de l ’ Ordre National de la Légion d ’ Honneur soit en droit de faire une réclame retentissante mondiale à l ’ œuvre immorale de Colette. Son style peut séduire les jurys littéraires et ses aventures de gigolos et de proxénètes intéresser une clientèle spéciale ; mais, j ’ estime qu ’ il n ’ appartient pas au Conseil de l ’ Ordre d ’ achalander une œuvre aussi dépravée, faisandée, démoralisante, quelque puisse être la valeur littéraire.
Le Conseil de la Légion « d ’ Honneur » ne peut vraiment couvrir cette marchandise dont le moins qu ’ on puisse dire est qu ’ elle n ’ est point « honorable ».
Il ne s ’ agit pas de rappeler que Colette, dans sa jeunesse, s ’ est exhibée « à poil » dans les Music ’ hall ; mais de considérer que c ’ est malheureusement toute sa littérature qui est « à poil ».
Si Colette devenait Grand-Officier, on ne voit pas pourquoi nous n ’ aurions pas, bientôt, le Lycée Colette maison d ’ éducation pour jeunes filles à déniaiser.
Au cas où le Conseil ne croirait pas devoir adopter mes conclusions, je vous demande, Monsieur le Grand Chancelier, de m ’ en considérer comme démissionnaire, à la date du jour où serait prise sa décision. Dans ce cas, je solliciterai la faveur de ne pas faire figurer mon nom dans le procès-verbal ; car je ne voudrais nullement faire une opposition officielle à la décision de collègues avec lesquels je n ’ ai jamais eu que des relations fort courtoises.
Mon attachement et ma reconnaissance les plus cordiaux pour vous, monsieur le Grand Chancelier et très cher ami demeurant, quoi qu ’ il arrive intact.
Général Audibert, 14 janvier 1953
Monsieur le grand Chancelier,
J ’ apprends avec stupeur l ’ élévation au grade de Grand-Officier de madame Colette !
458Ainsi, vous, gardien et responsable de l ’ honneur français, vous avez eu le triste courage d ’ approuver et de sanctionner cette honteuse nomination insultante pour tous les braves (et parfois obscurs) héros qui ont payé de leur santé et de leur vie leur pauvre petit bout de ruban.
Certes « madame » Colette a un charmant talent d ’ écrivain, d ’ une habile perversité, mais nous possédons plus d ’ une douzaine de femmes qui écrivent aussi bien et qui, elles, sont respectables.
Car, peut-on oublier qu ’ il y a cinquante ans, enlevée à grand fracas étant mariée par la plus célèbre lesbienne de l ’ époque, la répugnante marquise de Belbeuf, votre « grand officier de la légion d ’ honneur » osa en sa triste compagnie se montrer nue sur la scène du théâtre des Mathurins qu ’ elle dût évacuer précipitamment sous une pluie d ’ œufs et de fruits pourris et les vigoureuses huées d ’ un public écœuré et indigné.
Le scandale, le vice et la pornographie n ’ étaient pas en ce temps-là sur un piédestal.
Que pensez-vous de cela, Empereur, Pasteur, Curie, vous tous qui avez mis au service de la France vos souffrances, vos travaux, votre génie, si souvent ignorés ou méconnus.
Étranger, habitant depuis quarante ans cette lumineuse contrée, je souffre (et je ne suis que l ’ interprète de tous les Français qui m ’ entourent) dans mon amour et mon respect pour la France de l ’ offense que vous venez d ’ infliger à son honneur.
Veuillez croire, Monsieur le grand Chancelier, à ma considération distinguée.
Joe Mac Evans, février 1953
Colette est élevée au rang de Grand-Officier de la Légion d ’ Honneur le 3 mars 1953, son parrain est André MARIE.
*
* *
Actes du colloque Littérature et Libre Pensée en France et ailleurs des14 et 15 février 2020, juillet 2021, 231 pages, 15 €.
Pour qui n’est pas du sérail s’aventurer sur les terres libres penseuses c’est prendre le risque de l’excommunication. Découvrir la Libre Pensée d’aujourd’hui réserve quelques surprises. On apprend par exemple que France-Culture est le havre des libres penseurs, qu’il existe une « Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des Monuments pacifistes, républicains et anticléricaux » dont le but est de répertorier les monuments aux morts exempts de signes religieux et de motifs guerriers. Vaste programme. Si tous les athées ne sont pas libres penseurs, tous les libres penseurs sont athées. L’athée libre penseur ne se contente pas de penser librement, il lui faut ses sanctuaires, ses dogmes et ses grands prêtres. Ainsi il existe une Union des Athées qui a pour but « d’associer les femmes et les hommes qui considèrent les dieux comme des mythes et toutes les croyances comme des obstacles aux progrès de l’esprit humain ». Raymond Roze des Ordons fait remonter les grands prêtres à 600 ans avant Jésus-Christ avec le penseur indien Charvaka qui proclame déjà « Les écrits religieux n’ont aucun sens et sont du bavardage infantile ». Ses successeurs sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns : Socrate, Hippocrate, l’abbé Meslier, Diderot, d’Holbach et plus près de nous Zola, Aragon, François Cavanna et Siné. Nous allons en découvrir d’autres. Ainsi Madame Élisabeth Legros-Chapuis brosse l’itinéraire d’un incroyant, autre libre penseur, le regretté Roger Vailland auteur oublié de La Loi et de Drôle de jeu, le chantre de la « souveraineté » qui consiste à vouloir assumer son destin et ne pas l’asservir à quelque maître ou quelque dogme que ce soit. Paul-Henri Bourrelier, éminent historien de la Revue Blanche,rappelle succinctement les étapes de sa brève existence, mentionnant les rôles joués par Léon Blum, Octave Mirbeau et le libertaire Félix Fénéon. Ce dernier fut la véritable colonne vertébrale de la revue, il « se distingue par sa discrétion, sa courtoisie inépuisable, sa loyauté à toute épreuve, sa plume maniée comme du scalpel ». Pour terminer avec cette première journée, citons une contribution intitulée : « Narcisse en tyran : le régime au miroir des Châtiments, de Victor Hugo ; sa chute envisagée par un poète libre penseur ». Ce titre est un prétexte. Le tyran est Louis-Napoléon 460Bonaparte dont il est peu question aux dépens d’un autre tyran, à la tête du régime en question, Louis-Napoléon Macron. Louis-Napoléon Bonaparte a eu son Victor Hugo, le vrai. Le Victor Hugo du tyran Macron s’appelle Michel Sidoroff. Hélas, n’est pas Victor Hugo qui veut. On se demande par ailleurs ce que vient faire un président de la République française dans un colloque consacré à la Libre Pensée et à sa littérature. Passons. Nous en arrivons à la deuxième journée tenue dans les salons du Sénat. Les libres penseurs, en principe libertaires, ennemis de toute forme d’autorité et particulièrement de l’État, ne dédaignent pas de se réunir sous les ors d’un palais de la République par la grâce d’Anatole France (voir plus bas).
Venue tout exprès de sa lointaine Pologne Anita Staroń relate les sévices, vexations et traumatismes divers subis par Sébastien Roch alias Octave Mirbeau dans l’enfer d’un collège de jésuites. « Je n’ai qu’une haine au cœur, mais elle est profonde et vivace : la haine de l’éducation religieuse […]. Les maisons d’éducation religieuse, ce sont des maisons où se pratiquent des crimes de lèse-humanité. Elles sont une honte, et un danger permanent ». Sébastien n’a jamais fréquenté qu’« un » collège mais pour Octave la honte s’applique dorénavant à « toutes » les maisons d’éducation religieuse. Nous voyons ici le procédé : généraliser. L’ennui avec Octave Mirbeau, si l’on n’y regarde pas de près, est que sa verve, ou la pugnacité de sa rhétorique, comme on voudra, donne l’illusion de la vérité2. Nous restons en compagnie d’Octave avec l’universitaire uruguayenne Lucia Campanella qui démontre son influence dans la propagation des idées anarchistes dans le « Cône sud » de l’Amérique latine dès le début du xxe siècle. Le terreau s’y prête : d’une part la situation sociale due à l’exploitation des ouvriers est tendue, d’autre part des traducteurs locaux, anarchistes pour la plupart, s’emploient à faire connaître les écrits subversifs d’Octave et d’autres tels que Jean Grave. Alain (Georges) Leduc nous présente un autre pratiquant, il fut un temps président d’honneur de l’association nationale des Libres Penseurs et quelques années plus tôt jeune surveillant à la bibliothèque du Sénat (voir plus haut), Anatole France. La liberté de penser n’empêche pas d’être décoré de la Légion d’honneur et de devenir membre de l’Académie française, ce qui lui valut d’être classé à droite par les gens 461de gauche et à gauche par les gens de droite. N’avait-il pas déclaré : « On croit mourir pour la patrie. On meurt pour des industriels et des banquiers. » Il obtint son brevet d’anticléricalisme quand l’ensemble de son œuvre fit l’objet d’une condamnation papale. Médaille que n’a pas méritée son ami Mirbeau dont l’œuvre n’a probablement jamais franchi les marches du Vatican. Nous nous éloignons maintenant de cette terre d’anathèmes avec Madame Julie Palussière qui nous projette dans l’URSS de Staline où les écrivains étaient cantonnés à vanter l’idéal soviétique, et avec Fabien Jeannier qui traite du mouvement des Angry Young Men dans l’Angleterre conservatrice de l’après-guerre.
Retour en France où Laurent Doucet à l’aide d’un magistral portrait d’André Breton, démontre la consanguinité entre le surréalisme et la Libre Pensée dont on ne saura jamais quel est le plus anticlérical des deux mouvements. Son ami Benjamin Peret surnommé le « désastre noir » de la religion n’est pas en reste. Sans doute le plus anticatholique de tous, son fait d’arme ayant consisté à orner une photo le représentant « insultant un prêtre ». Preuve d’un courage exemplaire. Il ne fait pas bon être dans le champ de tir de Christophe Bidaud. Le cas de Bernard-Henri Lévy est vite réglé. Sa faute qui effectivement n’est pas anodine est d’avoir cité doctement un texte et son auteur, tous les deux sortis de l’imagination potache d’un chroniqueur du Canard enchaîné. Plus intéressant est celui de Michel Onfray. Michel Onfray est un pécheur. « Il n’est pas partisan de la défense de l’école laïque, il n’est pas partisan de la loi de séparation des Églises et de l’État, il n’est pas un partisan de la Libre Pensée ». Il se dit libertaire ? Imposture ! Libertaire celui qui ne supporte pas la contradiction ? Libertaire celui qui fait l’apologie de Charlotte Corday ? Libertaire celui qui se déclare partisan du capitalisme, qui accorde une interview à Famille chrétienne et à Valeurs actuelles ? Michel Onfray est quand même crédité d’un bon point : il a écrit un Traité d’athéologie. Pas suffisant pour Christian Eyschen, Secrétaire (avec un S majuscule) général de la Libre Pensée, qui le condamne sans appel : « Nous sommes en total désaccord avec Michel Onfray. Il ne suffit pas de se proclamer athée pour que cela entraine une adhésion de la Libre Pensée ». Pour conclure, les flammes sont promises à celui qui a osé écrire : « Malheureusement la libre-pensée (avec un l minuscule) contemporaine sent souvent l’encens, elle se parfume éhontément à l’eau bénite. En clergymen d’une Église de bigots athées, les acteurs de ce 462mouvement historiquement considérable ont, semble-t-il, manqué le train de la post-modernité. » Le temps imparti à Christophe Bidaud ne lui a pas permis de traiter le cas Finkielkraut. Il ne perd rien pour attendre.
Tristan Jordan
*
* *
Michel Onfray, Le Chemin de la Garenne, NRF Gallimard, 2019, 90 pages.
On sait les affinités de Michel Onfray avec Octave Mirbeau, qui lui est un pays, puisqu’ils sont nés tous deux dans l’Orne, à quelques encablures l’un de l’autre. L’un et l’autre partagent la même ferveur pour la solitude, une méfiance d’autrui et des institutions poussée jusqu’à la misanthropie, l’élan farouche vers une existence libérée des contraintes de la société.
Michel Onfray écrit beaucoup, c’est peu de le dire ; il écrit vite, sur tout, se rend présent sur tous les fronts, dans l’espace public, chez les petits éditeurs comme au sein des grandes maisons3, affiche une pléthorique bibliographie.
Le choix du genre autobiographique et du récit de souvenir présente ses difficultés et ses pièges ; compliqué de la forme brève (90 pages), l’auteur s’expose alors à un écueil générique de taille. Las ! force est de constater qu’il n’évite pas ici les topoï propres au discours sur soi, dont certains sont usés jusqu’au poncif ; le roman autobiographique permet, lui, de desserrer les liens contraignants qui rattachent le texte à un 463réel nécessairement problématique ; mais le chatouillement amusé du grillon taquiné dans sa galerie ne relève-t-il pas de l’exercice de style attendu dans tout récit de l’enfance campagnarde ? La baignade dans la Dives, l’involontaire confusion enfantine qui fait du cérumen une cire humaine, la mûre croquée qui détermine un sentiment panthéiste ou la fraise des bois qui suscite la conscience d’un élan vital, etc. accusent la valeur emblématique de scénettes et de tableautins campagnards qui s’étiole un peu, au fil des pages ; l’abeille qui meurt après avoir injecté son venin ne nous édifie pas ; et la leçon d’athéisme dispensée par les mêmes insectes, tarte à la crème du discours matérialiste qui enseigne là où on ne l’y attend pas, nous amuse quand il devrait nous informer. De même, la critique un peu téléphonée que mène Onfray à l’encontre des effets délétères de mai 68 manque un peu de naturel ; on sent intuitivement le complexe de l’homme de droite qui, l’âge venant, habite et taraude l’homme de gauche, et qui débouche sur un exercice de dénonciation systématique des répercussions néfastes sur la culture et l’idéologie. Rien de bien original, non plus, dans sa charge contre l’impact dévastateur de l’idéologie post-soixante-huitarde sur l’école de la république.
On peut également trouver un peu forcées et sans grandes nuances les charges contre les administrateurs du culte, même si le curé qui s’appuie sur l’exemplarité du magicien Gandalf et la valeur ontologique du Seigneur des anneaux pour justifier la souffrance terrestre nous fait sourire et apparaît en effet moins éloquent que les arguments de la substitution mystique, par exemple…
Trop souvent, donc, le philosophe Onfray, pédagogue directif, nous tient la main pour nous guider de façon un peu autoritaire vers l’essence de la leçon (le nœud d’anguilles : voilà sa signification), tantôt, heureusement, il cède au lecteur une liberté de déchiffrage plus grande. Il faut cependant reconnaître à l’auteur une force, dans la réussite à articuler la leçon de choses au cours de philosophie, l’enseignement épistémologique au spectacle de la nature, à qui il insuffle de façon parfois un peu péremptoire sa charge de sens, bergsonienne ou nietzschéenne, de préférence.
C’est peut-être qu’à cette lecture, nous attendions autre chose, que n’est pas Le Chemin de la garenne, et qui nous masque le discours propre et la richesse réelle de ce petit opuscule. La singulière posture poétique 464que tient Michel Onfray, son espace existentiel privilégié, le lieu même d’où il nous parle, semble-t-il, nous le rend en revanche sensiblement plus proche et plus touchant. Difficile en effet de s’accommoder de la mort, de son idée ; celle, réelle, des autres et notamment des proches ; mais aussi, imaginée et fantasmée, la sienne propre. Or, la disparition est le point focal de ce petit opuscule, tant il est vrai que la poésie du livre tient surtout à la tentative d’appréhender ce centre mystérieux de la pensée et de l’imaginaire de Michel Onfray, l’absence indicible. Qu’il s’agisse de « l’abattoir ontologique » ou des spectres du passé, des obsèques de FB ou de l’évocation de la disparition d’un père aimé, la mort rôde d’un point à l’autre du récit ; qu’est-elle, d’ailleurs, sinon un passage, un chemin parmi d’autres empruntés comme en guise d’entraînement à celui dont on ne revient pas ?
Samuel Lair
*
* *
Edmond et Jules de Goncourt, Idées et sensations, texte établi et présenté par Irène Bazin de Jessey, Société des textes français et modernes, Classiques Garnier, 2021, 447 pages, 25 €.
Paru en 1866 et dédié à Gustave Flaubert, Idées et sensations est constitué de 402 textes courts. Il tire l’essentiel de sa matière du Journal des deux frères, à la différence près qu’il demeure beaucoup plus allusif quant aux débats littéraires ; comme l’indique son titre, il est l’instantané de la création avant que le Journal ne décentre son attention vers autrui et la société parisienne. Le recueil des Goncourt se lit sans peine et avec une certaine délectation ; il est traversé de fulgurances comiques (« Il me semble voir dans une pharmacie homœpathique le protestantisme 465de la médecine »), de notations qui souvent touchent juste (« Combien d’hommes meurent dans un homme avant sa mort ! »), de traits qui ignorent le politiquement correct (« Trop suffit quelquefois à la femme »), de récits baudelairiens (texte 6 : « Hier j’avais rencontré dans la rue, sur une borne, un petit garçon de dix ans »), de trouvailles de style, d’échantillons de poèmes en prose (texte 304 : « Sept heures du soir. ») ; cette rhapsodie textuelle offre la bigarrure d’un volume qu’on pourrait qualifier de psaumes laïcs (« On pourrait définir l’orgueil, cette vanité qui empêche de faire des choses basses »). L’ensemble est malaisément cernable au plan générique, problématique qu’Irène Bazin de Jessey a raison de tenter de résoudre en s’appuyant sur les thèmes : l’art, le théâtre, la femme, l’enfant, etc. et les formes adoptées : l’aphorisme, la maxime, l’anecdote, la fantaisie, etc. La publication est servie en effet par une connaissance très complète de la période d’histoire littéraire et des théories critiques, d’une maturité étonnante chez une si jeune chercheuse (qui fut l’étudiante de l’auteur de ces lignes). L’appareil critique s’appuie notamment sur l’exemplaire annoté par Gustave Flaubert ; l’ouvrage est introduit par une éclairante préface de près de 90 pages qui en expose clairement les enjeux : comment parvenir à identifier les raisons de l’insuccès de l’opus à sa parution ? En partie éclipsé par le Journal, l’ouvrage présente des choix esthétiques peu ou mal compris par son public, valorisant la forme courte, la discontinuité, la réutilisation ; il expose une réflexion sur l’idéalisme et le sensualisme. Quelques raisons de plus pour s’y attarder.
Samuel Lair
*
* *
Antoine de Saint-Exupéry & Consuelo de Saint-Exupéry, Correspondance 1930-1944, Gallimard, 2021, 336 pages, 25 €.
…cette tension constante entre l’absence et la présence…. nourrit la création4.
Je meurs un peu tous les jours ! Mon amour ! Ressuscite-moi ! Écris, écris ! (Corr. 38 ; 5-I-1931).
Mon mari chéri, déjà votre moteur ronfle dans mon cœur (Corr. 65 ; 1931).
Plume d’or […] Une fée. J’aurais pleuré sur votre lettre […] Il faut être un Ketzal5, plume d’or, pour vous comprendre bien. […] Plume d’or, je prends l’engagement de vous rendre heureux (Antoine à Consuelo, juillet 1931).
Ma petite Consuelo, mon lapin, mon petit gars, je ne reçois pas [sic] une lettre de vous… (A. à C., Alger, III-1944).
J’ai besoin de vos lettres comme de pain… de temps en temps ça arrive et ça fait le printemps dans mon cœur. (A. à C. d’Alger, 30-III-1944).
La publication de la Correspondance entre Saint-Exupéry et Consuelo est un événement. « Conte de fées », conclut Olivier d’Agay dans son Avant-Propos. Voici un éclairage novateur – indispensable – pour saisir l’authenticité du Petit Prince, d’une intensité testamentaire… Parmi les milliers « d’histoires d’amour », l’on est bien au-delà d’un romantisme littéraire. Les Œuvres Complètes (2718 pages) que nous devons à M. Autrand et à M. Quesnel, en 1994 et 1999, ne livrent pas tout, malgré la section « Lettres Intimes6 », et d’autres, dites – par litote – « amicales et profession467nelles ». De plus, voici de quoi éclairer aussi Citadelle, longue « parabole » inachevée… Les épigraphes ci-dessus donnent la tonalité d’une « passion » où « l’Amour et la Mort s’en allaient d’un même pas7… » ! Il y a, dans ce vécu, de l’intimisme et du dramatique. Et combien paraît juste, ici, la formule du Cantique des Cantiques : « l’Amour est fort comme la Mort … ses traits sont des traits de feu… » (VIII, 6).
Ensemble ou séparé, le couple Antoine et Consuelo vit une passion – aux deux sens du terme – qu’on a pu qualifier de racinienne8. Ces 172 lettres – trésor peu banal9 – nous plongent dans l’intimité, avant la disparition du 31 juillet 1944. D’une sensibilité d’écorchés vifs, ils vivent, de 1939 à 1942, une période de souffrance. Leur partage10 des mots, avec dessins parfois, leur dit et leur non-dit, sont révélateurs d’une vie souvent mouvementée. Il est significatif aussi qu’en quatorze ans, 83 lettres sur 172 soient échangées pendant la seule année 1943.
D’emblée, l’on est frappé par un langage inouï de l’amour : style oral, lexique simple, mais dont les images, les symboles et le répétitif constant de « petits mots doux » peuvent inspirer le psychanalyste11. Surtout, l’ensemble offre un éclairage, en profondeur, du Petit Prince, chef-d’œuvre le plus traduit au monde après la Bible… Grâce à cette Correspondance, nous participons à cette quête d’une « vraie vie ». Comment concilier la soif d’Absolu du pilote héroïque aux besoins de douceurs en paisible foyer.
Étonnants « mots d’amour »
Antoine à sa « petite Consuelo de rêve » : « Plume d’or12 », « ma moisson d’or », « mon crabichon », « mon poussin à plumes invisibles », 468« mon abricot », « ma pimprenelle, mon mouton bête, ma Consuelo ». Juste avant son départ de New-York pour la Guerre, il répète ses rêves à sa « Consuelo-Consolation » : « Je suis tellement triste, tellement seul, tellement amer. J’ai tellement besoin de vous… […] Moi, j’ai rêvé d’une femme présente… que l’on retrouve comme la lampe du soir […] Je ne pars pas pour mourir. Je pars pour souffrir et aussi communier avec les miens. » (fin mars 1943, p. 161-164). Chez les deux époux aimants revient souvent, en refrain, comme caresse euphorique, l’adjectif apparemment banal « petit » : « Oui, mon petit Tonnio », commence une lettre d’amour datée de Nice, 1933. Dix ans après, en août 1943, elle redit : « dans ton petit salon de Bevin House Le Petit Prince est là sur la table où il est né ; viennent des “larmes douces” dans la lettre suivante à son “petit Tonnio” ». De son côté, l’époux amoureux, pilote et poète, trouve bien d’autres mots, mais répète l’usuel et banal « petit mot ». Ainsi, le 26 juillet 1944, soit cinq jours avant de disparaître : « Petite Consuelo chérie […] Ah ! Petite fille petite fille… il faut déjouer bien des pièges pour vous revoir » et il lui joint une lettre antérieure du même style : « ma petite Consuelo mon amour […] petite Consuelo, priez pour votre Papou qui fait la guerre malgré sa longue barbe blanche… »
On le constate, Consuelo n’est pas moins inventive, expressive dans ses appels hypocoristiques vers son « Tonnio », son « Papou » : « mon crabe magique », « mon crabe fuyant », « mon crabe à plumes », « mon Ketzal, mon cheval enchanté », « votre poussin boiteux », « chéri, grand sorcier des cloches perdues ». S’y mêlent parfois des plaintes : « mon canari… je ne crois pas que tu as changé de dame… » Et, souvent, reviennent en force des symboles : la planète, l’arbre, le jardin, l’abeille : « je t’embrasse comme mille abeilles qui cherchent la fleur… » ; « mon papou, mon bel arbre ensoleillé13… comme toute petite abeille ouvrière, m’avez faite reine et roi de tout bien. »
Les larmes !… Le rire en « grelots » en déclenche, qui noient le visage, celles de l’amoureuse dont le mari, le 20 avril 1943, s’embarque pour libérer son pays : « mon aimé, quand reviens-tu ? Je sais mal t’écrire, j’enlève mes lunettes à chaque phrase, à cause des larmes ». Même réaction encore de sa « petite Consuelo mon amour » à la longue lettre 469de son héros. « Votre lettre de juin me fait pleurer de joie ». Ultime télégramme d’amour que « Tonio » ne put lire !
Pressentiment, un an, jour pour jour, avant la disparition de « l’époux de tous [s]es instants », elle le confiait à Dieu ! « Alors, mes lettres ne vous arrivent point. Seigneur, que LUI vous les lise dans vos rêves ». Cette lettre de quatre pages, pathétique, elle l’écrit sur papier rose : « les papiers des amoureux sont de couleur rose… » Avant d’inclure sa signature sur une portée musicale, elle précise son chant : « si j’étais abeille, j’écrirais entre ses petites, petit… » Dès août 1943, la signature est appuyée, parfois, d’un « rouge-baiser » – fusionnel. Et, avant de signer « Pimprenelle », elle s’en remet à Dieu : « que le ciel te l’apporte avec toutes mes prières et mes baisers. » Que reste-t-il quand « l’essentiel est invisible pour les yeux » ? Son navigateur risque sa vie pour sa patrie, près de ses « étoiles amies », alors, « je prie souvent pour nous deux », lui écrit-elle.
Larmes d’amour, faute de mots, que déclenchait déjà, dès une première lecture, Le Petit Prince, écrit du printemps 1942 à fin mars 1943. À New York, après un dîner, Consuelo propose à un jeune lieutenant d’en lire « à haute voix quelques chapitres ». Aussitôt la femme de l’officier « a éclaté en sanglots. Impossible de la consoler… Et elle a voulu lire tout le livre… » écrit-elle à son « petit Tonnio », le 10 août 1943. Émotions et pressentiments ! À plusieurs reprises, elle fait cette prière : « Tonnio, revenez-moi tout entier… À chaque pas que je fais, je me dis : oui, il me reviendra Tout Entier[sic]. Et je remercie le ciel » (22 juin 1944). Une longue lettre de juillet 1944 à son « Papou » chéri, dès 4 h du matin, redit sa prière : « Ah ! Seigneur. Rendez-moi vite mon mari… »
Cette Correspondance le confirme : Le Petit Prince ne se réduit ni à la fable, ni au mythe. La fin de son chapitre ultime prend une valeur testamentaire, que ces lettres permettent de décrypter : « regardez le ciel. » La spatialité « étoile/planète » – inhérente au poète, au pilote héroïque surtout – peut se lire comme une parabole duelle entre « grelots » et « larmes ». Deux mots, et tout est résumé ! Si le « mouton a mangé la fleur […] alors ces “cinq cents millions de grelots” venus des étoiles se changent tous en larmes… » ! De même, à l’avant-dernier chapitre, quand, au désert, le Petit Prince se prépare à mourir dans « l’éclair jaune » du serpent, il répète par trois fois à l’aviateur : « je ne te quitterai pas »… Il 470ne pourrait vivre sans le chant des étoiles : « tu auras cinq cents millions de grelots, j’aurai cinq cents millions de fontaines… »
Les épreuves
Le couple connaît une période difficile (de 1937 à 1942) dont la Correspondance amoureuse garde les traces : « Mon homme que j’aime, perdu pour toujours. Comme votre anneau nuptial que vous faites passer à des autres et autres mains sans pouvoir le saisir jamais plus ». Soulignons cette soif d’un absolu partagé. Antoine, vu ses missions d’un continent à l’autre, la mort souvent frôlée, désire d’autant plus la douceur d’une « femme au foyer ». Mais, quelque peu frivole, Consuelo privilégie souvent son cercle d’amis, même quand son mari a pu programmer des retours, à l’heure près. Le voici seul… pour des nuits solitaires. « Consuelo, quand tu t’écartes ainsi une heure, je pense que je vais mourir… Des attentes incompréhensibles… avec tellement et tellement d’angoisse inutile […] ruinent mon travail pour des jours et des jours – et tuent votre Tonio » (1937). Souffrance après six ans de mariage, car Antoine, outre sa favorite à vie14, a parfois ses « mignonnes »… Si bien qu’en juillet 1938, ils se mettent d’accord pour une simple et provisoire séparation15. Mais Antoine découvre plusieurs fois sa porte mal refermée, des tiroirs ouverts, quelques livres et surtout des lettres disparus16 : « papiers mangés par le rat »… Vu « ce métier de rat… petit rat imbécile », finis les mots d’amour pour sa « petite grenouille d’avril17 »… Début juillet 1942, Consuelo entreprend un « affreux procès conjugal ». Antoine, « ravagé par l’angoisse, crucifié », lui crie son martyre, dessine, pleine page, un Petit Prince en souffrance, fleur à la bouche, collé à un arbre qui s’écroule. Dix fois il répète : « je ne veux pas souffrir… sinon dans ton amour… car je t’aime ». Puis, après une dizaine de lettres sans retour, il conclut : « je trouverai enfin la paix dans la mort ». Il s’engage dans la Guerre.
471Lyrisme et spiritualité
Alors, d’Alger, au printemps, 20 avril 1943, reviennent les « petits mots d’amour » vers son « Petit Poussin… chéri… » : « petit rat à plumes, ma pimprenelle ». En mai, l’image du « petit Poussin » est répétée dix-sept fois. En juin, mêmes cris d’amour lancés d’Oujda où il s’entraîne sur Lightning P-38 : « …Consuelo ma fontaine chantante… […] je préfère mourir bien vite, bien vite, plutôt que ne pas savoir où vous trouver… [sur] cette saloperie de planète où l’on est – à attendre – tellement malheureux… » Plus de vingt fois, il répète le nom de sa bien-aimée qui répondra, tout amoureuse, à son « crabe magique ».
Stylistique de la répétition – pour compenser l’absence ?… Après ses deux télégrammes d’amour du 31 décembre 1943, le 1er janvier 44, voici deux lettres enflammées : « Ah ma Consuelo… Oh ma Consuelo… ! » ; plus de vingt fois, il redit le nom de sa « Consuelo… cloche lointaine… Consuelo-de-mes tourments… ». Il rappelle la nature sacrée de leur union : « Consuelo, qui eusses pu, qui aurais dû être une sainte… habillée d’ailes d’ange. Petite fille, petite fille qui pourriez être sainte… » Dans cette « litanie » de souffrance – il se sent « vivre en moine » – il rappelle la force de leur union. Alors – cadeau du Nouvel An ? – le cœur à vif, il joint à sa lettre une « Prière que doit dire Consuelo chaque soir… ». Le rappel de leur union sacrée se marque par un « Amen ». Le 30 mars 1943, avant son départ en Europe pour la Guerre, il lui résumait « l’essentiel » : « Consuelo-de-ma-tendresse… chaque jour de cette affreuse absence me rapproche un peu plus de toi, me lie à toi. […] Vous êtes de plus en plus ma femme devant Dieu. » La litanie lyrique redit, sur tous les tons, le nom de sa « petite Consuelo chérie ». Loin d’être « comme des adolescents attardés [qui] boudent et se retrouvent18, » ils n’auront de cesse, désormais, de vivre leur « union sacrée19 ».
Certes, il y eut des périodes difficiles. Mais la promesse tenue, leur passion reste intense, renforcée par l’éloignement qu’impose la Guerre. « Pour toujours suis votre mari pour éternité » (télégramme d’Alger, 47213-IX-43). Même absolu pour l’épouse : « Mon Papou […] parlez-moi, Tonnio […] Mon petit, donnez-moi confiance, ou je veux bientôt mourir. […] » (New York, 27 mai 1944).
« Elle sera un poème » !En quatre mots, tout est dit, par ce titre d’Alban Cerisier (Corr., p. 19). Oui, « La plus tragique histoire d’amour depuis Tristan et Isolde », celle dont le « seul enfant fut le Petit prince » souligne Olivier d’Agay (« Avant-Propos », Corr., p. 15-16). N’est-ce pas ici l’essentiel ? Dans sa vie de pilote, de héros qui a choisi de côtoyer la mort, voici son cœur vibrant tout au rythme d’un autre. Cette étonnante Correspondance éclaire une réalité où passé et présent se conjuguent. Et voici transcendés la distance et le temps. Certes, l’on n’a pas retrouvé son corps, mais seulement la gourmette d’argent, gravée : « ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (CONSUELO20) ». Pourtant, par ces lettres échangées, nous pouvons tout revivre de « l’essentiel… absent », « écouter les étoiles… comme cinq cents millions de grelots »… Fascination… ! Par le pouvoir de 172 lettres, chaque lecteur reste captif du Petit Prince, les yeux vers l’étoile ultime, émerveillé…
Michel Brethenoux
*
* *
Les Origines du Monde, L ’ Invention de la Nature au xix e siècle, catalogue de l’exposition du musée d’Orsay, du 19 mai au 18 juillet 2021, sous la direction de Laura Bossi, musée d’Orsay / Gallimard 2021.
Covid oblige, la grande exposition sur Darwin n’a pas eu le succès mérité mais son imposant catalogue constitue un document précieux sur la relation art/science au xixe siècle. Darwin et le darwinisme au 473sens large ont révolutionné notre rapport à la nature – ce qui constitue une approche des plus pertinentes de l’œuvre de Mirbeau, hélas absent du catalogue.
Qu’un musée des Beaux-Arts se soit emparé d’un sujet scientifique peut surprendre, mais pourquoi couper l’art et la littérature des idées de leur époque ? Lire Mirbeau permet de comprendre que le sentiment esthétique séduit par les motifs floraux en peinture, de Monet à Van Gogh, exprimait une fascination pour la violence de la nature. Et la fin du parcours de l’exposition célébrait Claude Monet, grand ami de l’écrivain.
Dans le Frontispice du Jardin des Supplices, un « savant darwinien » exprime une vision de la Vie que Freud qualifiera plus tard de « blessure narcissique ». En mission charge ensuite le narrateur d’aller découvrir « l’initium protoplasmique de la vie organisée » – une recherche embryologique qui se transformera en quête anthropologique.
La nouvelle conception de la nature devient la source d’explications qui introduisent à une vision athéologique de l’homme et de l’univers. Elle semble menaçante et peu accueillante. Aujourd’hui la nature fait l’objet de craintes (dérèglement climatique, raréfaction des espèces, pandémies) tendant à l’idéaliser. La science du xixe siècle (biologie, paléontologie, bactériologie) la pensait en constante évolution, mais surtout comme un monde violent et sauvage où la lutte pour la vie prédomine. Non séparé de toutes les autres espèces vivantes, l’homme a des origines communes avec elles, ce qui remplace la doctrine du péché originel par un enracinement dans une nature plus inhumaine qu’humaine attirée par le meurtre. Le darwinisme de Mirbeau est plus noir que le naturalisme de Zola : la nature qui nous détermine est un faisceau de pulsions mortifères.
L ’ Origine des espèces, ouvrage pionnier de Darwin en 1859, sera popularisé par Haeckel pour qui « la nature produit dans son giron une masse inépuisable de formes merveilleuses qui dépassent par leur beauté et leur variété tout ce que l’homme peut créer comme formes artistiques ». Cette fascination pour la beauté luxuriante des formes de vie végétale sera le motif de Mirbeau dans le jardin qu’il cultive. Et de Darwin provient surtout une nouvelle façon de comprendre l’homme selon l’anthropologie criminelle (Lombroso) ou la psychologie (Freud). La dérive scientiste du darwinisme social et même le marxisme, où une 474lutte des classes succède à la lutte pour la vie, considèrent les sociétés comme le lieu d’une guerre toujours plus brutale. Dans le chapitre du catalogue intitulé Miroir mortifère des origines Philippe Comar note : « La beauté a quitté les hauteurs du Parnasse pour rejoindre le sol boueux de notre condition animale, la soupe primitive de sa genèse où se débattent protozoaires, méduse et cloportes kafkaïens luttant pour la vie sur fond de crime et de viol21. » C’est de cette mutation fangeuse de l’esthétique que Mirbeau avait admirablement témoigné en son temps.
Claire Margat
*
* *
Les Cahiers naturalistes (Oliver Lumbroso, dir.), Société Littéraire des Amis d’Émile Zola, no 95, 2021, 443 pages, 25 €.
Les Cahiers naturalistes (Oliver Lumbroso dir,), Société Littéraire des Amis d’Émile Zola, no 96, 2022, 356 pages, 25 €.
La diffusion en fin d’année 2022 des Cahiers Octave Mirbeau a quelque peu décalé notre recension des Cahiers naturalistes, si bien que nous aurions pu passer sous silence le numéro de septembre 2021. Pourtant, tout en prenant en compte la dernière livraison qui nous est parvenue, nous ne pouvons nous empêcher de revenir un peu en arrière car un changement important a eu lieu en 2021 : le passage de témoin entre Alain Pagès et Olivier Lumbroso. Simple modification administrative, diront certains. Sans doute en partie puisqu’Alain Pagès reste dans le comité de rédaction. Pour autant, il importe de signaler son remplacement tant le rôle d’un directeur de revue est loin d’être négligeable.
475La qualité des Cahiers naturalistes doit beaucoup à Alain Pagès. En digne successeur de Henri Mitterand (auquel il est rendu un bel hommage dans les Cahiers naturalistes 2022), il a non seulement maintenu l’exigence intellectuelle initiale à un haut degré, mais il a contribué à ouvrir de nouveaux champs d’exploration. Grâce à lui, par exemple, des écrivains longtemps considérés comme mineurs ont été conviés dans l’illustre revue, des pratiques littéraires jusque-là tenues pour marginales ont été interrogées, des projets ont été initiés. Ainsi Octave Mirbeau, Georges Darien ou les petits naturalistes ont eu droit à de riches dossiers, tandis que, par exemple, l’écriture journalistique zolienne a été soumise à l’analyse. La musique ou l’image (films, photographies) ont trouvé leur place – certes encore modeste – au milieu des considérations habituelles sur la stylistique zolienne. On n’oubliera pas évidemment le rôle éminent d’Alain Pagès dans la connaissance de l’affaire Dreyfus, que ce soit son déroulement au plus fort des événements ou l’épisode de la panthéonisation en 1908. Les Cahiers naturalistes de septembre 1998 et de septembre 2008 sont, à cet égard, des ouvrages essentiels pour quiconque s’intéresse peu ou prou à l’histoire du capitaine et à ses répercussions sur le corps social.
L’arrivée d’Olivier Lumbroso – dont les travaux sur la génétique des textes ou sur la correspondance zolienne font autorité – donne l’assurance que les Cahiers naturalistes « sont encore vivants » (pour paraphraser la formule qui clôt le préambule du numéro 95) et ont encore de beaux jours devant eux.
Les numéros 95 et 96 prouvent sans conteste que la continuité est déjà parfaitement assurée puisqu’ils proposent des articles érudits qui reposent, dans un cas, sur une lecture thématique de l’œuvre de Zola (Zola et les médecins / Le naturalisme au féminin, no 95) et, dans l’autre, sur un décryptage des romans (La Débâcle / La Curée, no 96). Sans doute pourrait-on se dire que les sujets proposés ont déjà été largement traités auparavant. Qui ne se souvient en effet de la remarquable thèse de Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes ou des ouvrages sur La Curée à l’occasion de son inscription dans les épreuves de l’agrégation ? Or, il n’en est rien ! Dans le numéro 95 de septembre 2021, Clive Thomson et Michaël Rosenfeld ont réussi à proposer un ensemble d’analyses novatrices d’abord sur les rapports de Zola avec les médecins, notamment les docteurs Édouard Toulouse (« Zola mis à nu 476par des psychiatres », Jacqueline Carroy) et Georges Saint-Paul (« Lettres inédites »), puis sur les incertitudes d’un écrivain trop souvent assimilé à un scientiste pur et dur. La preuve, le suicide comme les soucis de santé laissent le plus souvent les savants zoliens (sinon le romancier…) dans une forme d’inquiétude ou de stupéfaction. On lira à ce propos les textes d’Émilie Sermadiras (« La foi chancelante du médecin guérisseur ») ou de Sébastien Roldan (« Du Rêve à la Faute : guérir du suicide dans les Rougon-Macquart »).
Un tel approfondissement de la réflexion se retrouve dans « Le naturalisme au féminin », dossier dirigé par Nelly Sanchez. Bien connue des mirbelliens et des Cahiers Octave Mirbeau auxquels elle a livré quelques fines contributions, Nelly Sanchez continue à explorer l’écriture féminine et pour cela laisse la parole aux écrivaines qui ont tenté d’élaborer « un naturalisme féminin ». Avec l’aide de Maxime Bœuf (article sur Clara Viebig), Hans Färnlöf et Maria Hansson (article sur Victoria Benedictsson), Martine Cornet et Pascaline Hamon (articles sur Emilia Pardo Bazán), elle esquisse une nouvelle famille, celle que forment les « “filles cachées” du naturalisme » en dépit du manque de « gratitude ou d’intérêt » de Zola lui-même !
Étudier La Débâcle en cette année 2022 à l’occasion de la publication du numéro 96 et alors que le spectre d’une nouvelle guerre mondiale hante l’Europe, relève d’une coïncidence troublante. Cela montre combien ce roman – succès de librairie en son temps, aujourd’hui un peu mal aimé – reste actuel. En tout cas Éléonore Réverzy en est convaincue. C’est pourquoi, après Olivier Lumbroso (« À propos de la genèse de La Débâcle »), elle n’hésite pas à revenir sur la puissance romanesque particulière du texte et sur la volonté de l’auteur de « raconter le collectif d’un point de vue personnel » tout en « romancisant la matière épique ». Des études sur la rumeur (Bertrand Marquer), sur Napoléon III – le fantôme de La Débâcle – (Nicholas White), ou sur la chair et le sang (Nicolas Bourguinat) permettent, tour à tour, de montrer que, selon l’heureuse expression de Jean Kaempfer, « tout récit de guerre est guerre des récits ».
S’éloigne-t-on réellement du sujet avec le dossier sur La Curée, issu d’une journée d’études sous l’autorité de Cyril Barde et Michaël Rosenfeld ? Pas vraiment, car là aussi il s’agit de déplier derechef le récit pour en faire surgir des richesses insoupçonnées. Avec en ligne 477de mire, une question : « le traitement zolien des déliaisons entre sexe, genre et sexualité relève-t-il d’une critique conservatrice de la décadence des mœurs et des structures sociales ou préfigure-t-il une pensée plus consciente des rapports sociaux de sexe, ouverte à la labilité des identités ? » On voit comment, à partir d’une réflexion sur la liquidité initiée naguère par le sociologue Zygmunt Bauman, la masculinité (Soshana-Rose Marzel), le caviardage (Hortense Delair et Michaël Rosenfeld), le désir (Céline Grenaud-Tostain), voire le motif de la peau d’ours (Arnaud Verret) révèlent des interprétations nouvelles.
À la présentation de ces quatre dossiers, on pourrait ajouter celle des nombreuses et riches études proposées. On ne le fera pas, faute de place. En revanche, on invitera fortement les uns et les autres à ouvrir chacun des deux numéros des Cahiers naturalistes ; on ne manquera pas de faire de belles découvertes. Et puis, comme le soulignent Alain Pagès et Olivier Lumbroso, « la survie des revues universitaires réclame vigilance, soutien institutionnel et [surtout, insistons-nous] engagement collectif des auteurs comme des lecteurs ». On ne saurait mieux dire.
Yannick Lemarié
1 Une unique coquille, que sa solitude érige au rang de perle, ou d’écaille, et dont la drôlerie absout la présence et aurait ravi le connaisseur Léon-Paul Fargue, sous la forme de cette « tortue par l’espérance » qui tiraille Charles-Louis Philippe.
2 À ce sujet, voir Jean-Marie Seillan, Colonisation et colonialisme dans la littérature – Où situer Mirbeau ? Cahiers Octave Mirbeau no 28, 2021, p. 38.
3 Pléthore sur les risques de laquelle Gallimard devrait songer à anticiper, par une relecture attentive des ouvrages ; il est en effet peu courant de trouver d’aussi nombreuses coquilles ou de si lourdes anomalies de syntaxe, comme « le château dans laquelle », p. 44, par exemple.
4 Alban Cerisier, en préface de Correspondance 1930-1944, A. de Saint-Exupéry et Consuelo, Gallimard, 2021, p. 20. Abréviation : Corr.
5 Ketzal : oiseau sacré des Mayas, d’Amérique centrale, aux plumes chatoyantes (A à C., p. 59).
6 Pléiade, tome I, en 1994, et tome II, en 1999 : 7 Lettres à Lucie-Marie Decour, une à Nada de Bragance, 7 à Silvia Hamilton. Les 22 lettres à P. Chevrier (pseudonyme de Nelly de Vogüé [1908-2003) étant classées « Lettres amicales et professionnelles »… Intimité, oui, par exemple Nada de Bragance, en 1942 reçoit des confidences d’Antoine encore à New York qui l’appelle du même « mot doux » que Consuelo : « Mon petit Plume d’Ange … …Ah ! Plume d’Ange, que je suis triste, écœuré et las ! … » (Ibid., p. 923).
7 Cf. Montherlant, La Mort qui fait le trottoir, Gallimard, folio, 1972.
8 Alain Vircondelet, Préface à Consuelo de Saint-Exupéry, Mémoires de la rose, Plon, 2000, p. 20.
9 De même que la « gourmette » découverte le 7-IX-1998. Cf. Jean-Claude Bianco, Le Mystère englouti. Saint-Exupéry, Ramsay 2006 (p. 36-37).
10 Dans Partage de Midi (Claudel, 1905) ce terme définit un drame personnel également vécu.
11 Eugen Drewermann, L’essentiel est invisible – lecture psychanalytique du Petit Prince, Cerf, 1992, 199 p.
12 « Plume d’or » : le mot revient neuf fois dans la même lettre (Sahara, été 1931, Corr., p. 60-63).
13 « Pimprenelle… vous avez besoin de l’ombre d’un arbre et vous ne la trouverez qu’auprès de moi », Corr., p. 238 ; 1943.
14 La comtesse Nelly de Vogüé (1908-2003).
15 Cf. Mémoires de la rose, op. cit. Consuelo ne nie pas avoir eu parfois des amis, et qu’elle s’absente trois jours… Elle précise (p. 260) qu’elle le conduisit chez son avocat. « La discussion s’éleva… mon mari se leva et me planta un baiser sur la bouche ».
16 « Lettres d’amour de Nelly et d’une réponse non postée », précise Paul Webster : La Rose du Petit Prince, édition du Félin, 2000, p. 107.
17 « Avril ! » – Ils se sont mariés en avril 1931.
18 Observation d’Alain Vircondelet dans son Album : Saint-Exupéry, Vérité et légendes, édition du Chêne, 2000, p. 93.
19 Leur mariage religieux, célébré en la chapelle d’Agay, le 12 avril 1931, précéda de 10 jours le contrat du civil, à Nice. Saint Exupéry « conserve (en son portefeuille) une image de Thérèse de Lisieux, et demande à sa femme, à son retour de 1940, d’aller en pèlerinage à Lourdes et de se faire baptiser ensemble dans les piscines d’eau miraculeuse » ! A. Vircondelet, préface aux Mémoires de la rose, op. cit., p. 21.
20 Jean-Claude Bianco, op. cit., p. 39.
21 Catalogue Les Origines du monde, p. 306.