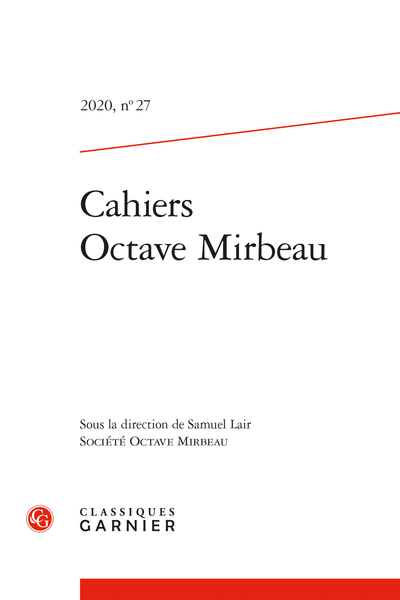
Éditorial Octave Mirbeau : arrêt sur image(s)
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Octave Mirbeau
2020, n° 27. varia - Auteur : Lair (Samuel)
- Pages : 13 à 17
- Revue : Cahiers Octave Mirbeau
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406105183
- ISBN : 978-2-406-10518-3
- ISSN : 2726-0518
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10518-3.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/04/2020
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
ÉDITORIAL
Octave Mirbeau : arrêt sur image(s)
In memoriam Michel Ragon.
La cause est entendue. Il semble que le courant naturaliste portait naturellement les germes d’une transposition possible en une forme, un langage et des codes a priori singulièrement dissemblables de ceux de l’œuvre littéraire, sous les traits du cinéma. Mais du discours textuel au discours cinématographique, le passage ne va pas de soi ; le roman zolien, par ses contraintes et ses spécificités romanesques, présentait-il vraiment un matériau de choix qui rendait aisée sa transposition au septième art ? Dans un contexte contemporain favorable aux reprises cinématographiques des grands textes d’Octave Mirbeau, Yannick Lemarié réunit ici un dossier complet dont les contributions s’attachent en la matière aux liens étroits, presque organiques, de prime abord, entre l’œuvre du romancier et ses adaptations. Films majeurs de l’histoire du cinéma ou semi-échecs, essais d’une transposition fidèle ou affirmation décomplexée d’un effort de transgression de l’œuvre originelle, projets avortés, ou simplement contrariés, grands noms de la réalisation ou seconds couteaux du cinéma : les films évoquées dans les diverses pièces de ce volet montrent aussi la variété des supports adoptés ou pressentis – l’œuvre longue, la comédie musicale, le film un tantinet racoleur, le passage du théâtre au cinéma, ou le plus canonique des romans mis à l’écran. Mais tous avouent deux identiques caractéristiques : l’impossibilité de se défaire peu ou prou du contexte culturel et historique où l’adaptation cinéma voit le jour, d’une part ; l’influence significative de l’écriture, de l’autre.
À ce titre, les diverses contributions ici réunies par Yannick Lemarié nous montrent que la transposition cinématographique des textes 14d’Octave Mirbeau met en relief un trait saillant qui est autant une ressource pour le cinéaste qu’une difficulté : l’éclatement des formes traditionnelles du récit est une incontournable réalité qui veut mettre à l’écran le texte de Mirbeau, fût-il Buñuel. Qu’il cherche à y échapper ou qu’il se soumette à cette forme capricante qu’est le récit de notre auteur, le réalisateur fait œuvre propre, privilégiant par exemple, en apparence tout au moins, la neutralité affective chez des personnages qui font valoir l’extinction des affects, à rebours de l’émotivité qu’on a coutume d’associer à la sensibilité paroxystique de Mirbeau (Yannick Lemarié), ou misant sur une dimension tragique sensiblement plus en retrait dans le texte littéraire (Florence Salaun). Corollaire aux multiples déclinaisons, cette même portée hautement subversive et transgressive des œuvres de Mirbeau expose dangereusement les réalisateurs aux aléas idéologiques, politiques, institutionnels ou simplement culturels que sécrète leur environnement. Qu’elle fasse l’objet d’une authentique démarche de censure ou d’une forme de discrédit porté sur l’œuvre du réalisateur, qu’elle soit instrumentalisée sous la forme de la dangereuse condamnation des cinéastes telle qu’elle est pratiquée par la politique du troisième Reich, la réception de l’œuvre de Mirbeau accède à travers le prisme du septième art à un degré exacerbé de lecture, et devient un matériau dont la plasticité laisse le champ libre à tous les excès, mais aussi à tous les malentendus. L’évocation par Elisabeth Muelsch de la première adaptation avortée du Journal d’une femme de chambre par Jean Renoir revêt, à cet égard, une valeur paradigmatique de cet opprobre jeté sur la dimension personnelle des équipes autant que sur une œuvre jugée, on l’imagine, assez peu en adéquation avec la censure allemande ; les analyses respectives de Didier Le Roux et Florence Salaun prolongent toutes deux la réflexion, en tâchant de prendre la vraie mesure du vichysme dans l’adaptation cinéma.
Notre deuxième volet se penche sur la gamme d’une toute autre série d’images, celle dont les composantes constituent, à en lire les contributions, le réseau assez cohérent de qu’il est dorénavant convenu d’appeler le style d’Octave Mirbeau ; à cet égard, certains auteurs intègrent pour les besoins de leur analyse le rapprochement des composantes du style de Mirbeau « par analogie, avec l’art cinématographique naissant » (Rémi de Raphélis) ; Jean-Paul Campillo, pour sa part, engage loin avant la très convaincante mise en perspective de l’œuvre de Buñuel 15et du texte de Mirbeau. Résolument distante des fleurs de rhétorique maîtrisées et diffusées par une forme de tradition littéraire, se déployant sur un registre qui est celui du dégoût (Loïc Le Sayec), du persiflage (Jacques-Philippe Saint-Gerand), de l’obscénité (Rémi de Raphélis), du lieu commun (Yoann Colin) ou de l’amplification (Pascaline Hamon), l’écriture protéiforme et évolutive du grand romancier présente une constante, celle de mettre sa plasticité au service de la polémique et de la défense des valeurs du Beau, du Bon, du Juste – Jean-Baptiste Baronian revient sur les affinités entre Georges Rodenbach et celui que ce dernier nommait le don Juan de l’Idéal. La variété des textes supports exploités par nos contributeurs – roman, théâtre, critique d’art, critique littéraire et, de façon assez inédite, ici, critique musicale grâce à Jacques-Philippe Saint-Gerand – rappelle s’il en était besoin que derrière le brassage des genres et la mise à mal des modèles littéraires, un seul homme, un même écrivain, tire des potentialités du verbe la matière et la forme d’un nouveau rapport au monde. Et si le style de Mirbeau sert brillamment son discours polémique, on peut sous forme de paradoxe énoncer cette vérité que son image de bretteur avisé expose, en retour, son style aux plus rares mouvements d’incompréhension. Loïc Le Sayec rappelle qu’à la sortie du Journal d’une femme de chambre, l’élan de réprobation morale s’identifie à une condamnation de l’écriture. De son côté, Anita Staroń s’appuie sur la mise en perspective des œuvres innombrables de la féconde Rachilde et de celles de Mirbeau pour convenir d’une même réception critique difficile : si la contributrice entrevoit une esthétique volontaire du patchwork qui découle d’une philosophie de la réécriture, elle rappelle que nombre de critiques contemporains de Mirbeau s’attachèrent au contraire à déceler dans cette esthétique de la reprise les fondements d’une littérature opportuniste, qui voit dans la répétition de cellules narratives de « simples solutions de facilité, employées pour faire face aux demandes du marché et aux obligations éditoriales ».
Les choix stylistiques reflètent au contraire pleinement la volonté didactique. La dialectique du vêtement qui à la fois cache et révèle, la valeur ambivalente de la boue, le va-et-vient entre le sale et le propre – jeu dialectique qui a déjà su attirer l’attention de Jean-Paul Campillo dans sa remarquable analyse des liens entre Buñuel et Mirbeau, déploient la variété des sens propre et figuré, « qui donne un effet totalisant au dégoût de Célestine », selon Loïc Le Sayec. Cette dimension totalisante 16de la métaphore n’est certes pas dépourvue de valeur poétique mais sert avant tout l’expression de la révolte de la domestique, tout en participant à l’effet d’unification discursive et narrative du grand roman 1900 ; de la même façon, une des hypothèses herméneutiques qui peut éclairer l’esthétique de la réécriture de ses propres œuvres par Mirbeau tient, selon Anita Staroń, à la volonté de toucher de nouveaux lecteurs, la fonction didactique impulsant une tendance mimétique : si la société réitère les mêmes erreurs, la critique doit multiplier d’identiques dénonciations. Le rapprochement des modalités d’écriture de Mirbeau de celles d’autres écrivains contemporains interpelle ici les auteurs. Rachilde présente avec l’auteur du Jardin des supplices nombre de traits communs ; Léon Bloy partage avec ce dernier le goût du verbe haut et la puissance de dénonciation du bourgeois passe, chez Mirbeau comme chez lui, par un certain emploi du lieu commun (Yoann Colin) : réécriture et écriture tautologique servent la parole pamphlétaire de ces trois écorchés vifs, en cachant mais tout aussi bien en révélant les limites de leur art. Rémi de Raphélis estime que le parti pris d’obscénité choisi par Mirbeau procède de la volonté de « mettre son lecteur en présence de vérités déplaisantes », « de soulever les masques, d’obliger ses contemporains à voir les réalités qu’ils préfèrent ignorer ».
Car indubitablement, à l’articulation du sujet qu’il exprime et de la société qu’il dénonce, le style – et singulièrement celui d’Octave Mirbeau – se présente comme une instance au croisement de la subjectivité de l’auteur et de la société à laquelle ce dernier appartient, procédant à la fois de l’individuel et de l’artistique, mais aussi du collectif et du didactique. Il en va de l’écriture comme de cette surface que définissait le poète : « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau ». L’intensité dramatique des écorchés de Raphaël Freida illustrant Le Jardin des supplices (Alain (Georges) Leduc), « la peau toute en houles violentes », exhibe cette intuition d’un traitement inouï infligé à la chair des hommes, et aux plis du texte. Travaillée par la nécessité d’accéder à une parole efficace, mais tendue vers la prétention à parvenir à une forme de style que la critique moderne associerait aujourd’hui à une littérarité, l’écriture d’Octave Mirbeau se présente au sens propre comme une peau, soulevée de contradictions internes, exhibant et cachant simultanément les désirs et les conflits, creusée par les indélébiles cicatrices qu’y ont laissées les batailles successives et les conflits avec le réel. Si elle est certes le lieu 17d’un échange poreux entre ses obsessions intimes et les impérieuses interpellations de l’extérieur, elle tâche de s’accommoder au mieux des tensions qui tour à tour l’aiguillonnent et la minent. Comme la peau, l’écriture de Mirbeau constitue cet entre-deux dans l’épaisseur infime duquel se tient l’espace entre l’intérieur et l’extérieur, le réel et le rêve (Rémi de Raphélis), entre l’effort réaliste et l’abandon à la vision, plus qu’à la vue ; comme la peau, elle est l’objet d’un tremblement, dont on ne saurait préciser si elle traduit une exaspération ou une angoisse mal contenue.
Samuel Lair