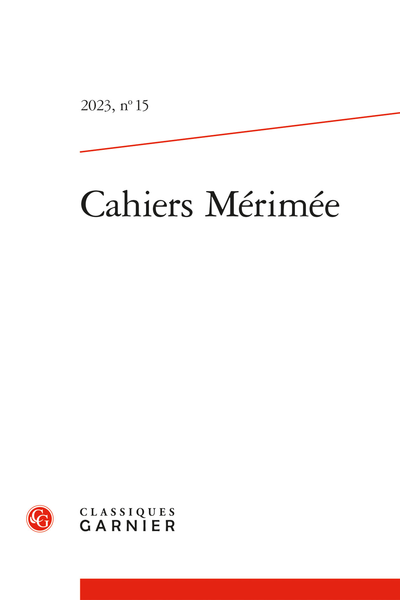
Compte rendu
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Mérimée
2023, n° 15. varia - Auteur : Arrous (Michel)
- Pages : 163 à 168
- Revue : Cahiers Mérimée
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406151395
- ISBN : 978-2-406-15139-5
- ISSN : 2262-2098
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15139-5.p.0163
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/08/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Xavier Bourdenet, L’Écriture de l’Histoire chez Mérimée. L’archive etl’archè, Paris, Classiques Garnier, 2022, 752 pages.
Cet essai sur le rapport de Mérimée à l’Histoire (thèse HDR, Sorbonne Université, 2018), fera date parce que la critique a quasiment ignoré cette part importante de l’œuvre de Mérimée. Un des mérites de l’enquête de Xavier Bourdenet est de mettre en évidence une problématique commune à l’œuvre érudite et à l’œuvre fictionnelle, quoique l’énigme caractérise la première et la recherche de la vérité la seconde. À la différence de Scott ou de Michelet, Mérimée « rejette le passé hors de toute contemporanéité » et son relativisme exclut l’empathie afin de souligner l’altérité ou la singularité du passé considéré comme un monde autre. Dans son introduction qu’on peut lire comme un état présent des études mériméennes, à la suite desquelles il s’inscrit – on pense surtout à Michel Crouzet, Antonia Fonyi et Pierre Glaudes –, Xavier Bourdenet justifie son choix d’une étude de la dimension anthropologique et mythique de la poétique historique de Mérimée. De cette traversée de l’œuvre fictionnelle et érudite, on ne rendra compte ici que partiellement tant elle est foisonnante.
Entièrement consacrée à Mérimée dramaturge, la première partie retrace la généalogie de ces tentatives de renouvellement des formes théâtrales que furent sous la Restauration les « scènes historiques ». Organisées autour d’un événement qui assure l’unité d’action, elles ont pour objet les guerres de religion, les conflits de la Ligue, la période de la Révolution et aussi les troubles politiques du Moyen Âge. Ce nouveau genre est examiné sous l’angle de la « vraisemblance historique », notion fort mouvante chez Vitet qui prétend faire de l’histoire et non de l’art tout en mêlant le vrai et le fictif. Avec La Jaquerie, Mérimée, lui aussi inspiré par l’historiographie contemporaine et qui revendique une posture historienne – ce qui ne l’empêche pas d’imaginer une intrigue amoureuse –, a tenté d’écrire autrement l’histoire, soit, comme il le dit, sous la forme d’une « petite tragédie romantique », ce qui n’exclut pas une certaine dose d’ironie. Il tire parti de l’absence, très relative, de sources 164historiques en échappant à deux difficultés signalées par Rémusat dès 1828 : « celle de suppléer au silence de l’histoire et celle de ne point lui donner le ton du roman ». La fiction l’emporte car tous les personnages sont fictifs ; il n’y a pas de héros, mais des masses ; quant aux libertés prises avec le cadre historique, elles sont nombreuses. Contrairement à une tradition critique qui reproche à La Jaquerie une prétendue faiblesse dramaturgique – la pièce ne serait qu’une juxtaposition de scènes –, ou qui la juge plus proche du roman que du théâtre, Xavier Bourdenet l’analyse « en fonction du cadre générique qu’elle se donne » (p. 115). Le but est sans nul doute historique, mais les procédés sont ceux du théâtre, comme le prouve l’étude des procédés structuraux déjà réalisée par B. Cooper et G. Zaragoza. Mérimée compose en dramaturge dans le sillage de Shakespeare sans toutefois négliger la poétique classique, même s’il ne se préoccupe guère des unités : « Racine et Shakespeare, n’en déplaise à Stendhal ! » Néanmoins, il « atténue l’impression de juxtaposition gratuite et de fragmentation » par des procédés qu’on retrouvera dans la Chronique : l’annonce de la scène suivante, l’écho dans les scènes en diptyque, la prolepse qui renvoie à l’événement central. L’analyse sociocritique souligne le phénomène d’atomisation d’une société qui ne vit que dans le conflit généré par le système féodal d’oppression et d’exploitation. Se pose alors une première question, celle de la nature politique de la Jaquerie qui remet en cause ce système et ouvre le débat sur la souveraineté du peuple réputé incapable de l’assurer selon la doxa libérale (p. 157 sqq.) ; la deuxième concerne les leçons que Mérimée tire du soulèvement populaire : « les excès de la féodalité devront amener d’autres excès » est-il dit dans la préface. Dans cette pièce sans transcendance ni dimension spirituelle, sans parler de son anticléricalisme radical, Mérimée exclut donc tout providentialisme. Sa conception de l’histoire est « binaire et horizontale » : l’excès produit toujours un contre-excès.
La deuxième partie porte sur le choix que fit Mérimée de devenir romancier en traitant un sujet à la mode, la Saint-Barthélemy, à la fois mythique (la lutte fratricide), historique (une historiographie abondante) et politique (en 1829, c’est un sujet d’opposition). Ce choix est commenté à la lumière de déclarations pour la plupart bien postérieures à la publication : Mérimée conteste la poétique scotienne, ce qui n’a empêché ni l’influence ni les emprunts, ni même la proximité. Comptent plus que ces traces les procédés de l’anti-roman, pertinemment relevés 165et analysés dans « Histoire, personnages, portraits : une poétique de l’esquive » (p. 172-179), section consacrée au fameux chapitre viii. L’esquive est bien sûr visible quand le lecteur, conformément à la tradition du roman historique, s’attend à quelques beaux portraits, mais aussi quand Mérimée, à la différence des auteurs du genre, n’affiche pas ses sources documentaires, se revendique romancier et prétend écrire une œuvre « largement comique » (p. 181). À cet effet détonnant s’ajoute le contraste avec les scènes terribles, comme les tableaux du massacre et du siège, opposés au chapitre comique des « deux moines ». Tout en refusant l’ethos de l’historien et de l’auteur de roman historique, Mérimée se préoccupe de l’unité et de la progression de son récit. Alors qu’on a souvent reproché à la Chronique d’être un roman fragmenté, voire une succession de scènes, de nouvelles ou de tableaux de mœurs, Xavier Bourdenet, sans pour autant délégitimer ce jugement, suggère de la lire comme un anti-roman et donc de la réintégrer de plein droit dans le genre romanesque. Est alors détaillée une poétique de l’écho ou du redoublement, laquelle contribue à la cohérence de l’ensemble (p. 190-194), et du « tissage » des chapitres pour gérer le passage d’une unité à une autre (la « rupture dispositive » selon la terminologie d’Ugo Dionne). Ce travail de scénarisation, on le retrouve dans l’analyse de la Chronique comme roman de formation (initiation sociale, amoureuse et historique) marqué par le conflit au sein du couple fraternel. La mise en scène du xvie siècle (le tableau de mœurs) comprend une réflexion sur la religion, plus exactement sur le mécanisme de la croyance sous ses diverses formes (foi, fanatisme, superstition, manipulation, mystification) et sur son aboutissement, la violence, manifestation de l’archè. On peut d’ailleurs voir dans la Chronique une entreprise de démythification de la religion (p. 213), les protestants étant plutôt favorisés, même si eux non plus n’échappent pas à la « dérive violente ».
Dans le dernier chapitre intitulé « Crédulité, causalité, supposition. La Chronique ou le texte duplice », est examinée l’apparente divergence entre le roman et sa préface où le romancier-érudit expose sa méthode et signale la difficulté à juger le xvie siècle avec les idées du xixe. Peu satisfait des interprétations de la Saint-Barthélemy, surtout de la thèse de la préméditation royale soutenue par les libéraux, Mérimée innocente les Valois et accuse le peuple sanguinaire, ce qui ne plut guère au Globe. Mais le discours préfaciel est contredit par le roman qui revient à 166l’interprétation traditionnelle du dessein criminel de Charles IX (p. 243-245). Sans doute délibérée, cette contradiction qui discrédite le roman à thèse, peut-elle aussi s’expliquer par la pratique de deux discours aux modalités différentes, celui de l’historien et celui de l’auteur de fiction ? D’un côté, il y a ceux qui constatent que la vérité historique n’est pas respectée, de l’autre, ceux qui reconnaissent dans la pratique mériméenne un des procédés de l’anti-roman. Tout en jugeant pertinentes les analyses de Claudie Bernard et de Peter Cogman qui parlent d’une équivoque structurelle propre au roman historique, Xavier Bourdenet préfère y déceler un « effet pragmatique » ou un « appel à interpréter » qui place le lecteur « dans une position d’inconfort » (p. 252-253). La méthode serait en accord avec le principe de la « narration duplice », avec les procédés connus de la prophétie (celle de Mila ou celle de la lettre mettant en garde Coligny), des épigraphes (qui ont fonction d’annonce directe), des prolepses et présages. Enfin, et contrairement à la pratique traditionnelle du bouclage, la Chronique s’achève sur une « clausule ouverte » (p. 262), ce qui rappelle la rupture de l’illusion théâtrale à la fin des pièces du Théâtre de Clara Gazul. Ce procédé est redoublé par l’incertitude du lecteur qui peut se demander à quel narrateur il a affaire, d’autant plus qu’il est sans cesse confronté à une série d’hypothèses ou à l’« ambiguïté généralisée » qui caractérise le récit et même les personnages du « méchant roman » (avec le cas emblématique de l’insaisissable Diane de Turgis). Cette ambiguïté est levée quand le peuple se déchaîne.
C’est à « Mérimée nouvelliste » qu’est consacrée la troisième partie sous-titrée « L’Histoire par morceaux ». Des cinq nouvelles publiées en 1829, deux sont retenues et analysées selon le même protocole anthropologique : Vision de Charles XI et L’Enlèvement de laredoute, entre la fable et l’Histoire pour l’une, épisode militaire initiatique et allégorie pour l’autre (p. 311-339). Suivent deux chapitres sur l’influence du modèle archéologique avec La Vénus d’Ille, Carmen et Lokis où fiction et érudition se déploient, quoique, à vrai dire, la fiction l’emporte. Dans La Vénus d’Ille comme dans Carmen, il s’agit d’une « quête savante » (les monuments historiques du Roussillon, le site de Munda), escamotée ou supplantée par la quête érotique, la séduction ou le malaise lors de la contemplation de la statue et dans la scène de première vue dans Carmen. S’opère alors un « déplacement érotique de l’objet de savoir » (p. 366). 167Les figures ressemblantes de la Vénus et de Carmen qui incarnent une force naturelle, le narrateur tente de les appréhender par le biais du langage (les inscriptions sur la statue, le rommani), c’est aussi le cas de Wittenbach à la recherche des traces de la langue originelle, comme le montre le chapitre « Archéo-logie : la langue de l’archè ».
Dans la dernière partie, « Mérimée historien », logiquement la plus développée (p. 443-691), Xavier Bourdenet examine la pratique historiographique de Mérimée qui semble à l’écart de la pensée historique de son temps, point qui aurait mérité examen. Comme on s’est quasiment désintéressé de ce large corpus, soit plus de vingt-cinq ans de travaux, il convenait de le considérer à nouveaux frais, à partir du tournant érudit qu’on date un peu abusivement de 1846, alors qu’avant Carmen Mérimée écrivit des notices historiques et ses Études sur l’histoire romaine, sans oublier la part érudite et historique des Notes de voyage. S’impose donc une nouvelle chronologie : 1835-1846, érudition et fiction ; 1846-1866, histoire d’abord majoritaire puis exclusive entre 1852 et 1866. Abondante et multiforme, l’œuvre historique de Mérimée est faite de monographies savantes, de comptes rendus qui sont de véritables études – c’est une des caractéristiques de sa pratique d’historien –, dans LeMoniteur universel, la Revue des Deux Mondes, le Journal des Savants ou la Revue archéologique. Bien qu’il ne soit pas un historien professionnel, Mérimée a conscience de l’altérité et de l’altération ou de l’obscurité du passé, et il a une méthode qui est une herméneutique. Par l’examen critique des sources (textuelles ou matérielles) et des témoignages, il veut expliquer les faits, les caractères et les actions de ces figures d’exception que sont don Pèdre, Catilina ou Pierre le Grand, car il privilégie la thèse du rôle des grands hommes dans l’Histoire, sans négliger l’influence des mœurs. Mérimée est un historien rationaliste, prudent, toujours préoccupé du vraisemblable quand il s’agit de trancher entre deux versions, considérant l’Histoire comme un récit dans lequel le narrateur doit intervenir (p. 508-514). Sa méthode et ses principes font l’objet des troisième et quatrième sections : « Une philosophie insciente de l’Histoire ». On lira avec profit les pages sur l’Histoire comme crise, avec ses agents (la populace et le grand homme), avant l’expérience de 1848 où Mérimée réagit en bon conservateur sinon en réactionnaire. La dernière section (« La fiction dans les marges de l’Histoire », p. 627-691) traite de la pratique de la traduction d’œuvres russes, c’est-à-dire la part 168hétérographe de l’œuvre de Mérimée, aspect déjà abordé à propos de Lokis et de « la langue de l’archè » (p. 399-414). On voit encore une fois qu’il n’existe pas toujours de frontière nette entre l’historiographie et la fiction, notamment quand, au fil d’une enquête érudite, entrent en jeu ces quatre dispositifs que sont la greffe (la pièce Les Débuts d’un aventurier dérive de l’entreprise historique des Faux Démétrius), la germination, quand l’histoire suscite la fiction (Don Pèdre et Carmen), l’entrelacs (présence dans Stenka Razine, ouvrage historique, de poésies légendaires), et enfin la contamination ou la surimpression (dans l’Histoire de la fausse Élisabeth l’historien est « gagné par le roman »). Deux exemples, Les Débuts d’un aventurier et Stenka Razine, permettent de montrer qu’il arrive parfois que le savoir historique subisse « l’épreuve de la fiction » (p. 634-691). Il y a « complémentarité génétique et distinction générique » dans les cas de la pièce et de l’épisode des Faux Démétrius, deux versions de la même « contre-histoire » par laquelle Mérimée s’oppose à la thèse de Karamzine ; dans le cas de Stenka Razine, le discours historique est concurrencé par la légende mise en scène selon le dispositif utilisé dans La Guzla, mais cette fois c’est « une version des faits que l’historien ne doit considérer qu’avec prudence et distance ».
Au terme de ce parcours, on comprend que dans l’œuvre de Mérimée, qui s’est toujours défié du « romanesque » et déclaré inapte au roman, l’histoire dans sa dimension anthropologique n’est ni une « diversion » ni une annulation de la littérature.
Michel Arrous
Sorbonne Université