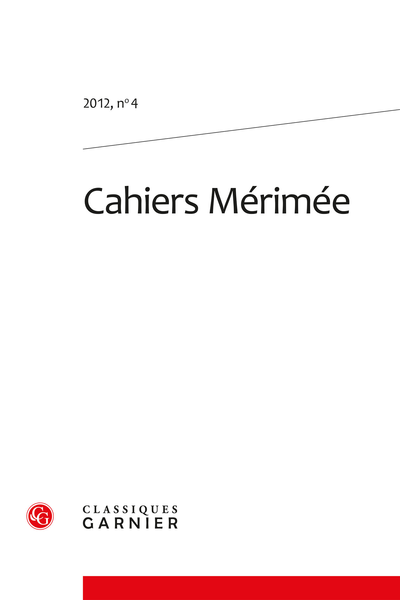
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Mérimée
2012, n° 4. varia - Auteurs : Becker (Colette), Aymes (Jean-René), Géal (François)
- Pages : 183 à 194
- Revue : Cahiers Mérimée
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439261
- ISBN : 978-2-8124-3926-1
- ISSN : 2262-2098
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3926-1.p.0183
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Prosper Mérimée, textes réunis et présentés par Antonia Fonyi, Caen, Lettres modernes, Minard, « Écritures XIX », 6, 2010, 264 p. (Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 2007.)
Ce volume rassemble vingt et une des communications présentées au colloque « Prosper Mérimée », qui s’est tenu à Cerisy du 1er au 8 septembre 2007. Pour rendre compte de cette manifestation dans son intégralité, il faut en ajouter trois autres, déjà parues dans le numéro 1 des Cahiers Mérimée (2009), dues à Pierre Glaudes (« Prosper Mérimée et la critique espagnole »), Jean Sentaurens (« C’est la faute à Carmen ») et Paolo Tortonese (« Mérimée, supercherie et couleur locale »).
Mérimée connut en son temps de gros tirages. Académicien, sénateur, écrivain respecté, il était célèbre. Mais, après sa disparition, il tomba au purgatoire. De sorte que, lors du centenaire de sa mort, en 1970, on ne s’intéressa guère qu’à l’inspecteur des Monuments historiques, qui, à partir de 1834, contribua considérablement, on le sait et ce fut rappelé à Cerisy, à la sauvegarde de notre patrimoine. Antonia Fonyi, dans son texte de présentation, retrace ces fluctuations dans l’approche de l’homme de lettres. Elle énumère aussi les initiatives à l’origine d’un retour d’intérêt pour une personnalité infiniment plus complexe qu’on ne le prétend encore trop souvent et pour une œuvre plurielle, en partie encore mal connue : séminaire qu’elle anime dans le cadre de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), site « Prosper Mérimée », ouvert par le ministère de la Culture lors du bicentenaire de la naissance de l’écrivain en 2003, qui lança une série de manifestations, création d’une Société Mérimée et des Cahiers Mérimée, publication, à la librairie Champion, des Œuvres Complètes en 16 volumes, à laquelle travaille quelque quarante chercheurs, etc. La tenue à Cerisy d’un colloque d’une semaine parachève et consacre cette « renaissance ».
Le volume qui en est sorti est divisé en quatre sections. La première, « Mérimée écrivain. Distance versus violence », regroupe huit communications qui, en s’appuyant sur divers aspects de l’œuvre (romans, nouvelles, pièces de théâtre, correspondance), mettent en relief son ancrage dans la société contemporaine et montrent un
Mérimée toujours en quête de savoirs, dont il nourrit sa réflexion et son imaginaire tout en se refusant à tout parti pris, à tout dogmatisme : curiosité, le plus souvent sceptique, à l’égard des fantômes (Daniel Sangsue, « Mérimée et les fantômes à travers sa correspondance »), des vampires (Scott Carpenter, « Vampirisme et production littéraire : se nourrir du sang des autres »), de l’histoire, les événements du passé permettant de mieux comprendre l’histoire récente, voire la violence inhérente à la nature humaine (Thierry Santurenne, « La Jaquerie de Mérimée : une dramaturgie de la violence sociale ») ou l’évolution des liens entre générations (Christian Chelebourg, « Le Sens de la famille : filiation, transmission, générations chez Prosper Mérimée »). Quatre communications approfondissent la personnalité de cet homme, en qui on ne voit trop souvent qu’un mondain froid, rationnel, ironique. Or, sa correspondance est caractérisée par la fantaisie, la liberté d’écriture (Thierry Ozwald, « Correspondance (1822-1835) : humoresques de Mérimée »). Elle est comme un laboratoire de l’œuvre, préparant, en quelque sorte, les « fantaisies dramatiques » du Théâtre de Clara Gazul, que Musset, auquel le lient affinités personnelles et esthétiques, n’oubliera pas (Sylvain Ledda, « Musset et Mérimée. Dramaturges de la fantaisie »), ou certaines nouvelles mondaines comme La Double Méprise, dans laquelle il décortique le cœur humain (Anne Geisler-Szmulewicz, « Les Nouvelles mondaines de Mérimée ou les comédies du cœur humain »). La désinvolture, apparente, la sprezzatura, masque souvent la profondeur de l’analyse et l’art de l’écriture (Philippe Garnier, « La sprezzatura de Mérimée »).
Le second ensemble de communications, « Vivre et écrire l’histoire », offre trois études qui reviennent sur quelques idées reçues concernant l’homme. Alors qu’on ne voit souvent en lui que le familier du couple impérial, Alain Schmitt montre qu’il fut un libéral, au sens de l’époque, longtemps proche d’un groupe constitué par Thiers et les doctrinaires (« Mérimée libéral »). Il porta un regard original sur Xénophon, dont il lit avec admiration L’Anabase et dont il fait un « philosophe pratique », un moderne, impartial parce que cosmopolite (Pierre Pontier, « Le Xénophon de Mérimée »). Quant à sa pratique d’historien, Michel Garcia l’étudie à travers la genèse de l’Histoire de Don Pèdre 1er, roi de Castille, insistant sur sa quête minutieuse des documents et sur leur utilisation non moins soucieuse de vérité.
Mérimée a aussi tenté la critique d’art. Mais on ne peut pas dire que ses deux Salons, publiés en 1839 (Revue des Deux Mondes) et 1859 (Le Moniteur Universel), sortis de l’oubli par Bruno Foucart, soient mémorables ! En revanche, l’action de l’inspecteur des Monuments historiques, sur laquelle reviennent, dans la troisième partie de l’ouvrage (« Art et Archéologie ») Françoise Bercé et Jannie Mayer, deux spécialistes en la matière, fut capitale. La première étudie son attitude devant les journées de 1848, sa lutte pour continuer la sauvegarde des monuments anciens, menacée par la situation financière, son ralliement au Second Empire étant dicté, selon elle, par son horreur des violences et par sa croyance en la nécessité d’un régime fort pour la poursuite de son œuvre (« Prosper Mérimée et la Seconde République »). Il devait travailler à la sauvegarde des édifices, mais aussi à celle du décor et des objets d’art. Jannie Mayer montre, maints exemples à l’appui, quel rôle de premier plan il a joué, en particulier pour la protection et la restauration des peintures murales (« Mérimée et les objets d’art »).
« Ailleurs mériméens », titre alléchant pour regrouper les dernières communications qui pointent de nouvelles facettes de l’homme et de l’œuvre : son goût pour les idiomes étrangers et leur valeur poétique (Éric Bordas, « Mérimée ou le romanesque de la linguistique »), son goût pour l’anecdote si décriée, mais pour lui riche en enseignements sur l’homme et le monde (Patrick Rebollar, « Tourisme en Mérimée »), son attitude envers les Polonais et ses relations étroites avec la Russie (Michel Cadot, « Le monde slave de Mérimée »), son admiration pour Cervantès auquel il consacra deux études, aux deux bouts de sa carrière, en 1826 et en 1869 (Jean Canavaggio, « Mérimée, lecteur de Don Quichotte »).
Certaines figures mériméennes constituent des matrices particulièrement fécondes, ainsi celle de Carmen, qui est, nous rappelle François Géal (« Le Mythe de Carmen entre les mains du cinéma espagnol : l’exemple de Carlos Saura (1983) »), à l’origine d’une centaine de films, dont le très original Carmen de Carlos Saura et du chorégraphe Antonio Gades, ou encore celle de la Vénus d’Ille, qui inspira plusieurs musiciens, dont Paul-Henri Busser, qui en tira un drame lyrique en 3 actes et 7 tableaux, présenté par Marie-Noëlle Auguste (« La Vénus d’Ille de Mérimée ou la muette opératique »).
Ce volume est ainsi caractérisé par une exceptionnelle diversité des approches : histoire littéraire, linguistique, histoire de l’art, histoire,
études cinématographiques, musicologie, etc. Il suggère à l’évidence la richesse d’une œuvre plurielle et d’une personnalité complexe, qui commencent à apparaître. De nombreuses pistes sont lancées, beaucoup reste à faire. La publication des Œuvres complètes permettra cette relecture, voire, pour certains textes, leur lecture.
Colette Becker
Université Paris X
Nanterre-La Défense
François Géal, Relire les Lettres d’Espagne de Mérimée, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 10, « Série Mérimée », 1, 2010.
À une époque où les éditeurs pratiquent plus que jamais le marketing, il faut regretter que l’ouvrage de François Géal ne comporte, en quatrième de couverture, outre une présentation des Lettres d’Espagne, qu’une pauvre phrase signalant la qualité de la recherche conduite par l’auteur, lequel propose « une relecture attentive » des pages de Mérimée. Cette phrase est désolante par son insuffisance, car, en vérité, le lecteur se voit offrir le résultat séduisant d’une recherche qui court au long de 400 pages, approfondie et difficilement surpassable, tout à la fois nuancée, ni trop savante, ni surchargée d’effets de style.
La bibliographie qui s’étend sur plus de 15 pages est d’une extraordinaire et insoupçonnable richesse. Sont répertoriés les « Études critiques sur Mérimée et son œuvre » (22 entrées), les textes relevant de la « Littérature de voyage » (45 entrées), les « Études critiques sur la littérature de voyage » (pas moins de 71 entrées), une « bibliographie particulière » pour chacune des Lettres et enfin une rubrique « Varia », un peu fourre-tout (plus de 70 entrées). On a mauvaise grâce à signaler que ne figurent pas, à moins qu’elles n’existent pas, des études postérieures à 2008. Pour cette année-là apparaissent les travaux portant sur Goya, dues à René Andioc récemment disparu.
L’une des séduisantes caractéristiques du travail de F. Géal est que celui-ci, loin de faire cavalier seul de façon présomptueuse, se reporte sans arrêt, sur tous les sujets abordés, aux spécialistes qui l’ont précédé, depuis les plus classiques (et, en général, pas les plus précis et convaincants) jusqu’aux actuels, quatre d’entre eux, dont le nom est mentionné, ayant livré de vive voix des informations à l’auteur. Par honnêteté intellectuelle, F. Géal multiplie les citations de ces nombreux spécialistes vers lesquels il se tourne de façon révérencieuse, hormis dans deux cas où il déclare son désaccord (avec un chercheur espagnol et avec les éditeurs du texte de Mérimée paru dans la collection de la Pléiade).
La richesse des notes de bas de page est telle que, en maintes occasions, elles occupent autant d’espace que le texte lui-même. La richesse des considérations, qui frôle la surabondance, conduit parfois à de légères réitérations observables entre l’Introduction (plus de 90 pages) et la
Conclusion (17 pages) qu’on pourrait souhaiter plus condensée et moins alourdie de nouvelles et longues notes de bas de page.
L’un des grands mérites de F. Géal est de ne pas s’en être tenu à un tête-à-tête avec l’œuvre de Mérimée, mais de l’avoir confrontée systématiquement, sur quantité de sujets, à d’autres récits de voyages en Espagne. Naturellement, on retrouve là Gautier, Chateaubriand, George Sand, Custine, Laborde, Stendhal, Ford, Taylor, Dumas (assez peu, curieusement), mais aussi des écrivains moins connus, tels que Cornille, Dembowski, outre les voyageurs de l’époque des Lumières, tel le marquis de Langle. En d’autres termes, l’étude conduite par F. Géal est fondamentalement comparative. Elle révèle l’impressionnante dimension de la culture et du champ de la curiosité de l’auteur. Hispanistes, francisants et comparatistes trouveront là une mine d’utiles informations et de suggestives observations ayant trait aux notions de « pittoresque », de « couleur locale », d’« exotisme », de « costumbrismo » et d’« imaginaire social ». On ne s’étonne pas dès lors que soient souvent appelés en renfort, à propos des romantiques, des spécialistes éminents tels que Pierre Brunel, Jean-Claude Berchet et d’autres entrés en lice plus récemment, comme Friedrich Wolfzettel ou Marie-Ève Thérenty.
Dans son Introduction, tout comme dans l’analyse des cinq Lettres de Mérimée, F. Géal analyse tout d’abord le contenu du texte et termine par l’étude de l’écriture propre à la forme épistolaire.
Me bornant à des observations schématiques et lacunaires, je me hasarderai à dégager et énumérer les idées qui, à mon sens, sont les plus pénétrantes et les plus innovantes, relativement au regard spécifique porté par Mérimée sur l’Espagne et les Espagnols au cours de son voyage outre-Pyrénées effectué en 1830 : celui-ci s’explique en partie, de manière inattendue, par une déception de nature sentimentale. Au contraire notamment de Laborde et de Taylor, Mérimée refuse le modèle encyclopédique. Il ne puise pas principalement à des sources littéraires, comme le font Gautier et de Chateaubriand. En revanche, il accorde un intérêt privilégié aux conversations engagées avec les habitants. Son regard prétend être personnel, neuf, sans médiations extérieures. Les stéréotypes n’occupent qu’une place mineure. Son voyage est conçu comme révélateur d’un « je » qui, toutefois, ne s’épanche pas, car le « moi » sensible demeure soumis au « moi » intellectuel.
Sans doute, comme les lecteurs français devaient s’y attendre, à la corrida est consacrée toute une Lettre et l’Andalousie est tenue pour la meilleure représentante de l’Espagne attirante, mais Valence et le Levant bénéficient d’une promotion inattendue. En revanche, en matière de peinture, dans la Lettre V centrée sur le musée madrilène du Prado, outre le silence maintenu sur les peintures allemande, française et espagnole contemporaines, Goya est gravement sous-évalué. Alors que le traitement de « L’Exécution capitale » (Lettre II) pouvait donner lieu à des commentaires « engagés » visant le détestable régime, absolutiste, répressif et obscurantiste, instauré par Ferdinand VII à partir de 1815, puis à partir de 1823, Mérimée, au contraire d’un Custine ou d’un Quinet, s’abstient – on pourra le regretter – de prendre parti ; d’où l’absence de positionnement politique. Même si son inclination le porte du côté des types populaires, et non du côté des puissants et des élites, il reste que, pour reprendre une expression de F. Géal, « le contexte social existe peu ». Mérimée n’est ni un juge, ni un moraliste, ni un réformateur. Cette retenue se retrouve dans son application à contrôler son écriture, à préférer la clarté aux pirouettes stylistiques et à se refuser aux envolées lyriques à la façon de Dumas. Ce qui peut être tenu pour des manques ou des limites ne nuit cependant pas, tant s’en faut, au plaisir de la découverte d’un récit de voyage fortement original qui, comme l’écrit F. Géal dans la dernière ligne de son admirable étude, se situe « à la frontière des genres et des discours, et à la frontière du littéraire ».
Jean-René Aymes
Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle
Jean Lacouture, Carmen. La Révoltée, Paris, Le Seuil, 2011, 227 p.
Dans Le Nouvel Observateur du 8 septembre 2011, l’annonce de la parution du dernier livre de Jean Lacouture s’achevait par cette conclusion : « Grâce à Lacouture, Carmen est dévoilée de [sic] son mystère. La Gitane est désormais sans filtre. »
À 90 ans, le juvénile M. Lacouture, grand reporter connu pour ses nombreuses biographies, a beau s’exprimer avec plus de correction et de brio que nombre de ses confrères de la presse écrite contemporaine (la citation qui précède est là pour en témoigner), son Carmen. La révoltée n’est pas sans défauts.
L’idée de revenir sur le personnage forgé par Mérimée n’a rien de condamnable, et l’on peut suivre M. Lacouture lorsqu’il écrit, p. 12 : « Mérimée avait dessiné un personnage littéraire saisissant, Bizet en a fait un mythe ». La thèse principale du livre, ressassée plutôt que démontrée, est la suivante : à la Carmen sombre de Mérimée, au « fatalisme radical » (p. 15), à cet « être ligoté par trois fatalités, en tant que femme, Gitane, et amoureuse » (p. 218), ferait pendant, trente ans plus tard, la Carmen solaire, émancipée et révoltée de Bizet et de ses compères librettistes Meilhac et Halévy : « Mérimée, qui aimait si ardemment l’Espagne, avait écrit l’histoire d’un malheur. Bizet et ses librettistes de 1873 écrivent celle d’un bonheur inaccompli » (p. 207). Se trouvent ainsi justifiés le titre et le sous-titre du livre, et, en couverture, la photographie quelque peu racoleuse d’Anna Caterina Antonacci, la cantatrice qui reprit en 2010 le rôle de Carmen à l’Opéra-Comique.
Cette évolution du texte à l’opéra, qualifiée de « mutation », tiendrait à la fois à des différences de tempérament des auteurs (cynisme et pessimisme d’un côté, fougue et optimisme de l’autre), et à des évolutions historico-culturelles de grande ampleur affectant l’Espagne et surtout la France, travaillée par « une dégradation du légitimisme monarchique et l’avènement chaotique des libertés » (p. 35). Prudent, Lacouture avoue lui-même : « On se contente de suggérer cette hypothèse. Non sans en mesurer la fragilité » (p. 192).
Mieux inspiré, il souligne le tour de force qui consista, pour les librettistes et Bizet, à transformer une histoire cruelle en « œuvre de divertissement » destinée au public familial de l’Opéra-Comique. Il met l’accent sur l’accueil désastreux que lui réserva la presse bien-pensante,
lors de sa création en 1875, ce qui ne l’empêcha pas de connaître bientôt une nouvelle carrière qui en fait aujourd’hui l’opéra le plus joué au monde.
De même, il souligne à juste titre l’importance, dans l’histoire de la culture et tout particulièrement de la musique et de la danse du xixe siècle, de l’hispanomanie qui submergea Paris dès l’époque romantique – un engouement devenu une véritable « mode » à partir de la fin des années 1830. Cette mode était en lien étroit avec la présence d’une émigration espagnole désireuse d’échapper à la répression du libéralisme par Ferdinand VII, puis, dans les décennies suivantes, aux troubles provoqués par les guerres carlistes. Cette population compta parmi ses membres des personnalités aussi éminentes que les compositeurs Manuel García (et ses filles Marie et Pauline, promptes à reprendre le flambeau), Sebastián Yradier, Fernando Sor, ou la danseuse Petra Cámara. Quel que soit le talent de Bizet, son opéra n’est pas né de rien.
J. Lacouture insiste aussi sur la pertinence des observations tauromachiques de Mérimée, la « finesse et la mesure » dont il fait preuve (p. 102) dans la première des Lettres d’Espagne. C’est elle qui explique, selon Jean Lacouture, la comparaison de la mort de Carmen avec le rituel tauromachique : « ce qui rapproche les deux mises à mort, c’est leur caractère prémédité ou programmé » (p. 143). Selon M. Lacouture, la construction narrative de la nouvelle se trouverait elle-même marquée par ce dispositif : premier tercio, apparition du matador, don José, désarmé mais menaçant ; 2e tercio : mise à mort de l’officier amoureux de Carmen ; 3e tercio : apparition du picador Lucas (p. 144-145). Le rapprochement nous semble néanmoins approximatif, d’autant qu’à la page suivante, M. Lacouture lui en substitue un autre : « Mérimée frappe trois fois : la culbute infligée par un taureau de Cordoue au picador Lucas, les coups de couteau dont José frappe Carmen, l’exécution de l’assassin » (p. 146) ; et encore un nouveau, p. 167 : « Plus la confession de José se prolonge et plus le nœud se resserre, comme si le récit n’était en fait que celui d’une mise à mort, du troisième tercio de la corrida, sans même que le lecteur-spectateur ait pu voir voltiger les capes ou s’agiter les banderilles. »
Plus convaincante est l’idée selon laquelle Carmen semble « un texte moins inventé que dicté. […] Ici, Mérimée n’est plus un conteur virtuose, il écrit comme un récitant, tendant l’oreille à une voix qui pourrait être celle du destin » (p. 152).
Une autre hypothèse, qui mériterait d’être creusée, a trait à l’évolution politique de Mérimée : selon M. Lacouture, c’est le second voyage en Espagne de 1840 qui le confronte à la mascarade du coup de force d’Espartero, et, bien avant les événements français de 1848, transforme le libéral qu’il était encore en 1830 en conservateur (p. 114 sq.). Du moins peut-on suivre l’essayiste lorsqu’il affirme : « L’amour pour cette culture, pour ce peuple, est quasi intact. Ce qui a changé chez Mérimée, c’est le regard qu’il porte sur les deux sociétés, de part et d’autre des Pyrénées » (p. 117).
Malheureusement, le propos est émaillé de nombreuses erreurs factuelles, d’affabulations et de lieux communs. Il serait trop long d’en dresser un catalogue exhaustif : nous nous contenterons d’un florilège.
M. Lacouture semble d’abord fâché avec les dates. La future reine Isabelle II n’avait pas trois ans en 1840 (p. 113), mais dix. Notre-Dame de Paris date de 1831 et non pas de 1838 comme il l’affirme (p. 134). Et il faut avoir une conception singulièrement vague de la chronologie pour affirmer que Le Vase étrusque a été écrit « à peu près à la même époque [que Carmen] » (p. 152).
Il est également fâché avec les vocables : « Jaque ? Espagnols ou français, les dictionnaires sont discrets sur ce mot et sa signification. L’un parle tout bonnement d’un “individu de peu d’importance”, l’autre d’un “type”, le troisième d’un “fier-à-bras” ? C’est la troisième acception du mot qu’on veut retenir ici » (p. 124). Tous les ouvrages lexicographiques attestent que dès l’époque classique, jaque (ou jaquetón) a toujours signifié une seule et même chose : « chulo, bravucón, fanfarrón », soit crâne, bravache, fanfaron.
Il est fâché avec les noms propres, qu’il s’agisse de personnages fictifs (Mateo Falcone écrit à plusieurs reprises avec deux t), ou de personnes réelles, au point de confondre Maurice Levaillant et notre collègue Jean Balsamo, auquel il attribue la réédition de Mosaïque de 1933 (p. 97, 136). Ce n’est pas non plus à Ivan Tourguéniev, dont il traduirait plus tard des ouvrages, que Mérimée proposa de l’accompagner en Espagne en 1830 (p. 86), mais à l’historien russe Alexandre Tourguéniev.
Les données biographiques ne sont pas mieux traitées. L’enfance de Mérimée est évoquée en des termes contestables : « Prosper Mérimée […] n’eut jamais avec ses parents que des rapports fondés sur l’autorité ou les convenances » (p. 69). Plus loin, M. Lacouture lui fait effectuer
un second séjour en Andalousie en 1840 (p. 123), alors qu’il y a mis les pieds pour la première et dernière fois en 1830.
Faire de Mérimée un voltairien « au sens le plus aigu du mot » (p. 67) n’est pas neuf ; ce n’est pas non plus absurde, et Jean Lacouture a raison de souligner qu’en pleine époque romantique, notre auteur « avance sur un autre chemin » (p. 66). Il n’en reste pas moins que Mérimée n’est pas cet homme du xviiie siècle égaré au siècle suivant : ce savant et polyglotte croit aux progrès des sciences humaines en voie de constitution (linguistique, ethnologie, et peut-être surtout archéologie) et il participe lui-même activement à leur essor.
M. Lacouture traite également avec une grande légèreté les données éditoriales les mieux avérées : contrairement à ce qu’il écrit (p. 97), Mérimée a bien publié l’essai sur la peinture espagnole qu’il projetait : il prit la forme d’une lettre intitulée « Musée du Prado », publiée dans L’Artiste en mars 1831. Toujours selon ses dires, l’écrivain qui, à cette époque, n’apprécie guère Goya, changera « plus tard » d’opinion (p. 87) : en réalité, jamais Mérimée n’admirerait vraiment le peintre aragonais.
Lorsque M. Lacouture ignore un détail, il l’invente : à propos du célèbre recueil Los españoles pintados por sí mismos (1843-1844), il affirme sans vergogne qu’il s’agissait d’un « colloque réuni à Paris au début des années 1840 sur le thème “Les Espagnols peints par eux-mêmes” », et animé par le prestigieux Estébanez Calderón (p. 121 ; et de nouveau, p. 136). En fait, il s’agissait d’une entreprise éditoriale en étroite liaison avec les milieux du journalisme, inspirée d’exemples anglais (The Heads of the People : or Portraits of the English, 1838) et français (Les Français peints par eux-mêmes, 1840-1842, volume dirigé par Léon Curmer, qui, dans la ligne des Physiologies, prétendait offrir au public contemporain rien de moins qu’une « Encyclopédie morale du xixe siècle »).
Un défaut plus grave consiste à faire assez naïvement d’une œuvre de fiction le simple calque des realia, realia évoqués du reste de façon approximative. Invoquant l’autorité d’Yves Harté (p. 126), M. Lacouture voit ainsi dans le personnage de José Navarro une transposition directe du célèbre torero et contrebandier José Ulloa Navarro, dit Tragabuches, attribuant à ce dernier une origine navarraise. Même si de nombreuses zones de mystère entourent cette figure fameuse, le Tragabuches était natif d’Arcos de la Frontera, dans la province de Cadix. Toujours à propos du personnage de José Navarro, il est également discutable de
prétendre que Mérimée traite « assez nonchalamment » des origines « ethniques » de don José et que la confusion entretenue entre les deux cultures basque et navarraise est « irritante » (p. 125-126). Il n’y a absolument pas contradiction : don José, né à Elizondo, est clairement navarrais, et sa langue maternelle est le basque. C’est tout aussi cavalièrement que M. Lacouture affirme à propos de la rédaction de la nouvelle mériméenne : « Prosper Mérimée n’avait d’ailleurs qu’à puiser dans ses propres dossiers – assez mal tenus [sic] – et ses œuvres antérieures […] pour évoquer avec pertinence l’univers des bandits » (p. 136-137).
Si la documentation est, on le voit, traitée avec désinvolture, le propos se caractérise souvent par la facilité. Les redites et les redondances abondent, et de longues citations empruntées à Carmen ou à la correspondance de Mérimée, qui donnent certes envie au lecteur de se reporter au texte, tiennent trop souvent lieu d’analyse.
Quant à la bibliographie, malgré quelques références précieuses (notamment aux travaux du grand hispaniste Jean Sentaurens), elle est à la fois disparate et datée. Elle contribue à donner à l’ouvrage un aspect hybride : ni travail universitaire, ni cet essai libre qu’on aurait pu attendre.
En définitive, cet ouvrage consacré pour les deux tiers à Mérimée comporte quelques idées suggestives, mais il risque fort de heurter les mériméistes en raison des informations erronées, des approximations et des jugements hâtifs ou hasardeux qu’il contient, défauts d’autant plus regrettables que l’on peut escompter de la notoriété de son auteur et de son éditeur (mais où sont donc passés les relecteurs qui ont tant fait pour le prestige de cette maison ?) une assez large diffusion auprès d’un public de lycéens, voire d’étudiants. Espérons pour M. Lacouture que les musicologues se montrent moins sévères vis-à-vis de celui qui a l’honneur de présider la Société des Amis de Georges Bizet…
François Géal
ENS Paris