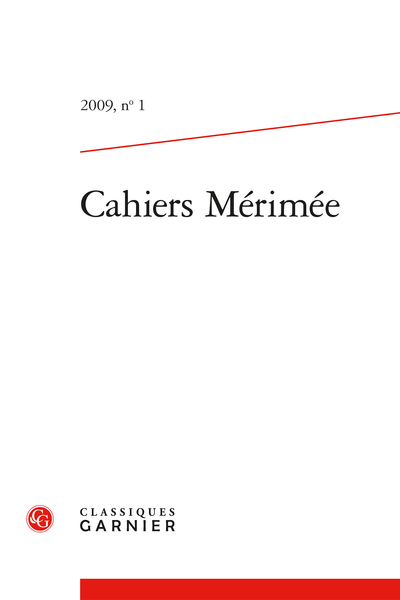
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Mérimée
2009, n° 1. varia - Auteurs : Coste (Bénédicte), Schmitt (Alain), Santurenne (Thierry), Galvez (Marie)
- Pages : 185 à 201
- Revue : Cahiers Mérimée
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439230
- ISBN : 978-2-8124-3923-0
- ISSN : 2262-2098
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3923-0.p.0185
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/12/2009
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Pierre Glaudes commente Nouvelles de Mérimée, Paris, Gallimard, « Foliothèque », 2007. 250 p.
L’ambition de cette collection est d’offrir une introduction substantielle à une œuvre ou un auteur par le biais d’un essai doublé d’extraits de critiques ayant fait date. Avec Mérimée la tâche se complique de l’hétérogénéité de ses nouvelles et du statut de l’écrivain dans les lettres francophones. Mal aimé, affligé d’un style jugé « sec », il fait pâle figure aux côtés de ses contemporains. C’est à contrer cette vision réductrice que s’emploie P. Glaudes en situant l’écriture mériméenne dans une nouvelle perspective esthétique et intellectuelle, et en rappelant que l’homme fut aussi un savant dont les recherches érudites et la curiosité nourrirent la prose.
Que Mérimée fut un sceptique n’est pas nouveau, mais l’auteur examine les conséquences littéraires de cette position héritée des Lumières. Mérimée se défie de la littérature qui masquerait le réel ou en donnerait une vision faussée. Il lui assigne rien moins que l’énonciation de la vérité des faits, ce qui en limite le déploiement pour la concentrer principalement sur la présentation des illusions humaines. Contre tout un pan lyrique ou social de la littérature contemporaine, Mérimée choisit d’écrire sur les limites posées à l’homme par le langage car il sait que ce dernier échoue devant un point de réel irréductible dans les choses et chez le sujet. Il est l’écrivain de la division subjective, qu’elle prenne l’aspect d’une stricte démarcation entre ses narrateurs et les personnages ou qu’elle touche ces derniers qui sont le plus souvent victimes de leurs illusions au moment où ils pensent les avoir dépassées.
Pour exprimer ces méconnaissances, l’écriture mériméenne adopte une distance ironique et use du pastiche. P. Glaudes se
livre à une analyse efficace des stratégies rhétoriques de Mérimée qui incluent la réécriture ironique de genres littéraires, la dénonciation de l’effet déformant d’une vision purement romanesque de l’existence et le refus de l’illusion référentielle à travers l’accent mis sur l’énonciation. La littérature devient expérience du passage parfois difficile de l’illusion à la réalité la plus prosaïque.
Quant à la division subjective, elle prend aussi l’aspect d’une faille entre deux états psychiques et culturels. Sauvages contre civilisés, hommes-animaux contre contemporains réduits à une creuse érudition. Mérimée est aussi un ethnographe et des plus avisés. Sa position est celle du voyageur, non du touriste, qui accepte de se laisser traverser par la rencontre de l’altérité sans chercher à la réduire au même (position réservée à certains de ses personnages pour l’édification du lecteur). Loin de tout folklore, il montre l’irréductible différence entre les hommes à partir d’un relativisme culturel toujours maintenu. Pourtant, au-delà des différences, il y a ce qui lie les hommes, cette violence originaire et si habilement présentée par l’écrivain.
Pessimiste et hanté par la mort, Mérimée adopte une anthropologie pessimiste qui se manifeste sous la forme d’une nature ou d’une divinité violente et mortifère. Cette figure de la transcendance empêche l’immanence pure et elle apparaît in fine puisque ses nouvelles vont du connu à l’arché qui dévoile la réalité objective de cette négativité dont Carmen est l’exemple. Toutefois, en postulant cette instance obscure, Mérimée reste sur le terrain de la doctrine catholique : il en inverse le contenu mais en garde la structure de pensée. S’il n’entretient aucune illusion sur les préceptes moraux ou religieux, tous instruments de domination, il n’est pas pour autant matérialiste. Il se révèle analyste pertinent des mécanismes du pouvoir et montre que les sociétés égalitaires masquent en fait l’antagonisme des dominants et des dominés. Toutefois, Mérimée ne peut se défendre d’un certain culte des grands hommes qui offrent l’image d’une adéquation entre l’individu et la nation. Cependant ils sont l’incarnation de la liberté
au prix de la liberté des autres. L’œuvre mériméenne n’élude pas la question du mal et son éthique est à la fois celle de la méfiance et de la liberté souveraine du désir qui transforme l’homme en un loup qu’il ne peut s’empêcher d’admirer.
Mérimée est aussi l’un des rares écrivains à l’époque à évoquer ce qui sera théorisé par Freud sous le nom de pulsion de mort, qu’elle prenne l’aspect extérieur du diable ou de Carmen ou de la haine de soi, de la mélancolie qui affecte certains personnages pour leur perte. Que cette divinité destructrice soit la mère archaïque ou une figure de l’inconscient comme gouffre obscur, le mal mériméen est intérieur et la place qu’il accorde à l’intériorité et à la négativité relève bien du processus moderne d’intériorisation de la transcendance, de la « résorption moderne » évoquée par M. Gauchet dans le Désenchantement du monde, constitutive d’une identité où l’altérité intériorisée n’en reste pas moins ambivalente. C’est l’art du commentateur que de désigner une veine de recherche encore peu explorée si l’on admet que les textes littéraires relèvent également de l’histoire des idées et de la philosophie politique.
P. Glaudes examine ensuite la « sécheresse » du style mériméen qu’il analyse comme écriture négative, faite d’une série de retranchements qui évoquent le dandysme littéraire plutôt que la négligence. Mérimée recherche l’impersonnalité, opère une réduction de l’énonciation narrative, choisit des phrases simples, asyndétiques, limite les rapports de causalité. Son écriture de l’euphémisme accorde une place à l’interprétation du lecteur dans la traque d’une vérité servie par le rythme des nouvelles qui s’accélère progressivement et produit un effet de sidération. Ce tempo particulier donne une intensité tragique à la brièveté de l’existence tandis que Mérimée atteint l’obscure clarté qui manifeste le triomphe du négatif. Sa visée consiste, in fine, à donner voix à ce qui est toujours refoulé : l’infans et l’on peut dire que son succès réside dans l’angoisse produite chez le lecteur, mais au prix de sa reconnaissance littéraire.
Cette synthèse très riche se double d’une bibliographie complète et d’une judicieuse sélection de critiques, dont certaines sont difficilement accessibles, et qui témoignent d’une reconnaissance discrète. C’est donc un ouvrage que les étudiants qui n’ont souvent qu’une connaissance parcellaire et orientée liront avec intérêt, non sans penser qu’une édition complète est plus que jamais nécessaire. Car la division subjective prend aussi ici l’aspect d’un clivage renforcé par l’édition et la sectorisation disciplinaire entre l’écrivain et le savant, avec, pour résultat, la méconnaissance des deux. Et c’est la force de cette lecture que de le rappeler, textes à l’appui.
Bénédicte Coste
Université de Montpellier 3, EA 741
Mérimée et le bon usage du savoir. La création à l’épreuve de la connaissance, éd. Pierre Glaudes, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, « Cribles », 2008. 244 p.
Ce volume, consacré aux problématiques du savoir et de la connaissance, présente une approche interdisciplinaire et transversale de l’œuvre de Mérimée. Dans l’introduction, Pierre Glaudes rappelle que la création littéraire de Mérimée « ne représente […] qu’un versant d’un massif largement plus étendu qu’on ne le croit communément » (p. 7), aussi l’unité et la cohérence de l’œuvre se trouvent-elles compromises lorsque seul l’homme de lettres est envisagé par la critique. Par là s’explique la conception du volume : « On s’y est intéressé aux liens du savant avec les institutions académiques et à différentes facettes de ses activités érudites quand il s’occupe d’histoire, d’archéologie ou d’ethnologie.
On s’y est efforcé, en outre, de mieux comprendre son épistémologie » (p. 8).
Sous le titre de « Réseaux de savoir et postures de savants », la première partie du volume est consacrée à l’inscription de Mérimée dans le champ des connaissances de son temps. Jean Leclant, après avoir rappelé les rapports de notre auteur avec les Monuments historiques, évoque ses activités au sein de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dont il était membre. Pierre Pontier aborde Mérimée en lecteur de Grote, en présentant la série d’articles qu’il a publiés, dans la Revue des Deux Mondes, sur la monumentale History of Greece de l’homme politique et historien anglais. Ayant montré la pertinence de ses analyses et relevé ses divergences avec Grote, Pierre Pontier souligne son intérêt peu commun pour la Macédoine et particulièrement pour Philippe II, et émet l’hypothèse que si Mérimée a pu être séduit par le modèle que représente celui-ci, c’est que « l’organisation du pouvoir macédonien évoque l’empire romain » (p. 37). Olivier Poisson s’intéresse à l’archéologue dont la vocation a pu naître, suggère-t-il, de la fréquentation de la famille de Laborde, dès le début des années 1830. C’est probablement à l’influence d’Alexandre de Laborde, initiateur en la matière, que Mérimée doit son orientation militante qui, tout en impliquant un rapport étroit entre étude et conservation, exige que cette dernière soit effectuée dans le cadre d’un État centralisé. Cette conception est à l’opposé de celle d’Arcisse de Caumont, autre archéologue influent de l’époque, et qui ne fait que décrire et classer les monuments. Mérimée, lui, interroge les formes et cherche à leur donner un sens. Une étude sur Mérimée théoricien de l’art, pour qui l’archéologie est une discipline du « savoir voir », serait bienvenue, conclut Olivier Poisson. Marie-Catherine Huet-Brichard étudie la mise en œuvre du savoir ethnologique dans La Guzla. Elle montre que dans le sillage des conceptions du xviiie siècle, à l’époque de Mérimée aussi, l’introduction de la culture dans l’histoire détruit le rapport d’immédiateté : l’esprit se substitue
à l’imagination, l’abstraction à la figuration. Dans cette opposition transparaît une économie du désir : ce sont les passions qui firent naître le langage et formalisèrent le discours, explique Rousseau ; ce sont elles aussi qui assurent la prise sur les êtres et les choses, plaide La Guzla. Et, lorsque la passion investit le langage, la poésie se fait performative, « elle dit et les choses sont » (p. 71). D’où se laisse conclure que « le savoir sur les cultures primitives permet à un écrivain, à travers une mystification, de circonscrire l’espace originaire de sa génération », de créer « une utopie, qui dit l’impossibilité d’échapper à l’ici et au maintenant tout en ne cessant de regretter l’avant et l’ailleurs » (p. 73).
Ce travail constitue un lien idéal avec la seconde partie du volume, intitulée « Discours de la méthode », terme polysémique s’il en est, et particulièrement en rapport avec le premier article dans lequel Antonia Fonyi rappelle que la problématique épistémologique qui sous-tend l’œuvre est celui de « l’archè », des origines, des commencements (p. 78). Elle retrace la voie que suit l’auteur de la fiction pour devenir « explorateur des origines inconnaissables » (p. 92). Dans ce dessein, elle montre que le récit mériméen est à double fond, avec une histoire de désir enchâssée dans une histoire de connaissance. Mais Mérimée doute que la connaissance, reconnue comme vérité, soit totalement accessible au sujet, que ce dernier en ait une approche se voulant objective ou qu’il soit un sujet subjectif de la connaissance, c’est-à-dire appuyant sa quête sur un univers de croyance a priori. Les nouvelles mettent en scène les deux types de sujet. Le sujet personnel de la connaissance qui approche de trop près son objet en mourra. Concernant le rapport qui s’établit dans les nouvelles entre connu et inconnu d’une part, et le récit lui-même, d’autre part, Boris Lyon-Caen distingue trois cas de figure. Dans le premier, l’inconnu réside en-deçà ou au-delà du connu (contes merveilleux et fantastiques) ; dans le second, les mystères sont élucidés ; dans le troisième, le savoir est intégralement dispensé par le texte. Pierre Glaudes, ayant noté que le rapport de Mérimée
au savoir est marqué par l’héritage des Lumières, émet l’hypothèse de l’influence de Locke. Il montre que « Mérimée est pris dans ce processus paradoxal analysé par Adorno et Horkheimer (la dialectique de la raison) en vertu duquel les rêves d’émancipation rationnelle, en se concrétisant, tendent à produire leur propre négation » (p. 117), et rejoint Antonia Fonyi en affirmant que la « réalité, dans sa pure objectivité, reste essentiellement impénétrable » et que « l’homme moderne est ressaisi, malgré lui, par les formes de pensée mythique » (p. 133).
Intitulée « Représentation de l’objet », la troisième partie du volume s’ouvre par l’article de Jean-Marie Pailler, traitant du rapport de Mérimée à la Gaule celtique. Bien que nombre des interprétations proposées par l’archéologue soient justes et que les méthodes qu’il préconise soient souvent en avance sur son temps, il n’en demeure pas moins écrivain plutôt que savant. La contribution de Françoise Bercé aussi a trait à l’Antiquité. Elle montre, à la suite d’une étude fouillée des rapports et des actions de Mérimée concernant les monuments antiques du midi de la France, pourquoi ses « échanges avec les savants érudits et les architectes […] ont conduit [l’inspecteur général] à soutenir les seconds, politique qui a favorisé une certaine forme de restauration, fort éloignée des principes affichés au début de la Monarchie de Juillet » (p. 170). Mérimée ne pouvait poursuivre sa quête des origines sans inscrire dans sa démarche épistémologique un voyage en Grèce. Voyage de savant – de philologue, épigraphiste, historien, archéologue, numismate –, comme le montre Adeline Grand-Clément, non sans insister sur le fait que Mérimée « s’imprègne pleinement de ce qu’il observe, pour mieux comprendre le passé et le présent » (p. 187). C’est que Mérimée, qui voyage au moment où l’image romantique de la Grèce cède la place à une vision folklorique, s’intéresse également aux habitants et à leurs coutumes, réconciliant ainsi les deux visions. Pour conclure le volume de manière emblématique, François Géal propose une étude du chapitre IV de Carmen, dont il analyse la structure et la fonction dans l’économie de la nouvelle. Il interroge l’utilisation de la langue gitane
dans l’ensemble du récit et particulièrement dans l’onomastique, suit Mérimée dans sa quête du savoir sur les tsiganes, et affirme que « les spécialistes actuels pourraient […] valider le contenu scientifique de ce chapitre de 1846 » (p. 209). Ayant montré que les gitans, un peuple qui a su maintenir son identité primitive au cours des siècles, permettent à Mérimée de satisfaire cette passion pour l’« archè » que nous retrouvons dans toute son œuvre, François Géal conclut que le chapitre IV de Carmen est un texte « qui ne s’en tient pas à un seul code, ni à un seul ton, qui se dérobe à toute étiquette précise par la subtile ironie qui l’habite » (p. 236).
En définitive, on voit que même si les contributions ne couvrent pas l’ensemble des rapports de Mérimée au savoir, ce qui aurait dépassé un volume, ce recueil en présente déjà un échantillonnage représentatif.
Alain Schmitt
Paris
Michel Crouzet, Mérimée-Stendhal. Roman. Nouvelle, s. l., Eurédit, 2008. 568 p.
Le titre retenu par Michel Crouzet pour son recueil d’articles consacrés à Stendhal et Mérimée associe d’emblée les patronymes de ces compagnons de route du romantisme, en même temps qu’il appose sur le mode de l’inversion les deux genres dans lesquels ils se sont respectivement illustrés : le roman pour Stendhal et la nouvelle pour Mérimée. Le croisement ainsi obtenu est significatif dans la mesure où il invite le lecteur à se montrer attentif aux liens subtils qui se tissent entre leurs œuvres, en dépit de différences de surface qu’on pourrait recenser à loisir pour les remettre aussitôt en question : architecture narrative ambitieuse vs paucité, revendication
d’un certain dilettantisme ancré dans le plaisir de l’instant vs passion de l’arché, ou encore goût pour la musique vs intérêt porté aux formes plastiques… Ce serait oublier de subtiles affinités sur lesquelles Michel Crouzet attire implicitement l’attention tout au long de ces huit articles, fruit d’une vingtaine d’années de réflexion conjointe sur les deux écrivains. Ainsi, dans les études consacrées à Stendhal, il s’interroge sur Armance, roman de jeunesse dont un des thèmes clés est l’impuissance, et Lamiel, roman inachevé, véritable laboratoire de variations romanesques. Sur pareils terrains, l’esthétique de Mérimée est cousine de celle de Stendhal : la fascination de l’auteur de La Vénus d’Ille pour une violence sans cesse soumise au joug de la civilisation pose en d’autres termes le rapport du désir et du réel tels que le personnage d’Octave permet à Stendhal de le problématiser. D’autre part, l’inachèvement de Lamiel renvoie sur un mode différent à l’art de la concision et de la suggestion pratiqué par Mérimée, tandis que son maniement de l’ironie ou du sous-entendu pourrait constituer un pendant inattendu au grotesque de l’opus stendhalien. Mais c’est dans l’étude « Mérimée, Stendhal et l’héroïne capricieuse : Lamiel et Carmen » que Michel Crouzet effectue un rapprochement explicite entre les deux écrivains grâce au regard porté sur deux héroïnes singulières, incarnations de ce caprice qui met le sujet en danger en l’éloignant de la loi et de la règle, « dans cette lacune à la fois de la moralité, de la raison, de l’identité […] une déraison et une dé-liaison qui nie tout ce qui surplombe le présent pur du plaisir, du hasard, de l’occasion » (p. 516). Attitudes féminines qui sont aussi celles de deux artistes attentifs aux mystères de l’instant et d’un désir facteur de trouble.
Si les stendhaliens seront plus particulièrement attentifs au texte suggestif consacré à la perception de Rome par Stendhal et Claudel, l’attention des mériméens se portera vers deux études éclairantes consacrées au seul Mérimée. Dans « Mérimée ethnologue et mythologue romantique », Michel Crouzet s’interroge sur les préoccupations anthropologiques d’un écrivain pour qui « le réel, c’est l’homme, […] absurde ou ambigu : rejeté de tout sens clair et concevable »
(p. 152). L’auteur relie ainsi les singularités d’une esthétique à cette approche des réalités humaines : le regard porté sur la violence et les forces obscures du Moi n’est possible que par la véritable réduction de champ qu’il s’impose, pour maintenir en respect mystères et superstitions – d’où cette prédilection bien connue pour l’ellipse et l’ironie. Est aussi mis en relief le recours de Mérimée à l’Histoire – qui « s’approvisionne à l’étude du cœur humain, de l’immuable stupidité ou férocités humaines » (p. 171) – et à l’ethnologie, moyen de redécouvrir grâce à l’altérité de l’étranger, voire de l’étrange « le contraire du conformisme moral, social et rationnel, quelque chose aussi que l’on ne peut ni penser ni cerner » (p. 176). Rien de moins vain chez Mérimée que la quête de la couleur locale, et il n’est pas jusqu’à l’apprentissage des langues étrangères et leur usage dans les nouvelles qui ne manifestent chez lui l’attirance pour une altérité permettant de redécouvrir la part occultée de l’homme moderne. Ainsi, dans Lokis, la quête linguistique est caractéristique de cet intérêt pour le secret des origines : Mérimée « inscrit le sens dans une différence de langues et de mentalités, il l’enfouit pour des fouilles à faire par le lecteur » (p. 187). De sorte qu’il faut respecter chez lui « le trou noir du récit, le vide central, l’impossibilité de conclure ou de comprendre qui constitue le récit » (p. 194).
Quant à l’étude « Mérimée, le roman et la nouvelle : l’exemple de Colomba », elle prolonge l’analyse de l’esthétique de la nouvelle mériméenne à travers l’étude d’un texte emblématique de sa production. Avec raison, Michel Crouzet relie le refus du romanesque à la méfiance de Mérimée envers un certain idéalisme romantique. Aux fléaux du roman – moralisation, psychologisme et lyrisme conformiste – le nouvelliste oppose la rigueur documentaire garantissant une juste approche du réel. Comme Stendhal, il endigue l’inflation de l’intellect et du langage – voie ouverte au « n’importe quoi de l’idéal conçu comme une activité métaphysique en quelque sorte illimitée et spontanée de la pensée » (p. 330) – grâce au laconisme de la brièveté, « discipline restrictive de l’invention » (p. 331). La méfiance envers l’imagination incontrôlée et
le romanesque vécu ou écrit garantit ainsi l’observation des « passions fondamentales et originelles de l’homme » (p. 336). Michel Crouzet montre bien comment le romanesque est directement mis en cause dans Colomba, notamment à travers le personnage de Lydia, comme miroir mimétique et entrave à la juste perception du réel. Plus encore, romans, papiers, paperasseries semblent s’opposer à la culture vivante de l’oralité : « L’écrit, c’est l’érosion des valeurs, la confusion de tout, il érige le mensonge en loi universelle » (p. 375). Nul doute alors que Colomba ne constitue un manifeste métalittéraire par lequel Mérimée défend son esthétique de la concision et de la paucité.
On saura gré à Michel Crouzet d’avoir collecté en un volume riche et stimulant des textes qui rappellent les grands axes dans lequels doit s’engager la critique mériméenne, tout en signalant nombre de pistes restant à explorer.
Thierry Santurenne
Université de Marne-la-Vallée
Prosper Mérimée au temps de Napoléon III. Actes du colloque organise au Musée national du Château de Compiègne, le 18 octobre 2003, éd. Françoise Maison, Paris, édition de la Réunion des Musées nationaux, 2008. 101 p.
Le 18 octobre 2003, se tenait au château de Compiègne, dans la demeure même qui l’a souvent reçu, un colloque consacré à Prosper Mérimée. Au cours de cette réunion, qui s’inscrivait dans les différentes manifestations organisées pour le bicentenaire de la naissance du grand homme, quatre communications furent faites étudiant chacune des aspects peu connus de son œuvre et de son existence. Celles-ci, rassemblées dans un recueil intitulé Prosper
Mérimée au temps de Napoléon III, édité par la Réunion des Musées nationaux, viennent d’être publiées. Elles portent sur la période la moins connue de l’existence de Mérimée, celle qui reste la plupart du temps dans l’ombre et qui, dans la répartition chronologique assez facile que l’on pratique d’habitude (elle consiste à présenter d’abord l’écrivain, puis l’inspecteur des Monuments historiques et enfin le courtisan) occupe la dernière place, résumée souvent par les termes de « mondain », d’« amuseur de la cour impériale », ou au mieux de « sénateur ». Étudier Mérimée « au temps de Napoléon III », c’est étudier l’histoire de ce personnage à partir de 1853, date du mariage du « neveu » avec Eugénie de Montijo, fille de la comtesse de Montijo, vieille amie et correspondante fidèle de l’écrivain. Cet événement a pour conséquence immédiate de rapprocher Mérimée d’un souverain vis-à-vis duquel il s’était toujours montré assez distant et de l’entraîner dans une vie mondaine autrement remplie que celle qu’il avait connue jusqu’alors.
Françoise Maison, conservateur en chef honoraire au Musée national du Château de Compiègne, dans sa communication intitulée « Prosper Mérimée à la cour de Napoléon III et d’Eugénie », rappelle que si Mérimée se voit bien vite accorder la charge de sénateur, en 1853, c’est essentiellement pour subvenir aux dépenses qu’entraîne sa nouvelle position de courtisan. Elle apporte de nombreuses informations sur le déroulement de cette vie de cour marquée par les cérémonies et réceptions officielles, les soirées, les séjours dans les résidences impériales et leur lot de divertissements : représentations théâtrales improvisées lors des « séries » de Compiègne en novembre, promenades dans le parc du château de Fontainebleau en juin et juillet, excursions en montagne dans les environs de la villa de Biarritz au début de l’automne. Mérimée prend part à toutes ces distractions, au moins jusqu’en 1863, date à laquelle son état de santé l’oblige à passer l’hiver à Cannes. Cette prescription médicale n’est pas pour lui déplaire car il n’a jamais vraiment recherché cette vie de cour. S’il assiste aux mondanités et aide même parfois, par ses bons mots et sa plume, aux divertissements, ce n’est pas par
goût mais par crainte de déplaire à celle qui est à la fois l’impératrice et la fille d’une de ses meilleures amies. Mérimée, sans jamais juger ceux pour qui il éprouve de l’amitié, est d’ailleurs tout à fait conscient de la frivolité ambiante. Fort heureusement, ces réunions mondaines sont aussi l’occasion de mettre en présence différents membres de l’élite du Second Empire (Morny, Viollet-le-Duc, l’érudit Félicien de Saulcy…) qui trouvent parfois le moyen d’échapper aux amusements pour converser de sujets sérieux. Mérimée parle souvent histoire ou archéologie avec Napoléon III, allant même jusqu’à devenir dans ce domaine son plus proche conseiller.
C’est sur ce rôle que revient Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec, docteur en archéologie, dans une communication intitulée « L’archéologue au service de l’empereur ». Mérimée, qui exerce les fonctions d’inspecteur général des Monuments historiques jusqu’en 1859 (de manière bénévole à présent que ses appointements de sénateur le placent définitivement à l’abri du besoin), et qui entretient d’excellentes relations avec les archéologues Charles Lenormant, Félicien de Saulcy et Adrien de Longpérier, se rapproche de Napoléon III au point de devenir auprès du souverain, de 1857 à 1860, un véritable conseiller en archéologie, notamment lorsque celui-ci découvre le site de Champlieu, non loin de Compiègne. Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec fait également le point sur la collaboration de Mérimée à la grande œuvre de l’empereur, l’Histoire de Jules César, préparée de 1860 à 1866, dont la paternité a souvent fait l’objet de remises en cause. Certes, l’écrivain a sans cesse été présent aux côtés de Napoléon III, répondant à ses questions, demandant des informations à ses collègues et à ses relations, participant même aux expériences et aux reconstitutions grandeur nature d’armements romains voulues par Sa Majesté, mais il n’a jamais rédigé lui-même cet ouvrage. D’ailleurs, il n’approuvait pas sa parution, doutant du degré d’érudition de son auteur et craignant de vives critiques de la part des savants français et étrangers. Ces craintes en réalité n’avaient pas de raison d’être car la publication, notamment du premier volume, en 1865, connut un réel succès. Après cette parution, de 1866 à 1870,
Mérimée poursuit son rôle de conseiller auprès de l’empereur mais son influence est surtout remarquable dans le domaine des musées. L’ancien inspecteur des Monuments historiques se bat pour que le patrimoine trouvé en France ne quitte pas le sol national et aille rejoindre les collections publiques. Il contribue à l’enrichissement de celles-ci par des dons nombreux faits aux musées, notamment au musée de Cluny auquel son ami Du Sommerard a légué ses collections. De manière générale, Mérimée souhaitait créer davantage de musées en France et a œuvré en ce sens. Pour corroborer ces propos, l’auteur donne en annexe une liste de ses dons et legs aux musées français, notamment au Musée de Cluny, à la Bibliothèque impériale (département des monnaies, médailles et antiques), au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et au musée Auguste Grasset de Varzy (Nièvre), et signale que certaines sources sur Mérimée archéologue restent encore inexploitées (lettres, rapports…).
Mérimée n’exerce pas le rôle de conseiller dans le seul domaine de l’archéologie. Ses connaissances et les liens qu’il entretient avec les savants étrangers le désignent pour représenter l’empereur dans nombre de manifestations culturelles internationales. Françoise Bercé, Inspecteur général honoraire du Patrimoine, dans sa communication « Mérimée, les beaux-arts et la Grande-Bretagne » insiste sur ce point. L’écrivain, qui correspond beaucoup avec le monde savant, effectue au cours de la période de nombreux voyages, notamment en Angleterre, pays à la mode, révélé par l’Exposition universelle de 1851, et qui passe alors pour la patrie de l’innovation économique et technologique, ainsi que du progrès en matière d’art et de goût. De 1857 à 1862, il effectue ces déplacements comme conseiller culturel de Napoléon III chargé d’assister à des événements officiels. Ses relations avec l’aristocratie anglaise (c’est un familier de Palmerston, de lord Granville et du premier ministre Gladstone) facilitent ces missions, qui, loin d’être un pensum, l’amusent au contraire beaucoup. Elles contribuent à façonner ses idées et ses goûts, et
l’influence britannique est perceptible dans ses opinions et ses prises de position en matière d’architecture (en réalité il n’aime pas l’architecture contemporaine anglaise et lui préfère l’architecture médiévale), de peinture, d’arts appliqués et d’industrie. Il participe activement à la préparation de l’Exposition universelle de Londres en 1862, comme membre de la section des « Arts appliqués à l’industrie », mais sa prise de position en faveur de la réforme de l’École des Beaux-Arts, sujet très débattu à l’époque, le prive de toute responsabilité lors de l’Exposition de 1867. De manière générale, ses réflexions sur l’art, la technique, la modernité, les matériaux, se situent dans le prolongement de ses interrogations sur la restauration de l’architecture ancienne. Ses positions rejoignent le plus souvent les observations des maîtres d’œuvres de son époque pour qui les matériaux, le métier et la technique sont plus importants que la théorie et la doctrine.
Comme le souligne Françoise Maison, Mérimée, lors des « séries » de Compiègne, déplore la superficialité de certains divertissements et tente parfois d’orienter les distractions de la cour vers des activités plus intellectuelles et réfléchies. Il parvient, par exemple, à organiser, avec la charmante comtesse Lise Przezdziecka, femme d’un ancien officier de l’armée polonaise en Russie, grand amateur de poésie, des divertissements d’esprit littéraire, sorte de « jeux floraux » auxquels participent les sages et les personnes cultivées. En 1866, il va jusqu’à lire sa dernière nouvelle, La Chambre bleue à l’Impératrice et à ses dames d’honneur.
Car littérature et écriture sont loin d’être absentes de la vie de Mérimée dans cette dernière partie de son existence. C’est ce que rappelle Antonia Fonyi, chercheur au CNRS (Institut des Textes et Manuscrits modernes) dans sa communication intitulée « Varia historiques et littéraires (1853-1870) » qui aborde la mosaïque d’études ou de nouvelles rédigées par Mérimée « au temps de Napoléon III ». Certes, il cesse de créer à partir de 1853, arrêt probablement dû à son état de santé, sa position de sénateur, sa rupture avec Valentine Delessert et les changements idéologiques de cette deuxième moitié
du siècle qui vont à l’encontre de ses convictions, mais il se plonge dans l’étude de périodes et de personnages historiques. Ce goût n’est pas entièrement nouveau puisqu’il s’était déjà lancé dans l’écriture d’une Vie de César, en 1838 (ouvrage qui restera inachevé), et, après la parution de ses Études sur l’histoire romaine (1844), s’était intéressé à l’histoire de l’Espagne, de la Russie et de l’Ukraine. Il aime particulièrement la Russie car, pour lui, ce n’est pas un pays encore tout à fait civilisé, à la différence de la France. Mérimée, qui divise les individus en civilisés et sauvages, pense qu’il existe encore des êtres appartenant à cette dernière catégorie dans ces contrées. Mais ce qui l’intéresse surtout, ce sont les entre-deux (comme César, comme Pierre le Grand) grâce auxquels il est peut-être possible de retrouver l’état des origines, l’archè. Sur ce thème paraissent « Les Cosaques de l’Ukraine et leurs derniers atamans » (1854), « Stenka Razine » (1861), « Bogdan Chmielnicki » (1863). Mérimée écrit également sur la jeunesse de Pierre le Grand et sur le procès du tsarévitch Alexis. Ces écrits développent des thèmes très présents dans son œuvres : ceux du père infanticide et de l’imposteur. Ces publications sont dans l’ensemble moins bien documentées que celles d’avant 1853, mais le style est plus propre à amuser le lecteur. Mérimée se consacre également à la rédaction d’un certain nombre de portraits de personnages historiques qui ont en commun une double nature, un double comportement : un penchant pour la violence et, en même temps, pour des activités civilisées (Agrippa d’Aubigné par exemple). Cette double nature peut se retrouver dans l’écriture même de Mérimée qui allie « une puissance sauvage » et « une maîtrise civilisée ». Enfin, l’écrivain renoue avec la création littéraire à partir de 1866, date qui correspond au rétablissement de relations amicales avec Valentine Delessert. La même année il rédige La Chambre bleue, avant d’entreprendre l’écriture de Lokis, en 1868. Sa toute dernière nouvelle, Djoûmane, est achevée en 1870. Les mêmes thèmes (ceux de l’archè et de l’être hybride) sont abordés mais traités de manière différente. Tous ces
« varia » n’ont malheureusement pas été recueillis par Mérimée, et, de nos jours encore, tous n’ont pas été publiés.
Cet ouvrage, constamment émaillé de gravures, de citations, de références précises aux dernières publications et à la Correspondance générale, remplit, comme tout bon livre, le double rôle d’instruire et d’amuser tant il est riche d’enseignements mais aussi d’anecdotes et de récits qui en rendent la lecture particulièrement plaisante. Il a l’immense avantage d’éclairer certains pans mal connus de la vie et de l’œuvre de Mérimée au cours d’une période longtemps restée dans l’ombre et peut-être un peu dédaignée, où, hôte du couple impérial, il est le « fou de Sa Majesté l’impératrice », mais aussi beaucoup plus que cela : un membre de l’élite du Second Empire, une figure indissociable du « temps de Napoléon III ». Cet ouvrage rompt de manière très claire avec la sempiternelle répartition chronologique de la vie de Mérimée et montre que celui-ci reste jusque dans la dernière partie de son existence ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un érudit au service des Monuments historiques, un curieux passionné d’art et d’archéologie, un écrivain talentueux et un ami dévoué.
Marie Galvez
École des Chartes, 3e année