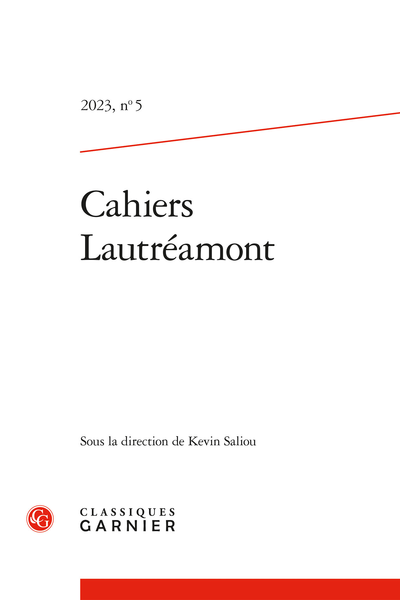
Une rencontre fortuite Lautréamont et Robert Musil
- Publication type: Journal article
- Journal: Cahiers Lautréamont
2023, n° 5. varia - Author: Ollivier (Mathilde)
- Abstract: Mathilde Ollivier uses a comparatist approach to study similarities between the educational trauma Ducasse evokes in Les Chants de Maldoror and that depicted by Robert Musil in Les Désarrois de l’élève Törless. This leads to a more detailed comparison of the two works.
- Pages: 301 to 306
- Journal: Lautréamont Studies
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406159957
- ISBN: 978-2-406-15995-7
- ISSN: 2607-754X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15995-7.p.0301
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-22-2023
- Periodicity: Annual
- Language: French
- Keyword: Musil, Homme sans qualités, Les Désarrois de l’élève Törless, Lautréamont, comparison, influence, comparatist
Une rencontre fortuite
Lautréamont et Robert Musil
Charles Dantzig, dans son émission consacrée à Lautréamont le 9 mai 2021, annonce, en préambule : « Les Chants de Maldoror c’est pour moi le livre qu’aurait écrit l’élève Törless, personnage des Désarrois de l’élève Törless de Musil, s’il s’était révolté1 ». Ce roman est le premier de l’écrivain autrichien Robert Musil, né dix ans après Ducasse, et décédé en 1942. On le connaît principalement pour L’Homme sans qualités, publié en deux tomes en 1930 et 1932 et traduit par Philippe Jaccottet. S’il fait l’objet d’un article entre ces pages, c’est parce qu’à la fréquentation de son œuvre, une ducassienne ne peut que bondir tant les ponts avec Les Chants de Maldoror sont nombreux. Nous commencerons ici à montrer et préciser ces ressemblances, en se concentrant en premier lieu sur le premier roman de Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, publié en 1906.
Ces ressemblances sont d’abord biographiques : Musil est membre d’une vieille famille autrichienne d’officiers, de fonctionnaires et d’ingénieurs. Il montre dans ses études un goût prononcé pour les sciences naturelles et les mathématiques, et fera des études d’ingénieur. Adolescent, il entre dans un pensionnat militaire, dans l’actuelle Tchéquie. Cette expérience sera une source d’inspiration pour l’ouvrage qui nous occupe. Il suivra ensuite des études à l’école polytechnique de Brünn (toujours dans l’actuelle Tchéquie), puis de philosophie et de psychologie à Berlin. Outre ses deux romans, Musil est un auteur prolifique, qui laissera des Journaux, des Proses éparses, et une correspondance abondante. Celui qui se surnommait « le vivisecteur » du xxe siècle2 y critique sans relâche la littérature germanophone de 302son temps, et règle ses comptes avec les frères Mann, Stefan George, Hermann Hesse, Hofmannsthal, Karl Kraus, ou encore Stefan Zweig. Friand d’aphorismes, il a comme références littéraires Maeterlinck, Nietzsche, ou La Rochefoucauld3. De sa première formation, il garde un goût pour les sciences naturelles, et pour les mathématiques. Dans ses Cahiers, il intitule un court morceau « La Science au regard mauvais » : « Il lui semblait logique de modifier à nouveau sa vie et il décida, pour remonter aux sources, de devenir mathématicien. Car il reconnut (croyait…) que cette science, apparemment la plus inerte, renfermait le secret même de la vie4. »
Dans son essai « L’Homme mathématique5 », il loue avec ferveur cette science :
Les mathématiques sont aujourd’hui l’une des dernières témérités somptuaires de la raison pure. Sans doute de nombreux philologues exercent-ils aussi une activité dont eux-mêmes ne voient pas le profit, pour ne rien dire des philatélistes et des collectionneurs de cravates. Mais ce sont là d’innocentes manies, qui se déploient fort loin des affaires sérieuses, alors que les mathématiques y font pénétrer, au contraire, quelques-unes des aventures les plus amusantes et les plus hardies de l’existence.
Laissons maintenant de côté une intertextualité fantasmée : il n’y a pas de trace de Lautréamont dans les écrits de Musil. Selon Jean Paulhan, qui l’a rencontré à Paris, il parlait « très mal le français » et « connaissait très mal la littérature française6 ». Il avait lu Baudelaire et Huysmans, mais disait lui-même : « Je ne comprenais pas Stendhal, et j’ignorais Flaubert7. » Selon Philippe Chardin, « on s’aperçoit que de manière générale les Journaux s’intéressent de près aux biographies des écrivains “maudits” du xixe siècle, à celles de Hölderlin, de Baudelaire, de Byron, de Dostoïevski8… » Le même auteur comparera son œuvre à 303celle d’André Breton9, et l’on sait que Musil appréciait le mouvement dada, sans trop le connaître.
Cette ignorance de l’œuvre de Lautréamont rend les ressemblances encore plus assourdissantes. Comment un lecteur si prolifique a-t-il pu passer à côté d’une œuvre ressemblant tant à la sienne ? Pourtant, les premières traductions allemandes des Chants de Maldoror datent de 1953 et 1954, plus de dix ans après la mort de Musil10. Voyons désormais en quoi un habitué de Ducasse ne peut qu’être saisi à la lecture des romans de Musil.
Musil publie Les Désarrois de l’Élève Törless à l’âge de vingt-six ans. Il est, nous l’avons dit, tiré de son expérience au pensionnat militaire. Ce bildungsroman baigne dans une atmosphère angoissée, spectrale, oppressante, ducassienne en somme. Les ressemblances avec les Chants étant si nombreuses, nous pouvons même les qualifier d’expérience commune.
L’internat où arrive Törless semble se trouver dans la campagne de la strophe des chiens11 :
À côté de chaque voie, comme une ombre sale, la trace noire inscrite sur le sol par les jets de vapeur brûlante. […] Ses bords se seraient confondus avec le terrain bourbeux d’alentour si ne les avaient jalonnés deux rangées d’acacias dressant tristement de chaque côté leurs feuilles desséchées, suffoquées par la poussière et le charbon. Était-ce le fait de ces couleurs tristes, était-ce la lumière du soleil couchant, blême, faible, épuisée par la bruine, les choses et les êtres avaient un tel air d’indifférence, d’insensibilité machinale, qu’on les aurait crus échappés d’un théâtre de marionnettes12.
Les alentours de l’internat sont décrits plus bas comme « des campagnes arides, presque inhabitées13 ». Comment ne pas penser à l’incipit des Chants ? La famille de l’élève l’accompagne, et on croirait rencontrer 304la version autrichienne de la famille de Mervyn : la mère, bourgeoise et rigide, « dissimulait sous une épaisse voilette des yeux tristes légèrement enflammés par les pleurs14 ». Törless s’abandonne ensuite aux côtés d’une prostituée, Bozena, une « créature », « avilie et vieillissante15 », qui a des « aspects grossiers et repoussants16 ». Lors de leur première rencontre, la lune est encore d’un « jaune vineux17 ».
À l’internat, il fait l’expérience de « la puissance paralysante de la captivité18 ». L’angoisse et la solitude ne quittent pas l’adolescent : « Törless sentit qu’il était parfaitement seul sous cette voûte impassible et muette, minuscule tache de vie écrasée par un cadavre gigantesque et transparent19. » Son mal-être ressemble à celui du narrateur dans la strophe de l’araignée20 : « Un frisson lui courut le long de l’épine dorsale, comme des pattes d’araignée, puis s’installa entre les omoplates et, de ses fines griffes, tira sur la peau de son crâne21 ». Il fera l’expérience du désir, de l’amour et de la cruauté avec certains de ses camarades. Une première relation avec le jeune prince H. est présentée comme « une véritable idylle22 ». Mais il découvrira véritablement le désir charnel en même temps que l’abjection. Deux de ses camarades, Beineberg et Reiting, décident de punir un troisième, Basini, qui a volé ses camarades pour rembourser ses dettes. Il est décrit comme « très fluet, avec des mouvements pleins de mollesse et de nonchalance, et un visage de fille23 ». Il sera fouetté, violenté et violé pendant des épisodes de cruauté nocturne. Törless reste un témoin passif, mais ces épisodes réveillent en lui des désirs jusqu’alors insoupçonnés : « Cette nuit-là, si violente était la sensualité qu’avait accumulée en lui le calvaire d’une journée d’hébétude, Törless fut à deux doigts de se jeter comme une bête sur Basini24 ». Les deux tortionnaires se livrent à des séances d’hypnose sur leur souffre-douleur : « Il me fait aussi grogner comme un porc et me 305répète, deux ou trois fois, tout d’une haleine, que j’ai quelque chose de cette bête en moi25 ». Enfin, l’éveil de Törless est aussi philosophique : il vit une crise métaphysique kantienne, et médite sur l’infini et les mathématiques : « Il éprouvait maintenant pour les mathématiques un soudain respect : d’aride matière à mémorisation, elles étaient devenues d’un coup pour lui problème vivant26 ». Il s’entretient avec son professeur de mathématiques, mais ce dernier n’arrive pas à assouvir la soif de connaissances de l’élève. À la fin de l’année scolaire, Törless quitte l’établissement sans regret.
Contrairement à Lautréamont, Musil se justifie de ses représentations de relations homosexuelles : « Je ne veux pas rendre la pédérastie compréhensible. Il n’est peut-être pas d’anomalie dont je me sente plus éloigné. Au moins sous sa forme actuelle. Que ce soit elle que j’aie choisie tient au hasard, à l’action que j’avais en mémoire27. » Là est peut-être la plus grande différence entre les deux postures auctoriales.
Ce livre « d’une grande cruauté et d’une grande tendresse28 » ne manquera pas d’intéresser les lecteurs et les lectrices des Chants de Maldoror. Quant au reste de l’œuvre de Musil et ses affinités avec Ducasse, ils feront l’objet de recherches futures.
Mathilde Ollivier
306Ouvrages cités
Cahier Musil, 1981, dirigé par Marie-Louise Roth et Roberto Olmi, Paris L’Herne.
Chardin, Philippe, 1998, Musil et la littérature européenne, Paris Presses Universitaires de France.
Chardin, Philippe, 2011, Musil et la littérature : amours lointaines et fureurs intempestives, Dijon Éditions universitaires de Dijon.
Dantzig, Charles, 2019, « Maldoror ou le mal contre le mal », France Culture, 28 avril 2019. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/personnages-en-personne/maldoror-ou-le-mal-contre-le-mal-6879215 [consulté le 3 juillet 2023].
Lautréamont, 1953, Zwei Gesänge Maldorors, Ubersetzung von Hans R. Linder, Bâle, Papillons Verlag, 20 p.
Lautréamont, 1954, Gesamtwerk, aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Ré Soupault, Heidelberg, Wolfgang Rothe Verlag, 351 p.
Musil, Robert, 1906, 2011, Les Désarrois de l’élève Törless, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris Points Seuil.
Musil, Robert, 1984, Essais, conférences, critique, aphorismes, réflexions, textes choisis, traduits de l’allemand et présentés par Philippe Jaccottet d’après l’édition d’Adolf Frisé, Paris Seuil, coll. « Don des Langues ».
Musil, Robert, 2000, « L’Homme mathématique », Alliage, no 43, mis en ligne le 04 septembre 2012. URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3893 [consulté le 3 juillet 2023].
1 Charles Dantzig, « Maldoror ou le mal contre le mal », France Culture, 28 avril 2019. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/personnages-en-personne/maldoror-ou-le-mal-contre-le-mal-6879215 [consulté le 3 juillet 2023].
2 Cahier Musil, dirigé par Marie-Louise Roth et Roberto Olmi avec des nombres inédits, Paris, L’Herne, 1981, p. 97.
3 Robert Musil, Essais, conférences, critique, aphorismes et réflexions, Paris, Seuil, 1984.
4 Cahier Musil, op. cit., p. 98.
5 Robert Musil, « L’Homme mathématique », Alliage, no 43, Juillet 2000, mis en ligne le 04 septembre 2012, URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3893 [consulté le 3 juillet 2023].
6 Extraits de propos recueillis par Jean-Paul Weber, Figaro littéraire, 2 avril 1968, cité dans Cahier Musil, op. cit., p. 274.
7 Cahier Musil, op. cit., p. 40.
8 Philippe Chardin, Musil et la littérature européenne, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 23.
9 Philippe Chardin, Musil et la littérature : amours lointaines et fureurs intempestives, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2011.
10 Zwei Gesänge Maldorors, Ubersetzung von Hans R. Linder, Bâle, Papillons Verlag, 1953, 20 p., et Lautréamont, Comte de, Gesamtwerk, aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Ré Soupault, Heidelberg, Wolfgang Rothe Verlag, 1954, 351 p.
11 Chant I, strophe 8 : « Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés des campagnes, l’on voit, plongé dans d’amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L’ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient, par diverses formes, en s’aplatissant, en se collant contre la terre. »
12 Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris, Points Seuil, 2021, p. 9.
13 Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, op. cit., p. 10.
14 Ibid., p. 10.
15 Ibid., p. 45.
16 Ibid., p. 43.
17 Ibid., p. 41.
18 Ibid., p. 32.
19 Ibid., p. 105.
20 Chant V, strophe 7.
21 Robert Musil, op. cit., p. 114.
22 Ibid., p. 15.
23 Ibid., p. 79.
24 Ibid., p. 161.
25 Ibid., p. 169.
26 Ibid., p. 123.
27 Dans une lettre citée par Philippe Jaccottet dans sa préface, Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, op. cit., p. 11.
28 Cahier de l ’ Herne, op. cit., p. 28.