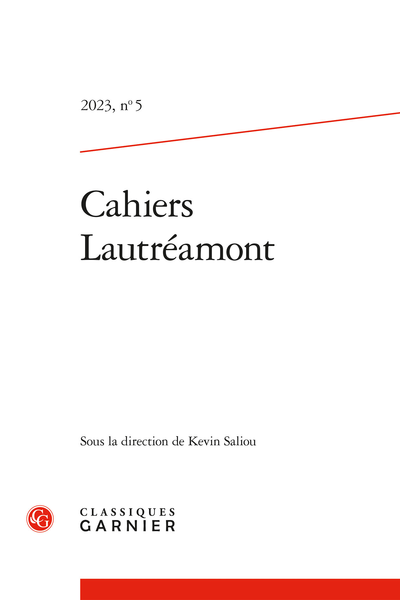
La Poésie faite par tous Une utopie en questions
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Lautréamont
2023, n° 5. varia - Auteur : Saliou (Kevin)
- Résumé : Compte rendu de l’excellent ouvrage d’Olivier Belin qui s’intéresse au succès de la formule des Poésies à travers ses récupérations par toutes les avant-gardes collectivistes du XXe siècle.
- Pages : 321 à 329
- Revue : Cahiers Lautréamont
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406159957
- ISBN : 978-2-406-15995-7
- ISSN : 2607-754X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15995-7.p.0321
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/11/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : Olivier Belin, collectivisme, utopies, avant-garde, compte rendu, Lautréamont, faite par tous
La Poésie faite par tous
Une utopie en questions
Olivier Belin, La Poésie faite par tous. Une utopie en questions, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2022, 437 p., 24€.
On aurait pu croire, à la lecture du titre de cet essai, à une énième perpétuation aveugle du contresens qui a longtemps pesé sur la fameuse citation des Poésies d’Isidore Ducasse. Un simple regard sur la table des matières nous montre, au contraire, un regard lucide sur la fortune littéraire de la formule, avec ses réappropriations fertiles au fil des générations de lecteurs successifs. Devenue, selon les mots d’Olivier Belin, « l’emblème d’une utopie communautaire », elle met au jour deux tensions contradictoires et inconciliables des avant-gardes littéraires : d’une part, le désir de descendre la poésie dans la rue, à la portée de tous, d’autre part, ce faisant, la déconstruction du statut sacré de l’auteur, l’expérimentation de méthodes de création collective, la génération combinatoire de textes où les repères traditionnels se brouillent. Paradoxalement, la poésie par tous et pour tous, avec ses jeux hermétiques sur le signifiant et les systèmes sémiotiques, se dissocie de la poésie commune et risque de ne plus être lisible que par un faible nombre d’élus. C’est ce rapport au vulgaire, ce lien entre la poésie et la vie réelle et cette tension entre ésotérisme et exotérisme qu’Olivier Belin se propose d’étudier à travers le succès de la formule de Ducasse, qui n’appelait peut-être pas cet idéal de poésie démocratique qu’elle semble avoir incarné par la suite.
On aurait tort de refermer prématurément ce livre en pensant qu’Olivier Belin tombe dans le piège d’une lecture rapide de la formule. D’abord, contre les lectures qui ont été faites à la suite de Goldfayn et Legrand, qui réinscrivaient la phrase dans le mouvement d’une pensée s’étendant plus largement sur plusieurs maximes, il n’est pas certain qu’il faille écarter chez Ducasse l’appel à une poésie collective. Certes, dans 322Poésies II, le fragment qui précède évoque les phénomènes de l’âme, et on a ainsi pu dire que « tous », dans cette maxime, y faisait référence : Ducasse ne revendiquerait donc pas une littérature ayant dépassé la question de l’auteur, mais demanderait à l’écrivain de puiser dans tous les phénomènes de l’âme la substance pour nourrir sa poésie. Pour autant, ce rectificatif a beaucoup été repris et doit être rediscuté : rares sont les passages, dans Poésies, qui se construisent comme une progression sur plusieurs maximes, et la plupart d’entre elles semblent parfaitement autonomes de leurs voisines. En outre, Ducasse n’a-t-il pas lui-même en d’autres endroits puisé dans le fond commun de la littérature, laissant place dans son texte à la pluralité des discours – le fameux dialogisme bakhtinien qui inspira à Kristeva le concept d’intertextualité – et faisant fi des questions de propriété intellectuelle pour devenir l’auteur de fragments qu’il n’avait pas écrit ? N’appelle-t-il pas, de même, au plagiat, et donc au dépassement de l’auctorialité ? Embrassons donc cette lecture, la plus évidente et la première, et celle qui fut longtemps faite par d’autres de la sentence ducassienne, et suivons Olivier Belin dans son analyse des pratiques de littérature collective.
Dans une première partie intitulée « Itinéraires d’une formule », le critique s’intéresse à la phrase de Ducasse, dont il souligne en premier lieu la concision, la force et la valeur de slogan. C’est d’ailleurs l’intention de Breton, qui écrit : « Cet aphorisme est même celui que nous avons voulu graver entre tous au fronton de l’édifice surréaliste1. » L’aphorisme sera repris ensuite par les oulipiens, les situationnistes, les membres de Tel Quel, les étudiants de mai 68, avec toujours des différences entre les projets respectifs mais le même horizon d’un communisme de la poésie au point qu’on a fini par détacher cette expression de son auteur et du contexte de sa production, « la poésie faite par tous » devenant un mot d’ordre et une revendication politique et non plus seulement littéraire, à peu près équivalents du quart d’heure de célébrité warholien ou de la démarche de l’art contemporain qui nous invite à transformer n’importe quoi en art par notre simple regard. Si la formule a connu une telle adaptabilité, c’est d’abord, concède Olivier Belin, parce qu’elle était suffisamment vague pour prêter à des lectures plurielles et devenir 323un signal de reconnaissance, un mot d’ordre fédérateur rassemblant des tendances diverses autour d’une idée commune aux avant-gardes : ramener la poésie dans la Cité, à la portée de tous. Olivier Belin analyse, en reprenant les théories de Dominique Maingueneau et d’Alice Krieg-Planque, la manière dont un fragment textuel peut se voir détaché de son contexte, reconfiguré, généralisé et figé pour devenir une citation à valeur d’argument d’autorité, comme c’est le cas ici. Avec beaucoup de finesse, Olivier Belin montre que la citation de Ducasse a cessé d’appartenir à la littérature pour entrer dans le domaine du discours à partir du surréalisme uniquement : avant cela, les premiers inventeurs de Lautréamont n’avaient guère prêté attention à ce mot d’ordre qui ne collait pas au projet symboliste : c’est précisément parce que la formule servait les objectifs du surréalisme qu’avec d’autres – le « changer la vie » de Rimbaud, le « transformer le monde » de Marx –, elle est devenue une formule autonome.
On lira avec beaucoup d’intérêt les quelques pages synthétiques mais brillantes de clarté qu’Olivier Belin consacre à la présentation du projet des Poésies ainsi qu’à l’épineux problème de leur continuité ou de leur discontinuité. Il fait remarquer que, si l’on doit replacer la formule dans une lecture prenant en compte le contexte immédiat – le cotexte en fait –, il faut alors rappeler la fin du fragment, à savoir une énumération de noms d’auteurs, ce qui plaide bien en faveur d’une maxime portant sur la création individuelle. Pour ce qui est de la lecture continue des Poésies – ici appelée linéaire –, Olivier Belin n’ignore pas les interprétations de Goldfayn et Legrand qui rattachent « tous » et « un » aux « phénomènes de l’âme » : il rappelle d’ailleurs très justement que, si cette lecture émerge d’un ouvrage coécrit par deux surréalistes, c’est dans un moment de l’histoire du mouvement où les poètes cherchent à se détacher de la « poésie faite par tous » telle qu’elle a été récupérée par les milieux communistes. Après 1960 donc, toutes les éditions prendront soin de recontextualiser la sentence en l’écartant, un peu trop vite peut-être, de l’appel à la poésie collective. La première lecture trouvait ses raisons d’être dans l’idéologie des avant-gardes : en s’attaquant à la propriété de l’auteur et à l’individualité du génie, celles-ci déconstruisaient aussi une conception bourgeoise de la littérature. Il n’est pas certain du tout, en revanche, que Ducasse ait eu cette arrière-pensée qui ne semble convenir ni à sa situation sociale, ni à l’époque dans laquelle il vit, antérieure à 324la Commune et à la diffusion de la doctrine marxiste : en remettant la poésie entre les mains de tous, Ducasse devait certainement lutter contre le mythe du génie romantique, à un moment charnière de l’histoire littéraire où il était contesté de toute part par l’hégémonie nouvelle des méthodes scientistes et naturalistes et par une poésie impersonnelle d’un genre nouveau, le Parnasse. Selon Olivier Belin, c’est aussi la volonté affirmée de constituer une poésie qui puisse servir de fondement à la morale publique : contre l’art pour l’art, Ducasse donne à la littérature une visée éthique et civique. C’est en ce sens que le plagiat, ou plutôt la correction, se voit détaché de toute connotation négative : il devient nécessaire, au nom du progrès moral. En définitive, Olivier Belin conclue à l’ambiguïté de la formule ducassienne qui, parce qu’elle reste vague, laisse ouvertes deux possibilités d’interprétations différentes et toutes deux pertinentes. Peu importe ce que Ducasse a véritablement voulu dire : le sens que la postérité retiendra est celui qui se montrera le plus fertile.
Le chapitre suivant est consacré à l’appropriation surréaliste et Olivier Belin commence par rappeler cette anecdote méconnue : lorsqu’en 1919, Breton fait reproduire dans le numéro 3 de Littérature le fascicule de Poésies II et son fameux fragment, il commet deux coquilles monumentales : « La poésie doit être faite pour tous. Non pas un. » Le texte et son sens se retrouvent ainsi altérés, orientés vers l’idée d’une poésie destinée au plus grand nombre. Soupault rectifie la double erreur dès son édition de 1920 au Sans Pareil, mais le mal est fait : les dadaïstes français sont déjà en train d’infléchir leurs pratiques littéraires dans le sens d’une aventure collective. Ce n’est pourtant qu’en 1925, dans la revue Clarté, que Paul Éluard s’empare de cette formule en particulier, avec une légère altération (« La poésie peut être faite par tous. »), pour en faire ce qui deviendra bientôt un lieu commun de la rhétorique surréaliste – collectivisme, universalisme, égalitarisme. Nous sommes à un moment de l’histoire du surréalisme où les débats se cristallisent autour de la radicalisation politique du mouvement, à travers la revue La Révolution surréaliste et la question de l’engagement communiste. Il s’agit dès lors de placer la poésie à hauteur d’homme, en chacun de nous, au moment où Aragon demande aux intellectuels de se reconnaître dans un « prolétariat de l’esprit ». De tous les surréalistes, Éluard est celui qui revient le plus souvent à la formule de Ducasse : c’est aussi lui qui se rapproche le plus de la pratique du plagiat des Poésies, avec son goût pour la réécriture 325de proverbes. Dans L’Évidence poétique, son essai à valeur de manifeste publié en 1937, il réaffirme sa croyance en une poésie commune à tous les hommes et dans Premières vues anciennes, c’est encore la formule de Ducasse qui vient clore le texte. À mesure que le surréalisme tend à se confondre avec la pensée hégéliano-marxiste, la formule de Ducasse prend une nouvelle connotation et finit par devenir une promesse de lendemains qui chantent : le triomphe d’un prolétariat enfin libéré de ses chaînes grâce aux pouvoirs de la parole poétique. Ducasse devient alors une référence obligée dans le débat qui articule poésie et révolution.
L’histoire du surréalisme, on le sait, est jalonnée de nombreuses exclusions. Les partisans d’une lecture communiste et collectiviste de la formule de Ducasse vont tour à tour quitter le navire à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, Breton restant finalement seul maître à bord pour ramener le mot d’ordre dans une direction qui lui convient mieux et qui serait compatible avec son goût pour l’ésotérisme. Commence alors, dans les années 1940, une lutte interne pour tirer à soi la formule ducassienne. D’un côté les communistes, portés par Aragon puis Éluard, cherchent à discréditer les interprétations surréalistes en faisant de la sentence une lecture parfaitement compatible avec la ligne politique du Parti, non sans malhonnêteté : Ducasse devient communard avant l’heure, ayant esquissé dans ses Poésies le projet d’un communisme intellectuel et littéraire. Les surréalistes deviennent alors les nouvelles Grandes-Têtes-Molles, académiciens des temps modernes déjà fossilisés et dépassés et contre qui on peut retourner toutes les attaques de Ducasse envers les romantiques. Sous l’Occupation, la formule de Ducasse devient aussi appel patriotique : c’est à un appel national qu’elle servira dans la préface aux Yeux d’Elsa, qui se livre à un éloge du patrimoine poétique français. Les communistes, à l’instar de Jean Marcenac par exemple, accuseront enfin les surréalistes d’avoir mené une politique de Terreur dans les lettres et d’avoir confisqué Lautréamont à des fins idéologiques et bourgeoises, empêchant toute réflexion sur les textes par esprit de dogmatisme le plus obtus.
De l’autre côté les surréalistes ripostent contre cette relecture prolétarienne de la formule : ils dénoncent ceux qui retournent Ducasse contre le surréalisme afin de masquer leurs propres désertions, ainsi que la captation du poète par l’intelligentsia stalinienne pour mieux l’asservir à une idéologie sans lien aucun avec la poésie. Benjamin Péret 326dénonce dans le communisme sa tentative de créer des mythes modernes et athées pour alimenter un fanatisme de propagande tout aussi dangereux que la religion, celui du prolétariat. Il dénoncera également, dans Le Déshonneur des poètes, la capitulation de la poésie, mise au service de la Résistance et donc de l’utilité politique. Si la poésie doit être faite par tous, tous ceux qui s’en réclament ne font malheureusement plus œuvre de poésie. Il se tourne alors vers les traditions orales des peuples premiers d’Amérique, dans lesquels il trouve une autre forme de poésie collective éloignée des travers de la propagande stalinienne. Quant à Breton, il prône désormais une occultation du surréalisme : pour contrer les récupérations politiques dont il a fait l’objet, le mouvement entame désormais un repli sur lui-même, un retour à l’hermétisme et à la sacralité du langage. En renouant avec une conception romantique du poète qui exprime les forces obscures de l’inconscient, il revient à ses racines mais constate, non sans amertume, que le projet de libération et d’émancipation des hommes n’a pu être mené. Dès lors, on relit Ducasse et sa formule comme un appel à la banalité, à rendre l’univers plus profane. C’est l’interprétation de Marcel Jean et d’Arpad Mezei et, à leur suite, de Goldfayn et Legrand, qui dégonflent la formule de toutes ses lectures révolutionnaires. La revue La Brèche, dans les années 1960, témoigne encore des querelles pour se réapproprier la formule en la lavant de sa charge prolétarienne dénoncée comme une escroquerie.
Un quatrième chapitre s’intéresse à la formule devenue, dans un contexte plus large, un lieu commun des avant-gardes. Entrée dans le langage courant à partir des années 30, elle est l’objet de réappropriations multiples et successives. Les ennemis du surréalisme n’hésitent pas à s’en emparer parfois pour manifester leur scepticisme et ironiser sur les prétentions utopistes des membres du mouvement. Certains, comme Bataille, réaffirment leur croyance en l’exceptionnalité du génie poétique. D’autres, comme Blanchot, estiment que l’expérience poétique passe par la mise à mort de l’individu qui se consume dans la réalisation de son œuvre pour parvenir à sa dépersonnalisation radicale. L’acte poétique implique, selon la conception post-mallarméenne de Blanchot, la disparition du sujet : en naissant, Lautréamont fait mourir Ducasse et dépasse son individualité pour élever l’écriture au-delà de sa personne. À l’inverse de ces lectures, d’autres récupérations rejoignent celle des communistes dans le sens d’un collectivisme. Ainsi en est-il 327de la lecture situationniste, fondée à partir de 1956 par Guy Debord et Gil J. Wolman : il s’agit d’ériger la récupération, le collage et le plagiat en principes fondateurs selon l’idée que tout peut servir et être réutilisé ou modifié pour produire du sens. L’ambition des situationnistes est, de manière assumée, propagandiste et partisane. Ils épousent alors, en la revendiquant, la théorie du plagiat que Ducasse a définie dans ses Poésies : corriger les œuvres, en changer le sens par des citations subverties au service de la révolution, tant communiste qu’anarchiste. Le modèle avoué des situationnistes est bien Ducasse, mais il s’agira maintenant de transporter ses enseignements hors de la littérature, sur le modèle de l’agit-prop ou de la publicité. Libérés de la gangue stalinienne, les situationnistes radicalisent leur action et leur discours, réclamant par exemple l’abolition de la propriété. Ils invitent, enfin, à sortir de la poésie pour s’inscrire dans la vie, par les actes matériels. Chez Raoul Vaneigem, la poésie faite par tous devient encore un moyen de lutter contre le discours fait par quelques-uns, à savoir la propagande d’état servie par la société du spectacle. La poésie devient alors l’acte révolutionnaire lui-même, préfigurant les événements de Mai 68 qui verront la formule de Ducasse inscrite sur les murs des universités bloquées.
Chez les membres de l’Oulipo, la référence à Ducasse est généralement plus discrète, mais aussi plus ludique et distanciée. La formule vient cependant conclure le « Mode d’emploi » des Cent mille milliards de poèmes de Queneau, ouvrage qui fait, comme chacun le sait, du lecteur le véritable compositeur des poèmes. En rendant la littérature combinatoire et mathématique, l’Oulipo réduit singulièrement le rôle de l’auteur pour lui substituer la puissance de la machine. Il n’est pas certain d’ailleurs que la référence à Ducasse sous la plume de Queneau ne soit pas d’abord une petite provocation adressée aux surréalistes, dont il a rejeté, juste avant, les jeux collectifs comme le cadavre exquis. L’impersonnalité visée par Ducasse aboutit ici à la pure opérativité d’un processus où la poésie se fait sans l’aide de personne. Enfin, Olivier Belin termine son tour d’horizon des avant-gardes en évoquant Tel Quel : sous l’influence de la poésie impersonnelle de Ponge, du formalisme russe et du structuralisme naissant, la revue remet en cause les concepts d’auteur ou d’œuvre et redéfinit le texte, non comme un ensemble clos mais comme un processus infini qui se génère de manière impersonnelle par une restructuration de la langue. Pour Marcelin Pleynet, les Poésies font tomber le concept 328d’auteur et celui de livre : dans un essai curieusement intitulé Lautréamont par lui-même, Pleynet prolonge et radicalise la lecture de Blanchot et évince Ducasse de la production d’un texte qui se fait et se défait tout seul sur les ruines fumantes de la littérature antérieure. Pour Philippe Sollers, les Poésies deviennent l’emblème d’une science du langage et de l’écriture : les genres s’abolissent, les discours se confondent, la poésie s’unit à la philosophie. La littérature n’est plus en rien une aventure personnelle, elle est un processus qui s’accomplit au-delà des individus et pour l’autonomie du texte. Enfin, Julia Kristeva replace les Poésies dans un contexte d’anticipation de la Commune : contre le solipsisme des romantiques, elles dessinent l’horizon d’une communauté par la négation paradoxale de l’ego.
Au terme de ce parcours, conclut Olivier Belin, nous sommes arrivés bien loin d’Isidore Ducasse, le poète se trouvant dépossédé de la formule dont il est l’inventeur. Commune à toutes ces avant-gardes en revanche est la volonté de dissoudre l’art dans une totalité où il serait fait pour tous et par tous. Ce fantasme, le critique le rapproche du Livre tant rêvé par Mallarmé, au point de se demander : « L’inconscient mallarméen des avant-gardes se serait-il formulé à travers la petite phrase de Ducasse2 ? » La suite de l’ouvrage, longue encore de 300 pages supplémentaires – nous n’en avons résumé que le premier quart, dédié à la réception de la formule ducassienne –, interrogera désormais la mise en pratique d’une poésie impersonnelle et collective, par le collage ou le sampling, par le rêve récurrent de couronner poètes d’illustres inconnus, enfants, fous ou marginaux ou par le désir de mettre en lumière les amateurs et autres versificateurs du dimanche pour ôter à l’écrivain son privilège. Nous ne saurions que trop recommander aux amateurs de Lautréamont ce passionnant volume, lucide et érudit, qui documente avec finesse les succès d’une seule petite phrase des Poésies.
Kevin Saliou
329Ouvrages cités
Belin, Olivier, 2022, La Poésie faite par tous. Une utopie en questions, Bruxelles Les Impressions nouvelles.
Breton, André, 1992, Position politique du surréalisme, recueilli dans Œuvres complètes, t. 2, Paris Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ».
1 André Breton, « Situation surréaliste de l’objet », Position politique du surréalisme, recueilli dans Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 479.
2 Olivier Belin, La Poésie faite par tous. Une utopie en questions, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2022, p. 126.