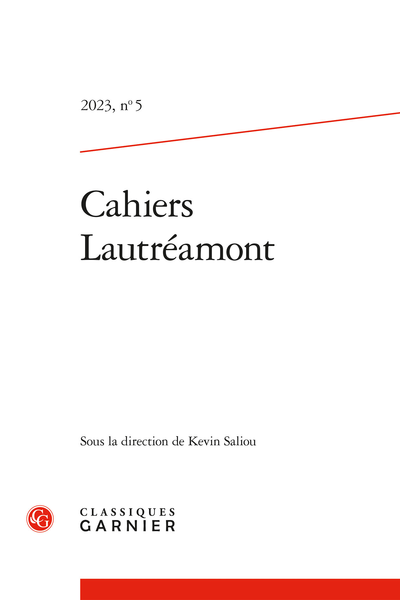
La Généalogie d’une révolte
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Lautréamont
2023, n° 5. varia - Auteur : Saliou (Kevin)
- Résumé : Compte rendu de l’ouvrage de Louis Janover, réédition augmentée de Lautréamont et les chants magnétiques.
- Pages : 311 à 315
- Revue : Cahiers Lautréamont
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406159957
- ISBN : 978-2-406-15995-7
- ISSN : 2607-754X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15995-7.p.0311
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/11/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : Lautréamont, Louis Janover, compte rendu, révolte, surréalisme
La Généalogie d ’ une révolte
Louis Janover, La Généalogie d’une révolte. Nerval, Lautréamont, Paris, Klincksieck, 2020, 206 p.
Dès l’introduction de son ouvrage, Louis Janover, ancien membre du groupe surréaliste qu’il quitta en 1962, rappelle que Nerval et Lautréamont ont été mis en avant par ce qu’on a appelé, tout au long du xxe siècle, les avant-gardes, au nom de la révolte. Lautréamont, lui, est présenté comme le trait d’union entre la subversion et la révolution. Nombre des œuvres qui ont porté le projet d’une révolte intégrale et radicale, le temps ayant fait son œuvre, sont désormais désamorcées et rendues inoffensives. Il s’agit donc d’interroger à nouveau la portée subversive de ces auteurs. En ce qui concerne Lautréamont, Louis Janover procède ici à une réédition de son essai Lautréamont et les champs magnétiques, paru en 2002, dans le but de montrer qu’Isidore Ducasse reste irrécupérable : l’histoire littéraire, consacrée par les manuels, les anthologies et les institutions, peine encore à lui accorder la place qu’elle a fini par donner à Rimbaud, ou même au surréalisme. Sacralisé, Lautréamont est resté « en dehors du cercle », il est devenu le point de cristallisation absolu des jugements esthétiques du surréalisme, la frontière entre ce qui était entré dans le canon littéraire et ce qui restait en dehors et cette ligne de crête, c’est aussi celle de la folie.
La généalogie que dessine Louis Janover nous conduit à Lautréamont en passant préalablement par Nerval, Aloysius Bertrand ou encore Restif de la Bretonne : c’est une poésie de la nuit et de la déraison, dans laquelle le savoir positif se dissout au profit de l’inquiétude et du trouble. Le prolongement logique en sera le Grand Jeu, et aussi la poésie d’Artaud. Après un chapitre consacré à « Nerval, notre prochain », qui figurait déjà dans Lautréamont et les chants magnétiques, Louis Janover a posé les jalons de sa démonstration : à partir du romantisme, une certaine 312frange de l’avant-garde se politise et devient réceptive aux problèmes politiques. Vers 1870, la critique de l’ordre moral religieux va de pair avec l’exigence de modernité artistique : il s’agit, par le scandale, la provocation et les manifestes ostentatoires, de mener une révolution et une remise en cause de tous les conservatismes de l’ordre bourgeois. « Bouleverser le monde des sens pour établir un rapport nouveau au sacré, à la nature et à l’autre », telle aura été la mission du romantisme que poursuit, à sa manière, Isidore Ducasse. Ce renversement passe par le recours au bestial et à une ménagerie monstrueuse. Louis Janover écrit que nul mieux que Ducasse n’a compris les impasses vers lesquelles tendait le romantisme, et ses Chants de Maldoror ont malgré lui accéléré un mouvement qu’il s’efforçait de freiner ou d’inverser. Il aura poussé jusqu’au bout la logique des « trembleurs de poésie » afin d’en souligner l’absurdité par son humour swiftien. En grossissant à l’excès l’hypertrophie du moi provoquée par le romantisme, il aura fait jaillir de sa conscience une subjectivité débridée s’exprimant dans le plus grand désordre, à l’image du chaos du monde. Pour parvenir à ces conclusions, Louis Janover considère les Poésies comme le constat initial, exprimant explicitement le « puéril revers des choses » et surtout du romantisme, d’où a germé le projet des Chants de Maldoror. Lautréamont apparaît ainsi comme l’extrême-pointe du romantisme, en même temps qu’il le regarde en arrière. Ces considérations ont pour but de réinscrire Lautréamont dans l’histoire, abordée selon la vision marxiste adoptée par Louis Janover, comme l’espace du conflit et de la lutte des classes. Par moment, l’analyse s’éloigne longuement de l’œuvre et, sous couvert de mettre en lumière sa portée révolutionnaire, s’attarde à des réflexions politiques inspirée de Marx, de l’anarchisme ou de la Révolution française, pour interroger et dénoncer les mensonges du capitalisme technocratique contemporain. Comme d’autres partisans de cette lecture politique et dialectique de Maldoror, Louis Janover se prend parfois à rêver au septième Chant, ultime moment d’une opération de dépassement et de synthèse qui n’a pas été dévoilé. Les diatribes de Ducasse contre les Grandes-Têtes-Molles du romantisme permettent à l’auteur de proposer qu’on désigne les « petites têtes molles du modernisme », parmi lesquels on mettra les auteurs ponctuellement épinglés au cours de cette lecture : Houellebecq, la revue Ligne de risque, etc., écrivains cyniques qui font mine de dénoncer les rouages du capitalisme contemporain tout en le 313célébrant sans même s’en rendre compte. Lautréamont, à l’inverse de tous ceux-là, exprime une pensée de liberté, sinon libertaire, qui procède à une dissolution des formes et des catégories pour repenser le champ du littéraire et le champ du social.
L’un des chapitres les plus intéressants de l’essai est « En attendant Lautréamont », dernier fragment de l’essai initial devenu le moment central de La Généalogie d’une révolte et reprise d’un article de 1978 paru dans Les Cahiers de l’Herne. Louis Janover s’interroge sur la continuité de l’œuvre et ce qui fait sa cohérence : puisque tout y est mouvant, à commencer par l’identité du polymorphique Maldoror, il faut chercher du côté de la source principale avec laquelle Ducasse dialogue, c’est-à-dire le roman noir auquel il fait subir un traitement original. Les codes du genre sont perpétuellement mis à mal : la campagne est privilégiée aux villes et aux châteaux gothiques, le héros n’est que rarement en proie à des états d’âmes, et ainsi, cette littérature très codifiée est à la fois imitée et brouillée, et le lecteur perdu. L’unité de l’œuvre ne tient pas non plus dans l’intrigue, sans continuité ni grande cohérence, tenue seulement par une révolte somme toute impersonnelle. Cet éclatement et cette dissolution du roman noir sont-ils un jeu innocent, ou une subversion voulue ? Louis Janover va démontrer, de manière assez convaincante, que l’intention de Ducasse est de nous mener au constat de l’impossibilité à poursuivre cette littérature. Lire Lautréamont est une errance : la quête du sens met la critique en déroute, l’ambiguïté est entretenue par l’auteur, et le fil du discours se perd sans cesse. Ce que Ducasse écrit, c’est ce à quoi mène le romantisme lorsqu’il est poussé dans ses derniers retranchements, une fois le moi délivré de toute barrière morale, une fois l’univers tout entier soumis à sa fantaisie individuelle. Le véritable sujet des Chants est donc l’hypertrophie du moi qui ne se rapporte plus qu’à lui-même, et ainsi, le dialogue avec le romantisme qui confine régulièrement au plagiat ne vise qu’à cette seule démonstration : Ducasse prend des situations topiques pour les pousser à l’excès. Le Créateur lui-même, façonnant l’image de l’homme, contribue à prolonger cet « impérialisme du moi ». Avec Sade, Lautréamont devient ainsi celui qui aura le plus érigé en valeur absolue la toute-puissance de la volonté individuelle, et cela passe nécessairement par la négation radicale de l’Autre. Mais paradoxalement, l’individu n’existe que dans et par la lutte contre l’obstacle à sa volonté, et sans le combat perpétuellement 314recommencé contre Dieu, Maldoror n’aurait plus de raison de vivre. Cette révolte sans finalité révolutionnaire ni positivité créatrice apparaît donc comme une aliénation, et il est aussi absurde de prendre le texte au sens littéral comme une apologie de la révolte luciférienne, que de n’y voir qu’une mystification gratuite. Il y a bien une logique dans l’œuvre, et plus généralement dans le dispositif Maldoror-Poésies : il s’agit d’une démonstration dialectique parfaitement ordonnée en vue d’un objectif, soumettre le romantisme à une épreuve d’exagération systématisée pour le démanteler et provoquer une rupture. La démonstration de Louis Janover est convaincante, d’autant plus qu’elle rompt ici avec la doxa surréaliste. Poésies serait la préface aux Chants, leur mode d’emploi, elles en donnent le sens si bien qu’il n’y a plus de contresens possible sur la démarche du poète. Mais en voulant donner à son récit une ampleur lyrique et un maximum de force persuasive, Lautréamont a redonné ses lettres de noblesse, malgré lui, au genre dont il entendait souligner les limites. C’est pourquoi Poésies vient changer de méthode et redire la même chose, sans la moindre ambiguïté possible : ce que cherche Ducasse, sans le moindre doute, c’est le bien et non le mal. Dès lors, Les Chants de Maldoror sont une entreprise de purification du roman noir, lavé de ses tics romantiques et soumis à la lumière aveuglante du Bien.
La fin du livre ne concerne plus tout à fait Lautréamont, mais plutôt la manière dont, dans son sillage, les nouvelles avant-gardes ont érigé un nouveau mouvement appelant lui aussi à la révolte et au renversement des normes littéraires. Ainsi, Louis Janover esquisse en effet cette « généalogie d’une révolte » dont parle le titre de l’œuvre, en analysant l’émergence de ce qui va devenir le surréalisme. Janover propose alors une traversée du xxe siècle par les avant-gardes, étudiant notamment leur rapport à l’aspiration révolutionnaire communiste, pour conclure, dans un chapitre consacré à Jacques Vaché, sur le paradoxe initié par Ducasse : toutes ces avant-gardes animées par la révolte se débattent avec la tentation du refus de l’art, et proposent des options différentes pour résoudre cette contradiction entre l’art et la vie.
Kevin Saliou
315OUVRAGES CITÉS
Janover, Louis, 2020, La Généalogie d’une révolte. Nerval, Lautréamont, Paris, Klincksieck.