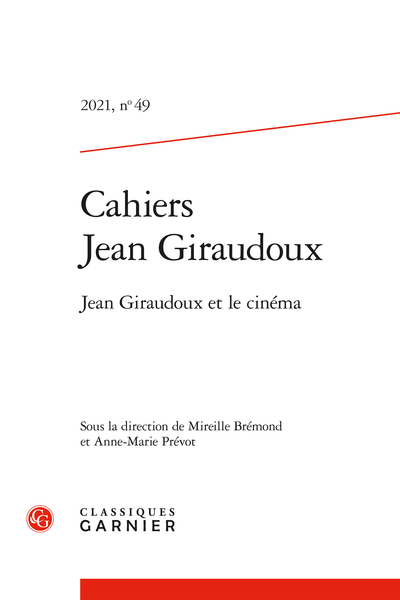
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Jean Giraudoux Jean Giraudoux et le cinéma
2021, n° 49. varia - Pages : 327 à 335
- Revue : Cahiers Jean Giraudoux
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126133
- ISBN : 978-2-406-12613-3
- ISSN : 2552-1004
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12613-3.p.0327
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/12/2021
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
ouvrages
Le diariste, la biographe et Giraudoux
Paul Morand, Journal de guerre, Londres-Paris-Vichy, 1939-1943, Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la NRF », 2020, 1038 pages.
Pauline Dreyfus, Paul Morand, Paris, Gallimard, « Biographies », 2020, 496 pages.
Parallèlement à la publication du premier volume des Essais de Jean Giraudoux, aux éditions Classiques Garnier, deux livres viennent, en écho à l’œuvre de cet auteur, remettre sur le devant de la scène littéraire, la figure de Paul Morand.
Le premier, « un document pour l’histoire », est son Journal de guerre, sous-titré Londres-Paris-Vichy 1939-1943, et publié chez Gallimard par Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation dont on peut rappeler les passionnants ouvrages sur Le Docteur Ménétrel, éminence grise et confident du Maréchal Pétain (Perrin, 2001), Bonnier de la Chapelle, l’assassin de l’amiral Darlan (Une Juvénile Fureur, Perrin, 2019) et Jean Moulin (Jean Moulin, l’affranchi, Paris, Flammarion, 2018).
Ce fort volume (1038 pages) réunit en fait dix lettres à May de Cossé-Brissac dont on connaît les liens quasi conjugaux avec le romancier, cinquante-neuf à son épouse, Hélène, écrites entre août 39 et mai 40 et le journal proprement dit, dont certaines pages prennent d’ailleurs une dimension épistolaire (cf. le 5 mai 1942), comme si Morand voulait l’inscrire dans un horizon dialogique – qu’on retrouve évidemment quand le diariste reproduit telle ou telle conversation ou laisse et fait parler X. Vallat, Laval, Chambrun.
Avec une certaine modestie Morand dit se rendre compte que « les notes qu’(il) prend au jour le jour n’ont aucune valeur humaine, littéraire. Ni vues historiques, ni portraits, ni atmosphères ou paysages » (19 juillet 1942). Et de fait, c’est le passionné d’histoire qui trouvera là 328surtout des informations sur la drôle de guerre vue de Londres ou la vie quotidienne dans le Vichy de la collaboration. Les notations de moralistes ne manquent cependant pas qui sonnent comme celles d’un La Bruyère ou d’un La Rochefoucauld, version snob, évidemment : « Il est charmant de devenir riche ; il est peu drôle de l’avoir toujours été, car un homme né dans la richesse, même intelligent, ne peut pas se rendre compte de la peine inouïe que coûtent les choses » (1er décembre 1941). Mais pas toujours : « la morale est un paysage » (19 avril 1943). En tout cas, la rosserie est souvent au rendez-vous : « Les grandes crises militaires ou sociales ont ce curieux effet de libérer de la peur de leur femme légitime les hommes faibles. Une peur chasse l’autre » (17 mai 1940). Le journal favorise aussi chez Morand son penchant pour la forme brève que sa théorie de la nouvelle avait appliquée à la fiction : il en naît des sortes de haïkus, volontaires ou non (« Coucher de soleil sur la Loire, boule de feu, méandres lilas, ciel plombé de chaleur » – 10 septembre 1942) ou des traits à la Jules Renard, quand le romancier note des petits faits de sa vie quotidienne : « Mimosa nous prend un oiseau. Joue avec. Il pousse des cris. La mère vole au-dessus. Le petit chat regarde passionné cette première leçon » (9 juin 1941).
Mais – et comment ne le serait-il pas – le journal est surtout un autoportrait, où se confirme au fil des pages (plutôt que ne se révèle) l’envieux des droits d’auteurs que touchent des confrères (sur ceux de Saint-Exupéry, voir « l’information » du 4 août 1942 qui sonne comme une dénonciation au fisc ou suggère des revenus de collaborateur), le romancier un peu vain ne cachant pas que, pour Charles Tharaud, « L’Homme pressé était le plus beau roman des dix dernières années » (octobre 1941), l’ambitieux, intriguant pour obtenir plus et mieux que son ambassade à Bucarest, le collaborationniste, l’antisémite notoire. Mais aussi à partir de 1943, Morand s’inquiète, légitimement, de son avenir : « Que retrouverai-je de la France, de ma maison, des miens ? Quand ? Sera-ce l’exil, le limogeage, la mort par contumace, une vie de fermier dans la Nièvre ou sur les bords du lac Nahuel Huapi ? » (2 août 1943). Et le journal « tremble », un peu, vers la fin. Bref, voilà le journal, non sans apprêt ni mauvaise foi, d’un collaborateur un peu doué que Bénédicte Vergez-Chaignon a établi, présenté (soixante-quinze page serrées et sérieuses) et annoté (avec précision) avec toute la maîtrise d’une historienne de qualité.
329Peut-être le Journal de Paul Morand nous intéresserait-il moins si l’écrivain-diplomate n’avait été l’ami de Jean Giraudoux et que, curieux de ce qui touche notre auteur, nous n’en cherchions toujours le nom dans l’index nominum de tous les ouvrages pouvant, de près ou de loin, le concerner. Or, le Journal répond à cette curiosité (quarante-neuf mentions). Comme tout journal, il voit cependant souvent l’Histoire par le gros bout de la lorgnette et Morand, commensal de Giraudoux, ne rate avant tout aucune scène de ménage entre l’auteur et Suzanne (26 octobre 1940 : trois pages ! Et 23 août 1943). On trouve, il est vrai, d’intéressants témoignages sur le fonctionnement du Commissariat à l’Information (1939-1940) miné par ses dissensions internes et torpillé par le gouvernement Daladier (octobre 39). Mais les sentiments de Morand à l’égard de « ce pauvre Giraudoux » (6 janvier 1940) apparaissent surtout teintés d’envie : en octobre 39, il suppose ainsi que Giraudoux a censuré l’annonce du décès de l’académicien Georges Goyau pour pouvoir être le seul à faire les visites de candidature à son fauteuil et ainsi être élu sans problème quai Conti… En janvier 40, quand il note « qu’on parle d’une ambassade pour Jean (Giraudoux) », on ne sent que trop qu’il aimerait mieux qu’on en parlât pour lui et il y revient deux fois en mars. En avril 40, il se livre à un parallèle entre lui, vrai passionné par la nature, et Giraudoux, simple « cueilleur de muguet » – sous-entendu, insincère. Ce n’est donc pas sans délectation qu’il mentionne « une éclipse théâtrale » de son ami, « analogue à celle d’Anatole France après 1900 » (23 avril 1943). Le divorce politique est plus entaché de mauvaise foi encore : « Giraudoux, Mauriac, Duhamel préféreraient prendre des positions dites nationales, faire tuer leurs fils et voir démolir Reims, Chartres et Amiens […] » (13 juin 1940), et ce thème de l’aveuglement de Giraudoux est repris pour dénoncer la foi du romancier dans la puissance américaine dont les aviateurs détruiraient sans pitié la cathédrale de Reims, qu’au contraire, un aviateur allemand, en temps de guerre épargnerait (26 septembre 1943)… Mais, en un sens, ces remarques valent brevet de patriotisme et de moralité politique, eu égard aux positions propres de Morand.
Concernant Giraudoux, on est donc d’autant plus étonné de lire un certain nombre d’affirmations rigoureusement contraires à celles de Morand dans le livre que Pauline Dreyfus vient de publier chez Gallimard sur cet auteur. Comme dans le Journal, un nombre important de mentions 330de Giraudoux attirent l’attention : quarante-six, dont beaucoup renvoient à des analyses sur les rapports entre les deux écrivains dépassant la page.
Si la rencontre de Morand avec Giraudoux, le compagnonnage parisien, l’aide apportée par l’aîné aux débuts de la carrière du cadet sont correctement traités, l’auteur ayant puisé à bonne source (la biographie de Jacques Body), tout se gâte cependant quand les années 30 sont abordées, puis la période de l’Occupation. Pauline Dreyfus ayant décidé de ne rien cacher de l’antisémitisme de Morand ni de ses attaches collaborationnistes, il semble qu’elle veuille – inconsciemment ? – compromettre Giraudoux pour faire bonne mesure des supposées dérives de toute une époque. Trois passages retiennent singulièrement l’attention : les pages 209, 230 et 276. Dans la dernière des trois, elle nous montre un Morand « saisi d’un étrange scrupule » (?) au moment de la mort de Giraudoux et taisant son « engagement au service de la collaboration », étrange propos qui peut-être s’explique par une lecture rapide de la biographie de Giraudoux : devra-t-on encore le répéter longtemps, c’est pendant la drôle de guerre, sous le gouvernement Daladier, que Giraudoux a été à la tête du Commissariat à l’Information. Le poste ou son équivalent (« Ministère de l’Information ») sera, pendant la guerre, détenu à Vichy, par Laval en personne… C’est confondre temps et personnalités que d’avancer de telles affirmations. Auparavant (page 230), Giraudoux est présenté comme un « germanophile convaincu, faisant l’apologie de l’armistice à qui veut l’entendre » (quand dans le Journal de Morand c’est un va-t-en-guerre anti-munichois). On sait qui croire, du diariste ou de la biographe. Ce n’est pas parce qu’il y a le mot « armistice » dans un titre de livre (« Armistice à Bordeaux ») qu’on est pour celui qui a été signé. Enfin, à bon droit, les lignes de Pleins Pouvoirs sur l’immigration des juifs de l’Est sont rappelées mais reprenant une vieille antienne, P. Dreyfus donne à l’expression « ministre de la (r)ace » un sens « goebbelsien » qui n’est pas celui, métaphorique, dans lequel Giraudoux l’entendait et en est même le contraire. Surtout, il est tout à fait faux d’écrire que, dans Pleins Pouvoirs, Giraudoux compare « les pays à des fruits où les vers sont à l’intérieur » en sous-entendant que ces « vers » seraient les réfugiés venus de l’Est. Or, l’expression se trouve dans Siegfried (« Les pays sont comme les fruits, les vers sont toujours à l’intérieur », acte I, sc. 6) qui date de 1928 et où c’est Zelten qui la prononce devant Robineau.
331On peut toujours dire des bêtises et même en écrire. L’ennuyeux c’est qu’elles sont lues et souvent crues. Sur Giraudoux, aucun amateur de l’écrivain ne se laissera prendre mais un esprit moins informé évidemment oui. De telles touches sont d’autant plus déplaisantes que l’ouvrage sur Morand lui-même est assez juste, repoussant toute « hagiographie » (p. 13) ; que son œuvre est présentée avec précision ; et que l’autrice a bénéficié de sources intéressantes : petite-fille d’Albert Fabre-Luce dont l’épouse « Lolotte » fut une amie intime de Morand, elle a eu accès à des documents familiaux et des correspondances encore inédites. Tout cela concourt évidemment à faire de cet ouvrage « la » biographie attendue sur Paul Morand et pour laquelle l’accueil critique est des plus favorables. Il est vrai que l’autrice est nourrie de l’objet de son étude, sur lequel on lira (ou on a peut-être déjà lu) aussi d’elle le très bon Immortel, enfin (Grasset, 2012) ou l’ultime campagne académique de Morand. Surtout, les deux romans de Pauline Dreyfus Ce sont des choses qui arrivent (Grasset, 2014) et Déjeuner des barricades (Grasset, 2017) sont à conseiller, qui retraitent sur le mode de la fiction tout l’univers de Morand, entre les années de guerre et les barricades de 68.
Christian Leroy
Professeur honoraire
de chaire supérieure
*
* *
Ernest Renan et Marcellin Berthelot, Correspondance, Classiques Garnier, 2021.
Nous avons appris la parution, aux éditions Classiques Garnier, de la correspondance entre Marcellin Berthelot (1827-1907), chimiste et 332homme politique français, père de Philippe Berthelot, et Ernest Renan (1823-1892). Voici sa présentation sur la liste des parutions de l’éditeur :
« La correspondance d’Ernest Renan et Marcellin Berthelot est à la fois le témoignage d’une amitié extraordinaire et le document d’une époque. Cette nouvelle édition enrichie permet de mettre au jour le dialogue unique entre deux figures majeures qui ont marqué le xixe siècle dans les champs intellectuel, scientifique et politique ».
Nous profitons de cette occasion pour signaler la très intéressante biographie de Philippe Berthelot par son ami Auguste Bréal (Gallimard, 1937).
*
* *
ARTICLES
Le tournage des Anges du péché vu par Romain Slocombe
On a déjà eu l’occasion, dans les Cahiers Jean Giraudoux, de mentionner la suite policière de Romain Slocombe, dont le héros, ou plutôt l’anti-héros, est le passablement ignoble inspecteur principal Léon Sadorski, chef du « Rayon juif » aux Renseignements généraux (voir CJG no 46, p. 89, n. 10). Paru chez Robert Laffont en 2018 (et réédité en 2019 dans la collection Points), le troisième volume s’intitule : Sadorski et l’Ange du péché. Au cours du récit (qui entremêle plusieurs intrigues), une bourgeoise parisienne vient demander à l’inspecteur des RG de la « débarrasser » de la jeune femme « demi-juive » que son mari entretient : Hortense Gutkind, un ancien mannequin, qui a tenu des rôles de second plan dans quelques films, et « tourne actuellement Les Anges du péché (production Synops) aux Studios Radio-Cinéma où elle interprète une religieuse », selon le rapport de filature d’un détective privé (Points, p. 290). Sadorski interroge ce dernier, qui lui présente en ces termes (qui à vrai dire sentent un peu la fiche… d’encyclopédie) le film et son tournage (id., p. 378-379) :
333Les Anges du péché, un truc avec des religieuses mis en scène par un jeune cinéaste. La société Pathé qui devait le produire a jeté l’éponge parce que le projet serait hasardeux, pas suffisamment commercial. Ils l’ont revendu à une petite boîte nommée Synops, que dirige le couple Tual, Denise et Roland. Ce dernier est lié au groupe des surréalistes. Les dialogues sont d’un écrivain célèbre, Giraudoux, assisté par un cureton nommé Bruckberger. L’histoire m’a l’air assez con, mais les comédiennes sont bonnes. On ne compte quasiment que des personnages féminins. Ça se tourne dans les studios Radio-Cinéma, aux Buttes-Chaumont. […] Y a un couvent entier dans le scénario du film ! Alors ça fait des dizaines de pépées plutôt jeunes, qui sont des religieuses factices, comme on dit le café factice ou le beurre factice ! Quand elles arrivent au studio, vers 22 heures, elles laissent leurs soucis à la porte et se déguisent avec leur tenue de nonne, le voile et tout le tralala. Et ça circule en pépiant comme dans une volière, un véritable pensionnat de jeunes filles ! Le seul gars sinistre, c’est le metteur en scène, qui s’y croit vraiment et fait enrager ou pleurer tout le monde. Un nommé Bresson, Robert.
À la suite de cette présentation… alléchante, Sadorski se rend un soir aux studios : le chapitre 27 du roman s’intitule donc « Les sœurs de Béthanie » ! Il apprend d’abord des actrices, qui plaisantent sur la « correction fraternelle », qu’Hortense Gutkind doit prononcer une unique réplique, qui dans le texte de Giraudoux est attribuée, tout au début du film, à « une mère » anonyme : « Sœur Saint-Blaise, vous êtes dispensée. Vous êtes souffrante. » (ORC II, p. 920). Puis il est témoin d’une brève confrontation entre Bruckberger, qui « réunit actrices et figurantes autour de lui comme un entraîneur sportif », et Bresson, qui « ressemble à un surveillant d’internat » (p. 435), avant d’assister, émerveillé, au tournage de ce qui constitue donc la seconde séquence du film, « Les couloirs du couvent » ; après quoi il entend un chœur répéter le Salve Regina… Sa rêverie est interrompue par Bresson, qui réunit « les trois nonnes responsables du dialogue » pour leur expliquer « pourquoi cette prise était nulle » en leur faisant un cours de « cinématographe » :
Rien n’est plus faux dans un film, Hortense, que ce ton « naturel » du théâtre recopiant la vie et calqué sur des sentiments étudiés. […] Dans le cinématographe, l’expression est obtenue par des rapports d’images et de sons, et non par une mimique, des gestes et des intonations de voix (p. 441-442).
Évidemment, Hortense ne comprend à peu près rien à ce discours, et Bruckberger intervient en reprochant à Bresson d’« intellectualiser à outrance ». S’ensuit un débat animé, que la script-girl commente pour 334Sadorski en lui expliquant que le dominicain se prend pour le véritable auteur du film, qu’il « est très populaire auprès des comédiennes » et que Bresson « ne le supporte plus » (p. 444).
À la fin du tournage, Sadorski demande à Hortense de l’accompagner à la buvette, où il est témoin d’un « spectacle étrange » : « des nonnes boivent et fument en compagnie de danseuses des Folies-Bergère vêtues de paillettes dorées et de plumes d’autruche ». Là, Hortense lui en dit un peu plus sur le sujet du film et sur son metteur en scène, « un tourmenteur » :
J’ai vu des figurantes pleurer d’humiliation et de rage à cause de ses exigences. […] Et il pique des colères épouvantables. De plus il n’a pas un gramme d’humour. […] Sa méthode, en réalité, chaque fois qu’une difficulté se présente, est d’aller trouver M. Bruckberger, ou M. Agostini le chef-opérateur, de leur demander leur solution, puis de la repousser d’un ton tranchant… et ensuite il revient au centre du plateau, impose cette même solution qui lui a été suggérée, mais comme si c’était le fruit de son intense méditation personnelle… (p. 448).
On comprend que plus tard dans le récit, ce soit en jubilant qu’elle lui raconte une anecdote empruntée aux mémoires de Bruckberger :
La nuit du 1er avril aux Buttes-Chaumont… On tournait une scène dans le décor du cloître avec les deux héroïnes, Renée Faure et Jany Holt. […] Renée Faure doit questionner : « Sœur Thérèse, connaissez-vous le langage des fleurs ? »… et Jany Holt, sombre et d’une voix caverneuse, répondre : « pour ce que j’ai à leur dire… ? ». On en était à la je ne sais combientième prise… […] Alors M. Bresson reprend sa place derrière la caméra, prononce de son ton lugubre : « Prêt ? Moteur… ». Et tout d’un coup une musique prodigieusement gaie éclate, on entend la voix gouailleuse de Mistinguett : « Paris, c’est une blonde… ». C’est la troupe des Folies-Bergère au grand complet qui déboule dans le décor bras dessus bras dessous, levant les jambes en cadence avec la musique, et faisant remuer leurs plumes ! Stupeur garantie et fous rires chez les figurantes et les techniciens. Notre génial metteur en scène en étouffait de rage… (p. 593-594).
Bien entendu, Hortense Gutkind est un personnage imaginaire : Slocombe lui-même nous informe que la comédienne qui était chargée de sa réplique se nommait en fait Christiane Barry (p. 645) ; et peu nous importe que Sadorski, pour son malheur, lui offre sa protection en échange de ses « faveurs »… Ce qui compte, c’est qu’un Slocombe très 335bien informé introduise son lecteur dans le studio des Buttes-Chaumont ; son livre se clôt d’ailleurs sur une imposante bibliographie, qui comprend bien sûr les mémoires de Bruckberger (Tu finiras sur l’échafaud), mais aussi ceux de Denise Tual (Le Temps dévoré) et plusieurs ouvrages de et sur Robert Bresson. On peut seulement regretter qu’il ne mentionne d’autre biographie de Giraudoux que celle de Philippe Dufay. Mais Giraudoux (heureusement ?) n’apparaît pas dans ce roman, où Bresson fait une assez « triste figure »…
Pierre d’Almeida
CELIS – Université Clermont-Auvergne