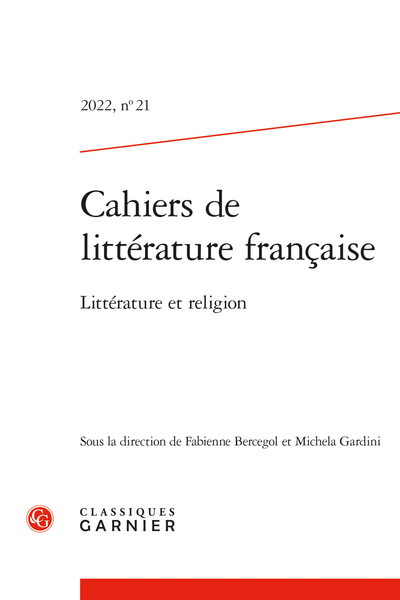
Avant-propos
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers de littérature française
2022, n° 21. Littérature et religion - Auteurs : Bercegol (Fabienne), Gardini (Michela)
- Pages : 9 à 11
- Revue : Cahiers de littérature française
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406144533
- ISBN : 978-2-406-14453-3
- ISSN : 2430-8293
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14453-3.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 04/01/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
AVANT-PROPOS
Qu’ils aient pris la plume pour la défendre, pour l’attaquer ou pour tenter de la réformer, les écrivains, au moins jusqu’au xxe siècle, ont rarement laissé totalement de côté la religion, ses dogmes, ses rites, ses institutions, les questions qu’elle leur posait sur leur rapport à la foi et sur leur conception de la condition humaine. Ce sont quelques échos de ce dialogue séculaire entre littérature française et religion, catholique surtout, que nous faisons entendre dans ce numéro dans le but, non pas d’analyser d’un point de vue théologique la croyance de tel ou tel écrivain, mais bien plutôt de montrer sur le plan de la poétique comment la matière religieuse a modelé leur imaginaire, la représentation de leur Moi et du monde, comment elle a pénétré les genres littéraires qu’ils pratiquaient et conditionné leur écriture. À un moment où l’on revient vers ces questions religieuses que les études littéraires avaient délaissées1, il s’agit pour nous de répondre à l’invitation lancée par Béatrice Didier d’enquêter sur la façon dont la religion « fournit des réseaux de thèmes, de structures, travaille profondément le texte, permet la création de personnages au théâtre comme dans le roman, de situations conflictuelles, source de toute intrigue, et, plus profondément, encore soutient les métaphores, inspire une certaine rhétorique, dicte même des formes littéraires2 ».
On ne sera pas étonné que plusieurs articles recueillis ici portent sur la première moitié du xixe siècle. C’est que, comme l’écrit encore Béatrice Didier, la « grande marée du retour du religieux [y] est envahissante3 ». Le temps est à la réhabilitation d’un culte que les révolutionnaires n’ont 10pas épargné. Chateaubriand ouvre le siècle avec la publication en 1802 du Génie du christianisme qui incite à redécouvrir le potentiel littéraire et artistique de cette religion, ainsi que son apport social et politique : les romans de Sophie Cottin ici présentés fournissent un exemple du succès de la formule mise au point par l’apologiste, qui fait l’éloge de l’obstacle que la religion peut opposer aux passions, voire de la passion exclusive de tout autre sentiment qu’elle peut devenir elle-même. Mais si la littérature, la poésie par exemple, avec les Méditations poétiques de Lamartine publiées en 1820, renoue avec l’inspiration spirituelle, l’héritage du combat mené par les Lumières contre l’Église n’est pas oublié pour autant. En témoignent ici la révolte de Stendhal contre le pouvoir des prêtres, mais aussi les différents articles qui portent sur le traitement du couvent et ce, déjà à partir du xviiie siècle avec les romans de Madame de Tencin, jusqu’à George Sand : tous montrent, certes à des degrés divers et avec des issues différentes, que s’il peut jouer le rôle de refuge et se prêter à des expériences émancipatrices de pensée, il reste globalement perçu comme un espace de violence physique et morale dans lequel s’élaborent des histoires pactisant avec les structures imaginaires du roman noir. Même Chateaubriand, qui entend pourtant défendre ces établissements, ne peut éviter qu’ils apparaissent comme le lieu par excellence de drames intérieurs difficilement sublimés en élans de foi et de charité.
La fascination exercée par la liturgie à la fin du xixe siècle et la forte esthétisation qui caractérise la représentation typiquement fin de siècle de la religion appartiennent à un imaginaire destiné à s’écrouler sous le choc du premier conflit mondial. À partir de là, notamment dans la première partie du xxe siècle avec Georges Bernanos, la religion apparaît de plus en plus comme un horizon moral et spirituel censé secouer la conscience des intellectuels ainsi que les lecteurs.
Si la religion fournit au roman un personnel et des espaces d’un grand intérêt dramatique, elle est aussi très présente dans les textes autobiographiques qui sondent les méandres de l’intériorité et qui retracent la genèse d’une personnalité, de ses sentiments comme de ses idées. Le constat du déclin du catholicisme dévoyé en morale hypocrite alimente la hantise de la décadence chez Drieu la Rochelle et dessine les contours de sa vocation littéraire, en le mettant au défi d’écrire dans un monde que la religion a déserté. Julien Green se construit et 11structure son œuvre autour du conflit violent qui se déclare entre son homosexualité et la religion qui en fait un motif de perdition. Henri Bauchau illustre au contraire les affinités profondes du journal intime et de la prière qui accompagnent la descente sereine en lui-même et l’éveillent à la beauté du monde.
Fabienne Bercegol
et Michela Gardini
1 La revue Orages vient par exemple de consacrer son dernier numéro (no 20, 2022) au « génie de la religion » : son dossier situe le Génie du christianisme de Chateaubriand dans le renouveau de l’apologétique et fait le point sur le retentissement de ses thèses.
2 Béatrice Didier, L’infâme et le sublime. Quelques représentations du sacré des Lumières au Romantisme, Paris, Champion, 2017, p. 24.
3 Ibid., p. 22.