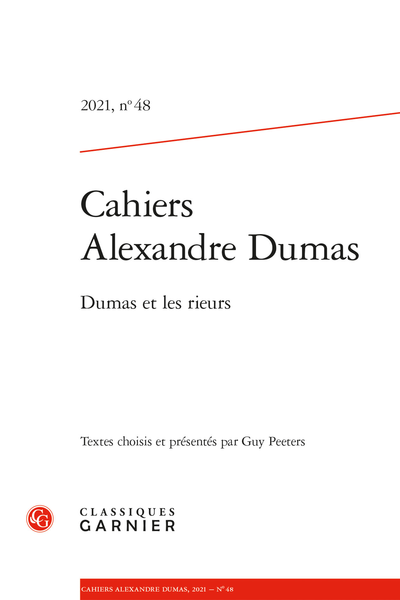
Préfarce…
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Cahiers Alexandre Dumas
2021, n° 48. Dumas et les rieurs - Résumé : Au XIXe siècle, les caricaturistes se paient la tête de Dumas et les journalistes renforcent ces charges en glissant dans leurs colonnes de petits articles satiriques qui soulignent son ego démesuré, ses débordements amoureux ou sa production boulimique. L’écrivain, qui veut occuper la scène et amuser le public, alimente lui-même ces échos en dévoilant une part de sa vie privée et en répandant ses bons mots. Aussi les « rieurs » le métamorphosent-ils en une personnalité mythique qui, pour les lecteurs, devient le vrai Dumas, irrésistiblement sympathique.
- Pages : 8 à 13
- Revue : Cahiers Alexandre Dumas
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126430
- ISBN : 978-2-406-12643-0
- ISSN : 2275-2986
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12643-0.p.0008
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 26/01/2022
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : Dumas père, littérature française, journalisme, satire, comique

Préfarce…
Pas de faute dans le titre ci-dessus. Simplement une façon de prévenir le lecteur qu’il tient en mains un ouvrage sérieux qui ne rassemble que des « farces ».
J’explique.
Au xixe siècle, à côté des caricaturistes, d’autres « rieurs » apparaissent dans une grande partie de la presse : ce sont les rédacteurs des « nouvelles à la main ».
Textes souvent courts, les « nouvelles à la main » évoquent des scènes, des anecdotes, des mots d’esprit qui chargent avec humour, quelquefois avec férocité, des personnalités connues. Ce genre s’est développé dans les journaux manuscrits, la plupart clandestins, du xviiie siècle. L’aristocratie en faisait alors les frais ; au xixe siècle, ce sont surtout les personnalités de la scène et de la littérature.
Quand Hippolyte de Villemessant refonde Le Figaro en 1854, il le veut « essentiellement parisien, bien vivant », plein du mouvement qui manque aux autres1. Le Figaro doit pouvoir être lu de la première à la dernière ligne2. Aussi introduit-il, chaque semaine, la rubrique des « Nouvelles à la main » dont il se chargera souvent lui-même. Ces nouvelles aideront à faire lire et à faire pardonner les articles sérieux de son hebdomadaire. « C’est comme qui dirait, écrit-il plaisamment, des capucines autour de la salade3. »
Villemessant sait la curiosité des lecteurs à l’égard de la vie des vedettes – curiosité qui aujourd’hui encore assure le succès de la presse people.
Et cela marche. Les petits journaux, résolument satiriques ceux-là, qui se multiplient à l’époque, usent et abuseront longtemps de la même 10recette, souvent sous des chapeaux différents. Ce seront les « Échos de Paris », « Mes tablettes », etc. Et leurs articles s’allongeront de plus en plus.
Sans conteste, l’auteur le plus voyant, dans les années 1840-1860, est Alexandre Dumas. Il empêche une partie de la France de dormir en publiant ses romans-feuilletons au rez-de-chaussée des grands quotidiens. « J’avais pris l’habitude, reconnaît le directeur du Figaro, de lire mon feuilleton le soir dans mon lit ; et, s’il m’avait manqué une seule fois, je me serais levé au milieu de la nuit pour me le procurer à tout prix4 » Dumas occupe les scènes de tous les théâtres, il publie ses propres journaux, il s’essaie à la politique en 1848, il se raconte dans ses Mémoires, il s’illustre dans des controverses et des procès multiples, il se pose en révolutionnaire et en libérateur de l’Italie au début des années 1860. Impossible de l’ignorer.
D’autant que l’existence de l’homme privé n’a rien de banal non plus. Son fol appétit de la vie, ses amours multiples, ses manies, ses extravagances répétées, son esprit, tout chez lui étonne. Mais il agit toujours avec tant de bonhomie et de candeur qu’il emporte la sympathie et qu’on lui pardonne tout. « C’est si bon de rester enfant ! dit-il le plus sérieusement du monde, et la folie est encore la plus grande des satisfactions5. »S’il fait de la littérature, c’est pour « amuser et intéresser6 ». Il trouve son plaisir dans ses propres inventions. Joseph Autran, son hôte de quelques nuits, a été réveillé plusieurs fois par « un bruyant éclat de rire » venant de la chambre voisine : Dumas venait d’écrire quelque chose de spirituel7.
Donc les rieurs avaient bien des raisons de le choisir comme principale tête de turc. Un homme hors du commun qui prête à rire et qui semble parfois y encourager.
À partir des années 1850 surtout, les journaux satiriques sont intarissables, n’hésitant pas à réécrire, avec de petites « variantes », des articles antérieurs de leurs confrères. Ainsi, la réplique cinglante de Dumas à 11un raciste (« Mon grand-père était un singe. Ma famille finit où la vôtre commence. »), ou l’histoire du perroquet étranglé par l’auteur. Tantôt ils sont gentiment moqueurs, attendris par la naïveté de Dumas, tantôt, plus rarement, ils se montrent grinçants.
Dumas, lui, les ignore ou feint de les ignorer. « On pouvait s’escrimer à coups de hache sur la bonne grosse vanité [de Dumas père] sans faire autre chose qu’effleurer son épiderme8. » Quand son collaborateur, Gaspard de Cherville, l’incite à répliquer, il se met à rire : « – Mon cher enfant, souvenez-vous bien d’une chose, c’est que le jour où vous ne lirez plus de mal de moi dans les journaux, ce jour-là je serai mort9 ! » « Être contesté, c’est être constaté10 », disait Victor Hugo. Dumas sait qu’il est avantageux d’occuper le terrain médiatique. Comme les caricatures qui pullulent11 ou les photos, ces échos journalistiques, en provoquant le rire ou le sourire, renforcent sa popularité. Ils créent un personnage drôlatique et attachant qui se superpose à sa personnalité réelle et qui le grandit encore. Tout le monde, bien sûr, n’adhère pas à ce battage autour du romancier. Sainte-Beuve, indigné, hausse les épaules. Une importance surfaite, pense-t-il. « Malgré tout son fracas », Dumas n’est « qu’un esprit de quatrième ordre » chez qui l’on chercherait en vain une pensée élevée12. Ce n’est qu’un représentant de la littérature « industrielle ». Émile Zola, plus féroce encore, surenchérit. Il dénonce à la fois, avec hargne, l’écrivain et le comportement de ses applaudisseurs.
Paris est un « gobeur », qui a besoin d’être amusé, écrit-il en 1880 […]. Dumas a été son enfant gâté pendant près d’un demi-siècle. Paris était à l’aise avec lui, riait de ses mots, lui tapait sur le ventre, gardait la reconnaissance du gros rire dont il l’emplissait. Ajoutez l’engouement de la presse pour un esprit sans profondeur, mais d’une verve intarissable. On adore toujours les gens qui ne vous forcent pas à penser, qui ne vous heurtent pas par un tempérament trop personnel, et dont l’heureuse nature vous entretient dans un doux état d’hilarité. (Le Figaro du 6 décembre 1880)
12Et il ajoutait, péremptoire : les œuvres de Dumas forment aujourd’hui « un tas, une charretée de vieux bouquins de plus en plus illisibles, qui finiront dans les greniers, rongés par les rats13. »
Zola s’exprimait en chef de l’école naturaliste et, comme tel, il se montrait partial à l’égard de ses devanciers de la génération 1830. Paradoxalement, vingt ans plus tôt, en 1861, il faut le rappeler, il avait souhaité devenir collaborateur d’Alexandre Dumas14.
Par contre, Lamartine – qui n’était assurément pas un « gobeur » – tenait un discours bien différent. Lui, qui riait rarement, affirmait qu’Alexandre Dumas avait été « le seul homme qui l’ait amusé15 ». Et il ne lui ménageait pas ses éloges. « Vous êtes surhumain : mon avis sur vous, c’est un point d’exclamation ! On avait cherché le mouvement perpétuel, vous avez fait mieux, vous avez créé l’étonnement perpétuel. Adieu, vivez, c’est-à-dire écrivez ; je suis là pour vous lire16. »
Zola s’est trompé, d’abord en déniant toute pérennité à l’œuvre de Dumas. Aujourd’hui, celui-ci est réédité dans les langues du monde entier. On le lit à Pékin comme à Varsovie. Et, lors de son bicentenaire, la France l’a conduit au Panthéon et l’a placé à côté de Victor Hugo et… d’Émile Zola.
Les rieurs n’ont pas desservi Alexandre Dumas, bien au contraire. Ceux-ci ont réussi à peaufiner, en forçant le trait, une image drôlatique de l’écrivain. Une image que Dumas lui-même entretenait délibérément.
Ce n’est pas le Dumas vrai, mais c’est le Dumas tel que ses lecteurs l’imaginaient et l’aimaient, et tel qu’on le verra toujours.
Au travers des « nouvelles à la main » et d’articles plus longs, on découvre avec quels éléments s’est construite cette biographie parallèle. Je n’en ai recueilli qu’un certain nombre. L’inventaire exhaustif demanderait des années, à moins de pouvoir compter, comme Dumas, sur quelques collaborateurs acharnés. Les journaux sont nombreux et les articles recherchés s’éparpillent sur une très longue période, bien au-delà de la mort de l’écrivain.
13Comme les caricatures anciennes, ces articles satiriques d’autrefois ont besoin d’être contextualisés pour être compris. J’ai donc ajouté des commentaires là où ils me semblaient utiles et, parfois même, j’ai introduit des textes d’autres plumes, – de ses proches et de ses amis – qui me paraissaient éclairants.
Un dernier mot, j’y tiens : mes remerciements et toute ma reconnaissance à Jacqueline Razgonnikoff, à Monica Oleffe, à Michel Oleffe et à Kathleen Smets qui m’ont aidé dans ce travail.
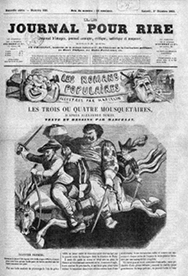
1 H. de Villemessant, Mémoires d’un journaliste, À travers Le Figaro, Paris, 1876, p. 32.
2 Ibid., p. 39.
3 Ibid., p. 41.
4 H. de Villemessant, Mémoires d’un journaliste, Paris, Dentu, 1872-1884, 2e série : Les hommes de mon temps, p. 248-249.
5 Olympe Audouard, Voyage au travers de mes souvenirs. Ceux que j’ai connus, ce que j’ai vu, Paris, Dentu, 1884, p. 108.
6 Dumas, Napoléon Bonaparte, drame en six actes, Paris, Chez Tournachon-Molin, 1831, Préface, p. x.
7 Autran, Œuvres complètes, VII : Lettres et notes de voyage, Paris, Calmann-Lévy, 1878, p. 166-167.
8 Arsenal, ms 13048, f. 194, lettre de Cherville à Jules Claretie, le 31 mars 1884.
9 Le Temps, 2 novembre 1883.
10 Victor Hugo, Tas de pierres, Genève, Milieu du Monde, 1951.
11 Cahier Alexandre Dumas, no 45, sous la dir. de J. Anselmini et I. Safa, « Dumas en caricatures », Classiques Garnier, 2019. – Cette remarquable étude complète en bien des points celle que nous proposons. La plupart des caricatures sélectionnées par les auteurs reprennent les thèmes développés par les « rieurs ».
12 Sainte-Beuve, Mes poisons, Paris, Plon, 1926, p. 29.
13 Le Figaro, supplément littéraire du dimanche 22 décembre 1878 : « Le roman contemporain » par Émile Zola.
14 Guy Peeters, Gaspard de Cherville, l’autre “nègre” d’Alexandre Dumas, Champion, 2017, p. 320-322.
15 Henri de Lacretelle, Lamartine et ses amis, Paris, Dreyfous, 1878, p. 223.
16 Le Mousquetaire du 23 décembre 1853.