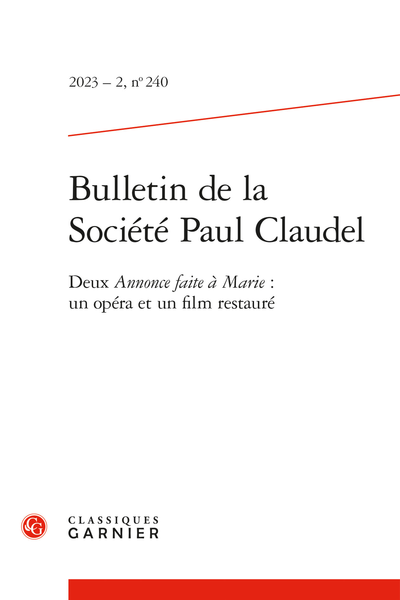
“Figures of the intimate and the extimate : reflections on the performance of Marina Hands and Éric Ruf in Phèdre by Jean Racine and Partage de midi by Paul Claudel”
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société Paul Claudel
2023 – 2, n° 240. Deux Annonce faite à Marie : un opéra et un film restauré - Author: Deregnoncourt (Marine)
- Pages: 119 to 121
- Journal: Bulletin of the Paul Claudel Society
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406155874
- ISBN: 978-2-406-15587-4
- ISSN: 2262-3108
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15587-4.p.0119
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-30-2023
- Periodicity: Four-monthly
- Language: French
Marine Deregnoncourt, « Figures de l’intime et de l’extime. Réflexions autour du jeu de Marina Hands et Éric Ruf face à Phèdre de Jean Racine et à Partage de midi de Paul Claudel »
Thèse soutenue le 16 février 2023, à la Maison des sciences humaines de Belval à l’université du Luxembourg.
Le jury était composé de : Sylvie Freyermuth (université du Luxembourg), directrice de thèse ; Pierre Degott (université de Lorraine), co-directeur de thèse ; Nathalie Roelens (université du Luxembourg), présidente ; Julia Gros de Gasquet (université de Paris III-Sorbonne nouvelle), rapporteur ; Frédéric Sounac (université de Toulouse-Jean Jaurès), rapporteur ; Olivier Goetz (université de Lorraine), vice-président.
Notre réflexion doctorale a abordé les concepts d’« intime » et d’« extime » à travers le jeu scénique et vocal de Marina Hands et Éric Ruf dans les mises en scène de Patrice Chéreau de Phèdre de Jean Racine, et d’Yves Beaunesne pour Partage de midi de Paul Claudel. Dans le cadre de ces deux spectacles, les acteurs précités s’avèrent capables de témoigner de l’« extimité » d’une gestique corporelle et d’une « intimité » grâce à une diction « chantée » de la langue versifiée qu’est l’alexandrin racinien ou le vers libre claudélien.
Nous avons souhaité tisser perpétuellement des liens entre les auteurs Jean Racine et Paul Claudel, grâce au jeu singulier de ces deux comédiens, dirigés par Patrice Chéreau et par Yves Beaunesne. La problématique qui a guidé notre réflexion est la suivante : « Comment l’extime de la gestique corporelle et l’intime de la diction “chantée” de Marina Hands et Éric Ruf donnent-ils accès à la musicalité de la langue racinienne et claudélienne ? » L’« intimité » se révèle « extimité » sur scène et le premier terme apparaît comme le revers et l’envers du second. De facto, l’« intimité » est continuellement recherchée non seulement par Patrice Chéreau, mais aussi par Yves Beaunesne – qui se pose en héritier du premier – au point de constituer l’essence de leurs créations artistiques, aux côtés des acteurs avec lesquels ils travaillent. En effet, cette « intimité » qui devient « extimité » se doit de passer par les corps des comédiens, au service du texte mis en scène. Dès lors, l’union entre le corps et le texte dramaturgique apparaît cardinale.
120Pour tenter de démontrer tout cela, notre thèse de doctorat s’est composée de deux grandes parties. « L’intimité d’un corps-à-corps palimpseste comme voie d’accès à la musicalité de la langue » fait, par son intitulé, écho à Palimpsestes, essai de Gérard Genette dans lequel le théoricien témoigne du fait qu’un écrivain entend faire acte de mémoire en évoquant, dans un texte inédit, un texte préexistant1. En tant que metteurs en scène, Patrice Chéreau et Yves Beaunesne procèdent exactement de la même manière, car leurs créations se ressemblent et se nourrissent les unes les autres.
Le premier chapitre de cette partie liminaire a été dédié à la « problématique de la subjectivité », mise au jour par Patrice Chéreau dès ses premiers spectacles, car elle s’avère un terrain et un terreau fertiles pour l’intime. Dans un deuxième chapitre, nous avons, d’une part, abordé le huis clos secret des répétitions permettant à Patrice Chéreau de (re)chercher chez les acteurs leur intimité en vue de l’extérioriser au mieux et de raconter des histoires avec eux à destination d’un public. D’autre part, nous avons envisagé à quel point Yves Beaunesne se posait en héritier de Patrice Chéreau.
C’est pourquoi notre troisième chapitre a été consacré au théâtre de Marivaux et de Maurice Maeterlinck comme une confrontation entre l’intime et le langage. Devenue emblématique, la mise en scène de Patrice Chéreau de La Dispute de Marivaux a fortement influencé le travail d’Yves Beaunesne sur La Princesse Maleine de Maurice Maeterlinck.
Nous en sommes alors venue au cœur de cette première partie de thèse, à savoir le quatrième chapitre consacré à Phèdre de Jean Racine, selon Patrice Chéreau, et à Partage de midi de Paul Claudel, vu par Yves Beaunesne.
En ce qui concerne Patrice Chéreau, nous avons d’abord étudié ses mises en scène de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès et d’Hamlet de William Shakespeare, car sa version de Phèdre, annonciatrice de sa vision de l’opéra wagnérien Tristan und Isolde, était incompréhensible sans ces détours.
Quant à Yves Beaunesne, s’il a décidé de mettre en scène une œuvre de Paul Claudel, c’était pour mieux révéler Marina Hands et Éric Ruf, comédiens qu’il a préalablement admirés dans les rôles respectifs d’Aricie et d’Hippolyte, sous le regard de Patrice Chéreau. En l’occurrence, le film réalisé par Claude Mouriéras à partir de la distribution du spectacle 121beaunesnien a constitué la transition parfaite vers notre deuxième partie de thèse intitulée : « Le silence comme contrepoint ou la diction au service de la musicalité de la langue ». Un premier chapitre s’est attaché à considérer la lecture à voix haute comme une « ascèse de l’intime2 ». Les lectures de Marina Hands et d’Éric Ruf, d’une part, des trois scènes centrales de Partage de midi de Paul Claudel aux Rencontres de Brangues en 2007, et, d’autre part, de larges extraits de lettres, choisis dans le recueil édité en 2017 par Gérald Antoine, intitulé Lettres à Ysé, dans le cadre de la WEB-TV (instaurée au printemps 2020 par la Comédie-Française, « La Comédie Continue ! »), nous ont permis de proposer une analyse comparée de ces deux œuvres, constitutives d’une « littérature de l’intime3 ». Celle-ci atteint son apogée avec le « Cantique de Mesa », fortement lié, nous semble-t-il, aux Cantiques Spirituels de Jean Racine.
Dans un deuxième chapitre, nous avons envisagé en miroir la diction de Jacques Dacquemine (Hippolyte), Denise Noël (Aricie) et d’Edwige Feuillère (Ysé), dirigés par Jean-Louis Barrault (metteur en scène de Phèdre de Jean Racine et interprète de Mesa) avec celle d’Éric Ruf (Hippolyte et Mesa) et de Marina Hands (Aricie et Ysé), dans les versions scéniques de Patrice Chéreau et d’Yves Beaunesne.
Quant au troisième et ultime chapitre intitulé « Le rythme fugué adopté par Marina Hands et Éric Ruf », il a constitué le cœur de cette seconde partie de thèse, car nous y avons défini, après un bref historique des relations entre poésie et musique, comment et pourquoi le phrasé ou rythme phonatoire des deux acteurs pouvait être perçu comme une fugue, forme musicale aux effets singuliers en littérature.
*
* *
1 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, « Poétique », 1982, 480 p.
2 Valérie Nativel,« La représentation de l’intimité dans le travail de Patrice Chéreau 1982-2010 », thèse de doctorat en études théâtrales, Sorbonne nouvelle, Institut de recherches en études théâtrales (Gilles Declercq, directeur), Paris, 2012, p. 339.
3 Ibid., p. 345.