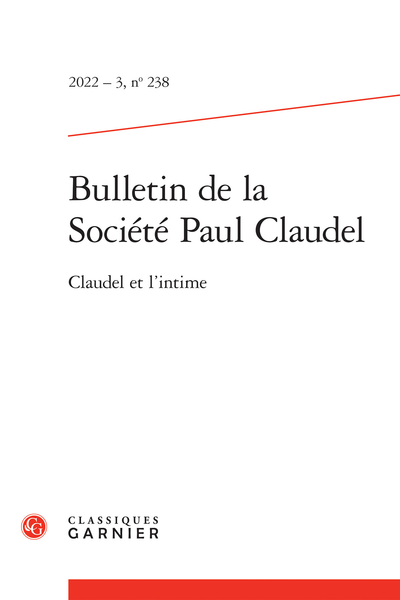
En marge des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
2022 – 3, n° 238. Claudel et l'intime - Auteurs : Wasserman (Michel), Pérez (Claude)
- Pages : 91 à 97
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406144557
- ISBN : 978-2-406-14455-7
- ISSN : 2262-3108
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14455-7.p.0091
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 28/12/2022
- Périodicité : Quadrimestrielle
- Langue : Français
Parution en version japonaise des Arches d’or de Paul Claudel. L’action culturelle de l’Ambassadeur de France au Japon et sa postérité de Michel Wasserman (Champion, 2020) aux éditions Suiseisha (avril 2022).
Voici donc un siècle que, le 19 novembre 1921, Claudel prenait son poste d’ambassadeur de France au Japon, prélude à une mission demeurée légendaire. L’ouvrage que nous avons publié en 2020 sur son action culturelle et ses remarquables développements vient de paraître en version japonaise. Il ne nous appartient certes pas, et je dirais même moins qu’à qui que ce soit, de revenir ici sur le livre lui-même. On renverra donc pour l’édition originale au compte rendu de Cécile Sakai (Bulletin no 231, 2020). Les circonstances de la parution de la version de l’ouvrage en langue japonaise nous paraissent toutefois mériter d’être signalées, du fait des propos liminaires et conclusifs que les deux traducteurs ont bien voulu rédiger, faisant de cette version un objet distinct de l’original, et singulièrement indicatif de l’héritage que l’« Ambassadeur-poète » (shijin taishi) a laissé dans le pays où, en cette année du centenaire de la prise de poste, il demeure plus que jamais un monument.
C’est par ailleurs grâce à ces deux traducteurs, et à leur relation privilégiée avec les archives liées à l’œuvre diplomatique de Claudel au Japon, que l’auteur a été à même d’écrire ce livre. Le Professeur Kôsuke Tsuiki, qui exerce à l’Institut de Recherche sur les Sciences humaines de l’Université de Kyoto, est en effet chargé d’un programme d’investigation sur l’apport de la France dans la construction de la modernité intellectuelle de l’ancienne capitale, et l’auteur, pourtant a priori bien armé en la matière, lui doit d’avoir eu accès à un remarquable complément de documentation sur l’Institut franco-japonais du Kansai puisé dans les archives diplomatiques françaises, littéralement labourées, à Nantes comme à La Courneuve, par l’une des doctorantes de M. Tsuiki. C’est par ailleurs au Professeur Nobutaka Miura, alors administrateur délégué de la Maison franco-japonaise (Tokyo), que l’auteur doit d’avoir eu accès aux archives du Bureau japonais de l’établissement (Cécile Sakai, alors responsable du Bureau français, lui ayant pour sa part ouvert les archives correspondantes). Faut-il dire que, sans la libéralité de ces diverses personnalités, le projet du livre n’aurait eu aucune chance d’aboutir.
92Le cent cinquantième anniversaire de la naissance de Claudel donna lieu à la Maison franco-japonaise à un symposium binational sur Claudel et le Japon qui se tint en novembre 2018. Invité par les organisateurs, du fait de ses responsabilités à la tête de l’établissement, à parler de Claudel en tant que fondateur d’institutions culturelles bilatérales, Nobutaka Miura eut pour conclure son intervention cette belle et saisissante formule : « nous sommes tous les petits-enfants de Claudel sans le savoir ». De fait, ni Miura, spécialiste de Valéry, ni Tsuiki, qui enseigne à l’université la pensée psychanalytique et pratique lui-même l’analyse en ville, ne sont à proprement parler des spécialistes de l’œuvre de Claudel. Mais l’apport du grand ambassadeur à la coopération bilatérale est telle que nul francisant japonais ne peut en réalité faire l’économie de Claudel, qui a tout initié. Miura rappelle ainsi dans sa préface que Claudel arrive en poste au Japon au lendemain de la Première Guerre mondiale, ayant reçu pour instruction du Quai de promouvoir par tous les moyens à sa portée la langue et la culture françaises face à l’influence allemande, qui demeure prédominante malgré la défaite du Reich.
Et tandis que le projet de Maison franco-japonaise, qui a préexisté à sa mission et dont on attend de lui à Paris qu’il le mène à bien, patine pour des raisons de politique générale sur lesquelles il n’a pas prise, Claudel ne cesse de se plaindre dans sa correspondance diplomatique depuis Tokyo du déficit, tant quantitatif que qualitatif, de notre emprise culturelle dans le pays. Le nombre des étudiants de français, il exagère à peine, serait « dans la proportion de 1 à 201 » avec celui des étudiants d’allemand, on n’enseigne que les rudiments de la langue, et par ailleurs nous manquons cruellement de japonisants français à même de travailler efficacement à la compréhension de ce pays qui domine alors l’Extrême-Orient. C’est dans ce contexte que Claudel, s’appuyant avec habileté et détermination sur de puissants mécènes francophiles à Tokyo (Eiichi Shibusawa) comme dans la région du Kansai (Katsutarô Inabata), va parvenir à retourner une situation compromise : en 1924 il procède à l’inauguration de la Maison franco-japonaise (Tokyo), et il jette les fondations statutaires d’un nouvel établissement, l’Institut franco-japonais du Kansai (Kyoto), à la veille de son départ pour Washington en février 1927 (l’établissement ouvrira ses portes en novembre). Dans une dépêche du 10 janvier 1927 que Miura cite en traduction dans sa préface, Claudel décrit la Maison franco-japonaise, centre de recherches sur l’Extrême-Orient, comme « un séminaire de hautes études où de 93jeunes savants [français] se forment à la connaissance approfondie des choses japonaises », et il assigne pour mission à l’Institut franco-japonais du Kansai, établissement d’enseignement et de diffusion culturelle, « la propagation de notre langue et l’initiation des jeunes [Japonais] aux idées françaises ». Prenant acte par ailleurs de la volonté d’un troisième mécène, le richissime fils de famille Jirôhachi Satsuma, de créer une résidence destinée aux étudiants japonais à la Cité universitaire de Paris qui ouvrira de fait ses portes en 1929, Claudel imagine pour l’établissement d’enseignement de Kyoto un cursus des plus ambitieux : ainsi informe-t-il le Quai en date du 14 octobre 1926 que « depuis le moment où la Maison franco-japonaise a été créée à Tokyo, je n’ai cessé de me préoccuper d’une fondation qui lui servirait de pendant à Kyoto. […] La nouvelle fondation fournira une base à l’édifice dont la Maison franco-japonaise de Tokyo sera le couronnement. Elle permettra de former une élite de jeunes [Japonais] dont les plus brillants seront envoyés à l’institution que M. Satsuma va fonder à Paris ».
Or c’est exactement ce qui est arrivé à nos deux traducteurs, comme à peu près à tout ce qui a compté depuis un siècle dans le domaine francisant au Japon : ayant satisfait aux épreuves du Concours des Bourses du Gouvernement français (créé en 1931) après avoir étudié en complément de leurs études universitaires japonaises à l’Institut de Kyoto pour Tsuiki, à celui de Tokyo (fondé en 1952 et lui aussi toujours en place) pour Miura, c’est ensuite en résidant dans l’établissement que Satsuma fit construire à Paris, ou Maison du Japon, qu’ils poursuivirent leurs études dans la capitale française. Comme ils ont par ailleurs la bonté de considérer que l’auteur (qui fut lui-même pensionnaire à la Maison franco-japonaise au début des années 80) compte parmi ces Français à même de travailler sur le Japon que Claudel appelait de ses vœux, ils estiment que nous sommes tous trois les héritiers, sinon les « produits » (sanbutsu) d’un système que Claudel se mit à même de réaliser en faisant appel à de grands mécènes francophiles, et qui survit miraculeusement cent ans après, de sorte que nous continuons à vivre sur l’acquis des réalisations de ces grands visionnaires des années vingt.
Les trois établissements sont en effet demeurés en fonction, fût-ce sur des sites qui se sont déplacés au cœur des villes et sous des formes architecturales qui ont évolué au cours du siècle. Seul l’étrange bâtiment éclectique conçu par Pierre Sardou pour la Maison du Japon de la Cité universitaire, qui soumet le béton aux formes improbables d’un château-fort japonais du temps des guerres féodales, est resté en place, tel 94quel. À Kyoto, tandis que le bâtiment originel en balcon sur la ville fut délaissé au cours des années trente pour rejoindre une localisation plus centrale et donc d’accès plus commode pour les usagers, une Médicis japonaise, la Villa Kujoyama, a ouvert ses portes en 1992 sur le site de l’ancien Institut, laissé à un lamentable abandon (le Quai avait fini par en perdre jusqu’au souvenir), et finalement détruit en 1981 devant les protestations des riverains qui en dénonçaient inlassablement le délabrement et la dangerosité. Il appartint à l’auteur, alors directeur de l’Institut franco-japonais du Kansai, de travailler au contenu programmatique du nouvel établissement. La Villa Kujoyama a donc célébré en mars-avril 2022 son trentième anniversaire par une exposition2 rétrospective sur le travail de ses résidents organisée pour partie dans ses murs, pour partie au Kyoto Art Center, superbe école primaire de style art déco, désaffectée au début de ce siècle du fait de la dépopulation des quartiers industriels et commerciaux du centre-ville, et métamorphosée en centre d’art contemporain. Claudel, qui pratiqua au Japon le métissage artistique en empruntant à la dramaturgie du kabuki (La Femme et son ombre) et aux prestiges de la calligraphie à l’encre de Chine et du haiku (Cent phrases pour éventails), eût sans aucun doute apprécié l’idée même d’une villa pour la création et la collaboration artistique dans une ville qu’il aima entre toutes. Sans doute eût-il admiré aussi le bâtiment ineffable que son concepteur, Kunio Katô, lui-même lauréat en 1959 du Concours des Bourses et auteur d’une thèse de doctorat sur l’architecture chez Valéry, voulut une métaphore de la relation bilatérale en unissant « dans un même espace architectural raison et délicatesse3 ». Sans doute Claudel eût-il aussi porté un jugement d’ensemble positif sur le travail des quelque quatre cents jeunes professionnels qui s’y sont d’ores et déjà succédés au terme d’une sélection exigeante.
Michel Wasserman
95*
* *
Compte rendu du colloque de Parme, Ergon ed energeia : Paul Claudel e altri scritti, dans La Torre di Babele, rivista di letteratura e linguistica (no 16, 2020, Université de Parme).
On sait que Claudel (son petit-fils, François, le rappelle précisément dans l’article qui termine ce volume) a eu des relations significatives avec l’Italie. Il y a notamment été en poste, en 1915-1916, en qualité d’attaché commercial, à un moment où les Français s’imaginaient pouvoir prendre dans le commerce de la péninsule la place prépondérante que les Allemands avaient occupée avant guerre ; et à un moment aussi où le conflit mondial montrait aux esprits lucides la nécessité d’une union des peuples d’Europe. Il a quitté le pays plus vite qu’il ne l’aurait souhaité, dès la fin de 1916, pour partir au Brésil, mais il est revenu par la suite, en diverses occasions, à Florence et à Rome.
Cependant, sa fortune littéraire et critique n’a jamais été très brillante de l’autre côté des Alpes, quoi qu’il ait parfois affirmé. Les Italiens catholiques ont en général soupçonné son orthodoxie ; et ceux qui se méfiaient de l’Église l’ont trouvé trop clérical.
Simonetta Valenti travaille assidûment à changer cet état de choses. Auteur d’un essai sur Claudel (Figures de la liberté dans le théâtre de Paul Claudel), traductrice du Soulier de Satin, du Partage de Midi, et tout récemment de Connaissance de l’Est, c’est elle qui a dirigé cet ouvrage, paru dans la revue de littérature et de linguistique de l’Université de Parme. Il réunit les actes d’une journée d’études organisée par elle, en 2018, à l’occasion du 150e anniversaire de Claudel.
L’ouvrage, au demeurant, exception faite pour l’article déjà mentionné, n’est nullement centré sur le ou les versants italiens du poète-ambassadeur. Et il réunit du reste des chercheurs venus de différents pays : Italie, France, États-Unis, Russie…
L’article de tête est celui de Dominique Millet-Gérard : « Poétique liturgique de Paul Claudel : la terre, les mots, le chant ». Le lien entre ces notions est indiqué par une citation de l’Art Poétique :« notre vie en Dieu sera comme un vers de la justesse la plus exquise ». L’auteur note avec justesse que le propos est réversible, et que le beau vers, le vers délectable aurait dit Claudel, est « un avant-goût, nécessairement 96imparfait, de paradis ». Éric Touya de Marenne revient lui sur la fameuse question « Qu’est-ce que cela veut dire ? » qui résume selon l’ancien auditeur des mardis, la poétique de Mallarmé. Touya de Marenne prend appui sur des philosophes d’aujourd’hui, qui ont en général renoncé à l’idée de finalité, si essentielle à Claudel : il suit que l’expression « fins du monde » a un sens tout différent chez les premiers et chez le second.
Françoise Dubor reprend la question du « Claudel cubiste ? » non pas à la façon d’Antoinette Weber-Caflisch qui la pose à propos du Soulier de Satin (et répond par l’affirmative) mais à propos d’une représentation de l’Annonce au théâtre Kamerny de Moscou, en 1920. Les illustrations jointes à l’article montrent le décor et les costumes, tout à fait inattendus. Le metteur en scène et le scénographe ont « considéré le cubisme comme le matériau qui permettait de présenter une intéressante et explicite stylisation du drame auquel ils s’étaient attachés ».
On ne quitte pas la Russie avec l’article suivant : « Claudel et Dostoïevski : questions de sotériologie ». On connaît l’importance de Dostoïevski pour Claudel et l’intérêt qu’il attachait à son esthétique, à sa manière de construire ses personnages. Mais Oksana Dubnyakova et Tatiana Kashina s’intéressent ici à des analogies d’ordre théologique entre Les Frères Karamazov et le Soulier :le salut est-il possible pour des pécheurs impénitents tels que Don Camille et Smerdiakov ?
Simonetta Valenti interroge quant à elle les « Chemins de la co-naissance du Divin » dans Connaissance de l’Est. Elle le fait en étudiant attentivement deux poèmes en prose du recueil : « Pagode » et « La Descente », et examine à leur propos la façon dont l’auteur confronte bouddhisme et christianisme.
Marie-Victoire Nantet étudie Le Jet de pierre, « série de petites scènes plastiques », disait l’auteur, écrites, ou plutôt inventées, ou rêvées, par lui en 1936 pour la belle Aliki Weiller et sa sœur Nada, et très rarement commentées. L’article en décrit finement les virtualités, sans dissimuler leur dimension énigmatique. Serait-ce une erreur de penser qu’elles ont quelque chose du Quad de Beckett, ou du moins sont avec les grandes pièces de Claudel dans un rapport analogue à celui que Quad et autres pièces pour la télévision entretiennent avec Godot ou Les Beaux jours.
Avant de se clore sur l’étude biographique – déjà citée – de François Claudel, le recueil fait place à un article, en langue italienne, d’Agnese Bezzera. Ces pages consacrées à « Paul Claudel e la biblioteca del castello di Brangues », rapportent quelques-unes des conclusions de l’excellente thèse que Mme Bezzera a soutenue au printemps dernier à l’Université 97de Parme. Cette « recherche action » n’a pas seulement permis de sauver des ouvrages menacés ; elle a aussi conduit à la découverte de documents inédits.
Une publication de ce travail serait bienvenue. Avec le présent volume de La Torre di Babele, cela pourrait témoigner d’un renouveau des études claudéliennes en Italie.
Claude-Pierre Pérez