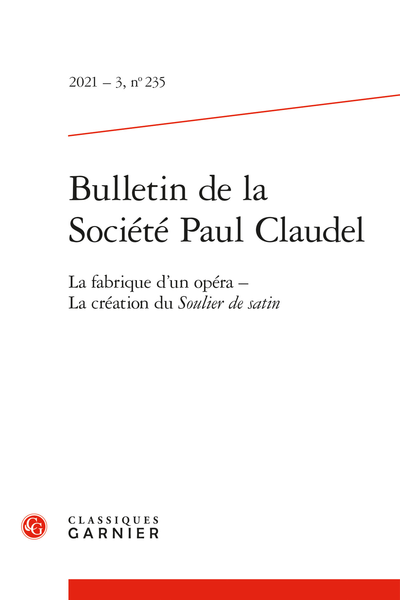
En marge des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
2021 – 3, n° 235. La fabrique d’un opéra – La création du Soulier de satin - Auteurs : Auzoux (Amélie), Mayaux (Catherine)
- Pages : 117 à 125
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406127116
- ISBN : 978-2-406-12711-6
- ISSN : 2262-3108
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12711-6.p.0117
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/12/2021
- Périodicité : Quadrimestrielle
- Langue : Français
Didier Alexandre (dir.), Paul Claudel, aujourd’hui, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Et si on (re)lisait Claudel aujourd’hui1 ? Pour ses presciences, ses mises en garde, ses visions d’apocalypse ? Pour la force du verbe ? L’acuité du regard ? Économie, écologie, politique, poétique, aucune des « sphères » du monde ne l’a laissé indifférent. Claudel qui confierait volontiers n’avoir été que « de passage » a profondément marqué les mondes littéraire, culturel, politique et idéologique de son temps. Mais que peut nous dire encore aujourd’hui cet homme né en 1868 ? Nous parle-t-il encore ? Aurait-il devancé, deviné ou même « annoncé » notre monde ? « J’ajoute que la lecture quotidienne du journal pour quelqu’un qui a connu le monde comme moi et qui a pratiqué la politique de tous les pays est d’un prodigieux intérêt. Il est passionnant de voir ainsi sur tout le front de l’univers avancer les lignes des événements », déclarait-il à Frédéric Lefèvre en avril 1925.
Interroger la « contemporanéité » de Claudel en multipliant les centres d’observation, en décentrant le regard, sans verser dans l’examen rétrospectif de l’œuvre, tel est l’objectif de cet ambitieux volume qui rassemble les actes des colloques commémoratifs du cent cinquantième anniversaire de sa naissance qui se sont tenus à Paris, à Chicago et à Tokyo en 2018. New York, Boston, Shangaï, Hankéou, Fou-Tchéou, Rio, Prague, Francfort, Hambourg, Copenhague, Rome, la liste est longue des villes étrangères où Claudel, reçu en 1890 au concours des Affaires étrangères, exerça ses fonctions. Ambassadeur de France au Japon (1921-1927), puis aux États-Unis (1927-1933), avant d’achever sa carrière diplomatique à Bruxelles (1933-1935), Claudel fut bien un homme du « monde entier ». Quelle empreinte l’écrivain, poète, diplomate et dramaturge a-t-il laissée sur le monde d’aujourd’hui ? L’ensemble des actes rassemblés par Didier Alexandre en prend, avec force et précision, la mesure.
Loin de rejouer la partition nationale de l’hymne, familière aux actes commémoratifs, ce volume offre un concert de voix, une « conversation » plurielle et internationale qui (s’)interroge – « Claudel, est-il encore lisible 118aujourd’hui ? Encore acceptable, encore parlant, encore présent pour nous ? » (Pascal Dethurens, p. 42) –, admet la dissonance, en particulier sur les limites du mondialisme claudélien au Japon, et n’arrête pas le sens d’une œuvre dont on a trop souvent lissé la complexité, « le monde de Claudel est un mais les visages de Claudel sont nombreux », souligne Didier Alexandre (p. 9), sa « personnalité multiforme », ajoute Dominique Millet-Gérard (p. 53). « Si Claudel fait partie de notre patrimoine, de quel Claudel parlons-nous ? » (p. 9). Du « poète diplomate » ayant traversé plusieurs continents et situé son œuvre sur la scène du « monde » ? Du « barbare chrétien », pour qui demeure cet « outre monde » au-delà de l’Ancien et du Nouveau monde ? Du « classique moderne », dont les révolutions esthétiques révèrent la tradition antique ?
Universitaires français, américains, chinois et japonais, mais aussi hommes de théâtre, interrogent aujourd’hui l’héritage de Claudel offrant ces « regards croisés » qui organisent le volume : « Claudel contemporain », « The World is one », « Claudel et ses contemporains », « Claudel, notre contemporain ».
Que signifie « Claudel contemporain » ? Dans ce premier ensemble, Jean-Luc Marion et Thomas Pavel apportent des éléments de réponse à travers l’œuvre de cet écrivain qui se voulait volontiers « inactuel » comme le rappelle Dominique Millet-Gérard. Reprenant l’essai de Giorgio Agamben (Qu’est-ce que le contemporain ?) – « peut se dire contemporain celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elles la part de l’ombre » –, Pascal Dethurens questionne la contemporanéité de Claudel qui, débarrassé « d’une vision nostalgique pour s’inscrire dans une vision projective du temps », reçoit l’épithète honorable – et engageante – du « contemporain » qui « voi[t] en avant », « voi[t] avant », « prévoi[t] même » (p. 48) : « Dans un wagon, il y a la banquette avant et la banquette arrière ; il y a des gens qui regardent le passé qui s’éloigne, les autres qui regardent le futur qui arrive ; eh ben [sic], à un moment, j’ai changé de banquette si vous voulez ; de la banquette arrière, j’ai passé à la banquette avant » (Mémoires improvisés).
Le monde mondialisé, « The World is one », tel est « monde maintenant total » (Cinq Grandes Odes), dont le poète diplomate est le « contemporain » aux lendemains de la Première Guerre mondiale comme l’analysent Pierre Brunel et Claude-Pierre Pérez. Pour Yvan Daniel, l’œuvre de l’écrivain offre ces « anticipations [qui] regardent directement certaines des grandes questions qui occupent aujourd’hui 119le xxie siècle : la mondialisation économique et culturelle, le développement politique, commercial et industriel des anciennes colonies ou “hypocolonies” (en Amérique ou en Asie), ou encore les conséquences de la crise écologique » (p. 262). Avec sa préhension économique et géopolitique mondiale, Claudel pense également la culture et la littérature à l’échelle du monde. Rares sont les contemporains qui ont ainsi participé, avec cette conscience – catholique – de l’univers, à la réévaluation des espaces extra-européens. « Il n’y a plus maintenant une partie du monde qui soit étrangère aux autres. Actuellement, un Français peut dire comme Mme de Sévigné qui disait à sa fille qu’elle avait mal à la gorge, eh bien, un Français a mal à la Corée, il a mal à la Palestine, il a mal à toutes les parties du monde dans lesquelles il se produit quelque chose [parce qu’]il se rend compte qu’il y a une étroite communion de l’une à l’autre » (Mémoires improvisés). Cette sensibilité au « grand corps du monde » est aussi abordée par Michel Jarrety interrogeant les convergences et les divergences de « l’idée » projective « d’Europe » chez Claudel et Valéry.
Le troisième volet de ce volume questionne le rapport de Claudel à ses contemporains. « Pendant laïc du bréviaire » (p. 183), selon l’expression de Catherine Mayaux, la lecture du journal quotidien ancre profondément l’écrivain dans son siècle : « chaque matin, le journal nous donne la physionomie de la terre, l’état de la politique, le bilan des échanges. Nous possédons le présent dans sa totalité, tout l’ouvrage se fait sous nos yeux ; toute la ligne du futur apparaît sur le rouleau d’impression qui l’attire » (Art poétique). Alors que Michel Jarrety étudie l’amitié « incertaine » entre Claudel et Valéry, Anne Verdure-Mary analyse la réception de l’œuvre claudélienne par le critique catholique Gabriel Marcel. En partant du wagnérisme de l’écrivain, Marie Gaboriaud interroge les « contacts » de Claudel, « mélomane mais non musicien » (p. 221), avec la musique de son temps. Venant décentrer ce regard français, l’article de Ayako Nishino aborde la réception de Claudel auprès de ses contemporains japonais. Le séjour japonais de Claudel est aussi au cœur de l’interculturalité de son théâtre comme l’analyse Pascale Alexandre-Bergues à travers l’influence du théâtre Nô. Sur cette question, Michel Wasserman n’hésite pas à parler de « métissage » artistique (« Le Japon, une ambassade mythique et fondatrice »).
Dans un quatrième et dernier ensemble, « Claudel, notre contemporain », Lionel Cuillé et Éric Touya de Marenne hissent l’écrivain diplomate à la hauteur des enjeux de notre siècle : « dans quelle mesure 120les questions que Claudel pose à son époque peuvent nourrir nos réflexions face aux problèmes actuels et futurs du xxie siècle liés aux crises politiques, économiques, et environnementales contemporaines, dans le contexte de ce que nous appelons la mondialisation ? » (É. Touya de Marenne, p. 363). « J’ai toujours eu, dans ma carrière, soit littéraire ou diplomatique ou positive, de l’intérêt à ce qui arrive. […] J’ai essayé de comprendre tous les pays qui m’étaient amenés du fond du futur, ce qu’ils pouvaient avoir de nouveau, la leçon qu’ils me donnaient, les connaissances nouvelles qu’ils me procuraient », déclarait Claudel à Jean Amrouche (Mémoires improvisés). Est-ce à dire que l’œuvre claudélienne nous livre, aujourd’hui, sa « leçon » ? À la suite de Lionel Cuillé qui évoque Claudel, familier de l’exégèse biblique, comme « un technophile apocalyptique et un technophobe providentialiste » (p. 362), Éric Touya de Marenne offre la réponse claudélienne aux défis de notre temps : une réconciliation de l’humanité avec la Création : « Claudel vient nous rappeler ce que le monde moderne semble oublier : l’homme n’est pas et ne saurait être le maître de la création » (p. 373). Et Claudel de s’adresser, par-dessus les années, aux lecteurs d’aujourd’hui : « La mécanique a tout remplacé. Maintenant, une vache est un laboratoire vivant qu’on nourrit par un bout, et qu’on trait, à l’électricité, par l’autre. Le cochon est un produit sélectionné qui fournit une grande quantité de lard conforme au standard. La poule errante et aventureuse est incarcérée et gavée scientifiquement. Sa ponte est devenue mathématique. Sont-ce encore des animaux, des créatures de Dieu, des frères et des sœurs de l’homme, des significations de la Sagesse divine, que l’on doit traiter avec respect ? » (Au milieu des vitraux de l’Apocalypse). Claudel, héraut de la cause animale ? Reste le domaine du théâtre que ce dernier volet interroge autour d’une table ronde animée par Florence Naugrette avec les metteurs en scène et acteurs Yves Beaunesne, Daniel Mesguich, Éric Ruf et Christian Schiaretti révélant la dette plus ou moins avouée du théâtre d’aujourd’hui à un auteur révolutionnaire trop souvent rangé « sous la cloche des calotins » (p. 471). Le « tribut est immense » (p. 389), déclare le metteur en scène Yves Beaunesne. En mai 2021, la création mondiale d’un opéra tiré du Soulier de Satin est programmée à l’Opéra Bastille.
Ayant suscité la vindicte des maurrassiens comme des surréalistes, avant d’occuper les doubles-pages des manuels d’histoire littéraire, Paul Claudel fait encore parler aujourd’hui. Résolument, ces « conversations », poursuivies entre Paris, Tokyo et Chicago, attestent de la présence vivante 121et mondiale de l’écrivain. Aujourd’hui, l’œuvre du « poète diplomate » a bien une postérité. Il est encore temps de (re)lire Claudel.
Amélie Auzoux
Sorbonne Université
*
* *
Pascal Lécroart et Dominique Millet-Gérard (dir.), « L’avènement d’un art nouveau ». Essaimage esthétique et spirituel de l’œuvre de Paul Claudel, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2021.
Pascal Lécroart et Dominique Millet-Gérard publient aux Presses Universitaires de Franche-Comté un volume collectif d’une excellente tenue2. Il est le fruit du colloque qu’ils avaient organisé à la Villa Finaly à Florence en décembre 2018 dans le cadre de l’année commémorative de la naissance de Paul Claudel. Un équilibre de bon aloi a été recherché pour faire converger les recherches de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés, de chercheurs français et étrangers (États-Unis, Russie, Japon, Allemagne, Pologne), spécialistes de Claudel ou excellents lecteurs de cette œuvre.
L’objet de recherche, excellemment choisi, visait à examiner comment et avec quelle ampleur Claudel renouvelle les formes d’art qu’il aborde ou pratique en littérature et dans d’autres arts, au point de stimuler metteurs en scène, peintres, traducteurs, musiciens… à renouveler le leur. C’est la fabuleuse créativité de Claudel qui est envisagée sous l’angle de son ensemencement à travers le temps et l’espace. Aussi faut-il dépasser le malentendu que peut susciter une lecture trop rapide du titre : « l’art nouveau » ne renvoie pas ici au « mouvement qui se développa dans les arts décoratifs au tournant des xixe et xxe siècles », mais à la capacité 122de Claudel « à constamment surprendre », à cette « sorte d’“avènement perpétuel” qu’est son œuvre » comme l’expliquent clairement les premières lignes de l’avant-propos de l’ouvrage.
Les études ont été regroupées en six chapitres de deux à trois textes chacun qui déploient en éventail les différents terrains de réflexion, selon un parcours clair et cohérent. Il va de la contextualisation des premières œuvres de Claudel au début du siècle, de ses liens avec les artistes peintres, dessinateurs et compositeurs, au renouvellement des formes par son expérience de l’Extrême-Orient. Il élargit l’étude du double essaimage, spirituel et géographique, aux dramaturgies et traductions étrangères. Odile Hamot et Graciane Laussucq-Dhiriart apportent au seuil du livre un éclairage historique bienvenu. La première resitue l’impression d’étrangeté ressentie par les lecteurs des années 1900 qui découvrent les poètes nouveaux que sont Claudel et Saint-Pol Roux, à la lumière de l’article que Camille Mauclair publia dans La Revue les 15 septembre et 1er octobre 1901. Ouvrant le compas aux années 1850-1950, Graciane Laussucq-Dhiriart montre que Claudel ne s’inscrit que très tangentiellement dans la mouvance du « renouveau catholique », alors même qu’il appelle de ses vœux le rapprochement du théâtre moderne et de la foi. Mais il se dérobe à toute inféodation à ce nouvel art catholique que prônent certains catholiques intransigeants.
Au chapitre deux, Madeleine Achard analyse la manière dont Claudel spiritualise certains tableaux, notamment dans le commentaire qu’il fait de la Danaé du Titien dans « La Peinture espagnole », ou encore de l’Adam et Ève du même peintre dans Au milieu des vitraux de l’Apocalypse : dans les deux cas, le commentateur procède à une opération de « volatilisation » du corps nu de la femme qui est transfiguré en matière poétique et spirituelle. Si, selon le poète, la peinture romantique et moderne réduit les corps à une masse amorphe et mortifère, à l’instar du Bain turc d’Ingres ou de La Mort de Sardanapale de Delacroix, la chair habitée par la présence d’anima de la peinture de la Contre-Réforme convertit la dimension sexuelle en élan spirituel et esthétique de l’ascèse charnelle. Nous renvoyons le lecteur à la magnifique conclusion de cette étude (p. 58-59) qui consonne en profondeur avec bien des textes claudéliens. Pascal Lécroart, dont on connaît les excellents travaux sur les liens de Claudel avec la musique et les compositeurs, relève le défi de montrer qu’il y a chez Claudel d’autres nouveautés encore que celles nées de ses collaborations – entre autres – avec Honegger et Milhaud : ce sont les « musiques du monde ». Il les découvrit (peut-être grâce à Debussy) au moment de l’Exposition de Paris de 1889, et par ses expériences des 123théâtres chinois et japonais. Son ouverture d’esprit permet à Claudel de réserver « un large accueil à tous les phénomènes sonores » et, premier de tous, il en fait un usage dramatique propre à « constituer un univers sonore entre musique, voix et bruits tout à fait saisissant » (p. 66). Nina Hellerstein approfondit son travail sur la collaboration entre Claudel et Jean Charlot qui devait illustrer une édition d’Au milieu des Vitraux de l’Apocalypse visant à marier le verbe à la forme plastique. Les archives de cette collaboration restée inaboutie permettent de comprendre en profondeur la conception – ou philosophie – du livre selon Claudel lorsque texte et image concourent ensemble à une saisie de la réalité, à une expérience « plus authentique et immédiate ». L’étude est agrémentée de six illustrations inédites, drôles et réjouissantes, qui confortent l’analyse.
Une autre porosité féconde est celle placée sous le signe de l’ailleurs et de la réalité du monde de la nature au chapitre trois. Shinobu Chujo reprend minutieusement deux exemples de « co-naissance », poème ou drame, co-créés par la rencontre avec le Japon. Claudel retient de sa découverte de la poésie japonaise comme du nô, la « signification occulte » qui donnera lieu sous sa plume à une nouvelle forme de poésie marquée par d’étonnants dispositifs visuels ainsi qu’à des oratorios dramatiques fruits d’une appropriation personnelle de l’esthétique japonaise. C’est au « discours sans mots », selon la formule de Cébès dans Tête d’Or, qu’Yvan Daniel consacre son étude sur la langue de la nature chez Claudel à partir de l’expérience extrême-orientale. Si la démonstration dans son ensemble convainc aisément d’un discours de la nature qui parle à l’intelligence sensible par-delà la raison et que capte le poète, le lecteur s’interroge sur le sens de la majuscule à Nature employée par le critique là où elle ne figure pas dans les citations proposées de Claudel ; et l’idée finale de « l’originalité de la langue claudélienne, marquée par des effets de naturels qui sont aussi des effets de nature » mériterait très certainement d’être explorée plus avant tant elle paraît fructueuse : à quelle condition et de quelle manière la poésie (celle de Claudel ou d’autres poètes) peut-elle produire, suggérer ou être un « discours sans mots » ?
Avec un beau sens de la circonstance, Dominique Millet-Gérard étudie au début du chapitre quatre (« Renouvellements et essaimages spirituels ») le texte de la conférence que Claudel prononça à Florence en 1925 au cours de l’année de césure entre ses deux séjours au Japon : « La philosophie [ou : physiologie] du Livre ». Il y opère la synthèse heureuse des cultures occidentale et extrême-orientale et expose sa conception d’une modernité fondée sur la continuité et non sur la rupture : 124« Toujours [Claudel] est soucieux, à l’enseigne doublement biblique des Nova et Vetera [Cant. 7, 13 et Matth. 13, 52] d’inscrire le nouveau dans le sillage de l’ancien, de présenter l’évolution esthétique comme une progression organique, un enrichissement de l’intérieur, le fruit d’une méditation inclusive et non point exclusive des grandeurs du passé […] » (p. 132). L’art nouveau concentre donc jusque dans la matérialité du Livre la haute pensée issue conjointement de « la sagesse millénaire de l’Extrême-Orient et [d]es splendeurs de l’art chrétien » (p. 133). Cette pensée spirituelle de Claudel irrigue celle du poète et penseur russe contemporain, Viatchéslav Ivanov, traducteur d’Eschyle lui aussi, et qui séjourna en Italie de 1924 à sa mort en 1949. Maria Cymborska Leboda montre combien la « Parabole d’Animus et d’Anima » dont le poète russe fit sans doute lecture dans son exemplaire de Prière et Poésie d’Henri Bremond, « devient un élément de sa conscience créatrice » au point que trois de ses articles en proposent une exégèse à chaque fois renouvelée, et qu’elle joua un rôle prépondérant dans sa réflexion sur la personne humaine et la métaphysique de l’âme humaine.
Dans le dernier chapitre consacré aux « Essaimages géographiques d’un nouvel art théâtral », Elena Galtsova resitue l’influence de Claudel sur metteurs en scène et traducteurs dans le contexte des années 20, avant que commence la « destruction massive par la politique culturelle soviétique ». Elle retrace précisément l’histoire de la traduction inaccomplie et inédite de Guéorgui Chenguéli dont une seule version a été retrouvée à ce jour, traduction entreprise en pleine guerre civile comme « une sorte de refuge intellectuel » (p. 163), au moment où Chenguéli écrivait lui-même des pièces et poèmes dramatiques. Inna Nekrassova de son côté décrit deux mises en scène originales de L’Annonce faite à Marie, réalisées en 2003 en Biélorussie et en 2017 en Lituanie, pays désormais dégagés de l’orbite soviétique. Dans un cas comme dans l’autre, les metteurs en scène puisent surtout « dans l’arsenal de la culture nationale et dans le domaine de la musique » pour familiariser le public contemporain avec les textes de Claudel, révélant la plasticité de son œuvre susceptible d’une approche renouvelée.
Le travail de Volker Kapp conclut tout ensemble le chapitre et le livre en apportant une nuance à l’idée d’une possible modernisation à tout crin d’une œuvre irréductible. Il livre en effet une étude différenciée des deux traductions allemandes du Soulier de satin, celle de Hans Urs von Balthasar de 1939 et celle réalisée en 2003 par le suisse Herbert Meier, influencé au demeurant par Balthasar qui fut aumônier de l’Université 125de Bâle où il était étudiant. L’étude de Volker Kapp, précise et pleine de délicatesse, fait nettement pencher la balance en faveur de la traduction du théologien qui ne visait pas, comme le voulait le directeur du théâtre de Bâle, Stefan Bachmann, à proposer « une version plus accessible aux contemporains grâce à l’utilisation d’un langage moderne » (p. 183), mais au contraire à rester « plus proche de l’original français » (p. 187).
Catherine Mayaux
1 Paul Claudel, aujourd’hui, sous la direction de Didier Alexandre, Classiques Garnier, 2021, 504 pages. Actes des colloques commémoratifs du cent cinquantième anniversaire de la naissance de Paul Claudel, qui se sont tenus à Paris, à Chicago et à Tokyo en 2018.
2 Sous la direction de Pascal Lécroart et Dominique Millet-Gérard, Presses Universitaires de Franche-Comté, Série « Centre Jacques-Petit », janvier 2021, 200 pages.