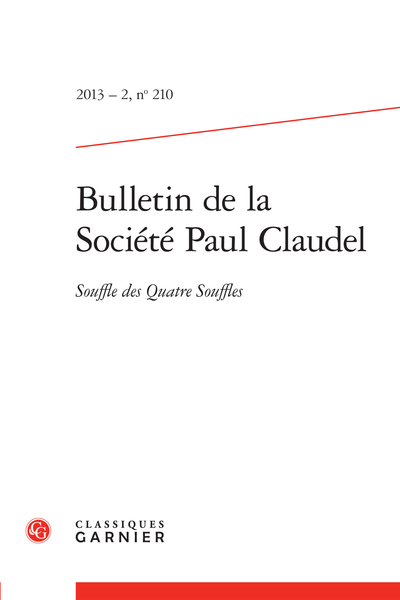
En marge des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
2013 – 2, n° 210. Souffle des Quatre Souffles - Auteurs : Barbier (Christèle), Angelier (François), Benoteau-Alexandre (Marie-Ève), Dubar (Monique)
- Pages : 67 à 88
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812413322
- ISBN : 978-2-8124-1332-2
- ISSN : 2262-3108
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1332-2.p.0067
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/08/2013
- Périodicité : Quadrimestrielle
- Langue : Français
Simonetta Valenti, Figures de la liberté dans le théâtre de Paul Claudel, Aoste, Le Château Edizioni, 2012
Simonetta Valenti, spécialiste du symbolisme et traductrice en italien de Partage de midi en 2008, et du Soulier de satin en 2011, nous offre dans son dernier ouvrage une étude thématique d’inspiration chrétienne sur la liberté dans le théâtre de Claudel.
Dans son introduction, elle rappelle l’historique de la réception de Claudel, et les lieux communs souvent attachés au nom du dramaturge qui ont contribué à le cataloguer en Italie comme auteur secondaire. Le thème de la liberté, entendue comme liberté d’accepter le Divin, ou lieu de la relation entre l’homme et Dieu, est pressenti comme un noyau herméneutique fondamental dans l’œuvre. Plaçant la conversion au cœur de l’expérience biographique et artistique de Paul Claudel, l’auteur propose de revisiter ses drames majeurs à travers le philtre thématique de la liberté pour saisir le dessein et la cohérence de l’œuvre sous la lumière des apports les plus récents de la critique claudélienne et de l’étude du contexte historique et littéraire. Simonetta Valenti détaille en trois parties ce jeu de la liberté des personnages dans leur rapport à la Transcendance qui fait d’eux des représentants, ou icônes, des différentes attitudes de l’humanité face au Divin, elle présente successivement les figures du refus, de l’accueil et de l’abandon avec de larges citations du théâtre claudélien dont elle donne des analyses de détail sur les images et le style.
Simonetta Valenti définit le mot « liberté » chez Claudel, associé à celui de « délivrance » dans les contextes spirituels, comme libre-arbitre qui s’exerce pour accueillir Dieu ou Le refuser dans une optique où la liberté s’exprime par l’action de la volonté humaine. Les figures du refus sont autant de personnages qui posent le choix de refuser le Divin dans un geste d’affirmation de soi qui est aussi négation de l’altérité et rejet d’une libération possible. Ce sont des figures de la rébellion métaphysique contre la finitude humaine dont Tête d’Or est l’emblème. La négation de l’existence de Dieu et l’exaltation de l’homme sont resituées dans l’atmosphère symboliste fin-de-siècle pour La Ville, pièce dans laquelle tout est détruit en vue d’une société plus équitable avec une liberté choisie et vécue dans le refus de Dieu. Don Camille dans Le Soulier de
satin, figure de la solitude et du blasphème, est aussi analysé comme une image de l’homme moderne retranché dans son refus délibéré de Dieu. Mara, dans L’Annonce faite à Marie, quant à elle, est une figure de la rébellion diabolique, un emblème du libre-arbitre qui, ayant refusé de reconnaître la souveraineté divine, s’abandonne aux mouvements les plus instinctifs de l’humanité. Don Pélage, dans Le Soulier de satin, sous un aspect de droiture, emploie sa liberté pour nier Dieu et se substituer à Lui en décidant du sort des autres personnages. Turelure, dans L’Otage, est décrit comme un opportuniste qui se sert de tout pour affirmer sa propre liberté et exalter sa personnalité, comme Amalric dans Partage de midi qui représente la figure de l’aventurier ou du conquérant. Enfin Louis Laine, dans L’Échange, incarne la tentation du naturel et du rêve, chimères qui le conduisent à sa perte. À travers les images employées par ces personnages et leur imaginaire, l’auteur répertorie les diversités du refus de Dieu et les multiples enjeux psychologiques, éthiques, philosophiques, historiques qu’ils recouvrent sous des traits différents. Pour l’auteur, le sens des drames vise à montrer que là où la liberté de l’homme nie toute transcendance, le destin de l’être humain se trouve marqué par sa fragilité constitutive, et que le rejet du Divin conduit les personnages à leur perte.
Les figures de l’accueil sont incarnées par des couples dont la liberté s’exprime en un choix qui transforme complètement leur vie, choix qui apporte avec la souffrance la délivrance, au terme d’une conversion intérieure et d’un itinéraire de découverte du Divin. Le Soulier de satin est longuement commenté comme œuvre qui met en scène deux figures archétypales du libre-arbitre conçu comme choix de la rencontre avec Dieu. Attiré au départ par la violence de la conquête et l’attrait du Nouveau Monde, Rodrigue convertit son désir pour accepter une mission catholique : réunir la Terre. Il choisit la voie du renoncement, et risque sa liberté pour entreprendre l’itinéraire d’acceptation de Dieu qui le conduit à la délivrance. L’abaissement final du personnage scelle la parabole existentielle de Rodrigue perçu comme un antihéros moderne. Prouhèze, par la logique du don de soi, conduit Rodrigue au Salut et devient pour le personnage source de la joie profonde qui jaillit de la délivrance. Dans Partage de midi, le couple formé par Mesa et Ysé, dans la dynamique du sacrifice, subit une transformation radicale, à la crise d’identité initiale des personnages, succède la découverte de l’altérité et la conversion intérieure qui renouvelle leur existence dans la rencontre avec Dieu. L’auteur évoque ensuite la conversion de Pensée dans Le Père
humilié, et la mort d’Orian qui fait de lui une figure christique. Dans L’Otage, le personnage de Sygne de Coûfontaine apparaît comme une figure ambigüe et complexe : elle a certains traits des héroïnes de chemin de conversion, mais aussi ceux de personnages dont la foi est inscrite dans la conscience et détermine le comportement. Sans atteindre au renoncement des figures de l’abandon, elle incarne la fidélité bien que son sacrifice soit marqué du sceau de l’ambiguïté : son geste semble absurde dans une pièce fermée à toute forme de délivrance ou de Rédemption. La notion de couple est dans cette partie analysée comme un avatar du thème du double chez Claudel, l’intérêt du dramaturge se focalise sur la relation d’amour qu’il investit d’une valeur rédemptrice en se positionnant aussi face aux acceptions artistiques contemporaines de la liberté et de l’amour.
Enfin Simonetta Valenti répertorie les figures de l’abandon, personnages qui adhèrent de façon libre et immédiate à l’appel du Divin, et qui acceptent le sacrifice et la souffrance qui les transforment en figures christiques. Violaine dans L’Annonce faite à Marie se transfigure par l’action de la douleur, l’Empereur dans Le Repos du Septième jour, transposition de la parabole christique dans le contexte culturel chinois, se sacrifie pour son peuple, Jeanne dans Jeanne au bûcher présente une synthèse entre la figure du Christ incarné par l’Empereur et l’icône du martyr chrétien personnifié par Violaine. Ces trois personnages sont analysés comme des icônes de la liberté, grâce à leur confiance, ils deviennent des instruments du Salut et permettent une forme d’accomplissement de l’accueil de Dieu autour d’eux. Ils diffusent la joie de la délivrance et emblématisent la dynamique spirituelle chrétienne. Dans ces trois pièces, Claudel réactualise la parabole accomplie par le Christ dans l’Histoire pour montrer le chemin de libération qui s’offre à ceux qui accueillent Dieu.
En conclusion, l’auteur définit la joie et le sacrifice représentés dans le théâtre claudélien comme deux faces de la liberté humaine, entendue comme adhésion à Dieu, et acceptation d’être créature. Elle souligne que l’aspiration à l’absolu et à la rencontre avec le Divin dans le théâtre de Claudel est le signe que la conversion est au centre d’une œuvre qui répond aux doutes et aux réalités de l’histoire contemporaine, ainsi son étude permet de réancrer Claudel pleinement dans son époque dont il connaît, et fait siennes, les sollicitations fondamentales.
Christèle Barbier
Romain Rolland, Journal de Vézelay – 1938-1944, annoté par Jean Lacoste, Paris, Bartillat, 2013, 1182 p.
Les mille pages inédites du Journal de Vézelay – 1938-1944 de Romain Rolland que publient, dans une remarquable édition du philosophe et germaniste Jean Lacoste, les éditions Bartillat sont une parution déterminante. Et ce, pour trois raisons. La première est qu’elles offrent un témoignage de première main sur la vie intellectuelle sous l’Occupation (portraits précis et fervents aussi bien de Paul Éluard que d’Alphonse de Chateaubriand, de Georges Bataille que de Louis Aragon ; évocation de la vie éditoriale en France occupée, du milieu de la Collaboration intellectuelle et de la Résistance ; peinture des souffrances de la vie quotidienne, parisienne et provinciale). La seconde est qu’elles proposent une vision passionnante de cette époque, vision à la fois ardente et pondérée d’un Prix Nobel (1915) au crépuscule de sa vie (il meurt le 30 décembre 1944), à la fois engagé politiquement (compagnon de route du PCF), investi dans une quête spirituelle non-dogmatique où se mêlent sagesses orientales et religions occidentales et dégagé de tout réflexe idéologique. La troisième raison nous touche directement : ce Journal de Vézelay prend rang désormais, par sa ferveur lucide et sa précision amicale, parmi les meilleurs témoignages et portraits de Paul Claudel. On a là, sur le Claudel de l’Occupation, toujours brocardé pour son pétainisme sonore et sa frilosité d’actionnaire, un portrait essentiel qui devrait pulvériser (mais ne rêvons pas) cette inoxydable caricature (dont j’ai d’ailleurs dû subir une présentation, récemment, face à des enseignants et libraires).
Détaillons. Romain Rolland et Paul Claudel, s’ils ont respectivement, à l’époque de ce journal, 72 et 70 ans, se connaissent depuis longtemps : condisciples à Louis-le-Grand de 1882 à 1885 ; passionnés, Claudel de poésie (Rimbaud et Mallarmé), Rolland de théâtre et de philosophie, ils y suivent l’enseignement de Burdeau et subissent la pesante férule positiviste. Les réussites universitaires et les moments-clé de leurs vies sépareront les deux hommes : le normalien Rolland adhèrera au Credo quia verum de Spinoza ; on sait ce qui se produira, à la Noël de 1886, pour l’élève de sciences-po Claudel. Leur ultime rencontre se fera à l’occasion d’une exécution de la Missa Solemnis de Beethoven, leur fascination commune. Chacun suivra ensuite une voie bien différente de l’autre. L’« absent professionnel » Claudel randonnera de par le monde, de poste en poste, de Rio à Tokyo, devenant une pierre d’angle du catholicisme intellectuel ; Rolland, devenu agrégé d’histoire, proche de
Péguy (le sujet de son dernier livre), accèdera à la célébrité avec Jean-Christophe et Au-dessus de la mêlée, devenant l’homme du pacifisme, de l’internationalisme, et de la fraternité communiste. Bien loin de Claudel, désormais. C’est à Marie Romain-Rolland, épouse de l’écrivain, que les deux hommes devront de se retrouver. En 1939, cette dernière, d’origine russe, liée au milieu blanc par sa vie familiale et aux cercles communistes par ses amitiés intellectuelles, s’avère violemment marquée par le pacte germano-soviétique. S’éloignant dès lors de l’idéologie communiste, elle souhaite se rapprocher d’un catholicisme dont la lecture des Cinq grandes odes semble lui ouvrir la porte. Elle devient dès lors, une « dirigée » de Paul Claudel qui assiste, avec le père Paillerets, à son abjuration en décembre 1940. Durant l’Occupation, on la verra veiller avec une énergie indomptable au calme et au quotidien de son époux malade et sans cesse sollicité.
Ce journal dense et méticuleux offre donc l’histoire d’une amitié refondée et d’une nouvelle approche, faite de souvenirs et de distance objective. Quand Claudel réapparaît, avant le ralliement catholique de sa femme, dans le champ intellectuel de Rolland la réaction n’est guère positive. Entendu à Radio-Strasbourg en mars 1939 par l’auteur de L’Âme enchantée, Claudel déçoit : « sa voix ne correspond nullement à ses poèmes – ni au souvenir que j’ai gardé du bouillant adolescent que j’ai connu. Elle évoque un vieux bourgeois triste et paisible… » (p. 187) ; à la Pâques de la même année 39, Claudel figure parmi les « pieuses éjaculations » qui poissent les ondes radio (p. 197) ; un peu plus loin dans l’année, Claudel devient l’un des « plus obtus des fanatiques cléricaux ». Néanmoins, des poèmes de Claudel lus par sa femme, Rolland goûte « la grande beauté ». Un premier portrait, émané des propos de Marie qui l’a vu à Paris, nous présente un Claudel « petit, gros, vieux, malade », mais « de franche gaîté » ; la littérature théologique du poète rebutant par ailleurs toujours autant son ancien condisciple des années 1880, « farcies de bouffonneries et de sarcasmes injurieux ». Deux premières lettres, amicales, semblent clarifier les rapports et ressouder les liens. Mais c’est la rencontre amicale, le 16 mars 1940, à une table gastronomique non loin de l’Odéon, des deux hommes, qui nous vaut un long et précieux portrait de Claudel : long récit détaillé, émouvant et drôle, de la vie de Claudel par Rolland (avec ce qui est un véritable second récit de conversion). À l’issue de ces retrouvailles, l’amitié semble là, simple, évidente, nourrie de souvenirs et accordée au présent. Visites, lettres et lectures vont rythmer une amitié retrouvée. Le 14 avril 1940,
Claudel est à Vézelay chez les Rolland : « son aspect de gros bourgeois aux mouvements lourds, à la voix forte et pesante, jure avec son art et avec l’idée que l’on se fait de lui », véritable mise en scène de soi-même qu’avalise Claudel sur le mode bouffe : « Qu’est ce que je suis ? Un gros cochon. Comme c’est gai de se montrer ainsi, aux yeux de qui attendent une image idéalisée d’un poète religieux inspiré » (p. 377). À cette date, récit également de l’histoire de Partage de midi, une histoire dont les Rolland vont être, ils ne le savent pas encore, les acteurs involontaires. En effet, le 22 mai, Claudel confie au couple le sort de « deux personnes qui lui sont chères ». Ces dernières arrivent en juin : il s’agit de Rosalie Vetch et de sa fille Louise. La première est perçue comme une « grande forte anglo-scandinave… mondaine, au teint fleuri, avec l’éternel sourire de la société britannique, et cette parole superficielle et enjouée, qui se croit obligée… à dérouler des récits sans fin, ou des propos indifférents et badins » (un peu plus tard, il évoquera sa « robustesse de grand cheval, et son rire perpétuel ») ; sa fille semblant, elle, par contre, souffreteuse et anémiée. Rolland mentionne qu’elle n’a su sa vraie naissance que vingt ou trente ans plus tard et apporte quelques éléments d’information sur la vie des deux femmes (mariages avec de riches négociants dans une atmosphère qui sent « la soute et les comptoirs d’Orient »). Les deux femmes repartiront pour Paris le 8 novembre, mais les Rolland continueront de s’informer de leur destin. Si, par instants, Romain Rolland se fait rétif face à Claudel (notamment, lorsqu’il apprend que le « Baron Turelure » émarge chez Gnome et Rhône), il reste en permanence dispos et à l’écoute, témoignant de son ouverture à l’universalité catholique et de son émotion à l’image d’un Claudel : « qui s’en va, chaque matin, avant l’aube, trébuchant dans la neige (c’est lui même ainsi qui se dépeint) prendre à la messe, avec ivresse, la communion » (p. 709). On voit même les Rolland défendre Claudel auprès d’un Éluard en visite qui ne peut « retenir son animosité et son mépris furieux pour l’homme, pour le cynique politique, pour l’affairiste plastronnant » (p. 717). Le dimanche 28 juin 1942, longue rencontre, à Paris, entre les Rolland et un Claudel radicalement anti-pétainiste, adonné sans trêve à l’exégèse biblique, à la lecture éblouie de Virgile, et surtout résolument philosémite. Dernière rencontre, abondamment commentée, le 5 avril 1943. À côté de ces échanges dont Rolland détaille finement la teneur, de nombreuses lettres sont reproduites qui constituent une correspondance éparse dans le volume (certaines, à Marie Rolland, spirituellement fort précieuses). La fin du
Journal, marquée par la maladie mortelle de Romain Rolland, l’est également par une prise de distance du poète à l’égard de sa dirigée, qu’il semble fuir : face à sa femme Marie qui « retombe dans l’abîme », Rolland tranche : « le “grand catholique” et les hommes d’Église ne se montrent pas sous un jour brillant ; ils font tort à leur foi, à la foi de qui les en prenait pour garant » (p. 995). Néanmoins, malgré ce final plutôt sombre, l’ensemble du Journal, redisons-le, offre un témoignage essentiel sur la vie, sociale et spirituelle, de Claudel sous l’Occupation, à la fois père de (deux) familles, homme d’affaires et exégète, simple paroissien et poète lauré, un Claudel que nous connaissons bien, mais que la finesse fervente et l’amitié lucide de son co-turne Romain Rolland rend encore plus touchant et passionnant.
François Angelier
Cahiers Francis Jammes 1 : 1894-1914. La révolution Francis Jammes, Association Francis Jammes, 2012
On ne peut qu’être séduit par le premier Cahier Francis Jammes, paru en décembre 2012. De nombreux détails rendent en effet cette publication particulièrement agréable : typographie irréprochable, illustrations originales, avant-propos, index, présentation des contributeurs du numéro, tout contribue à en faire une publication d’excellente qualité. Publiés par l’Association Francis Jammes, les Cahiers n’ont pas vocation à remplacer les deux bulletins qui, depuis 1983, paraissent chaque année : plus volumineux (presque deux cents pages pour ce premier numéro), ils témoignent au contraire, à la manière d’actes de colloque, de l’actualité et de la fécondité de l’œuvre de Jammes.
Consacré à la période 1894-1914 et intitulé La révolution Francis Jammes, le présent cahier est divisé en « études » d’une part, et « documents » d’autre part. Placé sous une vaste problématique qui vise à mettre en lumière le rôle que joua l’œuvre de Jammes dans la sortie du symbolisme, l’ensemble des contributions peut être réparti en trois ensembles.
Le premier serait consacré aux rapports de Francis Jammes avec les milieux littéraires contemporains, et plus précisément aux stratégies mises en œuvre pour « percer » en littérature. Sont ainsi envisagées dans trois articles successifs ses relations avec le poète belge Georges Rodenbach (article de Jean-Louis Meunier), Marcel Schwob (Bruno Fabre) ou encore Saint-Pol-Roux (Mikaël Lugan). Dans les trois cas, Jammes s’adresse à un aîné – au plan littéraire du moins –, susceptible de faire valoir son œuvre. Les relations avec Gide (article de Vincent Gogibu) sont évidemment plus complexes et seul le premier volet de l’article qui leur est consacré est ici publié. Ces quatre articles d’histoire littéraire permettent de faire découvrir des correspondances encore inédites, ou de donner un avant-goût de correspondances en cours d’édition : les six lettres de la correspondance Jammes-Schwob publiées dans les « documents » sont ainsi un extrait de l’édition que prépare Bruno Fabre, tandis que la correspondance Jammes-Gide connaîtra bientôt une nouvelle édition augmentée de près de 150 lettres.
L’examen des rapports de Jammes avec les revues relève d’une même démarche. Dans un brillant article, Pierre Lachasse analyse les contributions de Jammes à trois revues qualifiées de « revues de jeunes » : La Revue blanche, le Mercure de France et L’Ermitage. Il montre de manière
très convaincante comment Jammes se positionne dans le champ littéraire en fonction d’un double objectif : d’une part la reconnaissance par ses pairs (à savoir l’avant-garde littéraire), et la notoriété auprès d’un large public d’autre part. L’article de Vincent Gogibu étudie quant à lui les rapports de Jammes avec La NRF. Si, en 1909, il ne s’agit assurément plus pour Jammes de « percer », il est intéressant de voir comment la participation à une revue littéraire engage – et en partie détermine – l’image d’un écrivain : alors que L’Ermitage (revue de Gide au moins autant que La NRF) publiait volontiers Jammes, les rapports de celui-ci avec La NRF se tendent, sur fond de querelle religieuse.
L’intérêt de telles études pour les amateurs de Claudel est évident. Exactement contemporains, Claudel et Jammes ont eu, pour une part, les mêmes introducteurs, parmi lesquels Marcel Schwob et André Gide occupent une place particulière. Et la sociologie des revues qu’esquissent les articles de Pierre Lachasse et Vincent Gogibu consonent pour une large part avec ce que révèlent les premières publications en revue de Claudel.
Un second ensemble s’attache, dans ce Cahier, à une dimension plus proprement littéraire. Stéphanie Bertrand étudie ainsi avec finesse le style épistolaire de Jammes, en tâchant d’interpréter la propension à l’aphorisme qui s’y manifeste. D’abord lu comme un désir d’affirmation de soi, ce trait stylistique devient prosélytisme après la conversion de Jammes dans une correspondance qui se change en apostolat – ici encore, la comparaison avec Claudel serait intéressante. Cette dernière est explicite dans l’article de Sylvie Gazagne, qui étudie parallèlement les « poétiques de la conversion » de Jammes et Claudel. En dépit d’interprétations parfois rapides qu’on aimerait voir plus amplement développées, cet article met en lumière la différence essentielle de ces deux « poétiques » chrétiennes : alors que Claudel présente la spécificité d’un catholicisme très intellectuel, philosophique et théologique, la foi de Jammes, qui se manifeste dans son œuvre par une forme de retour à l’ordre, « reste toujours au plus près de l’être humain », « loin des préoccupations intellectuelles1 ».
Le tournant de la conversion constitue le point névralgique dans l’influence que put avoir Jammes sur des poètes contemporains. Patricia
Izquierdo se penche sur quatre d’entre eux : Anna de Noailles, Marie Dauguet, Marguerite Burnat-Provins et Cécile Sauvage. Alors que toutes quatre se reconnaissaient, plus ou moins explicitement, dans le sentiment de la nature et la naïveté qui caractérisent la première période de Jammes, elles ne partagent pas son retour à la foi (on connaît la célèbre pique de la comtesse de Noailles : « J’aimais mieux sa rosée que son eau bénite »), et s’éloignent de ce que devient alors l’esthétique de Jammes. C’est encore l’influence de Jammes qui retient Thanh-Vân Ton-That dans un article mêlant histoire littéraire et psychanalyse pour tenter d’éclairer l’énigmatique phrase du rêve du narrateur dans Sodome et Gomorrhe : « Cerfs, cerfs, Francis Jammes, fourchette ».
Enfin, un dernier ensemble se situe dans la lignée du colloque de 1993 consacré à la réception de Francis Jammes à l’étranger2. Shirley W. Vinall, à travers L’Anthologie-Revue de France et d’Italie, revue qui paraît entre 1897 et 1900, montre l’influence que put avoir Jammes sur le renouveau des lettres italiennes, tandis qu’Antoine Piantoni se consacre à la réception de Francis Jammes par la critique anglo-américaine, et plus spécifiquement dans le courant « moderniste ». Ce dernier article, complété par la reproduction de celui de Richard Buxton paru dans The New Age en 1912 (placé dans la section « documents »), montre de manière très fine comment Jammes, sans jamais devenir une référence esthétique, constitue peu à peu le « point de mire » de la critique anglo-américaine contemporaine. Antoine Piantoni rappelle le rôle que joua un Anglais, Crackanthorpe, dans la première publication de vers de Jammes, et les confusions sur la nationalité de Jammes qu’occasionna cette publication. À travers les pages critiques de Thompson, Flint, Buxton, Pound, ou Lowell consacrées à Jammes, il montre que « la courbe de la réception anglo-américaine de la figure et de l’œuvre du Cygne d’Orthez semble redupliquer celle de la réception francophone : les défauts que l’on reproche à Jammes [au premier rang desquels figurent la naïveté et une versification très imparfaite] font l’objet, de sa part et de ses partisans, d’un retournement progressif en qualités3 ». L’évolution littéraire du poète déçoit, comme en France, et l’œuvre semble délaissée après-guerre. Le soupçon de mystification, cependant, perdure outre-Manche. L’ambivalence propre à la poétique de Jammes, si elle est
appréciée d’un public érudit – sans jamais toutefois être unanimement reconnue –, ne lui permet pas de s’assurer une large notoriété.
Dépassant les frontières de l’Europe, la liste des traductions de Jammes en japonais, présentée dans les « documents », illustre l’étonnante réception de Jammes au Japon où il figure parmi les « classiques » de la littérature mondiale. De 1925 à 2012, ce ne sont pas moins de 27 traductions qui sont ainsi recensées, parmi lesquelles il convient de distinguer la publication en 1992 des Poésies complètes de Francis Jammes traduites par Shinichi Tezuka, trois ans avant la publication d’un recueil équivalent en France4. Cette réception japonaise n’est pas sans évoquer la place particulière réservée au Japon à l’œuvre de Claudel.
Les raisons de lire attentivement ce premier des Cahiers Francis Jammes sont donc nombreuses. Outre l’article de Sylvie Gazagne qui offre une comparaison directe entre Claudel et Jammes, les claudéliens trouveront de multiples points de contacts avec l’œuvre de Claudel. Le panorama d’histoire littéraire que dessinent les différents articles est précieux en ce qu’il permet d’envisager sous un angle légèrement différent la période de 1894 à 1914, décisive pour Jammes aussi bien que pour l’un de ses amis proches : Claudel.
Marie-Ève Benoteau-Alexandre
Paul Claudel Papers VIII-X
Il me revient de rendre compte ici du dernier volume des Paul Claudel Papers, VIII-X, paru en octobre 2012. Dans ses 141 pages il ne rassemble pas moins de huit articles, deux en anglais, six en français, et un compte rendu attentif, par Nina Hellerstein, de la nouvelle édition (Alexandre/Autrand), parue dans la Pléiade, du Théâtre volumes I et II, de Paul Claudel, événement majeur pour les claudéliens de tout bord et de tous les pays. Comme toujours le sommaire annonce une intéressante et réjouissante diversité, faisant la part belle à nombre des aspects ou sujets possibles et disponibles chez ce grand Protée.
Le premier article, « “Jeanne au-dessus de Jeanne” : Claudel’s Jeanne au bûcher as a New Play on History » est signé de M. Kathleen Madigan. L’auteur présente d’abord un rappel des circonstances de la conception du texte, la « pétition intime » à laquelle il a fini par souscrire, puis de quelques jalons dans la déjà longue histoire scénique, littéraire, voire cinématographique, du personnage de Jeanne (Shakespeare, Voltaire, Schiller, Shaw, Anouilh, Dreyer, Fleming (non nommé mais il est question de la pièce de Maxwell Anderson [1946] qui en est à l’origine, Rivette, Besson). Ces nombreuses références serviront à distinguer d’elles l’œuvre de Claudel, ou, éventuellement, à les en rapprocher. Ainsi Schiller dans la scène finale de Die Jungfrau von Orléans suggérant à son héroïne l’idée qu’elle a rêvé cette vie qu’elle va perdre – sur le champ de bataille, comme on sait. À notre avis, rapprocher les paroles ultimes de Johanna et celles de Jeanne, toutes deux montant littéralement dans une vision verticale où la présence de la Vierge confirme le salut et le dépassement (« Hinauf – hinauf – Die Erde flieht zurück – / Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude », rendant au ciel celle que Claudel appelle déjà son « alouette », eût été plus pertinent encore. Ou a contrario G. B. Shaw donnant à sa Saint Joan en la personne de l’évêque Cauchon un interlocuteur moins retors et moins indigne que le Porcus dominus noster claudélien. Suivent quelques considérations sur l’attitude de Claudel devant le drame historique en général et le personnage de Jeanne en particulier, qui s’impose à lui comme la figure auréolée de la sainte, désormais reconnue ; puis une description de l’agencement des scènes, qui insiste principalement sur la dernière. Sans écrire en toutes lettres qu’elle voit dans les paroles de la martyre une sorte de « Cantique de Jeanne », M. Kathleen Madigan suggère un rapprochement convaincant
entre elle et… Mesa, au moment ultime ; en revanche faut-il la suivre lorsque, citant l’étude d’Anne Llewellyn Barstow, elle reproche en somme à Claudel de privilégier en Jeanne la figure de la martyre, ce qui l’infantiliserait (?). Sa conclusion toutefois rend à Jeanne la conscience et la dimension volontaire, politique, historique donc, de sa mission, ainsi qu’annoncé dans le titre de l’article, dimension encore transcendée (« Jeanne : au-dessus de Jeanne ») par la musique d’Honegger à laquelle et à qui l’auteur rend brièvement hommage.
Dans sa contribution, « Le poète et le diplomate : Claudel ou le virtuose de la longitude », Eric Touya de Marenne, animateur de la Paul Claudel Society, introduit la question de l’actualisation des pensées claudéliennes à une époque, où, très effectivement « la scène » est devenue « le monde ». Il y répond en livrant ses réflexions successives sur la double carrière du diplomate et du poète, sur la double postulation du diplomate et du croyant, sur la double position du poète et du politique tel que le poète le considère, enfin sur le double registre de la musique et de la diplomatie. Eric Touya commence par rappeler l’importance de la toute première grande traversée, en solitaire quasiment (même si la citation, empruntée à L’Échange utilise le « nous »), traversée qui le séparait de son « monde ancien », et, le mettant à l’écoute de l’étendue, lui en ouvrait un autre, à com-prendre, c’est encore dire : à questionner, indéfiniment en poète, et en diplomate, tous deux occupés à – et s’aidant mutuellement à saisir « la pomme parfaite », sans aucune sorte d’incompatibilité avec les deux natures ou entre fonction et fonctionnement. Eric Touya nous fournit un rappel, toujours bienvenu des étapes et lieux de la carrière, un autre de quelques grandes figures politiques croisées, qui ne sauraient occulter le mépris dans lequel Claudel tient la plupart des autres. Dans un autre encore, une véritable perspective cavalière associe les titres de certaines des œuvres théâtrales à ce qu’elles contiennent de réflexion politique. Le tout émaillé de citations magnifiques comme toujours quand elles sont puisées à pareille source, plaisantes et sérieuses à la fois, à commencer par celle qui sert de titre à l’article et y reparaît ; mais il peut s’agir aussi de Starobinski voyant en Claudel une « magnifique figure de poète proférant [qui limite] son rôle à celui qui ne cesse d’écouter »…
« Madhuri Mukherjee : Claudel’s Poetics of Synesthesia »
Grâce à sa close reading, à ses analyses fouillées de quelques exemples choisis (mais dont on sent bien que l’auteur pourrait les multiplier à
l’envi), le lecteur connaît le bonheur de la redécouverte ou, pour être franc : de la véritable découverte. À bien suivre la fine démonstration de Madhuri Mukherjee à propos de l’une (une triple) des Cent Phrases pour éventails, on approche, toujours par le contact et l’écoute, la peau de la joue et l’oreille (mais une oreille qui « sent »), depuis la surface jusqu’au cœur de l’être. Partant de « ce bouddha de / pierre » qui conserve la chaleur de « la journée (a été) brûlante », passant par un « dieu chaud » on atteint « au fond de la / poitrine d’un dieu / l’amour ([qui] est long / à s’éteindre) ». À la suite, quelques pages du Poète et le Vase d’encens ainsi scrutées font que le lecteur pressent et se voit confirmer en effet que, à la ressemblance de l’œil qui écoutait, de l’oreille capable de sentir, même le nez peut… écouter (ce nez, cet odorat, dont la science récente, cf. citation et bibliographie, semble découvrir les qualités affectives et cognitives jusqu’ici assez peu mises en valeur). « Je t’écoute avec une seule narine »… sous l’humour, la vérité ! Le rappel initial de la hiérarchie des sens communément admise, cède la place à une belle illustration de ce que l’auteur, après Gino Casagrande ici cité, définit comme synesthesia, alias a kind of semantic metaphoric fusion of two or more sensory perceptions. Ainsi, des « Correspondances » de Baudelaire qui sent et ressent l’encens qu’il recense parmi les parfums « corrompus, riches et triomphants », Madhuri Mukerherjee rapproche la perception qu’a Claudel de l’odeur stagnante de la « ville pourrie » d’Angkor et de ses temples, de sa « puanteur hideusement parfumée qui, au fond de nos entrailles, lie je ne sais quelle connivence avec notre corruption intime ». Peut-être insiste-t-elle un peu trop sur les racines « symbolistes », désormais lointaines, du procédé (sans signaler toutefois l’étonnante expérience – manquée, mais elle a fait date – qui une fois au moins l’a illustré, de ce Cantique des Cantiques, donné le 11 décembre 1891 à la suite des Aveugles de Maeterlinck sur la scène du théâtre d’Art, présenté comme « une synthèse effective, une orchestration musicale, colorée, olfactive » (Jacques Robichez). Chercher à définir l’originalité de Claudel est plus intéressant encore du côté de l’interconnexion intime (souffle, lumière, parfum), de l’échange, de l’osmose entre l’homme et l’objet, le dialogue entre deux paroles ou la même mais double. On note en outre avec intérêt le souci pédagogique qui anime l’auteur, son attention de professeur à faire découvrir à ses étudiants les voies d’accès vers des domaines qui pourraient devenir ceux de leurs futurs recherches et travaux. Esquisser, tracer un chemin de l’avenir, n’est-ce pas offrir, ouvrir une belle perspective claudélienne ?
Christelle Brun, dans un article très complet intitulé « Images d’Hélène de Troie : Goethe et Claudel », soutient en somme une véritable gageure. Il est ici question en effet de confronter Goethe et Claudel, débat dont, pour l’avoir abordé dès sa thèse (« Claudel et le monde germanique » sous la direction de Michel Autrand), Christelle Brun connaît bien les termes et les enjeux ; question d’affronter chez Goethe un thème majeur du Faust, zweiter Teil, ou Faust II, moins connu chez nous, plus complexe encore que le premier – car il ne s’agit ici de rien moins que d’Hélène, « beaucoup admirée et beaucoup blâmée » ; et de la citer à comparaître devant une tout autre Hélène, superficielle, et menteuse, cédant son rang – qui n’est qu’un rôle – à la coquine nymphe Brindosier désireuse de quitter son île et de voir du pays. N’est-ce pas opposer Troie la légendaire, à Naxos, « gros gâteau de mariage anglais en sucre blanc », sorte d’île flottante, autre véritable dessert couronné de Chantilly ? N’est-ce pas rapprocher audacieusement la légende, l’épopée, le théâtre, tout cela, lumière et ombre comprises, repris aux Grecs par Goethe en son âge réputé classique – mais recréé à partir d’un souhait de Faust réalisé grâce aux inépuisables ressources et facéties anachroniques d’un charlatan nommé Méphistophélès, dissimulé sous les traits d’une (in)certaine Phorkyas… le rapprocher de la fantaisie débridée de la plaisanterie claudélienne qui dans son Protée, ses Protée, atteint les sommets de son extravagant comique, plaisamment cosmique – sans négliger le fait que toujours chez Claudel la plaisanterie est « une plaisanterie sérieuse » ? Là où Michel Autrand ne fait état que de « ressemblances mineures » (et déjà André Espiau de La Maëstre – cf. Bulletin no 176 – s’était étonné de le voir dans son édition critique « refuser toute réminiscence perceptible de l’acte d’Hélène de Faust II »), Christelle Brun cherche et trouve matière à une vaste investigation de grande qualité. Par exemple dans l’étude scrupuleuse qu’elle mène des registres des textes, dans son analyse fine de la forme poétique, métrique, comme de la nécessaire présence de la musique, réalisée par Milhaud pour Claudel ou imaginée chez Goethe, ou dans l’idée qu’elle développe d’une double expérience esthétique et intellectuelle renouvelée. Si toutefois l’étude n’aboutit pas complètement à l’équilibre qu’elle semble souhaiter, c’est sans doute parce que, d’un côté, de l’illusion foisonnante, extravagante elle aussi, déjà, le poète se sépare pour faire naître la vérité, – ainsi l’épisode de l’amour et du couple formé par Hélène et Faust en idéalise et célèbre la beauté, éternelle et fragile à la fois (chute d‘Euphorion, disparition d’Hélène) ; tandis que de l’autre, la plaisanterie de Brindosier meneuse
de jeu et sa victoire sur Ménélas, Protée, et une Hélène « synthétique » glorifient moins une idée qu’une merveilleuse machinerie inventive en diable au service de toutes les libertés de ton, d’action, de création de personnages. Il n’empêche, la lecture est particulièrement tonique qui permet d’assister, en témoin averti, au grand moment de la chute inévitable de l’Icare humain comme à celui de l’ascension saugrenue d’Hélène, la « vraie », mais toujours double, avec Naxos tout entière, dans l’empyrée !
« Paul Claudel : pétrir l’insurrection des formes »… Sous ce titre demeurant un temps sibyllin Marie Joqueviel-Bourjea fait à ses lecteurs la proposition originale de reconsidérer Claudel par le prisme d’un autre regard, le biais d’une autre œuvre, ceux du poète Jacques Réda, héritier, singulier et ignoré, de Claudel, Réda qui l’a placé dans son panthéon personnel et qui parle de lui comme d’une dose dont il a un besoin vital (« … un peu de Claudel pour les vitamines »). Après avoir évalué ce qui fait actuellement obstacle à Claudel lui-même et lui interdit une éventuelle postérité, l’auteur cite largement les propos « claudéliens » de Réda resitués essentiellement dans trois textes à lui consacrés, parus en 1995 dans La Sauvette : « Reconnaissance à l’Est », « Notre consul à Prague, 1910 » et « Un con ? Paul Claudel ». On aura repéré les allusions directes, voire l’interpellation que ces titres contiennent, et compris que le premier a été choisi manifestement par Réda pour dire identification et gratitude. Il s’agit également pour lui de célébrer la lyrique du verset, aussi rénovateur à ses yeux que le jazz (et Réda prône également les ouvrages de Charles-Albert Cingria), autant que la vigueur de la prose, dans le recueil, essentiel à ses yeux (il n’est pas le seul de cet avis) de Connaissance de l’Est. Cette véhémente prose claudélienne, Réda la caractérise abondamment, puissamment, la rapprochant de la parole insoumise et sauvage de Rimbaud : semblable « ressaisissement », même « rehaussement » de la langue, allant jusqu’à comparer « la compacité rythmique de la prose » claudélienne qui « littéralement, s’insurge » à « l’épaisseur / De la terre jaune empoigné[e] » par Camille Claudel, sculpteur. C’est en ce sens que l’énergie de la langue « pétrit l’insurrection des formes ». Cf. « Rêves », « Villes », « Religion du signe » et bien d’autres exemples d’une prose devenue paysage, bien plus sensible que lisible, nous dit Marie Joqueviel-Bourjea, rendue lisible et lue par une expérience du corps et des sens, et de citer « Heures dans le jardin » et « La Pluie » et de donner ainsi l’envie fondamentale de revenir aux textes, ainsi saisis et empoignés à nouveau.
Sabine Vergnaud intitule son long et précieux article « L’Homme et son désir, un ballet dont la “plastique” du poème de Paul Claudel est matérialisée par la musique de Milhaud ».
C’est une spécialiste reconnue de tout ce qui touche à « La musique et les arts dans la collaboration du Groupe des Six avec les Ballets suédois (1920-1924) », sujet de sa thèse de Musicologie, dirigée par Béatrice Ramaut-Chevassus, soutenue en 2010, que nous lisons ici. Le propos est d’analyser l’esprit qui a guidé, et les formes qu’a prises la collaboration singulière du poète et du musicien dans une telle « composition à quatre mains ». D’où une construction de l’article en deux parties, d’abord l’étude inédite des sources primaires du livret et de la partition, prouvant que « poème et musique ont été conçus ensemble », puis « l’analyse de l’orchestration et de la texture polyphonique de la composition en lien avec la mise en espace scénique », mettant « en évidence la dimension plastique de la musique de Darius Milhaud ». À partir d’une étude minutieuse des manuscrits (BnF, Centre Jacques-Petit de Besançon et Dansmuseet à Stockholm), différents quoique presque concomitants (1917, 1918) – et pour certains, non-datés – l’auteur montre ici (sans la développer comme dans la thèse mais pour la mettre en parallèle avec la composition de Milhaud) l’évolution du poème, sa réduction progressive de véritable « mode d’emploi pour le décorateur, le compositeur et le chorégraphe » au statut de texte d’un programme (deux pages dans la Pléiade) susceptible de renseigner comme de stimuler le spectateur. Ainsi on peut lire pour la première fois ce qui a été modifié dans – voire enlevé de – certaines des huit séquences inégales du texte, et découvrir en particulier ce qui a été amputé de beauté de la cinquième. Ne subsistent que toutes ces – merveilleuses – « choses de la forêt qui viennent regarder l’homme endormi », alors que « Tous les bruits de la forêt, toutes les notes élémentaires qui viennent tenter l’Homme endormi […] », au centre et au cœur de la scène, du texte et de la musique ont disparu, inédites. Ayant fait la part belle à l’imagination poétique et mystique de l’auteur du « texte », la musicologue scrute parallèlement et en détail (avec de nombreuses reproductions à la clef) partitions et indications du co-auteur, Darius Milhaud, montrant que sa composition repose à la lettre sur le livret qu’elle suit et prolonge, que la structure musicale close qu’il choisit illustre au mieux les intentions expresses de Claudel désireux de figurer que le drame continue quelque chose. Sabine Vergnaud précise avec schémas à l’appui la mise en espace du son, la particularité de l’emploi de musiciens danseurs,
faisant la « musique actrice du poème ». Virtuose, elle s’attache enfin longuement à l’analyse musicale des instruments et des thèmes, de la polyrythmie et polymétrie chargées de matérialiser l’écoulement inégal du temps cher à Claudel ; elle donne quasiment à entendre les sonorités et les rythmes si particuliers du musicien (pas de chant articulé, dix-huit percussionnistes sur les trente exécutants, entre autres). En tout cas, quand on connaît au moins par le disque cette musique, on la retrouve ici, plus éclairée, plus significative encore, plus plastique ou poétique, si on préfère. Certes on peut regretter que l’absence de la couleur dans les Paul Claudel Papers rende la lecture du texte-palimpseste du livret un peu compliquée, même si l’emploi de différentes nuances de grisés, voire le recours à la rature nous viennent en aide. De même les seuls trois clichés en noir et blanc illustrant le propos ne rendent pas justice au monde éclatant, original et mystérieux des créations d’Audrey Parr, co-auteur, elle aussi, pour les costumes et les décors. Toutefois le lecteur du Bulletin de la Société Paul Claudel peut utilement y associer ceux que la même Sabine Vergnaud a fait paraître dans le no 201 (et bien sûr y ajouter les nombreuses illustrations colorées fournies par Bengt Häger, auteur d’un beau livre sur les Ballets suédois, Denoël, 1989). Quoi qu’il en soit, sans musique (les fragments empruntés à la partition ne sont pas parlants pour tous) et sans la palette colorée des maquettes d’Audrey Parr, Sabine Vergnaud réussit la prouesse de nous faire entendre et voir l’originalité, la nouveauté de l’œuvre de Claudel. Que L’Homme et son désir n’est-il repris et re-dansé comme récemment La Création du monde, créé en 1923, soit deux ans plus tard, associant, lui, Blaise Cendrars pour le livret, Fernand Léger pour le rideau, les décors et les costumes, et le même Darius Milhaud pour la musique. Il eût fallu être présent à Besançon ou encore à Tokyo en 1968… Au moins peut-on lire en attendant que repasse la chance, non pas un simple scénario de ballet mais bien une œuvre de Claudel, ces deux pages dont le commentaire de Sabine Vergnaud aide à mieux mesurer la profondeur qu’il éclaire.
« Des anges sur le théâtre : du Soulier de satin à L’Histoire de Tobie et de Sara ». Hélène de Saint-Aubert est une spécialiste reconnue de L’Histoire de Tobie et de Sara dont elle a récemment rédigé les notes qui enrichissent la nouvelle édition de référence dans la Pléiade ; elle a déjà eu l’occasion d’écrire dans le Bulletin sur des points concernant ce beau texte, sujet de sa thèse (L’Histoire de Tobie et de Sara de Claudel – Pour une dramaturgie de la gloire, sous la direction de Michel Autrand, 2002) ;
texte qui n’a sans doute pas encore suffisamment trouvé son public, ou mieux, son audience. Elle s’attache ici à évoquer, à côté d’Azarias, visage visible de l’invisible Ange, ce Raphaël qui se révèle et se dépouille de ses vêtements humains au moment précis où il quitte ceux qu’il a assistés, un autre ange, l’Ange Gardien qu’on entrevoit d’abord veillant à son insu sur Prouhèze, qui le distingue plus tard sous la forme d’« un grand Ange blanc qui regarde la mer » et qu’on va alors entendre bien plus longuement disputer avec elle dans l’une des plus belles et mystérieuses scènes du Soulier de satin. Est-ce le prolongement d’une réflexion personnelle ? Le développement d’une intuition ou d’une hypothèse ? Au détour d’une phrase de ses notes dans la Pléiade Hélène de Saint-Aubert constate simplement qu’« Azarias joue dans L’Histoire de Tobie et de Sara un rôle plus important et plus constant que celui de l’ange du Soulier de satin ». Certes. Mais ici il est sans doute moins question de quantité et de mesure que de qualité et de nature ; il faut donc voir.
Pour pouvoir ensuite examiner sans réserves cet article, est-il permis d’émettre d’abord quelques critiques ? Il s’agit surtout de facilités (« ce pauvre Asmodée ») ou de simplifications de détail (le « spectateur français » serait-il, de nos jours encore, vraiment « gavé de théâtre classique », et partant, réfractaire à la « venue d’un ange à la scène » ?) Mais, plus encore que de telles approximations, ce sont les négligences ou obscurités de langage que l’on regrette : « la voix de l’être aimé qui épanche son appel » ? « …servir de tunnel à l’ubiquité de l’ange » ? « la requête lyrique est brutalement stoppée par une focalisation sur un objet scénique devenu actant », etc. Heureusement, rédigées, on l’a dit, par le même auteur, les notes de la Pléiade ne présentent nullement ce genre d’excès – ou de défauts. Heureusement aussi, l’intérêt du rapprochement proposé l’emporte. Un rapprochement nuancé qui met bien en lumière les contrastes entre les textes (on admettra qu’on peut ici faire abstraction de la deuxième version de la moralité – excepté sa dimension onirique) : résistance de Prouhèze, héroïne argumentante (Jean Guitton, pour caractériser Jeanne d’Arc et Marguerite et Catherine, les saintes ses modèles) au cours d’une « leçon de théologie » conflictuelle – et obéissance de Tobie ; différences entre Sara/l’Âme humaine et Prouhèze/l’amour humain à l’épreuve de l’amour divin ; entre la vision universelle de ce qui demeure un univers historique (globe conquis, siècle d’or espagnol) et, des ténèbres au Paradis, l’orbe de l’histoire du salut de l’humanité. Hélène de Saint-Aubert montre bien qu’au-delà de très réelles différences, de nombreux points communs ou images
communes existent et agissent (thèmes de la pêche et du poisson, du fil, de l’étoile). Le rapprochement qu’elle opère permet de donner à la « petite moralité » la mission d’être comme un prolongement de l’opus mirandum. Ainsi la présence de l’ange Azarias/Raphaël, messager dont le message ici est écouté, compris, accepté et suivi avec ferveur par tous (à l’exception d’Anna la Mère/Synagogue mais qui se rétracte à la fin), suggère plus fortement encore l’invisible et permet à la scène la venue du miracle.
Sous la plume de Nina Hellerstein enfin on peut lire une étude intitulée « Claudel, Segalen et un Travail de Bibliophile ; l’Édition canonique de Connaissance de l’Est dans la Collection Coréenne ». Cette belle étude se présente comme le commentaire de la « rencontre » entre Victor Segalen et Paul Claudel au lieu même de leurs expériences propres sur le double terrain de la poésie et de son édition, cette autre forme, bien plus que complémentaire, de la poésie même. En 1914 Segalen propose à Claudel à qui il a dédié Stèles deux ans plus tôt d’éditer dans la même « Collection Coréenne », Connaissance de l’Est, recueil paru une première fois en 1900. « Collection Coréenne » parce que produite sur un précieux papier coréen, correspondant encore mieux aux exigences et désirs de Segalen qu’un papier de Chine ou du Japon, le seul dit « impérial » apprenons-nous encore ici, parce que, « Grand Papier de Tribut », il était réservé par les feudataires Coréens « pour faire hommage au trône de Péking » (Segalen). On sait tout l’intérêt que Claudel porte lui aussi, à la suite de Mallarmé, à l’édition et l’impression du Poème et du Livre, intérêt que son premier séjour en Chine n’a pu que nourrir (et le retour au Japon ensuite confirmer, déterminant même des œuvres spécifiques comme les Cent Phrases pour éventails [1927] après Le Vieillard sur le mont Omi [1925]). La proposition de Segalen est un jalon dans une amitié (Nina Hellerstein rappelle les études de Didier Alexandre à ce sujet) faite de divergences et de convergences (c’est le cas ici), et sa réalisation est pour Claudel un grand sujet de joie tant le support exceptionnel magnifie en effet ce qu’il contient et le fait en quelque sorte renaître. Il reflète par et dans sa matière même, véritable monde naturel, l’immersion profonde du poète absorbé dans le même monde d’eau, de végétation et de vent et imprégné par lui (« Je suis comme l’algue dans le courant que son pied seul amarre… »). Sans doute selon Nina Hellerstein, la forme de la stèle, page monolithe, correspond mieux aux poèmes de Segalen, plus brefs et dès l’origine plus adaptés à la structure, qu’aux textes de
Connaissance, plus longs et plus variés ; mais le format de la Collection Coréenne possède ses facteurs propres « de continuité et d’unité » (mise en page de la forme-stèle, cernée d’un filet noir, cadre qui fait apparaître le texte « comme un bloc rectangulaire, suivant le modèle de la stèle en pierre gravée »). Un tel format, en résolvant le « conflit entre la linéarité de l’écriture […] et une forme synthétique globale » […] « incorpore la succession des soixante et un poèmes individuels […] dans un ensemble cohérent » qui rend à la fois plus lisible ce « mouvement en avant caractéristique de la prose » et sensible cette « atmosphère unique », telle qu’admirée par Claudel dans Les Fleurs du mal. Quatre pages illustrent l’article, malheureusement dans un « noir et blanc » qui n’est ni noir ni blanc et qui doit faire l’économie de ce fier rouge-cinabre des initiales. Celles-ci, imitées par Segalen des lettrines médiévales, aidant à construire l’architecture de la page et marquant de leur lumière le texte monochrome, sont aussi de la couleur des sceaux impériaux chinois qui donnent tant à rêver. On aimerait tout citer de cette étude qui réunit deux poètes dans une rencontre féconde, ouvrant à Claudel les possibilités d’une autre expérience ou navigation poétique à venir.
Et je ne voudrais pas omettre de rappeler, du même auteur, les pages du compte rendu de la nouvelle édition, par Didier Alexandre et Michel Autrand, du Théâtre de Claudel, dont Nina Hellerstein ne manque pas de souligner et saluer les nombreuses et remarquables qualités : introduction éclairante, originalité et innovation (au prix parfois de quelque complication pour le lecteur) dans l’organisation strictement chronologique des textes qui ne les suit donc plus dans leurs développements successifs propres, mais les met en regard des autres œuvres du même Claudel, leurs contemporaines ou leurs proches, révélant ainsi leurs rapports intimes ; permettant aussi de mieux suivre le développement progressif des innovations dramaturgiques et formelles de l’auteur. Nina Hellerstein se félicite également de l’enrichissement de la documentation et de l’approfondissement du sens des pièces, en particulier des moins connues ou davantage négligées comme Le Repos du Septième Jour ou L’Histoire de Tobie et de Sara grâce à l’élargissement des collaborations demandées à des spécialistes. À l’évidence, un nouvel instrument d’une valeur inestimable pour les chercheurs et les amateurs de l’œuvre.
On voit que ce volume des Paul Claudel Papers, s’il ne prétend évidemment pas faire le tour du monde claudélien propose à son lecteur
quelques belles escales et l’invite à visiter et revisiter, qu’il s’agisse de poésie, de théâtre, de ballet, de farce mythologique, d’oratorio, de théâtre exégétique prolongeant la méditation biblique, d’inventions diverses, quelques points particulièrement importants et intéressants de l’archipel innombrable et toujours renouvelé.
Un seul (mais vrai) regret : qu’une relecture plus sourcilleuse de l’ensemble n’ait pas été faite, qui aurait permis d’éviter les nombreuses et bien dommageables erreurs grammaticales qu’on a le déplaisir d’y trouver. Certes, on pourra toujours prendre le parti de sourire ou rire avec Claudel d’un tel souci pour cette
« Chère grammaire, belle grammaire, délicieuse grammaire, fille, épouse, mère, maîtresse et gagne-pain des professeurs » !
Last but not least, justement !
Monique Dubar
1 Cahier Francis Jammes 1, p. 58. Notons que Sylvie Gazagne a publié un article dans le Bulletin de la Société Paul Claudel 177, sous le titre : « Paul Claudel et Francis Jammes : convergences des poétiques et divergences des poésies ? »
2 Actes publiés en 1995 sous le titre Rayonnement international de Francis Jammes (Biarritz, J&D éditions).
3 Cahier Francis Jammes 1, p. 144.
4 Œuvre poétique complète, éd. Michel Haurie, Biarritz : J&D éditions, 1995.