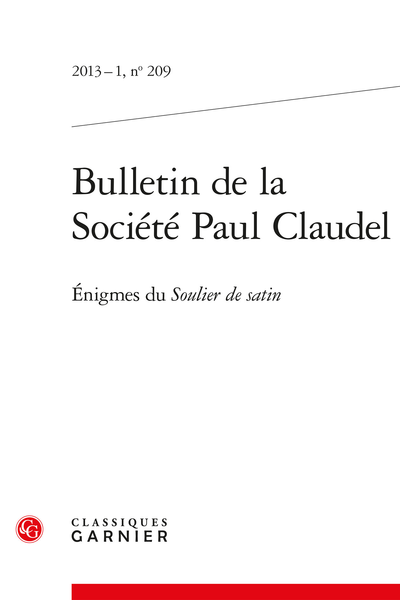
Théâtre
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société Paul Claudel
2013 – 1, n° 209. Énigmes du Soulier de satin - Authors: Le Roux (Monique), Vismes Marès (Armelle de)
- Pages: 85 to 94
- Journal: Bulletin of the Paul Claudel Society
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812410741
- ISBN: 978-2-8124-1074-1
- ISSN: 2262-3108
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-1074-1.p.0085
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-18-2013
- Periodicity: Four-monthly
- Language: French
Le Soulier de satin
au Schauspielhaus de Vienne
Mettre en scène Le Soulier de satin semble un défi à la représentation, qui constitue toujours un événement. C’est plus encore le cas quand un théâtre autrichien, consacré aux écritures contemporaines, fait exception dans sa programmation et confie à de jeunes auteurs et metteurs en scène un projet très ambitieux de réécriture à partir des quatre journées.
Le Schauspielhaus est connu comme « théâtre du présent » ; depuis l’arrivée à sa tête d’Andreas Beck, il se caractérise par une autre particularité : chaque saison, en plusieurs représentations ou en intégrale, est programmée une « série ». Furent ainsi confiés à de jeunes auteurs, par exemple en 2008-2009 Freud, en 2010-2011 le chancelier Kreisky, en 2011-2012 Schubert, soit trois grandes figures autrichiennes. Pour Andreas Beck, qui conçoit ces « séries » comme une recherche sous forme d’esquisses, d’ébauches, permises par un temps de répétition réduit, Paul Claudel apparaît quasiment « post-dramatique » (le comble de la modernité germanique), vu sa liberté de composition, sa conception de la mise en scène qui compense le fait qu’il ne soit ni contemporain, ni Autrichien. Paradoxalement Le Soulier de satin, considéré comme si inaccessible, semble ainsi bien adapté à la pratique du Schauspielhaus. Il se prête en outre à la règle de chaque « série », le choix d’une thématique contemporaine, en l’occurrence : « Une société sécularisée ? Entre transcendance et réalisation de soi ». Andreas Beck trouve une actualité de la pièce dans une immense nostalgie contemporaine, une quête spirituelle, dont témoignent pour lui de nombreuses pratiques parfois vécues comme ersatz de religion, dans une interrogation sur un absolu et des valeurs, dont la société capitaliste n’aurait laissé que souvenirs et regrets.
Dans les pays de langue allemande, la grande référence reste la mise en scène en 2003 du Suisse Stefan Bachmann, coproduite par les théâtres de Bâle et de Bochum. Elle est souvent présentée comme une résurrection de la pièce et le démenti de son caractère irreprésentable, comme si les performances d’Antoine Vitez et d’Olivier Py étaient ignorées.
L’entreprise du Schauspielhaus est radicalement nouvelle, confiée à des auteurs et metteurs en scène différents pour chaque journée, tout juste trentenaires ou à peine plus âgés, d’origine allemande, autrichienne ou suisse, formés aussi bien à Berlin, Vienne ou Zürich. La plus connue, Anja Hilling, choisie comme révélation de l’année 2005 par la prestigieuse revue Theater Heute, bénéficie d’un renom international et a été par exemple inscrite à l’affiche du Théâtre national de la Colline, début 2013, avec sa pièce Tristesse animal noir, jouée pour la première fois en Autriche la saison 2008-2009, précisément au Schauspielhaus. Elle a pris la plus grande liberté par rapport au texte, réécrivant entièrement la troisième journée dans un registre actuel. Les autres sont restés plus ou moins fidèles à l’excellente traduction de Herbert Meier, réalisée en collaboration avec Yvonne Meir-Haas, et ont conçu une version scénique, ramenée à la durée d’environ une heure et demie de représentation par journée. Ils ont surtout ajouté, par insertion de fragments originaux ou création de personnages supplémentaires, une tonalité contemporaine, confirmée par les citations dans les programmes, d’Alain Badiou à Peter Sloterdijk, de Jean-Luc Nancy à Jürgen Habermas, associées à celles de Paul Claudel. Les premières se sont échelonnées en octobre et novembre jusqu’aux intégrales d’environ huit heures, qualifiées de « marathon-Claudel », exigeantes pour les spectateurs et plus encore pour la troupe de jeunes interprètes, impressionnants d’énergie et de vitalité. Elles ont suscité un grand intérêt dans la presse autrichienne et des réactions ambivalentes. La réception ne pouvait que varier selon la connaissance préalable de la pièce, s’avérer très contrastée d’une journée à l’autre en fonction de l’attente, attente d’une nouvelle mise en scène d’un chef-d’œuvre ou d’écritures contemporaines suscitées par une pièce du passé.
Le titre de l’ensemble était toujours accompagné du sous-titre Le Pire n’est pas toujours sûr ; mais chaque journée était intitulée différemment. Thomas Artz appelle la première Le Pèlerin du bonheur et se limite à quelques mises en perspective personnelles. Dans un texte très éclairant du programme, il accepte de s’interroger sur la foi, indissociable pour lui du doute. Il se reconnaît dans ce moderne « pèlerin du bonheur », prisonnier d’un dilemme, resté étranger au monde et à lui-même, déchiré par l’aspiration à la fois à se libérer de Dieu et à dépasser les satisfactions individuelles d’un monde matérialiste. Lui-même, toujours en chemin vers autre chose, interprète le mouvement incessant des personnages comme une quête sans fin et leur prête ce doute, en particulier à Prouhèze, dont il fait un très beau portrait de « femme aimante et
chrétienne croyante, à l’intérieur d’un monde patriarcal et hiérarchisé ». Surtout il incarne cette expression du doute dans un ange déchu, inventé dès le prologue, désigné comme « l’ange en train de tomber », auquel il prête une parole rythmée, brève, actuelle. La mise en scène de Gernot Grünewald commence sur la chute de cet ange, suivie par des caméras mobiles, accompagnée de machines à vent, puis sur le violent arrachage des ailes, une fois touchée terre. Elle préfigure ainsi, dans le spectacle, l’association de la technologie et de l’artisanat, de la projection d’un portrait de la Vierge en vidéo sur un mur de briques dorées et de la suspension des costumes destinés à progressivement transformer des silhouettes actuelles en personnages de la cour espagnole « à la fin du xvie, à moins que ce ne soit le début du xviie siècle ». Reste, au delà de cette première journée, attaché par un fil l’escarpin de satin rouge accroché, après plusieurs échecs, par Prouhèze devant l’image de Marie.
Pour la deuxième journée, intitulée Où tu n’es pas, Melanie Huber ne rompt pas en effet radicalement dans ses choix de mise en scène avec la première, pas plus que Jörg Albrecht avec la traduction. L’auteur reste proche du texte, mais il compense certaines coupes par des fragments de sa propre écriture : commentaire dans la deuxième scène du double cri de Prouhèze : « Rodrigue ! », de la séparation par d’« épais murs », des « escaliers du délire » parcourus en vain ; variations sur le monologue de Saint-Jacques interrompu à deux reprises ; nombreuses interrogations et réponses actualisées de Dona Musique et du Vice-Roi ; relecture des dernières scènes – de l’ombre double et de la lune – à la lumière d’une réflexion contemporaine. Cette relative fidélité à la pièce se pressent dès le programme : « Il en va du rôle que la langue joue dans l’amour, et du rôle que la langue joue dans la foi qui n’est rien d’autre que la foi transcendée », malgré une formulation quelque peu rhétorique, manière d’associer « la langue et l’impossibilité » comme « impossibilité de la langue » et « langue d’une impossibilité ». Jörg Albrecht insiste sur son choix de répondre à la proposition d’Andreas Beck par l’accent mis sur l’amour, la langue, le possible et l’impossible. Mais il considère la conception claudélienne de l’amour comme indépendante de son catholicisme. Il retrouve dans la séparation de Prouhèze et de Rodrigue une expérience indissociable de tout amour humain, terrestre et charnel. Et quand il élargit la notion d’amour à différentes formes, par exemple celle des idées ou des compagnons de lutte pour des militants, il voit ceux-ci également confrontés à un irréalisable accomplissement. Il ne néglige pas en effet la dimension politique de l’œuvre, la « conquête du
monde » et la colonisation. Et il cite dans le programme cet échange des cavaliers dans la première scène de la deuxième journée, la seule supprimée par Antoine Vitez dans sa version (quasi) intégrale : « Il y a sur notre boule terrestre un côté au soleil et un côté à l’ombre », « une partie réelle et une qui ne réussit pas à l’être tout à fait ». Il amorce ainsi une réflexion sur la division du monde en réel et irréel, en permis et interdit, à laquelle il ne peut se résoudre.
Dans cette réécriture de l’ensemble, les auteurs des deux premières journées s’efforcent à la fois de respecter la langue, traduite, et de comprendre une vision du monde, plus ou moins distante de la leur, ce qu’ils suggèrent par l’insertion de fragments autonomes. Les deux jeunes femmes, chargées des troisième et quatrième journées, ont fait des choix différents. Anja Hilling est partie d’une admiration manifeste pour la langue de Claudel et ne souhaitait rien ajouter de sa propre écriture. Elle a préféré donner une version nouvelle située à l’époque actuelle, appelée la Conquête de la solitude. Elle conserve les principales étapes de ce qui constitue pour elle un parcours d’échec, « une capitulation sans échappatoire », par rapport à un projet impossible, la quête de l’absolu. Elle se situe explicitement dans une perspective étrangère au catholicisme, ce qui lui fait par exemple considérer « la rencontre réelle des amants » à la fois comme « grandiose et ridicule ». Elle fait de Prouhèze et Camille un « couple de notre temps », où celle-ci peut traiter son partenaire de « trou du cul » et s’entendre dire : « Tu baises et tu appelles ça prier », vocabulaire, semble-t-il assez représentatif du niveau de langue dans cette troisième journée. La mise en scène de Christine Eder, à mi-chemin entre l’esthétique de la bande dessinée et celle du film d’aventures, laisse deviner leurs relations sexuelles dans une tente, à travers la toile rouge translucide, utilisée à un autre moment comme voile d’un bateau. Seul un épisode échappe à la totale actualisation : la rencontre fictive d’Henri Bergson, Camille Claudel, Claude Debussy et Stéphane Mallarmé au Japon, où Paul Claudel était ambassadeur à partir de 1921 et écrivait Le Soulier de satin. Mais leurs échanges résonnent de manière quelque peu anachronique, quand le musicien parle de « baiser avec l’éternité » ou Camille dit au philosophe : « Tu es gentil Henri. Mais pour parler de liberté il te manque l’expérience ».
Tine Rahel Völcker crée elle aussi de nouveaux rôles dans la quatrième journée, mise en scène par Pedro Martin Beja. Mais elle les introduit dans des débats politiques contemporains et dans des épisodes partagés avec les personnages de la pièce originale, non sans conséquence pour
ceux-ci. Elle donne la parole à des représentants de l’islam, un pêcheur, un employé et deux femmes, l’une désignée comme la tête de chacal et l’autre comme la noire. Ces Égyptiens ont des discussions entre eux, par exemple sur le port du niqab comme moyen de résistance au monde occidental ; surtout ils influent sur l’ensemble des enjeux. Sept-Épées ne peut qu’être entendue autrement dans son dialogue avec Rodrigue, après avoir frappé la femme chacal et l’avoir menacée lors de leur rencontre sur mer : « Qui es-tu ? Dégage. C’est ma mer. Et bientôt elle se colorera de rouge avec le sang des Arabes et des Turcs. Est-ce que tu comprends ma langue ? Pas un mot, est-ce que j’ai raison ? (…) Je connais Jean d’Autriche et il a des bateaux de guerre ». La scène neuf prend un sens nouveau, quand le palais flottant et la Cour d’Espagne sont rejoints par le bateau des Égyptiens, quand le pêcheur finit par être tué par le Roi après ses interventions, par exemple sa reprise et sa modification de la phrase de Rodrigue : « Je demande que l’Espagne aussitôt que possible retire ses soldats et ses bateaux des côtes africaines » ou sa réponse à l’hypothèse d’une agression : « Il s’agit de savoir qui agresse qui ». À partir du constat que la fin de la pièce a lieu sur la mer, Tine Rahel Völcker oppose dans le programme « les bateaux de Claudel » et les siens, ceux qu’elle introduit dans son texte : « les bateaux arabes ». Elle a d’ailleurs choisi comme titre à l’ensemble celui donné à une très longue scène, entre les deux Égyptiennes, finalement rejointes par Sept-Épées : Le Bateau des millions. Elle veut ainsi perturber le « catholicisme universel » de l’écrivain par la parole de l’ennemi muet. Elle est allemande et se réfère à des emprunts explicites à la culture arabe qui lui faisaient défaut. Mais elle se situe manifestement du côté de ceux qui ne supportent pas une humiliation ancestrale, contre l’Europe actuelle en déclin, symbolisée par le royaume d’Espagne. En cela elle participe d’un regard nouveau porté sur Le Soulier de satin ou Le Pire n’est pas toujours sûr par quatre jeunes écrivains. Mais à la différence des trois autres, sensibles à la langue du poète, plus ou moins éloignés de la vision du monde religieuse et politique d’un autre temps, elle bascule dans une instrumentalisation de la pièce. À la fois elle la prend comme prétexte à l’expression de sa propre idéologie et se livre à une critique radicale quelque peu anachronique.
Monique Le Roux
L’Annonce faite à Marie
au théâtre Montansier à Versailles
Jean-Daniel Laval a créé L’Annonce faite à Marie en novembre 2012 au théâtre Montansier de Versailles, dans sa « version définitive de 19121 ».
L’histoire de ce « mystère » (Th II, 11) réécrit quatre fois2 – une première version intitulée La Jeune Fille Violaine en fut publiée en 1892 – témoigne à la fois de l’influence de l’expérience théâtrale sur l’écriture de Paul Claudel, mais aussi des tensions spécifiques à l’œuvre dans ce drame. À la fois parabole (Th II, 1394) et mystère se passant « à la fin d’un Moyen Âge de convention, tel que les poètes du Moyen Âge pouvaient se figurer l’antiquité » (Th II, 11), mélodrame campagnard, spectacle ponctué de contrepoints musicaux et imprégné de symbolisme mystique L’Annonce faite à Marie est, dans un autre registre que Le Soulier de satin, le plus complet des drames de Paul Claudel, celui qui représente « presque tous les côtés de [ses] différentes possibilités3 » et qu’il considère comme le plus apte à la scène. Si L’Annonce faite à Marie est emblématique de son œuvre, elle est aussi épineuse à monter. Elle le fut tout d’abord à cause de l’attachement épidermique de l’auteur à cette pièce : Jacques Copeau, Charles Dullin, Louis Jouvet et même Jean-Louis Barrault, quoique différemment, en firent les frais4. Elle le reste aujourd’hui par ses ambiguïtés religieuses, à une époque où le discours de l’Église catholique vis-à-vis de la souffrance a beaucoup évolué. Comment comprendre la dimension mystique du drame sans le réduire à une image sulpicienne d’exaltation de la souffrance ? Comment faire
pour que le spectateur accède au symbolisme de ce « mystère » quand la plupart des spectateurs s’accrochent à la dimension littérale du langage religieux, confondant dévotion populaire et propos théologique ?
Jean-Daniel Laval revendique, dans sa note d’intention, « une mise en scène dépouillée de tout effet, sobre et “stricto sensu”. » Cette approche iconoclaste résonne de manière étrange associée à l’univers claudélien, mais observons la scénographie. Le drame se joue sur trois plans, en profondeur, et non en hauteur comme envisagé par l’auteur et ses collaborateurs lors des premières mises en scène5. L’avant du plateau est dédié aux scènes d’intérieur du début et de la fin du drame. Deux grandes et solides tables en bois agrémentées de bancs occupent la scène en diagonale. Un crucifix orne l’une d’elles au lointain. Elles seront déplacées au fil de l’intrigue : reléguées de part et d’autre du plateau pour les deux actes centraux, ouvrant ainsi l’espace, puis réutilisées à la fin pour accueillir le corps de Violaine. Le second plan apparaît en transparence derrière un voile de tissu lorsque l’action le nécessite : deux monticules permettent de comprendre qu’il s’agit de scènes d’extérieur : le baiser de Violaine à Pierre de Craon y a lieu, la scène près de la fontaine y démarre avant de se prolonger à l’avant-scène (II, 3), tout comme l’acte III jusqu’au miracle. Le dernier plan, derrière un autre voile, s’illumine enfin de temps à autre et laisse apparaître au lointain le chœur formant tableau vivant et chantant a cappella, tourné vers jardin. Deux échafaudages encadrent la scène et valorisent un vitrail en ogive placé au centre, dont la construction évolue à chaque nouvelle apparition du chœur. La cathédrale de Pierre de Craon s’érige donc en toile de fond et non à l’intérieur du drame.
La création vocale, d’inspiration grégorienne, est de Sylvain Audinovski : elle s’insère aux endroits indiqués par Paul Claudel, rappelant que celui-ci a commencé à écrire une forme opératique de ce drame dans les années 1930 en collaboration avec Darius Milhaud6.
Les costumes sont simples et adoptent les codes du Moyen Âge tel qu’on se l’imagine. La dalmatique de Violaine pour la scène de la fontaine se veut scrupuleusement fidèle aux indications de la version de 1912, dans la lignée d’Alain Cuny7.
Le choix des comédiens s’avère tout aussi conventionnel : Violaine est blonde à la joue rose, comme il se doit, fraîche et virginalement lumineuse ; celle qui incarne Mara brune, petite, énergique, à la démarche rapide. Toutes deux investissent le jeu avec générosité, face à des rôles masculins endossés par des acteurs plutôt ternes. Le jeu, très narratif, est bien souvent tenté par le pathos : une maladresse de style qui confère à l’ensemble, déjà lisse, un côté bien-pensant ne laissant au second degré de Paul Claudel que peu de place pour s’exprimer.
À trop vouloir faire corps avec la littéralité du texte, le metteur en scène semble n’en valoriser que la simple religiosité au détriment du drame existentiel. Ainsi, l’approche du rôle d’Anne Vercors est plutôt déplacée : au début du drame on le voit boiteux, colérique, affublé d’un bonnet, de cheveux longs et d’un collier de barbe remettre son alliance à son épouse (?), et revenir à la fin, simple et débarrassé de tous ces oripeaux. Sa transformation extérieure, bien appuyée, édulcore complètement le sens de la réconciliation finale, faisant de la foi une espèce de baume trouvé en Terre Sainte plutôt que la capacité à accueillir le don d’amour ou par-don offert par Violaine aux siens avant de mourir. La note d’intention de Jean-Daniel Laval parlant de « reconquête de la foi » et de « mission que s’est donnée Paul Claudel » révèle un glissement naïf et insidieux vers une sorte de théâtre moral : si Paul Claudel a nourri des aspirations paradoxales quant à sa vocation de poète dramatique catholique et à la dimension sacerdotale de ses drames8, l’y enfermer serait projeter sur le drame un sens qu’il n’a pas, en faire une œuvre d’édification là où il s’agit plutôt d’exigence dramatique.
La principale question posée par la pièce, comme dans tous les drames de Claudel9, est celle de la vocation : qu’est-ce qu’accomplir la volonté divine ? Peut-on vivre un bonheur particulier en se désolidarisant du destin de l’humanité souffrante ? Ai-je droit au bonheur10 ? Chaque personnage, de manière archétypale, comme dans les contes, tente de répondre à cette question. Il ne s’agit donc pas tant de donner raison à
l’un ou à l’autre que de faire apparaître le processus de transformation à l’œuvre en chacun. Jean-Daniel Laval ne semble pas avoir perçu cet enjeu : l’intelligence dramatique de Paul Claudel vient toutefois à son secours en obligeant Violaine à jouer le visage caché. La seconde partie de la représentation y gagne de ce simple fait.
Sans doute la finesse des plus grands metteurs en scène est-elle nécessaire pour réussir un jeu qui soit tantôt musical et hiératique, nous plaçant d’emblée dans la sphère poétique, tantôt enraciné dans le concret ? Cette tentative, aussi sincère soit-elle, nous paraît tronquer la part essentielle du drame et démontre la difficulté à mettre en scène des archétypes sans convoquer tous les poncifs du stéréotype.
Armelle de Vismes
1 Cette inexactitude figure dans le dossier de presse et le programme. La mise en scène entretient la confusion : on y retrouve des éléments de la première version (1912), par exemple concernant le costume de Violaine (II, 3), mais l’acte IV choisi est bien la variante de 1938. Enfin, la mise en espace se réfère constamment aux didascalies de la version « pour la scène » de 1948.
2 Les étapes de la composition du drame sont détaillées dans Th II, p. 1381-1383.
3 MI, p. 260.
4 Voir les Cahiers Paul Claudel VI et X qui retranscrivent la correspondance de Paul Claudel avec ces hommes de théâtre.
5 Voir à ce sujet Mes idées sur le théâtre, p. 33-36, p. 40-46, p. 216-221 et Th II, p. 1384 sqq.
6 Mes idées sur le théâtre, « La tentation de l’opéra. Un projet pour L’Annonce faite à Marie », p. 131-142.
7 Adaptation cinématographique de 1991. Alain Cuny, a contrario, n’avait pas craint d’introduire quelques anachronismes esthétiques.
8 Voir à ce sujet Raphaèle Fleury, « Claudel et le théâtre populaire » in Bulletin de la Société Paul Claudel, no 198.
9 Paul Claudel résume merveilleusement cette idée en décrivant les « forces en présence » dans Le Soulier de satin : « Les plus primitives entre lesquelles le cœur humain ait jamais été partagé. D’une part, le désir passionné du bonheur individuel […] D’autre part, l’injonction d’un impératif extérieur dont ce désir a à s’accommoder. Quand ces deux forces, je n’hésite pas à le dire, toutes deux sacrées, se trouvent en opposition, il y a une question à résoudre, une solution à pratiquer, il y a drame. Sans opposition, pas de composition. » Th II, p. 1473-1474.
10 Claudel dit de Mara qu’elle « croit que Dieu peut lui faire du bien. » Th II, p. 1396.