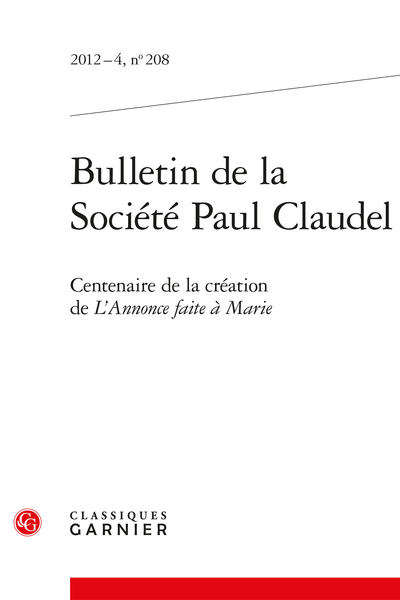
En marge des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
2012 – 4, n° 208. Centenaire de la création de L’Annonce faite à Marie - Auteurs : Turkova (Sœur Barbora), Lécroart (Pascal), Daniel (Yvan), Cagin (Frère Michel), Humbrecht op. (Père Thierry-Dominique), Beretta (Alain)
- Pages : 71 à 94
- Revue : Bulletin de la Société Paul Claudel
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812408922
- ISBN : 978-2-8124-0892-2
- ISSN : 2262-3108
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0892-2.p.0071
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/01/2013
- Périodicité : Quadrimestrielle
- Langue : Français
Traduction en langue tchèque de Partage de Midi, par Vladimir Mikes
La maison d’édition tchèque ARTUR a publié en 2012 dans la série des classiques du théâtre Partage de Midi de Paul Claudel dans sa traduction tchèque. Le traducteur Vladimir Mikes a choisi la « version pour la scène » montée à Paris en 1949 par J.-L. Barrault, ce qui est l’avant-dernière version de la pièce.
Il faut saluer la présentation simple et soignée (presque pas de fautes d’orthographe en ces temps où les relectures se font rares), la couverture renvoie à l’art typographique des années trente et son motif de soleil coupé en deux s’harmonise parfaitement avec le titre.
Cette traduction est un véritable service rendu même au lecteur francophone, étant donné que Partage de Midi est un drame complexe et malgré la sobriété de langage (fait assez rare chez Claudel) peut ne pas être directement compréhensible. Nous ne prétendons pas faire la leçon au traducteur expérimenté mais nous nous demandons simplement s’il a respecté le style vigoureux, parlé (sans aucune redondance cependant), comme épuré de l’original. Nous croyons qu’en général il y a réussi. Il a même su rendre savoureuses, drôles et inattendues les sentences que Claudel place volontiers dans la bouche de ses personnages, et ici plus particulièrement dans la bouche d’Amalric. Il y a également une réelle beauté dans les dialogues d’Ysé et de Mesa.
En revanche parfois derrière une expression tchèque un peu vague, on entend l’expression française précise car c’est une des difficultés bien connue qu’il faut concrétiser en tchèque les expressions qui en français restent naturellement plus générales ou abstraites. Dans le Partage de Midi l’enchaînement des idées dans les dialogues est très rigoureux et même des répliques du registre familier et d’allure banale transmettent une idée ou plusieurs et ainsi le lecteur se trouve au cœur du drame sans grands effets de style. Le traducteur est parfois amené à sacrifier une partie de la richesse du sens de l’original en restant dans le vague. L’exemple le plus frappant se trouve tout au début de la pièce. L’auteur joue probablement sur deux plans.
Amalric. – Mon bon ami vous vous êtes laissé enguirlander.
Mesa. – Vous savez, la chose n’est pas faite encore.
Amalric. – Alors ne la faites pas. Croyez-moi,
Je vous aime bien, Mesa ! Oh ! comme on l’aime son petit Mesa ! Ne le faites pas.
Mesa. – L’affaire ne me paraît pas tellement mauvaise.
Amalric. – Mais l’homme qui la fait ?
Mesa. – Eh ! bien, il a ses qualités.
Il s’agit de l’affaire commerciale mais aussi sous-entendue de cette autre affaire, le drame de la vie de Claudel et le cœur du drame Partage de Midi, de cette épreuve du cœur qui arrive quasi inévitablement à cette période périlleuse du milieu de la vie, en l’occurrence le péché d’adultère. Cette entrée en matière discrète et directe manque dans la version tchèque. Claudel reprend le même jeu de mots à l’acte II où Ysé, au cimetière, partagée entre les deux hommes dit à Mesa en présence de son mari De Ciz :
– Mesa, voici mon mari qui a à voir par ici pour ses affaires, des affaires
Qui ne vous regardent pas.
Il est très difficile de rendre en tchèque cette duplicité de langage.
Il y aurait quelques améliorations à apporter au texte tchèque à quelques endroits où le traducteur a fait un contresens (les deux autres versions du drame peuvent apporter de précieuses lumières sur le sens de certaines expressions). Par ex. dans le dialogue d’adieu au 2e acte De Ciz dit clairement à Ysé :
– Il ne faut pas être dure. Bientôt je ne serai plus avec toi. Adieu, mon cœur.
C’est la rupture définitive. Il est absurde de traduire : Désormais je ne serai plus qu’avec toi.
Dans le 2e acte dans leur dialogue d’amour Ysé dit à Mesa :
– Certes, il convient que je sois belle pour ce présent que je t’apporte.
Mesa. – Une chose inestimable en effet.
Le « présent » a ici exclusivement le sens de don et non pas d’une séquence de temps. Ces erreurs sans grande importance dans une prose rendent malheureusement certains passages de ce drame poétique incompréhensibles.
Dans l’acte III, au moment de la mort imminente des protagonistes, la question de Dieu se pose à tous. Claudel installe une icône dans le décor, il fait chanter par un enfant un chant évoquant les Lamentations du Vendredi Saint. Le drame reçoit donc à la fin une forte couleur
liturgique et religieuse ce qui ne se remarque pas assez dans la traduction. Mesa, qui reconnaît qu’Ysé a fini par le christianiser à travers son péché, s’identifie au Crucifié, jusqu’à faire sienne la parole célèbre du Christ dite à l’âme de sainte Angèle de Foligno : « Je ne t’ai point aimée pour rire ! » Le lecteur tchèque reste au niveau existentiel sans issue véritable, sans cette merveilleuse issue de la Foi et de la grâce que Claudel n’a pas cessé de chanter tout au long de son œuvre.
Sœur Barbora Turkova
Raphaèle Fleury, Paul Claudel et les spectacles populaires. Le paradoxe du pantin, Paris, Classiques Garnier, « Études de littérature des xxe et xxie siècles », 2012
Les lecteurs du bulletin connaissent Raphaèle Fleury par les divers articles qu’elle a publiés dans le bulletin, en particulier celui consacré au « projet du marionnettiste Georges Lafaye pour L’Ours et la Lune », paru dans le no 191, et celui intitulé « Claudel et le théâtre populaire », publié dans le no 198, qui reproduisait le texte d’une intervention faite à Brangues dans le cadre des Rencontres de 2009. Auteure d’une thèse précisément consacrée aux Influences du spectacle populaire sur le théâtre de Claudel (1868-1955), dirigée par Denis Guénoun et soutenue en novembre 2008 à l’université de Paris-Sorbonne, elle a repris et publié ce travail cette année dans la collection des Classiques Garnier. Cet ouvrage apparaît d’emblée comme une somme de presque 900 pages – un peu plus de 700 si l’on s’en tient au texte proprement dit, complété par un précieux dossier iconographique, quelques annexes, la bibliographie et un index très complet, avant la table des matières.
Un travail d’une telle ampleur étonne a priori sur un sujet quelque peu paradoxal : en effet, Claudel reste prisonnier du cliché qui le présente comme un auteur difficile dont le théâtre, plus poétique que dramatique, serait réservé à une élite. On sait que ses textes n’ont accédé que tard à la scène et qu’il a vraiment fallu le choc engendré par les représentations par Barrault du Soulier de satin en 1943-44, précédé du succès à Paris des représentations de L’Annonce faite à Marie par le Rideau des jeunes en 1941, pour que le théâtre claudélien s’impose durablement à la scène, en France, mais aussi à l’étranger : c’est ainsi que Claudel, préfaçant l’ouvrage que lui consacre Louis Barjon en 1953, précise : « le poète abscons que l’on s’est si longtemps et si obstinément efforcé d’isoler est devenu, si j’en crois les succès partout obtenus, le seul auteur aujourd’hui d’un théâtre vraiment populaire, s’adressant à toutes les âmes et accessible à tous les cœurs ». Cette citation ouvre l’introduction générale de l’ouvrage. Pourtant, ce n’est pas cette perspective historique, voire sociologique, que l’auteure a creusée : selon une approche principalement esthétique et pragmatique, il s’agit de s’interroger sur la dramaturgie des œuvres dramatiques claudéliennes en montrant comment celles-ci n’ont cessé de tirer parti de la théâtralité des spectacles dits populaires. Si le travail de Raphaèle Fleury se situe ainsi dans la lignée des grandes études universitaires consacrées à la dramaturgie claudélienne – en particulier
le travail fondateur de Michel Lioure, prolongé par les études de Michel Autrand et par tous les travaux consacrés plus spécifiquement à Claudel comme praticien de la scène (citons en particulier Yehuda Moraly ou Alain Beretta) –, son angle d’approche est singulier en ce qu’il rassemble, derrière l’étiquette de « spectacle populaire », « une catégorie de pratiques scéniques rassemblant théâtre d’ombres ou de marionnettes, numéros de cirque, de café-concert ou de music-hall, et autres attractions foraines » (p. 23), c’est-à-dire une « forme pure du spectaculaire », contre une approche littéraire du théâtre. Dans les débats du tournant des xixe et xxe siècles sur la question du théâtre populaire, il s’agit de montrer que Claudel a écrit pour le peuple, non seulement à sa place, comme il le signifiait dans une lettre célèbre à son ami Maurice Pottecher, mais aussi à son intention. De là la recherche d’une efficacité scénique qui entre en interaction avec un projet apostolique sous-jacent et qui aboutit à des constructions dramaturgiques inédites redéfinissant fondamentalement le rapport entre la scène et la salle en jouant tour à tour de la connivence et de la provocation.
L’étude s’organise en trois parties. La première, de manière très classique, sous le titre général « Contacts et circonstances », examine « Claudel spectateur des spectacles populaires ». Si Claudel, contrairement à certains de ses contemporains, « n’a pas explicitement revendiqué d’influence directe de ce répertoire et de ces arts dits mineurs, ne professe pas une passion exacerbée pour ces formes de spectacles, et n’établit pas de système idéologique ou esthétique qui s’en inspire » (p. 49), toute sa vie l’a confronté à ce type de spectacles. Dès l’enfance, il a ainsi connu des spectacles de foires et de jardins publics, des fééries, des spectacles de marionnettes et le théâtre d’ombre, sans oublier les spectacles vus lors de l’Exposition universelle de 1889. Ensuite, le séjour en Chine lui a permis de connaître une multitude de formes théâtrales populaires, confortant la connaissance du théâtre chinois acquise à New York. Dans l’écriture de L’Ours et la lune, en 1917, on trouve l’influence de sa fréquentation du théâtre de marionnettes les Piccoli à Rome, et peut-être celle du mamulengo brésilien, avant que les projets de représentation ne lui fassent connaître les spectacles de marionnettes du musée Grévin. Au Japon, il s’intéresse au kabuki, au kyôgen et au bunraku. Enfin, de manière historiquement plus diffuse, Raphaèle Fleury fait le point sur l’attitude contradictoire de Claudel à l’égard du cinéma et de l’ensemble des spectacles de variété (café-concert, music-hall et cirque). L’ensemble de ces contacts, aussi divers soient-ils, ont pu susciter des
jugements négatifs comme enthousiastes, des témoignages sommaires comme abondants, avec une évidente marge d’approximation dans leur connaissance réelle : Raphaèle Fleury le reconnaît bien volontiers et si la compréhension de l’œuvre claudélienne s’enrichit de la connaissance de telle ou telle source probablement sous-jacente, il faut également se méfier du travers universitaire qui croit toujours identifier des influences ou résurgences, tandis que l’invention artistique est tout aussi possible. Est issu de ces fréquentations « un ensemble de techniques et de ressorts qu[e Claudel] a progressivement intégrés à son théâtre à mesure que la possibilité de le faire jouer s’est accrue » (p. 226), ce qui lui a permis d’accompagner, voire de précéder la révolution théâtrale du début du xxe siècle contre l’aristotélisme et le textocentrisme. L’intérêt de cette partie vient principalement de l’habileté de l’auteure à faire parler toutes les références glanées notamment dans le Journal et les correspondances de Claudel à l’aide d’une documentation riche et abondante qui apporte un vrai complément par rapport aux études antérieures sur les sources de la dramaturgie claudélienne.
Les seconde et troisième parties portent un même sous-titre : « Mises en œuvre des ressources du spectaculaire populaire ». Plutôt qu’une organisation chronologique, Raphaèle Fleury a rassemblé dans la seconde partie tout ce qui relève de l’influence des spectacles d’effigies : marionnettes et pantins, théâtre d’ombre et cinéma. La troisième partie, intitulée « Spectacles de variétés, entre jeu et cruauté », aborde successivement « Les corps spectaculaires », « Le geste et le jeu », « Musique populaire et spectacle en “miousic” », « Machines et trucs ». Il n’est pas possible de synthétiser, dans ces quelques pages, l’ensemble des analyses produites qui ont le mérite de prendre en compte la totalité du théâtre de Claudel, même si les œuvres scéniques plus tardives du poète, à dimension expérimentale, ont naturellement le plus de place. On est également impressionné par l’usage qui est fait de toutes les études antérieures sur le théâtre de Claudel, Raphaèle Fleury partant des acquis pour les approfondir, nuancer, voire corriger. Elle tire par exemple très bien parti de la thèse de Sever Martinot-Lagarde, hélas encore inédite, sur La Bouffonnerie dans le théâtre de Paul Claudel, mais exploite également les travaux de Dominique Millet-Gérard avec le souci d’interpréter toujours dans un sens symbolique, philosophique et théologique les options dramaturgiques de Claudel. On apprécie particulièrement les analyses qui soulignent le sens symbolique fort des marionnettes ou des pantins, qui étudient la gestion de la scène avec ses différents niveaux ou
ses jeux d’ombres et d’arrière-plans, qui explorent le rapport complexe du théâtre et de la religion. À ce sujet, on relève en particulier ces très riches pages où Raphaèle Fleury définit le « paradoxe du pantin » en prenant en compte le rapport du spectacle et du mal et la question de l’herméneutique forcément diverse du spectacle par le public (p. 271-277) ; elle y revient dans la conclusion de la troisième partie autour des notions d’« appâts » et de « pièges » (p. 692-696) qui trouvent, avec le fameux récit de la conversion, un comparant séduisant. Enfin, sa conclusion générale creuse la difficile question du rapport entre théâtre et liturgie, sans masquer le « problème interprétatif » général qui reste ouvert. La foi catholique du poète est-elle le ciment des divers aspects de sa personnalité, y compris artistique, ou faut-il donner une place autonome à un Claudel artiste, capable d’exploiter à la scène des procédés qu’il réprouve moralement comme spectateur par ailleurs ? Jamais l’auteure n’enferme le rapport entre le dramaturge et ces formes théâtrales populaires dans une théorie : Claudel n’est pas Craig ou Brecht. C’est un rapport pragmatique à la scène qui l’emporte, multiple et parfois contradictoire. L’auteure souligne ainsi certaines incohérences techniques, par exemple dans l’emploi hétérogène de différents types de marionnettes dans L’Ours et la lune. Cette faiblesse en fait paradoxalement la force dans la mesure où il y a là toujours de quoi provoquer, émoustiller les professionnels de la scène afin d’ouvrir le champ à de nouvelles pratiques ; on sait que rien n’est plus dangereux qu’un théâtre précisément conçu pour un type de scène dans la mesure où il risque de vieillir aussi vite que les techniques dramatiques de son époque. Raphaèle Fleury souligne également le danger de faire de Barrault le réalisateur des ambitions scéniques claudéliennes : on connaît le dialogue constant, mais aussi les échanges parfois vifs, entre le dramaturge et le metteur en scène, celui-ci ayant parfois précisément du mal à suivre Claudel dans le champ des expérimentations scéniques où la recherche de l’efficacité dramatique l’emportait sur toute valeur poétique et littéraire. Peut-être manque-t-il parfois précisément une interrogation critique sur la pertinence esthétique des choix dramaturgiques de Claudel – les quelques expériences où il a pu avoir un vrai contrôle de la représentation n’ont généralement pas été les plus appréciées –, de même que le portrait de Claudel en « metteur en scène » s’essayant dans la « direction de spectateurs » pose le problème du statut d’indications qui relèvent du texte et non de la pratique scénique ; mais l’étude, nourrie de multiples et riches analyses du texte claudélien envisagé de manière exhaustive,
ne peut qu’impressionner par son envergure, sa rigueur intellectuelle et la qualité de l’information et de la réflexion. Écrite dans une langue claire, jamais jargonnante, elle vient compléter précieusement le corpus des études sur la dramaturgie claudélienne.
Pascal Lécroart
Jacques Houriez, Paul Claudel ou les tribulations d’un poète ambassadeur. Chine, Japon, Paris, Paris, Honoré Champion, 361 p.
L’introduction de cet ouvrage est intitulée Pourquoi Claudel ? Elle pose le portrait d’un auteur dans « la violence de ses contradictions et de ses luttes intérieures », contradictions auxquelles s’ajoutent les « contraintes » et les « désaccords » d’un « double rôle », celui d’artiste créateur et celui de diplomate économiste. Après quelques pages sur Claudel dramaturge et la réception de son œuvre, l’auteur se demande si le poète a « gardé parmi nous quelque étrangeté », et se propose de suivre ses « expériences humaines » pour expliquer « la difficulté qu’ont pu avoir l’œuvre et l’homme à se faire reconnaître. »
L’Auteur et son public (1) est une étude de réception de l’œuvre dramatique et poétique de Paul Claudel, de sa diffusion dans l’édition et la presse du début du xxe siècle, et sur le rôle important joué par André Gide dans les publications parisiennes de plusieurs œuvres importantes (notamment L’Échange et L’Otage).
Puis c’est La rencontre de la Chine (2), la Chine des morts et des démons, mais aussi celle des Jésuites et du Tao, cette « doctrine » à laquelle Claudel « semble avoir adhéré immédiatement, mais en la christianisant ». À ce titre, les pages consacrées au Repos du septième jour, le drame composé en Chine en 1896, se fondent essentiellement sur l’influence supposée des traductions du Père Léon Wieger : Folklore chinois moderne (1909) et Textes philosophiques (1930). Dans Le Consul de Fou-tchéou (3), l’auteur revient sur les missions les plus souvent étudiées, la reconstruction de l’arsenal de cette même ville, la construction de la ligne de chemin de fer Pékin-Hankéou, ou encore l’affaire de la Pagode de Ningpo. Dans La diplomatie du Consul (4), l’étude de l’affaire de Monyang, liée aux conséquences d’incendies d’églises missionnaires en 1887, de même que celle de la mission ayant donné lieu à un « voyage au Shansi » (Shanxi) en 1908, proposent quelques informations un peu moins connues. L’ouvrage en revient ensuite à La Chine de l’économiste (5), qui sous-tendait la plupart des missions précédentes, principalement à partir des travaux de Christopher Flood et d’Ilhan Alagoz, pour le Livre sur la Chine et Sous le signe du Dragon. C’est sur les Agendas de Chine que repose le chapitre suivant (6), pour examiner le « regard intérieur », qui apparaît comme « tout autre » par rapport à celui de l’économiste, de 1896 à 1899. On peut alors suivre les lectures de Claudel, indiquées par de brèves notations des titres lus pendant cette période ; mais aussi
ses voyages ou promenades dans les campagnes chinoises qui sont à l’origine de certains poèmes de Connaissance de l’Est.
Le chapitre suivant (7) passe à la partie japonaise de Connaissance de l’Est, en référence au premier voyage que Claudel fit au Japon en 1898. Il examine dans ce cadre plusieurs textes importants, en particulier Le Pin, L’Arche d’or dans la forêt, ou encore Le Promeneur. Dans ses analyses, Jacques Houriez insiste sur le pouvoir de « perception originale » du poète, observateur actif qui réunit toutes les facultés de perception et de composition de son objet. De son point de vue, l’objet observé – en l’occurrence ici le monde naturel – n’est qu’un « prétexte » livré au « hasard », comme les couleurs du pin et de l’érable, mais le poète parvient à corriger « l’erreur qui fait oublier la réalité de la chose pour son utilité. » Le Japon de Claudel (8) aborde le séjour diplomatique de 1921, et en particulier les poèmes du recueil Cent Phrases pour éventails, apparaissant dans une « écriture du souffle ». Le deuxième volet, « Ambassadeur et poète au Japon » se penche sur les rapports amicaux entre Claudel et l’orientaliste français Léonard Aurousseau, membre de l’École Française d’Extrême-Orient, dont la correspondance a été publiée par Shinobu Chujo.
Le lecteur est ramené en France dans le chapitre suivant (9), qui étudie les relations de Paul Claudel avec la presse, la réception de son théâtre (Gabriel Marcel, François Mauriac), enfin ses rapports avec l’Académie française. Deux ambassadeurs devant leur époque (10) présente ensuite une analyse comparée originale des carrières diplomatiques de Paul Claudel et du comte Wladimir d’Ormesson. Le chapitre qui suit, consacré à La dramaturgie claudélienne (11), présente un « théâtre symbolique », marqué par la parabole, le lyrisme et le « drame personnel ». Dans un dernier mouvement, il revient au Japon, pour considérer l’influence du théâtre Nô comme un « approfondissement du sacré ». Dans De la destruction de la Ville à la cité de l’avenir (12), c’est la « tentation anarchiste » qui est examinée ensuite, en particulier dans Tête d’Or et La Ville, pour aboutir finalement à un « projet social concret » dans différents textes et conversations plus tardifs de Claudel.
Le chapitre De la Chine à l’Europe (13) envisage pour finir différentes analyses ou représentations des particularités nationales ou continentales dans les textes de Claudel, en montrant cette « obsession de l’unité » et ce « rêve d’unanimisme pacifique » qui sont bien d’un diplomate.
La conclusion est intitulée Le Créateur et l’homme, elle en revient à la question des contradictions qui ont caractérisé le poète en « éternel
insatisfait », en interrogeant cette fois la distinction à faire entre l’artiste et l’homme du quotidien. Est-ce finalement ce qu’on appelait autrefois la « sagesse de l’Orient » qui permit à Paul Claudel de dépasser ces contradictions ? C’est ce que semblent suggérer les dernières lignes de l’ouvrage en remarquant que la « passion de l’univers née en l’enfant s’est épanouie en désir de fraternité. Et ce même désir, malgré l’européocentrisme dominant de l’époque, l’a ouvert aux sagesses orientales. »
Yvan Daniel
Aidan Nichols, o.p., The Poet as believer, A theological study of Paul Claudel, Ashgate, 2011, XI-275 p.
Le sujet est immense, central, intempestif (unzeitgemäss).
« Cet élargissement et cet enrichissement du patrimoine – écrivait déjà Charles Journet en 1943 –, cette réintroduction de l’univers de la révélation dans la matière du dialogue que le poète noue avec le peuple, Verlaine l’a commencée discrètement, délicatement, musicalement. Péguy s’y est pris différemment, nous persuadant, par l’incantation de son incomparable dialectique, de rentrer en possession consciente des trésors que nous portions enfouis au plus profond de nous-mêmes. Mais Claudel n’a usé d’aucun ménagement. Il a comme pris plaisir à déchirer les voiles sous lesquels se dissimulaient les cœurs, pour découvrir brusquement au-dessus d’eux l’immensité oubliée des constellations. Sa confession de foi a éclaté comme une bombe au milieu des lettres françaises déchristianisées. Il a réintroduit par un coup de force le bloc des vérités révélées dans un monde qui pensait les avoir exorcisées pour de bon. Et il n’a eu besoin pour cela, comme Léon Bloy, que de l’extraordinaire, solitaire, mais victorieuse puissance de son art1. »
Pour Claudel, on le sait, « l’objet de la poésie […], c’est cette sainte réalité, donnée une fois pour toutes, au centre de laquelle nous sommes placés. C’est l’univers des choses visibles auquel la Foi ajoute celui des choses invisibles. C’est tout cela qui nous regarde et que nous regardons. Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui fait la matière inépuisable des récits et des chants du plus grand poète comme du plus pauvre petit oiseau2. »
O credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte avec un cœur catholique3 !
C’est cette « catholicité » qui a retenu Aidan Nichols – dans le double sens (qui ne fait qu’un, en réalité, dans l’œuvre de Claudel) d’un attachement passionné à la Tradition de l’Église catholique et d’une universalité qui embrasse le monde tout entier de la création et de la civilisation (cf. op. rec., p. 266).
L’auteur aborde Claudel comme poète et penseur religieux. Sa perspective se veut résolument théologique, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage. « Son » Claudel (« My Claudel ») est avant tout, dit-il, un poète de la liturgie et des saints, et, dans cette mesure même, poète de la création, de la rédemption et de l’eschatologie, même lorsqu’il ne parle ni des saints ni de la liturgie. L’œuvre tout entière de Claudel n’est pas seulement « métaphysique » et « existentielle », mais aussi « spirituelle, religieuse et ecclésiale » (p. x).
L’étude d’Aidan Nichols consiste en une lecture en quelque sorte linéaire d’un certain nombre d’œuvres du poète où la dimension religieuse apparaît de la manière la plus évidente.
Un premier chapitre est consacré à un survol de la vie et de l’œuvre de Claudel en 18 pages (l’ouvrage s’adresse à un public anglophone, pour qui le poète français n’est pas nécessairement familier), appuyé sur les biographies de M.-J. Guers (Paul Claudel. Biographie, Actes Sud, 1987) et de L. Chaigne (Vie de Paul Claudel et genèse de son œuvre, 1961). Chaque chapitre présente ensuite une œuvre ou un ensemble d’œuvres : Les Cinq grandes odes (chap. 2), les « Traités » qui composent l’Art poétique (chap. 3), La Messe là-bas (chap. 4), le cycle du Temporal, de Noël au Vendredi saint (chap. 5), de Pâques au Christ-Roi (chap. 6), le cycle du Sanctoral (chap. 7), les écrits sur la Vierge Marie (chap. 8, « The Mother of the Lord »), Claudel commentateur de la Bible, à partir du texte : Du sens figuré de l’Écriture et des commentaires sur l’Apocalypse, le Cantique des cantiques et le Livre d’Isaïe (chap. 9), enfin un « aperçu » sur le théâtre (chap. 10).
Cette « étude théologique » consiste à marquer les références et allusions théologiques ou liturgiques du texte claudélien. Des remarques intéressantes, des éléments éclairants4, sont ainsi relevés au fil d’une lecture suivie. Mais celle-ci ne se démarque pour ainsi dire jamais de la paraphrase ou d’une traduction prosaïque et reste un peu myope.
On aurait aimé en effet voir se dégager des lignes de fond, les grands thèmes de prédilection auxquels la foi du poète donne voix et contours.
Par exemple : l’Église, le mystère d’Israël, la présence de Dieu au monde, le monde des corps ressuscités, l’Eucharistie, le problème du mal… Nous ne voulons pas dire que ces thèmes ne sont pas présents, mais ils ne sont pas regardés pour eux-mêmes, seulement épars au gré d’une lecture sur le mode de la paraphrase. Plus encore on aurait aimé voir l’auteur chercher le centre par rapport à quoi tout se comprend.
On aurait attendu que fût au moins posée la question de ce que le don de poésie, lorsqu’il s’empare des vérités de la foi, apporte à ce que la théologie peut en dire. Ou encore ce dont la foi et la vie théologale du poète enrichissent sa condition d’homme et son expérience de poète, par exemple face à la beauté et à la contingence de ce monde (l’auteur a bien vu que la question qui est au cœur de l’Introït de La Messe là-bas est centrale, omniprésente chez Claudel ; mais est-elle bien posée ? S’agit-il exactement de réconcilier la primauté de l’amour de Dieu avec l’amour de la création ?)
Reconnaissons-le, ce livre nous laisse un sentiment de déception. Il pourra sans doute aider le lecteur anglophone à entrer dans l’œuvre de Claudel et à prendre la mesure de sa portée théologique. Mais ce n’est pas l’étude sur « Claudel le théologien » dont le Père de Lubac, invoqué à la fin de la Préface, appelait de ses vœux.
fr. Michel Cagin
Bostjan Marko Turk, Paul Claudel et l’actualité de l’être. L’inspiration thomiste dans l’œuvre claudélienne, « Croire et savoir », Paris, Téqui, 2011, 384 p.
L’auteur s’inscrit dans la recherche récente sur la restitution de Claudel à son inspiration puisée dans saint Thomas d’Aquin5. Son étude présente chacun des thèmes présents dans le corpus claudélien qui peuvent être rapportés au thomisme (I. L’Art poétique ; II. Cinq grandes odes ; III. Ego sum). L’ensemble est fouillé et manifeste une aisance remarquable de l’auteur dans l’œuvre de Claudel. Les thèmes claudéliens que sont l’acte, l’être, la finalité, la connaissance, le temps et la cause, sont ainsi éclairés.
Si nombre de développements – appuyés par de substantielles citations – viennent étayer l’affirmation selon laquelle le thomisme de Claudel fut un choix conscient et un adieu au kantisme et au cartésianisme (p. 10), en revanche, apparaît aussi, tout au long du livre, la différence entre le mode poétique et le mode philosophique. À tel point que l’on se demande parfois si Claudel et Thomas parlent de la même chose, ou, plutôt, en parlent au nom de la même chose, discours propre chez Thomas, jeu métaphorique chez le poëte. Certes, l’auteur nous prévient de l’erreur qui « consiste à prendre l’être dans le sens strict de la définition gilsonienne et à en faire la preuve du non-thomisme de Claudel » (p. 18). Néanmoins, ce sont bien des mêmes réalités que les deux géants entendent parler, l’un appuyé sur l’autre. La différence d’approche n’en est que plus flagrante, par exemple pour tout ce qui concerne l’analogie et la théologie négative (p. 157 sq., 233 sq., 327 sq.) L’auteur fait état de telles différences.
Toutefois, s’il est permis d’émettre un regret, c’est à propos de ces différences mêmes. Il eût été intéressant d’en apprendre davantage, en quelque sorte au second degré, sur quel type de thomisme dont disposait Claudel, sur ce qu’il en était du thomisme de son époque. Nous savons mieux aujourd’hui combien les cadres interprétatifs ont différencié les lectures de saint Thomas, parfois malgré les apparences. Or la perception des modèles métaphysiques, disons des écoles d’interprétation, semble échapper pour une part à la construction de l’ouvrage. Les références secondaires aux œuvres des thomistes eussent gagné, à ce titre, à rendre compte des choix qui ont précédé à leur sélection (elles sont d’inégale autorité).
Certes, mieux vaut parler de la façon dont Claudel reçoit et entend saint Thomas lui-même : cela est fort défendable. Néanmoins, dans la mesure où Claudel se réfère sans cesse à Thomas et de surcroît sous le mode de l’interprétation poétique, il eût été passionnant de comprendre comment une telle lecture est à la fois autre que Thomas lui-même et peut-être aussi dépendante de ses principes. Tout cela, afin de prendre davantage la mesure de l’approche claudélienne et de sa spécificité. Les deux auteurs, dont les thèmes ne cessent de s’approcher, semblent parfois juxtaposés. Mais pourrait-il en aller autrement ?
La beauté et la profondeur des idées claudéliennes rapportées par l’auteur sont bien mises en valeur, avec cependant des néologismes parfois inutilement sophistiqués.
Thierry-Dominique Humbrecht
Hélène Hoppenot : Journal 1918-1933, édition établie, introduite et annotée par Marie-France Mousli, éditions Claire Paulhan, 2012.
L’amitié entre Claudel et le diplomate Henri Hoppenot est bien connue. Ce dernier a relaté en 1961, dans sa préface à l’édition de la Correspondance entre Claudel et Darius Milhaud (Cahiers Paul Claudel 3, Gallimard), les épisodes essentiels de sa rencontre avec le poète en 1914 et les relations qui s’en sont suivies. Puis en 1993, Michel Lioure a présenté dans le Bulletin de la Société Paul Claudel no 131, onze des 65 lettres écrites par Claudel à Hoppenot de 1915 à 1951. C’est à présent grâce au Journal de l’épouse d’Henri, Hélène, qu’on en apprend beaucoup plus sur le diplomate-écrivain, essentiellement au long de l’année 1918 où les trois protagonistes se fréquentent quasi quotidiennement au Brésil. Rappelons que Claudel, nommé en novembre 1916 ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro, y avait débarqué le 1er février 1917, accompagné par Milhaud comme secrétaire particulier. Un an plus tard, Henri Hoppenot, en tant qu’« attaché autorisé », et sa jeune épouse rejoignent ce « campement diplomatique », et dès lors, de février à novembre 1918, ils partageront l’intimité de Claudel et Milhaud, créant ainsi des liens de toute une vie.
Dès son arrivée à Rio, Hélène commence à écrire un Journal, destiné à relater son apprentissage de la vie diplomatique. La jeune femme de 24 ans s’effraie un peu de devoir assumer la fonction de représentation, d’autant que Madame Claudel est restée en France et que c’est donc à elle que revient le rôle de « dame » de la légation de France. Mais elle va vite s’en acquitter avec succès : femme moderne et indépendante, en parfaite harmonie avec son mari dont elle partage les goûts culturels, elle s’instruit beaucoup auprès de mentors peu ordinaires comme Claudel et met à profit ses talents artistiques, notamment musicaux.
Hélène Hoppenot (1894-1990) a longtemps hésité à faire publier son Journal, car elle n’y trouvait « aucun intérêt, mais du journalisme primaire, et quant au style, mieux vaut n’en pas parler6 ». Cette autocritique est évidement excessive. Certes Hélène Hoppenot n’a pas fait œuvre d’historienne, mais elle donne « sa vérité de l’histoire » : comme l’écrit dans son introduction Marie-France Mousli, « ces milliers de pages font revivre une époque avec des personnages du monde diplomatique, politique et artistique, qu’elle croque d’une plume acérée en réussissant à être à la fois actrice et observatrice » (p. 15). Ce document, qui s’étend de
1918 à 1980, avec quelques interruptions, a d’abord été déposé partiellement, sous forme de tapuscrit, en 1973 à la bibliothèque Jacques-Doucet, puis Hélène continue à écrire jusqu’au 13 février 19807, au lendemain du jour où elle a vu, lors d’une projection privée, une interview de son mari décédé en 1977, après plus de 60 ans de mariage, émotion qui lui a fait clore son Journal. Henri fut d’ailleurs le seul autorisé à lire le journal de son épouse, qui avait stipulé qu’on ne le publie que 20 ans après sa mort : aussi Claire Paulhan a-t-elle attendu 2012 pour éditer le premier tome, couvrant les années 1918-1933. En complément de ce Journal, Hélène Hoppenot a regroupé ses agendas dans un éphéméride permettant de reconstituer son emploi du temps pendant les périodes sans journal. De plus, sont déposées à la bibliothèque Jacques-Doucet ses nombreuses lettres à près de 300 correspondants, dont Milhaud, Léon-Paul Fargue, Blaise Cendrars, Adrienne Monnier, Sylvia Beach, Alexis Leger et Jacques Rivière. Mais c’est Claudel qui, le premier, la fascine et l’occupe principalement au long des quelque 80 premières pages de ce Journal consacrées à l’année 1918.
Sous le regard d’Hélène Hoppenot, le grand poète-diplomate se trouve pour le moins démythifié. Le naturel de la jeune femme lui fait brosser un portrait sans complaisance de celui que ses amis appellent « le cacique », et elle fait preuve d’un humour qui frôle parfois la caricature dans la dérision. La première impression d’Hélène est naturellement physique : « Paul Claudel est plutôt petit. Cheveux châtains, yeux d’un très beau bleu, bouche sarcastique et sensuelle, un peu trop recouverte par une moustache inégale et court taillée. Si le visage est ingrat, le regard est magnifique ; le corps semble prêt à dégager une charrue embourbée » (p. 38). Simultanément, Claudel révèle très vite son tempérament impulsif, où dominent deux traits qui ne feront que s’intensifier au fil des jours : son esprit facétieux et son égocentrisme. Le premier aspect se manifeste dès la première rencontre : alors qu’Hélène est intriguée par l’inutilité d’une fausse porte du bureau ministériel, Claudel lui dit : « Derrière, il y a le cadavre de mon dernier secrétaire » (p. 38). Quelques jours plus tard, l’humour noir devient moquerie osée lorsque Claudel glisse à l’oreille d’Hélène que la femme d’un attaché naval américain, qui est pourtant proche d’eux, ressemble à « un vrai singe femelle » (p. 46) ou lorsque le poète, lors d’une réception musicale,
parodie, « avec d’incroyables roulements d’yeux et sans le souci des invités qui l’entourent », une jeune fille qui chante après avoir, reconnaît Hélène, « mâché laborieusement des vers de Musset » (p. 56). L’audace de Claudel bravant la politesse mondaine est telle que la presse brésilienne n’hésite pas parfois à blâmer « le diplomate gaffeur » (p. 59), que ses distractions et sa sauvagerie (il ne fréquente guère ses collègues) achèvent de rendre marginal. Mais c’est surtout son égocentrisme qui choque Hélène, et en particulier sa volonté de soumettre ses amis à ses désirs : « le cacique ne tolérerait pas que nous échappions à l’une de ses corvées. “Ce sont là mes raffinements”, fait- il. Une allusion à sa tyrannie » (p. 69). C’est ainsi qu’après Audrey Parr, qui semble avoir pris ses distances, Hélène est « exploitée » pour effectuer des découpages et collages destinés à des œuvres de Claudel (ou Milhaud) : « Ce serait passionnant s’il ne changeait d’idée toutes les cinq minutes et s’il n’exigeait pas de défaire ce qui n’était déjà qu’ébauché » (p. 50-51), sans parler de son impossibilité d’attendre. Mais c’est Milhaud qui, sans jamais se rebeller, paraît être le plus victime de l’intransigeance claudélienne, subissant des humiliations tant matérielles (un petit salon qui lui était affecté est subitement offert à Audrey Parr) que morales : Claudel n’hésite pas à critiquer parfois ses compositions musicales ainsi que sa pratique des rites juifs : ne voudrait-il pas le convertir ?
Mais si Hélène s’avoue irritée par le comportement de l’homme Claudel, elle reconnaît au diplomate plusieurs qualités, à commencer par sa compétence professionnelle, dans des circonstances pourtant problématiques. En effet, rappelons que le Brésil a déclaré la guerre à l’Allemagne en avril 1917 et que le ministre de France y occupe un poste économique : concrètement, Claudel est chargé de négocier l’achat de denrées (café, matières premières) et l’affrètement de navires ex-allemands. Or, depuis son arrivée, il s’est trouvé en difficultés commerciales et politiques avec les Brésiliens. Cependant, il a su les résoudre efficacement, avec une conscience aiguë de la réalité. Par exemple, alors que le chef de la mission économique anglaise, Sir Maurice Bunsen, voulait en mai 1918 acheter du café et utiliser pour son transport les derniers bateaux allemands confisqués, « Claudel, en deux minutes, lui a démontré qu’il ne restait plus un sac de café sur place » et lui a conseillé d’« acheter du caoutchouc et donner du charbon » (p. 69)8. Par ailleurs, le diplomate
manifeste un réel désir de découvrir le Brésil dans sa vérité autant qu’il le peut, de préférence hors des sentiers battus (il fuit le carnaval), parfois même dans des circonstances aventureuses : il confie ainsi à Hélène qu’en juin 1917, il a fait un voyage dans la forêt vierge avec Milhaud, dans un train qui a été arrêté par deux chefs de bande rebelle armés, auxquels il a dû donner asile.
Néanmoins, les difficultés professionnelles rencontrées, et plus encore l’éloignement des siens, amènent Claudel à vouloir quitter le Brésil, mais deux demandes de congé lui sont refusées au printemps 1918, son supérieur Philippe Berthelot lui demandant de rester encore six mois : le congé sera effectivement obtenu fin septembre, peu avant l’armistice. Lorsque Claudel manifeste sa détresse d’exilé, l’homme facétieux devient grave et s’épanche parfois pour livrer, toujours brièvement, le fond de son cœur, notamment auprès de Milhaud : « Il lui a dit que la plus grande révélation de sa vie – si on excepte sa conversion – a été la découverte de la Chine, suivie de celle de l’amour » (p. 72). Faisant un jour le bilan provisoire de son existence, il avoue à Hélène : « Il m’a toujours semblé qu’une main invisible me conduisait à travers les plus petits événements de la vie. J’agis toujours avec la même décision dans le bien comme dans le mal » (p. 84). Hélène admire en particulier la profondeur de sa piété et de son attachement à ses enfants (alors qu’il n’a encore jamais vu sa dernière fille).
Outre l’individu et le diplomate, c’est également l’homme de lettres qui apparaît dans le Journal d’Hélène Hoppenot, à la fois à travers ses goûts artistiques et ses propres œuvres. On sait le rejet claudélien d’une grande partie de la littérature française : il réapparaît ici, en particulier à l’égard de Victor Hugo (pourtant très respecté au Brésil), d’Anatole France, d’Ernest Renan et d’André Gide, qui « a une telle envie d’avoir la rosette de la Légion d’Honneur que des verrues lui ont poussé à la place » (p. 50). Ajoutons-y une moquerie envers Goethe, dont « la plus grande joie fut certainement d’avoir tenu le crâne de Schiller dans ses mains » (p. 54). En revanche, Claudel fait un vibrant éloge de Baudelaire, qui « seul avec Chénier et Racine manie l’alexandrin avec aisance et lui fait rendre quelque chose », mais qui « est parfois obligé d’exprimer en deux vers ce que Virgile a exprimé en trois mots et avec d’aussi belles images. Celui-là est d’une perfection décourageante… Il est bien plus
grand que Dante » (p. 70), poète pourtant fort apprécié, surtout pour son Enfer. D’une manière plus générale, Claudel avoue préférer les romans anglais aux français, « car à côté de longueurs interminables, on y trouve tout à coup une idée, un passage intéressants » (p. 42). Plus précisément, le poète se vante d’avoir été le premier à faire connaître Conrad au public français, regrette de n’avoir pu traduire Orthodoxy de Chesterton, et avoue goûter fort les œuvres de Wells et Kipling, tout en plaçant bien au-dessus d’eux Thomas Hardy. La chose écrite a une telle importance pour Claudel que, selon Hélène, « il ne cherche dans l’art que le côté littéraire » (p. 107). C’est le cas en peinture : visitant une exposition, Claudel rejette brutalement le tableau de Maurice Denis Les Régates au profit d’une toile d’Albert Besnard, La Source, dont le motif l’inspire plus, et « il avoue volontiers qu’il cherche surtout la littérature chez les peintres : Rubens et Tintoret n’ont jamais été dépassés » (p. 43). De même en musique, Tannhäuser est l’œuvre de Wagner qu’il admire le plus, car « qu’y a-t-il de plus beau que ce sujet ? » (p. 107), tout comme, dans la Symphonie Pastorale de Beethoven, « ce qui l’amuse, ce sont les bruits de la nature : l’orage, le rossignol, le coucou » (p. 107). Claudel se montre au moins aussi passionné par la danse : l’année précédente, il avait admiré Nijinski à Rio, mais, auprès d’Hélène, il est déçu par la Pavlova : « J’ignorais que l’on pût faire des trilles avec ses doigts de pied » (p. 65). D’une manière générale, il estime que « les danseurs ne se rendent pas suffisamment compte que le geste doit toujours suivre la respiration » (p. 71), et pour illustrer cette idée, « il esquisse devant nous quelques mouvements, mais vite à bout de souffle, il est obligé de s’asseoir » (p. 71). Le risque du ridicule affecte moins le ministre que son goût pour la facétie, car il renouvelle souvent ses « démonstrations esthétiques » : à l’occasion d’un bain dans un océan glacé, il « exécute une pantomine lourde et désordonnée qu’il appelle la danse du gorille » (p. 91). En fait, c’est sa passion du jeu théâtral qu’il trahit ainsi, à laquelle on peut associer sa découverte enthousiaste de la photographie, sous l’égide d’un certain Perrin (ou Perrier). Claudel admire les clichés pris par ce dernier, surtout une photo de lui poitrine découverte, qu’il fait suspendre dans son bureau au-dessous de la photo de Rimbaud jeune homme ; mais en outre il réalise lui-même quelques portraits dont il est très fier, notamment un du pianiste Arthur Rubinstein, et surtout, il adore poser, même dans les attitudes les plus excentriques,… comme au théâtre. C’est jusque dans le domaine de la mode vestimentaire que se manifeste ce goût claudélien du théâtral : estimant les habits masculins
trop ternes en général, il imagine que, quand il rentrera à Paris, il ira trouver le couturier Poiret pour lui démontrer « que l’habillement actuel des hommes est innommable. Je voudrais les voir revêtus d’étoffes de couleurs éclatantes » (p. 97).
Enfin, Claudel nous livre quelques renseignements sur ses propres œuvres théâtrales. Au sujet de leur mise en scène en général, il déclare assez curieusement : « Gémier est le seul qui ait compris la façon de jouer mes pièces9 » (p. 57), avant d’ajouter : « Je me figure que Rachel eût été pour moi l’interprète idéale ». Plus ponctuellement, le dramaturge revient sur certaines de ses œuvres, souhaitant par exemple que Tête d’Or soit un jour « jouée par des jeunes gens, presque des enfants, sans aucune morgue et comme en s’amusant » (p. 52), ou révélant incidemment la genèse de La Cantate à trois voix : « Un jour, (Claudel est alors en Chine, à Fou-Tchéou), je vis ma femme monter une colline, entourée par deux amies, elle brune, les autres blondes : d’où ma Cantate » (p. 114). Parallèlement à ces œuvres anciennes, il ébauche quelques projets : dans la foulée de L’Homme et son désir, il a confié à la danseuse russe Natalia Trouhanova « le plan d’un ballet qu’elle ne m’a jamais rendu » (p. 71) ; par ailleurs, il a l’intention d’écrire une suite au Père humilié, « une sorte de conclusion des trois pièces » (p. 114).
Mais ce sont évidemment les deux œuvres que Claudel vient tout juste d’écrire qui le préoccupent le plus. En 1917, il a commencé le scénario du ballet L’Homme et son désir, à la suite de sa découverte fascinée de Nijinski, en profitant du talent d’Audrey Parr pour le dessin des décors et costumes, mais en 1918 elle semble avoir abandonné la tâche. Le dramaturge est alors en proie à l’hésitation : « Il a tant d’idées qu’il ne fait pas le choix entre celles qui sont réalisables et les autres » (p. 44), ce qui ne l’empêche pas de se livrer à une lecture publique de l’œuvre et d’expliquer « ses idées nouvelles de mise en scène » (p. 44), notamment la division du plateau scénique en quatre étages. Attentif au moindre détail, Claudel se soucie du choix de l’étoffe destinée à recouvrir les exemplaires du scénario qui seront reliés, et comme il ne peut plus compter sur « l’ingrate fée Margotine » (p. 94), alias Audrey Parr, il s’adresse à un jeune peintre brésilien, Carlos Oswald, tentative qui s’avèrera « un fiasco complet » (p. 102). Outre L’Homme et son désir,
Claudel vient d’écrire une pièce pour marionnettes, L’Ours et la lune, après avoir été « impressionné par les théâtres de ce genre en Italie » (p. 44). À la suite d’une lecture de passages de cette œuvre en mai 1918, il en explique ainsi la genèse : « Je l’ai commencée à Olten10, et j’en ai eu l’idée en voyant mes enfants jouer avec un grand ours qu’ils faisaient sauter à coups de pied. Je leur racontais son histoire » (p. 73).
Claudel a tellement accaparé en tous domaines les Hoppenot que lorsqu’il quitte le Brésil avec Milhaud en novembre 1918, la vie de l’ambassade devient bien terne, au point qu’Hélène abandonnera la rédaction de son journal jusqu’en 1920, au début d’un nouveau séjour diplomatique en Perse. Néanmoins, malgré la séparation, l’amitié continuera à se manifester, essentiellement à travers les correspondances. Avant même ce Journal, on connaissait des lettres de Claudel à Henri : ainsi, dès le 27 novembre 1918, à bord du « Léopoldina » qui vogue entre Rio et New York, il lui écrit qu’il emporte le meilleur souvenir de leur collaboration diplomatique et qu’il reste sensible à la bonne affection témoignée par le couple, avant d’ajouter : « De votre côté, ne m’en veuillez pas de mes coups de boutoir, dont ceux que j’apprécie le plus ne sont pas les plus exempts11 ». Par la suite, Hélène n’oubliera pas son mentor, au gré de lettres ou de rencontres. Le 30 août 1920, alors que les Hoppenot sont en Perse, une longue lettre de Claudel commence par constater avec satisfaction : « Je vois que vous ne m’en voulez pas des mes accès de rudesse et de mauvaise humeur dont vous avez eu à souffrir au Brésil. La poésie et la solitude ne rendent pas tout le monde aimable » (p. 186). Puis l’écrivain enchaîne en donnant quelques nouvelles de ses œuvres : il regrette que la partition de Milhaud pour Protée n’ait pu sortir, et il annonce qu’il a terminé la première « journée » de ce qui s’intitule alors, d’après Calderon, Le Pire n’est pas toujours sûr, « une énorme pièce dans le style espagnol avec une multitude de scènes qui se passent à tous les coins de la terre et même dans l’autre monde » (p. 187). Le 20 avril 1923, Hélène, alors au Chili, rend hommage à Claudel en prénommant Violaine la petite fille qu’elle met au monde. En décembre 1924, dans « une lettre mélancolique », le poète constate amèrement que « sa génération ne l’a pas compris » (p. 364), et il cherche le réconfort chez ses anciens amis. Dans l’été 1925, les Hoppenot répondent à l’invitation des
Claudel au château de Lutaine : leur rencontre évoque notamment le récent mariage de Milhaud, qu’ils semblent tous déplorer. Le 19 juillet 1926, c’est de Tokyo que l’ambassadeur donne de ses nouvelles : il se plaît beaucoup au Japon et annonce son écriture de L’Oiseau noir dans le soleil levant, « livre qui ferait pendant à Connaissance de l’Est » (p. 428). Mais, lorsqu’en mai 1927 Claudel retrouve ses amis à Paris, il a dû quitter le Japon et avoue avoir pleuré en « sachant qu’il ne retournerait plus jamais en Extrême-Orient » (p. 452), d’autant qu’il est fort déçu de son premier contact avec les États-Unis. Claudel reste présent jusque dans les toutes dernières pages du Journal, au cours de l’année 1933. On y apprend notamment qu’il s’est « coulé » mondainement aux États-Unis : tout le monde reconnaît que ses rapports sont remarquables, mais que, personnellement, « il est impossible » (p. 594).
Cette ultime allusion d’Hélène Hoppenot à Claudel semble résumer l’impression contradictoire que lui a toujours faite le grand homme : elle admire ses compétences (diplomatiques et artistiques), mais reste choquée par son tempérament. Ne peut-on pas alors conclure en reprenant ce qu’elle objectait en avril 1918 à Rio au chef de la Légation royale des Pays-Bas qui critiquait l’excentricité du comportement claudélien : « Bah !… Vous pensez vraiment, M. le ministre, que ces petites imperfections ont de l’importance quand on est le plus grand poète vivant en France ? » (p. 59).
Alain Beretta
1 Charles Journet, Préface aux Études claudéliennes d’Ernest Friche. Cf. Michel Cagin, Paul Claudel-Charles Journet, Entre poésie et théologie, Ad Solem, 2006, p. 139 ; Charles Journet, Œuvres complètes, t. X, Lethielleux-DDB, 2010, p. 471-472.
2 « Introduction à un poème sur Dante », Positions et propositions I.
3 Paul Claudel, Cinq grandes odes, II – « L’Esprit et l’eau ».
4 Ils demeurent cependant parfois très vagues. Pour expliquer les versets de la deuxième Ode : « La superficie de votre lumière est invincible et je ne puis trouver / Le défaut de vos éclatantes ténèbres », Nichols note simplement : « Drawing on the mystical theology of the Fathers he identifies the impenetrable divine light with the divine darkness » (op. rec., p. 27). – La remarque, à propos de quelques lignes de Du sens figuré… (« Tout ce qui passe est promu à la dignité d’expression, tout ce qui se passe est promu à la dignité de signification… »), qui voit dans ces lignes l’amorce de la « dramatique divine » de Hans Urs von Balthasar, aurait mérité un développement.
5 Cf. Dominique Millet-Gérard, Claudel thomiste ?, Paris, Honoré Champion, 1999.
6 Journal inédit, 1er janvier 1979.
7 Partie du Journal conservée dans des archives privées.
8 La compétence diplomatique de Claudel est confirmée dans un livre paru fin 1918 à Rio, Paul Claudel et la Revue Franco-Brésilienne, où on peut lire que les vingt mois de présence claudélienne ont constitué « un délai suffisant pour un diplomate actif, doué d’intelligence, patriote et dévoué ».
9 Firmin Gémier avait monté L’Otage au Théâtre Antoine en décembre 1916. En 1921, il collaborera avec Gaston Baty à la mise en scène de L’Annonce faite à Marie à la Comédie-Montaigne, mais il n’appréciera guère cette pièce.
10 Olten est une petite ville suisse du canton de Soleure où Claudel a fait une conférence en mai 1915 à l’invitation de la revue Les Cahiers vaudois.
11 Bulletin de la Société Paul Claudel, no 131, 3e trimestre 1993, p. 7.