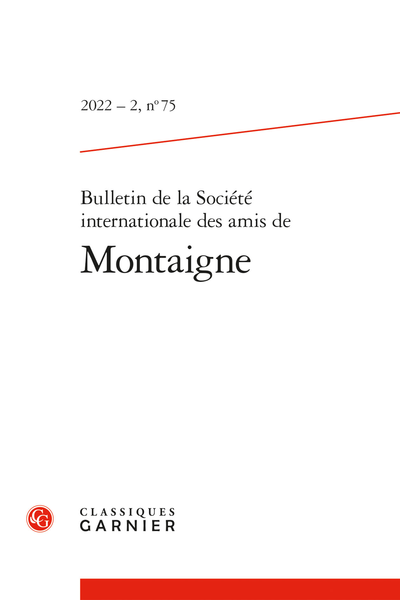
Comptes rendus de lecture
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2022 – 2, n° 75. varia - Auteurs : Schneikert (Élisabeth), Roussel (François), Guerrier (Olivier)
- Pages : 91 à 116
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406141143
- ISBN : 978-2-406-14114-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14114-3.p.0091
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/09/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Alicia Viaud, À hauteur humaine, La fortune dans l’écriture de l’histoire (1560-1600), Travaux d’humanisme et Renaissance DCXXV, Genève, Droz, 2021, 663 p., ISBN : 978-2-600-06272-5.
Cet ouvrage est issu de la thèse d’Alicia Viaud, soutenue en 2018 à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, sous la direction de Michel Magnien.
Le point de départ de la réflexion est la phrase de Montaigne que l’on trouve dans « De l’art de conférer » : « Les mouvements publics, despendent plus de la conduicte de la fortune, les privez de la nostre » qui suscite trois interrogations : comment la fortune peut-elle être un mode de compréhension de l’histoire pour l’homme du xvie siècle ? Quel est son rapport avec d’autres instances, telles la volonté humaine ou la providence ? Est-il possible de délimiter un champ propre à la fortune ? Montaigne constate sa domination au niveau de l’histoire collective mais son absence dans les parcours singuliers. Il convient dès lors de comparer histoire et Mémoires et d’apprécier le rôle qu’y joue la fortune, à la fois puissance motrice et principe explicatif.
Le riche corpus étudié convoque des historiens et des mémorialistes chez qui la fortune est une notion commune : François de Belleforest, Lancelot Voisin de la Popelinière, Louis Le Roy, Blaise de Monluc, Henri de Mesmes, Marguerite de Valois, et Montaigne qui n’est ni historien ni mémorialiste. Il permet d’évaluer de quelle façon la fortune est à l’articulation entre l’histoire personnelle et l’histoire collective, car la fortune permet d’écrire une histoire « à hauteur humaine », comme le rapporte une inscription de la bibliothèque de Montaigne due à Sophocle. L’ouvrage s’attache donc à montrer « en quoi la fortune, plutôt qu’un concept au contenu précis, est pour les historiens et les mémorialistes une manière d’établir des relations, qui engage à la fois une conception de l’histoire et une conception de la place que l’être humain y occupe » (p. 21). L’ouvrage présente des chapitres consacrés plus spécifiquement à un historien ou un mémorialiste et des chapitres où les notions ou problématiques sont 92étudiées de façon transversale. Cette recension s’attache au premier chef à ce qui touche à Montaigne.
Le prologue, fourni, revient sur les spécificités de l’histoire dans la seconde moitié du xvie siècle, tant comme pratique que comme texte, avant d’envisager la fortune comme lieu commun et comme objet polémique. Elle est définie en tant que compromis acceptable pour donner à hauteur humaine une forme et une valeur au passé. Dans les Essais, la transformation de l’écriture de l’histoire en écriture de l’essai puis en écriture de soi révèle la dynamique profonde du texte. Pour apprécier la valeur polémique de la fortune, A. Viaud revient sur le terme passé au crible de la censure. Dans l’édition de 1595 attribuée à Simon Goulart, le mot « fortune » est remplacé par ceux de « condition », « aventure », « rencontre », mais au regard de la censure romaine le mot est finalement considéré comme une simple imperfection. Le chapitre « Des prières » fait à ce titre l’objet d’un examen attentif. Montaigne s’en remet à la censure, garante de l’orthodoxie, « l’entière soumission à la censure rend possible l’essai en tant que discours ‘doubteux’, qui progresse sans se soucier de la conformité de son propos avec le dogme » (p. 92). Le prologue conclut sur l’idée que la fortune est un cadre intellectuel restreint mais choisi, « la marque d’une limite que l’histoire adopte par défaut », à la fois par manque de compréhension mais aussi par « souci de mieux penser les implications de l’action humaine » (p. 103).
La réflexion se déploie ensuite en trois grandes parties équilibrées. La première partie, forte de ses cinq chapitres, montre comment la fortune permet de penser l’adversité. La notion de vicissitude est en particulier appliquée aux essais « De la vanité », « De la physionomie », « De l’expérience », « Des coches » et à l’« Apologie », afin de la distinguer de la fortune. Les vicissitudes sont des mouvements à l’origine systématiques, perçus comme des phénomènes naturels régis en dernière instance par Dieu, ce qui tend à minimiser le rôle de la fortune, qui est tantôt distinguée de la nature, tantôt assimilée à elle comme moteur de changement, soumise à Dieu. L’histoire est ainsi pensée comme mouvement, qu’il s’agisse d’un mouvement récurrent ou d’instabilités répétées (p. 139). Face à l’adversité, la position de Montaigne est comparée à celle d’Henri de Mesmes. Ils montrent l’un et l’autre la même exigence de fermeté morale. L’essai I, 40 invite à travailler sur la représentation des maux. Montaigne s’abandonne à la fortune et y promeut l’idéal d’une position 93moyenne. Il serait « parvenu à ne pas offrir de prise à la vindicte de la fortune, ou plutôt à voir en elle une force qui tantôt ne le concerne pas, tantôt le favorise. » (p. 270)
La seconde partie s’attache à montrer comment la fortune autorise à concevoir l’action. Montaigne trouve sa place parmi Blaise de Monluc, François de Belleforest, Lancelot Voisin de la Popelinère. L’« Apologie », « De l’incertitude de nostre jugement », « Divers événements de même conseil », « De la physionomie » sont convoqués pour interroger la puissance de la fortune au regard de la prudence et définir une attitude faite autant de maîtrise que d’abandon. Montaigne interroge la pratique consistant, plutôt que de saisir l’occasion pourtant idéal de l’action, à temporiser, César représentant un modèle que l’on peut interroger (I, 34).
La dernière partie, la plus substantielle en ce qui regarde Montaigne, montre comment la figure de la fortune permet de s’approprier le passé et comment les historiens et les mémorialistes en emploient toute la palette des usages. Intitulée « S’approprier le passé : le singulier et le commun », elle s’emploie à voir à quel point les usages de la fortune sont au cœur d’une tension entre l’établissement de généralités et la mise en valeur de spécificités. Après un panorama relatif à l’histoire nationale élaborée sur le modèle de l’histoire de Rome, où se trouve un court passage sur les ruines de Rome telles que Montaigne les appréhende lors de son voyage, A. Viaud s’attache à déployer la polysémie du mot « fortune » chez Montaigne (chap. XII). Le terme permet de dire un phénomène biologique (« Des Destriers »), mais il est le plus souvent associé à des termes désignant le mérite et la réputation ; il désigne un statut et un comportement ; il repose parfois sur l’apparence, tout ce qui est extérieur à l’individu. Montaigne présente des degrés de fortune, qui organisent la hiérarchie sociale, laquelle doit être en adéquation avec le mode de vie. Il démystifie les privilèges accordés à la grande fortune (« De l’inéqualité qui est entre nous ») et invite chacun à rester à son niveau de fortune (« Du pédantisme »). La proposition la plus intéressante est celle qui concerne les vertus d’une fortune intermédiaire, le contentement à occuper une position médiane, qui tient à la fois d’un discours d’autodénigrement et du jugement positif porté sur la fuite de la grandeur. Ainsi se voit déplacé le critère de la bonne fortune, une condition se vivant sans effort et sans risque, sur le modèle socratique. Ce que dessine Montaigne, c’est l’idéal de l’homme médiocre, dont le 94principal souci est de bien servir, sans chercher à s’élever soi-même. Le chapitre XVI, à partir des essais « De la presomption » et « De l’incertitude notre jugement » établit la difficulté à déterminer des règles pratiques valables de tout temps à partir de l’histoire. Dans « De la constance », la fortune est la véritable maîtresse de l’action, de sorte que l’exemplarité est en concurrence avec la puissance de la fortune. Il faut alors considérer la maîtrise des intentions plutôt que l’issue pour juger de nos actions. A. Viaud propose en ce sens une lecture fine des essais « Par divers moyens on arrive à pareille fin », « De la coustume et de ne changer aisement une loy receue », « Si le chef d’une place assiégée doit sortir pour parlementer ». Elle en vient naturellement à évaluer la position de Montaigne à l’aune de Machiavel et de la Popelinière, plus pragmatique que l’essayiste, qui s’interroge sur l’héroïsme des conduites, leur éthique et la beauté du geste, ce qui engage aussi la question de la délibération. L’essai « De l’incertitude de nostre jugement » est alors lu en parallèle des Ogdoades de Guillaume du Bellay. En définitive, la fortune fragilise à la fois l’exemplarité et la délibération.
La conclusion reprend la métaphore de l’« Apologie » : la fortune est « une fausse monnaie », qui reste néanmoins acceptable. Au sein des Mémoires, elle concourt à l’élaboration des structures temporelles et logiques et permet de passer d’un espace singulier à un espace commun intelligible. Pour les historiens, elle constitue un memento mori tout autant qu’une donnée essentielle à la prise de décision. Enfin, elle apparaît comme un outil de l’écriture de l’histoire et crée un espace de valeurs partagées avec le lecteur.
Cet ouvrage de grande maîtrise navigue remarquablement d’un auteur à l’autre pour saisir l’ensemble du panel des usages de la fortune. Le lecteur de Montaigne y trouvera avec bonheur une saisie synthétique de certaines positions de l’essayiste tout comme des micro lectures d’essais significatifs. La circulation fluide dans les Essais qui est ici proposée permet en définitive de prendre la mesure de la complexité que présente la pensée de Montaigne en ce qui concerne la fortune.
Élisabeth Schneikert
Strasbourg
95*
* *
La littérature et l’esprit. Hommage à Jean-Yves Pouilloux, Édition coordonnée par Sandrine Bédouret-Larraburu, David Diop, Valérie Fasseur, Hans Hartje, Nadine Laporte, Marie-Françoise Marein, Avec Christiane Albert, Genève, Droz, Histoire des Idées et Critique Littéraire 2021, 283 p., ISBN : 978-2-600-06275-6.
Depuis la mort de Jean-Yves Pouilloux, qui a précédé de quelques mois celle d’André Tournon, il y a eu de nombreuses occasions de lui et de leur rendre hommage, dont celle du Bulletin qui a voulu joindre l’évocation de ces deux figures majeures dans un précédent numéro de 2019, rappelant combien tous deux ont compté dans la vie et dans l’animation, à tous les sens du terme, de la SIAAM, et plus largement encore dans le renouveau des études montaignistes depuis quelques décennies, littérature et philosophie mêlées. Ce récent recueil d’hommage vient confirmer l’importance du travail de J.-Y. Pouilloux concernant la lecture des Essais, avec sa continuité et ses infléchissements au fil du « temps qui passe », nourrie par la complémentarité reconnue et reconnaissante envers les analyses d’A. Tournon. C’est ce « commerce » ininterrompu avec l’écriture de Montaigne que retracent avec justesse et acuité un certain nombre de contributions, notamment celles d’Antoine Compagnon, Olivier Guerrier, Laurent Jenny, John D. Lyons, ou la singulière réflexion de Jaume Casals Pons sur « Pouilloux poète », décelant dans l’évolution de son écriture une différenciation interne, mais non pas une scission, entre un versant salutairement « destructeur » des fausses évidences et un versant plus attentif « à la construction d’une recherche de la finesse, de l’écoute délicate des textes et du regard ».
Ce livre d’hommage, ponctué en couverture par le beau portrait au fusain dû à son ami le peintre Alexandre Hollan, marque donc aussi et peut-être surtout l’importance de plus en plus grande accordée par J.-Y. Pouilloux, chemins faisant, au registre du « visible » et du contemplatif, comme le confirment certains de ses textes librement poétiques publiés dans une première partie, de même que le récapitulatif 96présentant sa soutenance de thèse sur travaux en 1994, significativement intitulé : « Écrire l’expérience du visible ». Ces textes, marqués par le souci de percevoir et de restituer, autant que faire se peut, une présence vivante dans ses aspects les plus concrets, sont suivis par une riche suite de témoignages et réflexions évoquant les empreintes (au plus loin de toute « emprise ») que la fréquentation occasionnelle ou plus continue de J.-Y. Pouilloux a laissées sur les uns et les autres, à telle ou telle époque de ses propres trajets institutionnels et personnels. C’est ce qu’indique sobrement et fort justement le texte introductif de Laurent Jenny en parlant d’une double dimension : celle des « traces » écrites et celle des « sillages » ouverts par ces traces ou par les paroles vives de J.-Y. Pouilloux, toujours « enquérantes » ou, pour le dire en écho à Montaigne, avec « cette façon de répondre enquêteuse, non résolutive ».
Beaucoup de ses collègues, étudiant·e·s, ami·e·s de très longue date ou dans des périodes plus récentes, ont dit – et le lui avaient déjà dit de son vivant – à quel point il a pu être déterminant dans certains aspects de leurs différentes trajectoires et centres d’intérêt, au plus près ou parfois assez loin de la fréquentation des Essais (cf. le texte de Francis Jauréguiberry sur la question de la reconnaissance d’être un « sujet », entre sociologie et littérature), mais toujours avec intensité, vivacité et qualité d’écoute dans les liens et les échanges. Je fais partie de celles et ceux, beaucoup plus nombreux, qui n’ont pas eu cette proximité effective, ces liens d’amitié, de travail, de discussions renouvelées, nourries et éprouvées dans une continuité qui n’exclut pas toujours les moments d’altercation sinon de rupture, y compris de « rupture avec soi » comme le suggère avec un grand scrupule son collègue et proche ami récemment décédé, André Lacaux, dans un texte retraçant les itinéraires parfois tourmentés ou escarpés de J.-Y. Pouilloux (est-ce là comme un écho montaignien : « je marche plus sûr et plus ferme à monts qu’à val » ?). C’est encore ce qu’un autre ami de jeunesse, Claude Burgelin, nomme avec le même scrupule ses vives « tensions » et « contradictions », évoquant des « conflits » longtemps sinon toujours maintenus, quoique plus apaisés au fil des périodes vécues et de ce qui s’exprime dans des tonalités différentes en fonction des sujets et des formes d’écriture choisies. Pour faire écho à d’autres termes qui reviennent parfois au fil des évocations, il y a là une part de « mystère » ou de « réserve », une certaine « énigme » qui subsiste, sans pour autant recouvrir l’évidence 97d’une présence chaleureuse jusque dans la « malice » et l’ironie parfois mordante voire « féroce ».
C’est l’une des raisons qui rend d’autant plus sensible la lecture de ce recueil constitué de témoignages et d’analyses riches et diverses dont ces quelques échos voudraient au moins restituer une certaine tonalité, avec sa dimension plus « affective ». Ce qui frappe d’abord à leur lecture suivie, c’est bien la profondeur et la vitalité des traces laissées en chacun et chacune, dès lors que le contact était véritablement « noué » – et ce verbe prend ici toute sa valeur, comme lorsque J.-Y. Pouilloux évoque, dans l’ultime recueil de textes publié de son vivant, L’art et la formule, « l’amitié qui s’est nouée » pour lui avec Alexandre Hollan. Le plus significatif dans cet hommage pluriel n’est donc pas le souci de retracer en détail les divers cheminements intellectuels, institutionnels et esthétiques nourrissant une écriture « d’essais » toujours attentive à la singularité des objets (littérature et peinture pour l’essentiel). Plusieurs, dont Ariane Bayle ou Olivier Guerrier, l’avaient fait à l’annonce de la mort de J.-Y. Pouilloux, avec le souvenir des liens tissés dans le travail ou dans la vie – et souvent dans l’accointance des deux. On retrouve néanmoins les éléments principaux de ces cheminements parfois heurtés dans les premiers témoignages et souvenirs du recueil dont le titre, La littérature et l’esprit, fait judicieusement écho à L’œil et l’esprit de Maurice Merleau-Ponty, philosophe dont les analyses sur la perception et le regard, ainsi que le rappellent diversement plusieurs textes (Patrick Hochart, Jaume Casals Pons, Régis Lefort), aura beaucoup compté dans l’orientation de plus en plus marquée d’une écriture cherchant à articuler le visible et le dicible, tout en maintenant leur tension, comme on l’entend tout particulièrement dans L’art et la formule où Proust voisine avec nombre d’autres écrivains et artistes tels Raymond Queneau, Jean Paulhan, Philippe Jacottet, Nicolas Bouvier, Pierre Michon, Pierre-Albert Jourdan, Alexandre Hollan, et bien évidemment Montaigne à qui il est impossible de ne pas revenir afin d’en relancer, à chaque nouvelle lecture, l’énergie d’écriture.
Sans avoir eu donc cette proximité de travail (enseignement et recherche) ou d’amitié qui marque tous les témoignages recueillis dans ce volume, j’ai comme beaucoup d’autres éprouvé d’emblée, à la lecture de Lire les « essais » de Montaigne, l’importance de ce qui y était tracé avec rigueur et vigueur, s’inscrivant d’une manière singulière dans la vitalité 98intellectuelle et politique des riches années soixante et ouvrant ainsi à une compréhension en mouvement (et même assez mouvementée face à l’inertie et au conformisme universitaire) de ce que contient de puissance et d’innovation pensante l’écriture de Montaigne. Dans un précédent volume collectif publié de son vivant, « Éveils ». En l’honneur de Jean-Yves Pouilloux, Bernard Sève a exprimé cela très justement, évoquant à propos de ce livre inaugural une double « dissonnance » : 1) l’écart avec les thèmes des ouvrages publiés en ces temps-là chez Maspéro, Montaigne pouvant y apparaître comme un auteur sans vitalité ni pertinence au regard des élans et passions politiques de l’époque ; 2) plus marquante encore et à contrecourant de cette idée, la rupture réfléchie, frontale et argumentée que ce livre effectuait tout particulièrement « avec les lectures conventionnelles et douillettement humanistes » des Essais. B. Sève rappelait au passage que le thème de « l’anti-humanisme » était plutôt en vogue dans ces années-là – même si ce vocable s’inscrivait dans des horizons conceptuels et politiques assez divergents qu’il faudrait reprendre plus attentivement.
On pourrait s’autoriser, dans un registre plus contemporain, à entendre la lecture de J.-Y. Pouilloux comme un « alter-humanisme » (différent par ailleurs de ce qu’Emmanuel Lévinas nomme « humanisme de l’autre homme ») ; et il y avait à coup sûr une forme de provocation salutaire à suggérer qu’une telle orientation permettait de restituer quelque chose de l’énergie singulière de l’écriture de Montaigne, de son « double-jeu » précisément identifié qui ne renvoie pas à une duplicité mais bien à la relance vitale d’un questionnement succédant ou s’articulant, dans le même mouvement, à l’énoncé d’une « pensée » ou « fantasie » quelconque : qu’est-ce qui fait que je pense cela, « hic et nunc » ? C’est ce que J.-Y. Pouilloux nommait de manière frappante « l’écoute de nos voix fourchues », l’écriture dédoublée des Essais indiquant en quoi, selon lui, « la lecture trace des différences dans le texte, ne serait-ce que pour repérer la façon dont Montaigne prend la mesure des mots et trace les bifurcations avec une inlassable patience, avec liberté et oisiveté qui sont science et malice ». Il est difficile de ne pas penser que ces deux vocables caractérisent aussi ses propres « parcours » pour reprendre le terme privilégié par plusieurs textes du recueil qui rappellent les scrupules d’époque devant l’idée d’une « œuvre » – à moins que, comme cet autre ami mort en 2016, Pierre Pachet, on suggère plutôt de parler de « l’œuvre des jours ».
99S’agissait-il, avec ce premier livre parfois qualifié de « brûlot », d’un « emportement juvénile » comme l’écrira son auteur 25 ans plus tard en le rééditant dans Montaigne. L’éveil de la pensée, accompagné d’autres lectures des Essais ? Il y faisait alors écho, pour s’y reconnaître, à une célèbre formule de Montaigne marquant le passage du temps, à défaut d’une incertaine et indécidable progression pensant trop présomptueusement pouvoir corriger une lecture antérieure : « Moi alors et moi aujourd’hui sommes bien deux ». Mais outre que J.-Y. Pouilloux était, comme Montaigne, le premier sensible à cette imprudente présomption de croire à une plus grande sagacité (sinon « sagesse ») que l’expérience accumulée aurait rendue possible, on pourrait également dire – je le dis au moins pour moi – que là où certains voient rétrospectivement dans ce livre tranchant une « raideur » assimilée à un excès d’exigence théorique (ne parlons pas de « démon »), cet « emportement », cette « verdeur » et cette « alacrité » ont conservé toute leur énergie et leur capacité d’incitation à lire autrement, au-delà même des seuls Essais, à quelque moment qu’on ait pu rencontrer ce livre définitivement intempestif. C’est d’ailleurs ce que dit d’une autre façon le texte introductif de Laurent Jenny dans ce recueil d’hommage, en renvoyant tout particulièrement à la réflexion incisive de John D. Lyons concernant l’extrême attention apportée par J.-Y. Pouilloux à une singulière temporalité de présence dans et par l’écriture-lecture : « Il est clair que Jean-Yves a fait sienne une telle expérience de “la différence dans le moment” et qu’elle est sans doute au cœur de toute aventure de pensée ».
Bien que le mot de « maître » ait toujours paru assez dérisoire à ses yeux comme à ceux d’A. Tournon (ils ont partagé entre eux et avec Montaigne la répugnance à l’égard des discours de « régence » – et une anecdote du texte d’Yves Darrigand sur les cafés philo d’Orthez le rappelle malicieusement), il est difficile de traduire autrement ce qu’a été et continue d’être le « commerce » ininterrompu avec les écrits de J.-Y. Pouilloux, y compris lorsqu’il s’agit d’auteurs et de domaines très divers : apprendre à mieux relire ce qu’on a déjà lu, à ne pas se laisser absorber ou résorber dans une compréhension constituée au risque de se figer dans une forme de « bêtise » ; comprendre en l’éprouvant, à l’incitation de ces deux infatigables lecteurs conjuguant leurs manières différentes d’aborder la texture des Essais, la nécessité rigoureuse et fructueuse de ce qu’est une relance, l’importance vitale et vitalisante de chercher 100telle « route par ailleurs », sans oublier, effacer ou renier pour autant les cheminements antérieurs. J’ai au moins eu la chance de lier quelques échanges à distance avec J.-Y. Pouilloux et d’éprouver la bienveillance de cette rigueur, sa capacité inlassable à indiquer pourquoi et comment y aller voir de plus près, là où on pouvait penser un peu trop vite y être déjà arrivé. Et c’est aussi ce que disent avec reconnaissance ou gratitude certains textes du recueil, notamment ceux d’Elisabeth Ladenson, de Guillaume Andreucci, de Guillaume Béhague, de Pierre Loiseau ou de Stéphane Barthe, rappelant quel « pédagogue » exigeant, inspirant et généreux a pu être J.-Y. Pouilloux tout au long de ses enseignements ici ou là, sur des auteurs et des « objets » très divers ; Montaigne bien évidemment, mais aussi Rabelais, Flaubert, Proust, Queneau, Borgès et beaucoup d’autres déjà évoqués auxquels certaines analyses plus spécifiques sont consacrées dans ce recueil (y compris en « détournant » la manière de lire de J.-Y. Pouilloux en direction d’autres écrivains tels Fernando Pessoa) : ainsi les textes de Charles Méla, Michel Sandras, David Diop, Régis Salado, Thomas Barège, Anne-Elodie Meunier.
Des témoignages sensibles et « inspirés » qui restituent la grande respiration produite par cette parole librement enseignante, j’extrais deux fragments qui résonnent comme autant d’éclats. Le premier est tiré du texte de Guillaume Andreucci évoquant la manière de faire de J.-Y. Pouilloux : « Il ne m’a jamais par exemple rien expliqué de ce que voulait dire ou ne pas dire Montaigne dans tel ou tel chapitre des Essais, mais me disait souvent : “les Essais ne sont pas un texte qui a été écrit, mais dicté. Or, si un texte écrit procède de ce qui a été énoncé précédemment, un texte dicté anticipe toujours ce qui va être dit. Si tu ne comprends pas un passage de Montaigne, ne reviens pas en arrière mais poursuis ta lecture, et tout s’éclairera rétrospectivement” ; et le texte des Essais de s’éclairer subitement pour mon esprit, lorsque j’étais rentré chez moi et que je le reprenais, dans la solitude de la lecture, un peu ivre de n’avoir pas saisi exactement tout ce que m’avait appris Jean-Yves ». Et un peu plus loin, il donne une indication marquante qu’on retrouve dans d’autres témoignages et dans les textes mêmes de J.-Y. Pouilloux sur plusieurs écrivains tels René Daumal : « Aussi ai-je découvert en assistant à ses cours que la littérature n’était pas toujours au service de la ‘fallacieuse imagination’, mais pouvait – et devait – avoir un lien direct avec le réel, en ce que l’expérience de la lecture transforme 101l’expérience du monde et de soi-même ». On ne peut mieux rassembler les fils de ce qui aura toujours importé pour J.-Y. Pouilloux, quel que soit l’objet visé par l’écriture et son irrémédiable limite en regard d’une présence impossible à atteindre ou rejoindre sans reste, comme l’atteste encore ce texte dans L’art et la formule : « Je ne sais ce que je vois qu’en écrivant », détournement d’une formule d’Alberto Giacometti à laquelle fait notamment référence Régis Lefort en multipliant dans son texte les échos poétiques qu’elle peut susciter.
L’autre éclat que j’extrais de la richesse des témoignages et réflexions est dû à Amélie Jaouen évoquant une bouteille dont le nom de cépage, « Hic et nunc », lui fit immédiatement penser à J.-Y. Pouilloux à qui elle n’aura pu l’offrir : « “Hic et nunc” est une locution qu’il utilisait souvent en cours. Quand on parle de son travail, ce qui fait écho, c’est cet éveil, présence à soi, fulgurance de l’instant, conscience. Et tellement plus. C’est cette quête qui lui était chère (…). À travers ses chemins, Jean-Yves a appris à saisir en chacun de nous forces et faiblesses, comme lui-même pouvait être solaire et sage et l’instant suivant, hésitant et timide ; à l’instant choisi, féroce ». Ce dernier adjectif apparemment dissonant n’est pas là, il me semble, pour conjurer le risque d’un texte trop hagiographique, mais bien pour marquer une coexistence de contrastes où l’exigence de rigueur peut avoir sa part plus rugueuse en dépit de la générosité et de la bienveillance ordinaire (rugosité et parfois dureté dont parlent d’une autre manière A. Lacaux et C. Burgelin à propos d’une amitié tenue dans la longue durée mais dont l’exigence et parfois le tranchant n’étaient pas toujours faciles à affronter). Évoquant peu après les multiples randonnées faites en commun, Amélie Jaouen ajoute ceci qui est tout aussi marquant : « N’oublions pas sa passion pour les chemins de montagne, les parois d’alpinisme, les sommets. Souvenons-nous du vertige, souvenons-nous des courbatures. Souvenons-nous aussi que ces sentiers se finissaient très souvent en ripailles, moment privilégié de partage et d’amitié. De réserve aussi. Le grand homme, comme disait Betty, étant plus homme d’indices que de révélation ».
Il y a dans ce passage une concentration de motifs et de fils qu’en dépit de la différence des expériences et des époques, on retrouve dans beaucoup d’autres textes du recueil ; et c’est ce qui en rend la lecture précieuse et vitalisante. Mais plus particulièrement, dans les termes choisis par sa femme Betty pour l’évoquer : « plus homme d’indices que de 102révélation », je ne peux m’empêcher de percevoir l’écho au moins implicite de telle ou telle « formule » de Montaigne – à condition d’entendre ce vocable à contre-courant des « maximes » de sagesse morale qu’on voudrait extraire des Essais comme autant de « sentences » à ruminer. C’est ce que rappelle à juste titre John D. Lyons dans l’analyse très fine de ce qu’indiquait J.-Y. Pouilloux à cet égard : « une bonne formule n’est pas attendue et, par son ingénuité et par sa parfaite adéquation avec le moment où on la prononce ou on l’écrit, elle correspond à la manifestation de la perfection formelle, au timing, qu’on connaît comme le kairos. Que la formule soit prononcée ou silencieusement glissée sur le papier, elle est en quelque sorte à mi-chemin entre l’oral et l’écrit (…). Elle manifeste cette sprezzatura si prisée à la Renaissance. Elle surprend, que ce soit pour blesser ou pour amuser ». Repérer des « indices », faire voir ou entrevoir ce qui semble le plus significatif, sans pour autant prétendre à quelque « révélation » ou « magistrale » leçon que ce soit, voilà ce qui, dans les traces écrites et orales de J.-Y. Pouilloux, consonne avec certaines « formules » ou formulations insistantes de Montaigne auxquelles il a toujours suggéré de porter singulièrement et diversement attention : « Tant y a, qu’en ces mémoires, si on y regarde, on trouvera que j’ai tout dit, ou tout désigné : Ce que je ne puis exprimer, je le montre au doigt » ; « Joint qu’à l’aventure ai-je quelque obligation particulière à ne dire qu’à demi, à dire confusément, à dire discordamment » ; « Plutarque dit qu’il vit [acquit] le langage latin par les choses. Ici de même : le sens éclaire et produit les paroles : Non plus de vent, ains de chair et d’os. Elles signifient plus qu’elles ne disent ». C’est bien quelque chose de cet ordre que le témoignage précis et concis d’Amélie Jaouen permet de mieux entendre concernant la présence maintenue de J.-Y. Pouilloux, à travers et bien au-delà du seul commerce qu’il n’aura jamais cessé d’entretenir avec les Essais.
Comme il est impossible de faire également et justement écho à la richesse et à la densité des textes de ce recueil, je choisis pour conclure, parmi beaucoup d’autres fils tissés entre eux, deux « motifs » qui ouvriront, je l’espère, sur le désir d’une lecture plus suivie. D’abord le « motif » de l’arbre, ainsi que le nomme très justement P. Hochart qui en détaille très attentivement plusieurs éléments en apparence hétérogènes où s’entrecroisent à nouveau Montaigne et Proust. Ce « motif » de l’arbre court à travers plusieurs autres réflexions du recueil ; et il renvoie tout 103autant à la méditation de J.-Y. Pouilloux sur le travail perceptif et expressif d’A. Hollan – peintre dont un autre fusain, Le bois des trois Grâces, est également reproduit, comme une ponctuation en suspens ou en attente faisant suite aux textes « poétiques » de J.-Y. Pouilloux. Et c’est justement dans l’un de ces textes repris dans le recueil, D’ouest en ouest, que ce « motif » de l’arbre surgit avec une très singulière et vive présence : « Il m’est arrivé de rencontrer, de l’autre côté du monde, un arbre insolite. Ça sort du rocher, ça pousse comme un pin de tous les jours. Au bout d’un moment, la tête, frappée par la foudre ou cassée par le vent, se perd. L’arbre continue, autrement. Avec l’âge l’écorce se fend, du haut jusqu’en bas, puis s’ouvre lentement et s’enroule sur elle-même ; l’intérieur devient l’extérieur, le cœur devient la peau. De longues veines vont chercher dans le roc l’aliment pour de frêles bouquets verts au bout des doigts maigres de branches squelettiques. Et ça dure depuis plus de quatre mille ans. On dit par ici que ce sont les plus anciennes créatures vivantes à la surface de la terre. Ce sont des arbres-pierre. On les appelle “bristlecone pines” ».
Là encore, dans cette très précise description d’un déploiement vital obstiné, insolite et tourmenté, il est difficile de ne pas entendre ce qui pourrait tout autant éclairer la construction complexe, jamais achevée et se retournant sur elle-même, de certains textes, tels ceux des Essais, qui résistent à l’image trop rassurante de l’arbre en majesté, notamment celui par lequel Descartes caractérise le développement de la philosophie dans une montée linéaire et rassurante à travers les racines, le tronc et les branches. À l’encontre de cette image d’un savoir en croissance continue, assuré de ses protocoles et de sa puissance d’action sur les choses et les êtres, il faut percevoir une autre forme d’arborescence improbable mais tenace constituée de fractures internes et d’enroulements sur soi qui viennent compliquer et même inverser les rapports de « l’intérieur » et de « l’extérieur », du « cœur » et de « la peau ». Au risque de forcer un peu la portée de cette saisissante description, on pourrait y entendre en sourdine une certaine façon de lire les Essais à laquelle J.-Y. Pouilloux, de concert avec sa reconnaissance du « travail obstiné » d’A. Tournon, nous a rendus attentifs et sensibles. Comme il le dit encore dans un texte où il est question de la contemplation d’un frêne, texte recueilli dans L’art et la formule et finalement intitulé « Sans titre » (où l’on peut aussi entendre ironiquement l’expression : « sans titre à faire valoir »), 104il faut rompre autant que possible avec ces figurations d’arbres qui peuplent nos représentations les plus familières et recouvrent ce qu’il faudrait à rebours percevoir le plus singulièrement possible : « Que je me débarrasse de l’arbre généalogique, de l’arbre de Porphyre qui porte les catégories d’Aristote, de l’arbre de la connaissance, d’Adam et Eve, et peut-être surtout de l’arbre de vie qui se ramifie à l’intérieur d’une partie étrange de ma tête nommée cervelet. Les noms et les idées d’arbre empiètent sur la relation étrange elle aussi qui semblait s’être tissée, matin après matin, soir après soir, entre ce frêne, être frêle et léger aux feuilles aérées, et moi, non moins frêle et fragile, mais pesant et terrien ». Au-delà d’une veine nominaliste poussée dans ses ultimes retranchements (« Distingo est le plus universel membre de ma logique »), il s’agit bien pour J.-Y. Pouilloux de toucher aux limites de toute énonciation, attestant, comme il le dit à propos de Paulhan et de Jacottet, ce qui ne peut alors que déborder la parole : « une retenue qui cède pourtant à la nécessité de dire, qui parle tout en se taisant » (comme un autre écho à ce que Montaigne nomme « un taire parlier »).
La dernière évocation sur laquelle s’arrêtera ce compte rendu concerne la relation avec Georges Perec dont il est fait plusieurs fois mention dans le recueil et dont attestent plus expressément certains écrits de J.-Y. Pouilloux (notamment un texte sur La vie mode d’emploi), ou que révèle une trace parfois plus en creux mais néanmoins perceptible (ainsi l’incipit perecquien du texte intitulé « Le temps présent », recueilli dans L’art et la formule : « Je cherche en même temps l’éphémère et l’éternel »). L’évocation de C. Burgelin, qui a été le probable intercesseur de cette rencontre, essaie d’en ressaisir après-coup les traits marquants : « Ils se sont trouvés l’un l’autre pour beaucoup dans l’infra-verbal (et dans le partage d’alcools ?). Pas de hasard si Jean-Yves a écrit sur les rapports de Perec à la peinture. Autrement dit là où ça parle en se taisant. Il ne semble pas que Jean-Yves ait été passionné plus que ça par l’Oulipo. Le Witz, les cabrioles verbales de Perec, il adorait, mais n’en faisait pas, comme on le voit parfois aujourd’hui, l’alpha et l’oméga de son œuvre (…). au fond, ce qu’il aimait en Perec, c’est ce qu’il aimait en Montaigne : un art pour capter le jaillissement, accueillir les ruptures, les dénivellations, les moments où, sous le jeu des lettres, le sens se cherche. ‘Je ne peins pas l’être, je peins le passage’, formule bien connue de Montaigne. La phrase pourrait s’appliquer au Perec d’Espèces d’espaces, bondissant de 105la chambre à la rue, de la rue au quartier, du quartier à la ville et aux espaces infinis, explorant les ‘laps’, questionnant les ruptures d’espaces, nos façons changeantes de les occuper, traquant les moments où la pensée n’est pas encore figée, coagulée dans ses formules ».
À cet entrecroisement subtilement suggéré par le double sens des « passages » (celui d’un espace à l’autre étant aussi important et significatif que celui d’une année, d’une heure, d’une minute à l’autre), on pourrait d’ailleurs joindre un texte plus singulier de J.-Y. Pouilloux qui va bien au-delà de la symétrie verbale de son titre : « Deux discours de Montaigne : du manque d’espace à l’espace du manque ». Est-ce une apparente facilité ou jonglerie verbale d’époque qui l’a retenu de republier ultérieurement ce texte ? Je ne sais – à moins que cette republication m’ait échappée ou que cette analyse ait été ultérieurement refondue. Prolongeant l’évocation de cette rencontre de bonne « fortune » interrompue par la mort de G. Perec, C. Burgelin fait également le lien avec leur intérêt commun quoique probablement différent pour Queneau et Borgès (auteurs auxquels J.-Y. Pouilloux a consacré deux études portant sur Les Fleurs bleues et sur Fictions). Et il ajoute une note qui concentre à nouveau la coexistence des contrastes : « Somme toute il y avait dans le côté joueur et farceur de Perec, dans la simplicité et l’acuité de ses démarches comme dans leur côté à la fois méthodique et inventif, voire déconnant, quelque chose qui le séduisait infiniment. Mais il savait être requis par ces moments où Perec dit sobrement des choses essentielles et graves que Jean-Yves, je peux en témoigner, savait entendre ».
En écho final à cette remarque qui pourrait également résonner comme l’expression de Queneau, « pleurire aux larmes », on peut simplement ajouter que ce recueil d’hommage fait à son tour entendre avec beaucoup de justesse et d’intensité ce que J.-Y. Pouilloux, cherchant lui-même à percevoir plus précisément et à exprimer malgré tout, à travers les limites éprouvées du langage, ce qui constitue une « pure présence », aura toujours essayé de faire entendre, dès lors qu’on prenait le temps de l’écouter – et dès qu’on prend à nouveau le temps de le lire.
François Roussel
Paris
106*
* *
Marc Foglia, Montaigne, Pas à pas, Paris, Ellipses, 2021, collection « Pas à pas », 192 p., ISBN : 978-2-340-06080-7.
Publié dans une collection à vocation pédagogique, le récent livre de Marc Foglia s’inscrit dans la lignée de deux précédents ouvrages sur Montaigne plus spécifiquement axés sur les notions de « jugement » et « d’interprétation » considérées à juste titre comme offrant un prisme d’analyse transversale des Essais. On en retrouve certains éléments substantiels dans ce nouvel opus qui se présente davantage comme une introduction générale à la lecture de Montaigne et plus précisément à la compréhension de sa manière de pratiquer la philosophie à travers une forme singulière d’écriture réflexive. Mais l’exigence analytique n’en n’est pas abaissée pour autant et évite les réductions appauvrissantes au prétexte qu’il faudrait proposer un accès facilité à la lecture des Essais dont l’abord apparaît légitimement difficile voire rébarbatif à plusieurs titres.
La première page met d’emblée en garde contre ce travers réducteur et confirme qu’il s’agit de conjuguer l’ouverture à un lectorat non spécialisé et la rigueur maintenue concernant les éléments de présentation et de mise en perspective, l’auteur soulignant l’effort d’approche et la reconnaissance de ce qui fait obstacle à une appropriation ajustée sinon pleine et entière des Essais (pour peu que l’expression ait un sens). Cela est lié notamment à « l’effet d’étrangeté » que produisent leur langue et la multiplicité des références culturelles et historiques dont le texte est parsemé voire « truffé » (notamment les poètes latins : Horace, Virgile, Lucrèce). Concernant cette pratique d’emprunts nombreux et divers aux auteurs de la culture dite « classique » ou à d’autres plus contemporains de Montaigne, M. Foglia rappelle la remarque faite jadis par André Gide : « L’abondance des citations qui font, de certains chapitres des Essais, un pudding compact d’auteurs grecs et latins, nous ferait douter de l’originalité de Montaigne ; il faut que celle-ci soit bien vive pour dominer ce fatras ». Sans forcément que l’on partage les termes de cette 107remarque concernant l’éventuel caractère indigeste du poids des citations, il est incontestable que cette pratique familière à nombre d’auteurs de la Renaissance appelle une réflexion soutenue sur ce qui fait malgré tout la singularité de l’écriture des Essais, initialement nourrie par ce qu’on peut nommer des « notes de lecture » et des recueils de « lieux communs » qui servent d’appui à des commentaires, gloses et développements plus soutenus selon l’inspiration et l’occasion.
C’est donc très logiquement que le livre consacre une première partie éclairante à l’activité entremêlée de « Lire, écrire, relire » – la relecture étant alors moins celle des auteurs les plus sollicités par Montaigne que celle des chapitres déjà écrits et souvent retravaillés, augmentés, parfois infléchis voire nettement modifiés tout au long de la longue durée d’accroissement des Essais. Cette réécriture, accompagnant l’ajout de nouveaux chapitres dans un substantiel troisième livre, s’est poursuivie jusqu’à la mort de Montaigne, confirmant ainsi une formulation célèbre du chapitre « De la vanité » : « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde ? ». L’analyse de M. Foglia insiste à juste titre sur le mouvement incessant et complexe d’un libre rapport aux auteurs sollicités, cités et commentés ou « glosés » en fonction d’un cadre de réflexion qu’ils ont pu susciter ou dans lequel ils prennent place. Et il est éclairant de rappeler et de faire valoir à cet égard l’importance du développement de l’imprimerie dans la transformation des modalités de lecture et d’interprétation des textes en fonction de contextes et d’usages moins strictement encadrés et codifiés. C’est ce que précise le chapitre « Lire à pièces décousues » en reprenant une expression par laquelle Montaigne, dans « Des livres », désigne et explicite la « façon » de procéder de ses philosophes de prédilection (Plutarque et Sénèque), et sa propre manière de « peser », plutôt que de « compter » les citations, c’est-à-dire de les choisir comme incitation à la réflexion et non comme « autorité » ou comme ornement de culture lettrée.
L’écriture des Essais s’inscrit pleinement dans la continuité de cette pratique de lecture libre ou « nonchalante », refusant de suivre les normes conventionnelles ou scolastiques du commentaire ordonné en vue d’une fin préalablement fixée (enseignement moral, argumentation philosophique ou théologique). Tout en soulignant l’ambivalence de la critique de Montaigne qui déplore ironiquement, en s’y incluant, le fait 108de « nous entregloser » là où il serait préférable d’inventer, M. Foglia précise les traits caractéristiques de son écriture : une constante attention aux changements incessants qui portent autant sur les choses que sur les manières de s’identifier et de se saisir soi-même comme en perpétuel mouvement : « Et nous, et notre jugement, et toutes choses mortelles, vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi il ne se peut établir rien de certain de l’un à l’autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle mutation et branle ». L’exercice constamment reconduit de la mise à « l’essai » du jugement est bien le moteur de cette « œuvre mobile » assimilée à une forme d’héraclitéisme qui donne toute sa part aux transformations et renversements imprévus, au hasard, à la « fortune », et ne prétend nullement se présenter comme « maîtrise » ou « régence », bien que l’écriture soit en elle-même un effort persistant de description et d’enregistrement des mouvements les plus divers et les plus contradictoires de l’esprit humain, et plus particulièrement de ce que Montaigne nomme ses propres « fantaisies », aussi étranges, ineptes et monstrueuses soient-elles.
Cette insistance sur le rôle des « faveurs et disgrâces de la fortune », jusque dans le peu d’ordre et de constance de nos pensées et passions, n’est cependant pas exclusivement négative, bien que ce désordre confirme la faiblesse, la volatilité et la vanité de l’esprit humain. M. Foglia remarque à juste titre que « Montaigne ne se désole qu’en apparence de l’inconstance de la raison, qui va en réalité lui servir d’alliée contre le dogmatisme ». Il ne s’agit pas pour autant d’assigner les Essais à une forme de scepticisme « radical », seule manière de combattre la propension affirmative et dogmatique de la raison. Sur ce point le chapitre 3 de la troisième partie offre une synthèse partielle qui tient compte de nombreuses analyses ayant renouvelé cette question depuis les travaux pionniers de Jean-Yves Pouilloux et d’André Tournon. Le scepticisme singulier à l’œuvre dans les Essais ne renonce pas à la recherche de vérité mais constate que rien n’autorise à penser qu’on en atteindra le terme, bien qu’il faille en garder l’exigence. C’est le sens très précis de cette formule cardinale : « Nous sommes nés à quêter la vérité. Il appartient de la posséder à une plus grande puissance ». Autrement dit : nous ne pouvons nous prévaloir d’une pleine et entière connaissance ni des choses, ni de nous-mêmes ; mais nous sommes appelés à en avoir une jouissance légitime, au sens d’un usage le plus utile et plaisant 109possible : « Les biens de la fortune, tous tels qu’ils sont, encores faut il avoir du sentiment pour les savourer. C’est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux ». Et ce « savoir jouir loyalement de son être » passe par la recherche d’une parole aussi véridique ou sincère que possible, y compris dans la reconnaissnce de nos replis les plus obscurs et les moins avouables. Tel est le sens de la « bonne foi » qui ouvre le livre dans l’adresse « Au lecteur » : tenir autant que possible une parole vraie sur soi, à défaut de prétendre pouvoir saisir la pleine connaissance des choses. À la suite notamment des analyses décisives d’André Tournon, M. Foglia insiste donc sur l’exercice du jugement comme exigence de « sincérité » qui engage et « oblige » la parole en première personne et où ce qui importe est non la prétention toujours présomptueuse à un énoncé vrai mais bien davantage « la véracité de l’énonciation ».
Les deuxième et troisième parties du livre sont alors consacrées à « Connaître » et « Bien juger », dans le sens où ce qui est d’abord en jeu, ce n’est pas tel objet de connaissance, y compris la connaissance de soi comme thème privilégié, mais le rapport réfléchi à nos opinions et raisonnements qui doivent autant que possible être passées au crible du jugement. Tel est exactement le sens du verbe « essayer » dans son usage dominant : mettre à l’épreuve le jugement comme capacité réflexive, en faire constamment l’épreuve, y compris dans la reconnaissance de sa fragilité. Un exemple éclairant en est donné à propos des questions militaires qui abondent dans le livre I des Essais et qui ne tiennent pas seulement au contexte des violentes guerres de religion dans lequel ils ont été écrits. M. Foglia relève que les nombreuses situations historiques évoquées par Montaigne confirment qu’il n’y a pas de principes et de règles universelles qui serviraient de boussole en toutes circonstances. Il faut constamment relier la valeur d’une règle de conduite à l’analyse de la situation et des mœurs d’une époque, en distinguant notamment entre époques « vertueuses » et époques « dépravées » telle celle des guerres civiles avec leurs incessantes tractations, renversements d’alliances, trahisons, massacres et cruautés extrêmes. Pour autant, la reconnaissance que la ruse peut être un moyen légitime en contexte de guerre ne conduit pas à en justifier la généralisation sans limite, comme si la violence guerrière abolissait toute dimension morale et donc tout exercice ajusté du jugement en fonction des circonstances et de la fin visée.
110L’analyse vaut également dans le domaine de la médecine, au-delà des critiques réitérées que Montaigne adresse à cet « art » dont il se méfie et sur lequel il ironise parfois férocement en lui opposant un souci « diététique » que chacun devrait pouvoir mettre en œuvre en s’observant de près dans ses singularité les plus « bassement » corporelles. Plus généralement et concernant d’autres domaines comme l’exercice de la justice (sur lequel le livre ne s’attarde pas et qui fut « l’office » de Montaigne avant sa « retraite » oisive mais studieuse), ou encore les méandres innombrables et retors de l’action politique, M. Foglia insiste sur l’articulation problématique mais nécessaire entre l’expérience accumulée à travers des « pratiques » et l’importance d’en extraire des règles de compréhension qui donnent forme à l’exercice du jugement, sans pour autant prétendre y enfermer le cours des évènements et leur part essentielle d’imprévisibilité. À cet égard il est bienvenu de rappeler que l’humanisme renaissant comporte un héritage aristotélicien que Montaigne met en œuvre à sa manière dans cette importance reconnue à la reprise réflexive de l’expérience sensible et de ce qu’elle comporte de connaissance relative mais effective dès lors que la mise en œuvre du jugement y voit sa place pleinement reconnue. C’est notamment ce qu’explicite ce passage du chapitre « De l’art de conférer » : « l’expérience d’un chirurgien n’est pas l’histoire de ses pratiques, et se souvenir qu’il a guéri quatre empestés et trois goûteux, s’il ne sait de cet usage tirer de quoi former son jugement, et ne nous sait faire sentir qu’il soit devenu plus sage à l’usage de son art (…). Si les voyages et les charges les ont amendés, c’est à la production de leur entendement de le faire paraître. Ce n’est pas assez de compter ses expériences, il les faut peser et assortir ; et les faut avoir digérées et alambiquées, pour en tirer les raisons et conclusions qu’elles portent ».
Tout aussi éclairante est l’analyse concernant le fait de « Cultiver le sens du relatif », de même que celle concernant ses nécessaires « contrepoids » qui viennent équilibrer par la réflexion du jugement la puissance indéniable et parfois étouffante voire tyrannique de la « coutume », puissance qui met en question la référence trop formelle et abstraite à une « raison universelle ». M. Foglia propose un relevé précis qui permet chemin faisant de faire justice d’un double travers interprétatif concernant l’orientation générale des Essais : soit la glorification d’un relativisme sans limite désarmant le principe même d’une réflexion distanciée à l’égard des 111multiples coutumes qui constituent les formes de vie humaines ; soit à l’inverse sa dénonciation véhémente fustigeant une approche dissolvante au prétexte que « tout se vaudrait », faisant alors perdre toute portée morale et politique à la description, à la confrontation et à l’évaluation des différentes mœurs humaines.
À l’inverse de cette dénonciation rituelle et paresseuse sinon de pure mauvaise foi ne voyant là qu’un relativisme généralisé, le livre explicite ce qu’il importe de comprendre dans l’attention portée par Montaigne à l’extrême diversité que l’expérience nous enseigne continuellement : celle des choses qui composent la nature, celle des différentes formes de vie animales, et plus particulièrement celle des comportements humains en regard de normes et de valeurs proclamées à défaut d’être respectées. Ce qui fait toute l’importance du « sens du relatif » qui traverse les Essais, c’est d’abord la reconnaissance des limites de nos connaissances qui n’égaleront jamais la profusion et parfois l’étrangeté des formes du monde dès lors qu’on s’efforce de le considérer en son entier, au moins imaginairement. Comme le redira Pascal en écho à Montaigne, l’imagination « se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir ». Et là encore, ce constat ne conduit pas à un scepticisme « radical » qui nierait l’importance de ce qu’apporte l’expérience et la nécessité d’y exercer son jugement : il y aurait une inconséquence évidente à faire du « relatif » un absolu, même lorsque Montaigne fait l’éloge d’une ignorance qui vient corriger sans ménagement la présomption ordinaire, l’orgueil sans mesure de de l’esprit humain.
De manière plus familière sinon convenue, le « sens du relatif » renvoie plus spécifiquement à la description nourrie de la très grande diversité des mœurs humaines (coutumes, normes, manières). Mais là encore, si « relativisme » il y a dans les Essais, c’est bien dans l’attention portée à la saisie des relations qui constituent un ensemble donné de valeurs et de comportements, avec les tensions et contradictions que cet ensemble instable et changeant comporte inévitablement, sous toutes les latitudes et à toutes les époques. L’essentiel à cet égard est de pouvoir se « décentrer » par rapport à ses propres habitudes et normes d’évaluation, de constituer une distanciation salutaire que M. Foglia nomme judicieusement, en écho latéral à une formule de Kant, « réveiller le jugement de son sommeil coutumier ». C’est ce que rendent possible les voyages effectifs ou leurs récits plus ou moins fiables, nourrissant comparaisons et confrontations des 112« coutumes » et institutions ; ou encore, sur un autre plan, c’est ce à quoi incite la lecture des auteurs anciens, par un effet de décalage historique ; et c’est encore ce à quoi ouvre un certain usage de l’imagination, dès lors qu’elle est attentive à corriger ce que l’expérience immédiate peut avoir de trop restrictif par rapport à la diversité des formes naturelles et des comportements humains. M. Foglia le dit de manière éclairante en opposant un usage « généralisant » et un usage « relativisant » de l’imagination : « L’usage généralisant donne au particulier la valeur du général, tandis que l’usage relativisant rend au particulier sa valeur de particulier ». Et il conclut cette analyse par une formulation bienvenue : « S’essayer soi-même, c’est paradoxalement s’imaginer à la place des autres » ; formulation qu’il faut entendre dans toutes ses implications concernant la reconnaissance et l’attention portée à une altérité humaine qui n’est jamais absolue, contrairement à l’usage ordinaire du mot « barbarie » qui croit pouvoir porter un jugement sans appel sur cette altérité, sans être capable d’en reconnaître la présence au moins potentielle – et souvent effective – dans ses propres comportements effectifs.
Sur ce point névralgique, le chapitre 1 de la troisième partie : « Bien juger de la barbarie » apporte les précisions qui s’imposent, Montaigne rappelant du même mouvement que l’accusation de « barbarie » est la chose du monde la mieux partagée : « Nous appelons barbare ce qui n’est pas de notre usage », mais que pour autant il y a des comportements humains qu’on peut identifier à bon droit comme « barbares » dès lors qu’on ne s’en croit pas inexplicablement préservé. Nombre de passage des Essais dénoncent sans réserve la violence de la conquête du monde nouvellement découvert, avec ses pillages et l’asservissement ou l’extermination des peuples qui y vivaient, y compris les peuples cannibales évoqués dans le célèbre et complexe chapitre 31 du livre I. Il ne s’agit pas pour autant de soutenir que cette pratique cannibale n’a rien de « barbare » eu égard à des règles générales d’humanité, mais de souligner que ces rituels de dévoration relèvent, comme toute autre coutume humaine, d’une construction symbolique à identifier et à décrire, et que le fait d’en dénoncer la « barbarie » n’exempte en rien les peuples chrétiens de leur propres violences et extrêmes cruauté dirigées à la fois contre les peuples du « nouveau monde » mais également contre les chrétiens d’une autre confession (catholiques contre protestants en l’occurrence). Dans cette réflexion concernant les usages communs des termes « barbare » et « barbarie », on voit là aussi à l’œuvre 113l’exercice d’un jugement critique capable de porter sur les coutumes et pratiques les plus familières, y compris les formes de cruauté institutionnelles comme celle des pratiques judiciaires de torture, quelles que soient les justifications apportées. C’est ce que, reprenant une formule inscrite sur l’une des poutres de la « librairie » du château de Montaigne, M. Foglia explicite au titre de « l’alternance du jugement », seul gage de son « bon usage » tel qu’il est plus particulièrement explicité dans les chapitres 2 et 4 de la troisième partie du livre.
La dernière partie, « Eclaircir les esprits » reprend également une formulation du chapitre « De l’art de conférer » compris sous l’angle d’une réflexion critique concernant la manière dont on se rapporte à ses propres idées et opinions, et comment il est nécessaire de s’interroger sans relâche sur les dangers d’y tenir de manière trop « opiniâtre », c’est-à-dire en y étant rivé sans se donner les moyens ni l’énergie d’y exercer notre jugement. D’où les analyses consacrées à la réflexion perplexe de Montaigne sur les miracles, et à sa critique constamment réitérée de la présomption humaine dont il faut se moquer aussi rudement que possible faute d’y retomber instamment par « auto-persuasion » aveugle, complaisante et délétère. De même M. Foglia s’arrête à juste titre sur la dénonciation de ce qu’il nomme « fanatisme », même si le terme correspondant est plutôt dans les Essais celui d’« opiniâtreté », attitude d’autant plus redoutable qu’elle s’appuie sur des institutions politiques et théologiques, comme dans le cas de la persécution des sorcières analysée et critiquée de façon très « hardie » dans le chapitre « Des boiteux » où Montaigne s’oppose notamment aux conceptions intransigeantes de Jean Bodin.
Dans tous les aspects abordés dont on a essayé de donner un aperçu forcément parcellaire en laissant de côté les éventuels points de discussion (nuances ou divergences éventuelles), le livre de M. Foglia remplit donc efficacement le contrat de lecture de la collection qui propose de suivre « pas à pas » les méandres et complexités diverses d’un auteur, et plus singulièrement dans le cas de Montaigne les cheminements d’une écriture qui ne revendique ironiquement une dimension philosophique que de manière « impréméditée et fortuite » selon ses dires mêmes. Pour qui veut entrer dans une lecture progressive des Essais tenant compte de leurs difficultés d’appropriation pour un public contemporain, ce livre constitue un guide éclairant sur nombre de points essentiels. Il peut même donner envie de poursuivre, outre la lecture des Essais ainsi utilement balisée, 114par celle des précédents livres plus spécialisés que l’auteur a consacrés à Montaigne, dont celui-ci offre une synthèse et un prolongement bienvenus.
François Roussel
Paris
*
* *
Alain Legros, Montaigne en quatre-vingts jours, Paris, Albin Michel, 2022, 304 p., ISBN : 978-2-226-46485-9.
Après la vogue de la biographie, la critique montaigniste semble renouer avec les lectures affectives, empathiques, que les Essais notamment ont toujours stimulées, par où l’objet second se rapproche quelque peu du premier par le tour subjectif et/ou plastique qu’il adopte. Tels sont, dans les toutes dernières parutions, le Dictionnaire amoureux de Montaigne d’André Comte-Sponville (Paris, Plon, 2020), et le Montaigne en quatre-vingts jours d’Alain Legros – lequel s’est interdit la consultation de l’« ouvrage cousin » avant d’avoir achevé son propre manuscrit (p. 13).
Disons-le de suite : ce Montaigne en quatre-vingts jours est selon nous une réussite. Il assume son usage de la première personne, présente d’un bout à l’autre de ses quelques 258 pages d’analyse, les toutes dernières étant occupées par un « florilège » de formules du Bordelais décontextualisées. Celles et ceux qui connaissent le critique y reconnaîtront sa voix familière et sa bonhommie spirituelle, dans les concetti qui ponctuent les sections particulièrement, où peuvent poindre des confidences. On fraye ainsi déjà avec l’essai, ce qui est encore renforcé par la configuration de l’ouvrage, et le souci de disposition qui l’anime. Sous l’égide du titre célèbre de Jules Verne paraphrasé, il s’offre, selon la « Proposition » introductive, comme une suite de « quatre menus », « de vingt plats chacun » (p. 9), soit vingt 115courtes sections avec titre et citation liminaire trouvée chez Montaigne sous chacun des chapeaux que sont « Jalons et focus », « L’auteur et son livre », « Philosophie et religion », « Vestiges et découvertes ». Montaigne se disait « échanson », Alain Legros prend son relais, nous invitant à savourer, dans l’ordre que l’on voudra, ce savant banquet.
Savant, de fait. Si l’ouverture, là encore, cible un lectorat selon le principe du « grand écart », soit à la fois les « spécialistes assez bienveillants » et les « curieux un peu attentifs » (p. 9), on peut penser que le défi sera relevé tant en la circonstance la science, et des plus hautes, ne se présente jamais « en une marche étudiée ». Il faut avoir consacré « trente ans de bonnes et loyales recherches » (p. 7), et des meilleures, à une œuvre, il faut la plus profonde et intime connaissance de cette dernière, pour être capable d’exposer avec tant de simplicité et de clarté ce qui en constitue les traits et les singularités les plus remarquables.
C’est donc ici un « bilan » d’enquêtes, qui déterminent le choix des différentes sections. Du coup, l’autocitation – tropisme démesurément développé dans la gent universitaire – n’agace pas, d’autant que cette érudition est réservée pour des notes de fin de volume, et qu’Alain Legros sait en outre rendre justice, dans les références qu’il retient, à nombre de travaux autres que les siens qui comptent dans la critique montaigniste. Regrettera-t-on au passage que ces renvois soient faits par un appel de note placé à la fin de chaque section, qui permet de suivre, un peu tant bien que mal, la numérotation du tout ? Celle des chapitres eux-mêmes eût sans doute été plus claire, et surtout plus mimétique des Essais eux-mêmes.
Cette broutille passée, autorisé par un livre qui encourage la liberté dans la lecture comme la lecture en liberté, on signalera, au milieu de quantité de développements réjouissants, celui sur « Devise et jeu de paume » (I.16) et le verbe « soutenir » relevant de celui-ci (p. 63), d’ailleurs repris dans « Duel à quatre » (II.30) alors qu’il est désormais question d’escrime (p. 108) ; les variation sur « Du rouleau au codex » (II.26), imprégnées du savoir bibliophile d’Alain Legros ; celles sur les Essais vus comme « une grande petite annonce » (II.38) ; celles sur la Saint Barthélémy et son absence de l’œuvre (IV.63), sur le travail de Montaigne magistrat (IV.64 et 65), et bien entendu sur les poutres, les livres, les Essais dans le temps.
Par-delà et parmi les découvertes considérables qui sont ici rappelées, l’une semble chère à Alain Legros, qui est exposée dans « Un aveu 116indiscret et tardif » (II.32), et qu’en vertu d’une sorte d’obliquité entre certains développements, on retrouve dans l’ultime chapitre « Éditions posthumes » (IV.80). Elle tient à une confidence présente dans les éditions de 1595 et 1598 et pas sur l’Exemplaire de Bordeaux, si triviale qu’il est difficile de l’imputer à la Demoiselle de Gournay. Et voilà relancé le débat sur le texte des Essais, à propos duquel l’auteur de Montaigne en quatre-vingts jours semble prendre discrètement position. Et ce n’est pas tout en la matière, tant les Essais imposent de se prononcer, voire de parier, à un moment ou un autre, sur leur statut et leur visée. Dans le premier « envoi » qui conclut le livre, « destiné idéalement aux futurs critiques de Montaigne », Alain Legros, au risque de s’attirer « une volée de bois vert » de ses « amis mêmes » (p. 263), énumère toutes les pièces versées au dossier de la mauvaise foi de Montaigne, avant de leur opposer tout net le passage de « De l’utile et de l’honnête » « Ceux qui disent communément contre ma profession, que ce que j’appelle franchise, simplesse et naïveté en mes mœurs, c’est art et finesse […] ». Ou comment résumer avec humour et légèreté un clivage essentiel et décisif dans les lectures montaignistes, tout en indiquant vers quoi semble-t-il on penche.
Non dogmatique, parfois amusant jusqu’à la surprise (« Bienvenue chez Messire Michel, seigneur de Frankenstein ! », p. 81), empli de bonheurs d’écriture (« Les Essais sont un livre blessé, et qui le restera », p. 105), Montaigne en quatre-vingts jours est un essai littéraire, sur une œuvre plurielle, dont il restitue la contemporanéité (ainsi, exemplairement, dans l’abécédaire qui constitue le « second envoi » final) sur fond de la plus belle connaissance historique, philologique et philosophique qui soit. Le plaisir qu’il suscite et la connivence qu’il crée sont dignes de ce que produisent les Essais, et sont la meilleure voie pour relire ou découvrir ces derniers. On pourrait presque appliquer à Alain Legros la formule par laquelle il célèbre Montaigne à la fin de la seconde partie et du quarantième chapitre, soit le centre numérique, de son ouvrage : « Merveilleux auteur, qui fait de son lecteur, un interlocuteur, un convive, un amant » (p. 138).
Olivier Guerrier
Université Toulouse Jean Jaurès