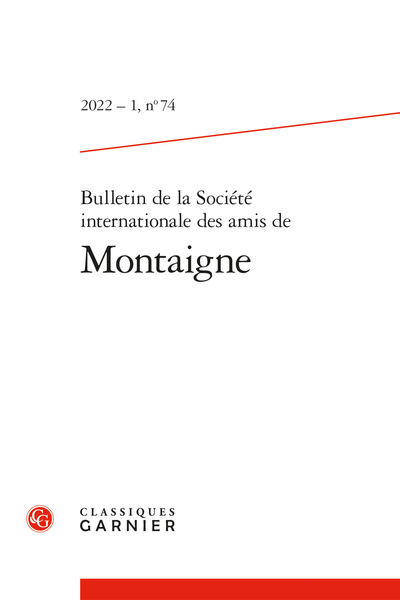
Tracing the design of the Essays
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne Montaigne outre-Manche
2022 – 1, n° 74. varia - Author: Fallanca (Vittoria)
- Abstract: Do the Essais have a guiding thread? Surely not : as recent scholarship emphasises, this is a polyphonic, fragmented, malleable text, open to multiple interpretations, reducible to none. Not to mention that it risks resuscitating the tired debates over authorial intention. This article proposes to revive this question by reading the Essais not for the presence of an intention but of a design, paying attention to role of the polysemic term “dessein” in Montaigne’s project.
- Pages: 207 to 222
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406129752
- ISBN: 978-2-406-12975-2
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12975-2.p.0207
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-30-2022
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: design, intention, project, polysemy, teleology
PARCOURIR LE DESSEIN DES ESSAIS
DESSEIN : MOT CLÉ, MOT CONTESTÉ
Cet article reprend le fil de mon article paru dans le dernier numéro du BSIAM1. Là, je m’étais interrogée sur les possibilités interprétatives de la ligne dans la pensée montaignienne, proposant une alternative aux lectures « intentionnalistes », ou simplement linéairement téléologiques, des Essais. Ici j’approfondis une dimension en particulier de cet article, à savoir l’importance et la portée herméneutique du mot « dessein » et ses connotations dans l’écriture de Montaigne. Mon premier but c’est d’éclaircir les diverses façons dont Montaigne conçoit ce terme, et d’étudier comment ces diversités sémantiques peuvent à leur tour éclairer le projet des Essais. Le deuxième but de cet article, non moins important mais sensiblement bien plus difficile à prouver objectivement, est d’établir le mot « dessein » comme mot clé des Essais, c’est-à-dire, un terme qui révèle des aspects fondamentaux de l’attitude de Montaigne envers son œuvre. En me concentrant sur des occurrences du mot dessein et en m’appuyant sur sa complexité sémantique, j’espère éclaircir certaines des dynamiques au cœur de la façon dont Montaigne se sert de se terme, et en deuxième lieu aborder le rôle de ce que j’appelle le « dessein textuel » des Essais.
Rappelons pour commencer que, dans les années 1570 quand Montaigne se met à rédiger ses Essais, le mot dessein possède une flexibilité sémantique notable. Comme le constate la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie Française, le terme d’art dessin n’entre dans la langue française qu’au cours du dix-huitième siècle2 :
208Dessin. Terme d’Art. Il se dit De la représentation d’une ou de plusieurs figures, d’un paysage, d’un morceau d’Architecture, etc. soit au crayon, soit à la plume3.
Avant cette époque, c’est le terme dessein qui possède les connotations visuelles et graphiques qui vont, plus tard, s’attacher à dessin. Dessein apparaît aussi dans un dictionnaire paru quelques années plus tôt, l’édition de 1787 du Dictionnaire critique de la langue française, dont l’auteur, en reconnaissant le schisme sémantique qui a déjà eu lieu entre dessein et dessin et soulignant l’anachronisme de la définition de l’Académie Française, écrit que dessin est « une heureûse innovation, pour exprimer l’art de dessiner et l’ouvrage du Dessinateur » et qu’« [o]n écrivait auparavant dessein, l’Acad. l’écrit encore de même4 ». L’utilisation du mot heureuse dans cette définition, ainsi que du mot innovation, révèle la nécessité apparente de la part de la communauté linguistique française de s’appuyer sur un terme capable de capturer la production visuelle ou graphique, un terme qui peut, sans ambiguïté extraordinaire, rendre intelligible dans la langue française le résultat d’un processus d’inscription ou de représentation manuelle. Antérieurement, dessein était communément utilisé pour renvoyer soit à un but, un projet ou une intention, soit à cet art de représentation graphique.
Montaigne utilise le mot « dessein » dans ses diverses formulations 95 fois dans l’Exemplaire de Bordeaux – c’est-à-dire une fois de plus que les occurrences notées dans la Concordance des « Essais » de Montaigne éditée par Roy Leake, qui saute l’occurrence du verbe desseigner dans « De la solitude ». Malgré quelques divergences, il y a également 95 occurrences dans l’édition de 15955. Ce nombre en soi n’est pas particulièrement étonnant – le substantif le plus utilisé, homme, est présent 1.180 fois en tout si on compte les occurrences au singulier et au pluriel. Pourtant la fréquence de dessein est comparable à d’autres termes qui 209peuvent être considérés des « mots clés » des Essais, mots tels que volupté (qui paraît 105 fois) et hazard (63)6. Le terme dessein mérite une attention spéciale parce que le langage portant sur la notion de dessein est ancré dans l’imagination littéraire de Montaigne et fait partie intégrante de son écriture – y compris, et c’est crucial, au niveau méta-textuel : ces endroits où Montaigne affronte les problèmes et les limites de sa propre position d’auteur.
Voici une explication qui pourrait rendre compte de la façon dont Montaigne utilise le mot dessein : au cours de la rédaction des trois « couches » des Essais, l’écriture montaignienne devient de plus en plus autoréflexive, le processus d’écriture de l’auteur s’intègre au contenu des chapitres, et l’écriture même devient une façon d’enregistrer ses pensées sur l’art d’écrire et la nature expérimentale de son projet. Cette explication concorde avec une vision familière des Essais et du chemin parcouru par Montaigne vers une position de plus grande réflexivité sur sa position d’écrivain. Il existe aussi une autre explication possible, notamment une explication culturelle et linguistique qui concerne le développement du terme dessin : dans cette perspective, les usages montaigniens font partie d’un courant sémantique qui va vers une externalisation de la signification du terme dessein, c’est-à-dire vers une signification plus visuelle/matérielle. Selon cette interprétation, les Essais représentent un exemple d’écriture française qui répond à ce changement sémantique en reflétant, implicitement ou explicitement, la relation entre les deux « pôles » de dessein : l’intentionnel, et l’artistique ou le matériel7.
210Pourtant, ni l’une ni l’autre de ces deux explications n’est capable de saisir les nuances du langage du dessein chez Montaigne. Premièrement, il n’y a pas de ligne certaine qu’on puisse tracer dans les Essais qui correspondrait à une progression téléologique vers une plus grande autoréférentialité de la part de l’auteur en ce qui concerne sa propre intention. Si les usages auto-référentiels du mot dessein sont plus fréquents dans le troisième livre, ainsi que dans les couches tardives, nous pouvons constater la présence d’un langage personnel de dessein qui s’attache à des descriptions de son propre projet d’écriture dès les premières pages du livre, notamment à partir de l’avis « Au lecteur » où Montaigne utilise pour la première fois le mot dessein en essayant de formuler ses intentions :
C’est icy un livre de bonne foy, lecteur. Il t’advertit dès l’entrée, que je ne m’y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n’y ay eu nulle consideration de ton service, ny de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d’un tel dessein. (38)
Le contenu sémantique des occurrences plus tardives du mot dessein, avec toutes leurs associations d’un projet plus mûr, plus assuré en ses qualités expérimentales, est en relation dialogique avec ces réflexions textuellement plus « jeunes » où Montaigne exploite les possibilités expressives du mot dessein9. En second lieu, l’hypothèse d’une inscription de Montaigne dans le développement historique du mot dessein allant vers un courant artistique et visif est séduisante, mais elle reste une connexion difficile à prouver scientifiquement. Non seulement pour l’absence de preuves certaines que Montaigne ait lu ou autrement ait eu connaissance des textes et des courants artistiques de l’époque qui s’appuyaient sur la polysémie visuelle de dessein, mais aussi parce que, plus abstraitement, le changement linguistique est un phénomène extrêmement complexe et non unidirectionnel10. Même s’il est évident que les textes littéraires 211reflètent ces types de changements linguistiques, ils sont aussi des agents actifs qui produisent eux-mêmes ces changements11. Rien n’exclut en principe le fait que Montagne ait influencé ce changement en même temps qu’il en fut influencé.
Pris comme une séries de constellations interconnectées, donc, plutôt que des points dans une trajectoire linéaire, les usages de dessein dans les Essais ne nous aident pas à construire l’histoire d’un Montaigne comme auteur qui tendrait avec le temps à réfléchir toujours plus sur la nature et l’intention de son projet, mais ils attestent en revanche que l’auteur a toujours été captivé par la question, cruciale pour lui, de l’intention humaine et de ses vicissitudes, et que cette question est inextricable du processus de l’écriture. Dans la suite de cet article, je vais me concentrer sur une poignée d’occurrences de dessein pour clarifier et approfondir cette relation.
LES MEILLEURS DESSEINS
ONT TOUJOURS DES FAILLES
Des 95 occurrences de dessein dans les Essais, presque toutes font référence à des desseins humains, et la majorité à des desseins des hommes12. Les plus intéressants peuvent se grouper sur une triade de thèmes : la mort, la fortune, et le jugement. Examinons une occurrence dans un chapitre qui est explicitement intéressé par ces trois thèmes : « De juger 212de la mort d’autruy13 ». La première occurrence du mot dans ce chapitre se trouve juste après que Montaigne développe l’idée que peu de gens sont à proprement parler prêts à mourir – pour l’auteur cette idée comporte une compréhension au niveau épistémique : il faut savoir qu’on est près de mourir. Montaigne écrit que, grâce à la prévalence de cette ignorance, on ne peut pas juger quelqu’un courageux face à la mort. La plupart des gens, écrit-il, font semblant de tenir ferme mais pensent en réalité pouvoir survivre et jouir d’une bonne réputation. C’est ici qu’on trouve dessein : Montaigne écrit que de tous ceux qu’il a vus mourir « la fortune a disposé les contenances, non leur dessein » (607). Un rapprochement entre le terme dessein et le terme fortune peut se constater aussi dans une autre occurrence de dessein dans le même chapitre, alors que Montaigne traite de l’exemple de l’empereur Héliogabale :
De maniere que le plus effeminé homme du monde Heliogabalus, parmy ses plus lasches voluptez, desseignoit bien de faire mourir delicatement, ou l’occasion l’en forceroit : Et afin que sa mort ne dementist point le reste de sa vie, avoit faict bastir exprès une tour somptueuse, le bas et le devant de laquelle estoit planché d’ais enrichis d’or et de pierrerie pour se precipiter : et aussi faict faire des cordes d’or et de soye pour s’estrangler : et battre une espée d’or pour s’enferrer : et gardoit du venin dans des vaisseaux d’emeraude et de topaze pour s’empoisonner, selon que l’envie lui prendoit de choisir de toutes ces façons de mourir. (607)
Cette anecdote est représentative d’un thème qui préoccupe Montaigne tout au long des Essais, notamment la question de savoir si la mort s’aligne ou non avec la vie – si elle reflète la manière dont on a vécu. L’idée de « bien mourir » constitue un lieu commun au seizième siècle, où elle est maniée par les écrivains de cette époque à partir de la tradition médiévale chrétienne de l’ars moriendi14. Héliogabale représente un exemple important de cette préoccupation avec l’art de bien mourir 213poussé à une conclusion plutôt extrême, et il était souvent cité par les écrivains de la Renaissance comme exemple de la décadence et de la frivolité15. Il n’est pas du tout implicite que Montaigne trouve le cas d’Héliogabale complètement ridicule : il le cite comme exemple de quelqu’un doté d’une bonne santé mentale et physique qui décide de se tuer pour pouvoir être le maître de sa propre mort, tout en s’ôtant par conséquent la possibilité de démontrer du courage et de la fermeté face à une mort non préméditée. Il y a aussi la dimension du genre dans ce jugement, comme le révèlent les mots « efféminé » et « lasches16 ». L’insistance sur l’excessivité du dessein d’Héliogabale sert aussi à mettre en valeur les aspects comiques de cet exemple, et il est probable que Montaigne prenait pour acquis que son lecteur connaissait la fin malheureuse d’Héliogabale : assassiné par la Garde prétorienne et son corps abandonné dans un égout, c’était une fin bien éloignée, en forme et circonstances, de celle qu’il se proposait. Héliogabale avait comme dessein de bien mourir, de mourir délicatement (et avait matériellement planifié les choses pour s’assurer une mort convenable), mais ce dessein a été finalement démenti par des facteurs indépendants de sa volonté. La fortune, nous dit Montaigne, a peut-être aidé à nous faire parvenir l’idée de sa « contenance » (celle d’un homme qui prenait plaisir dans les belles choses, le luxe et l’opulence), mais a complètement détruit le dessein qu’il avait de garantir que sa mort aurait manifesté la même extravagance que sa vie.
L’occurrence de dessein dans ce chapitre marque une des relativement rares occasions où Montaigne utilise la forme verbale de dessein (desseignoit) – des 95 occurrences seulement 12 sont sous cette forme. En choisissant le verbe, Montaigne souligne la dimension temporelle du 214dessein d’Héliogabale, c’est quelque chose qui vise le futur, bien sûr, mais aussi qui comporte une série d’actions séquentielles. La forme verbale de dessein se retrouve une nouvelle fois dans le contexte des discussions de la mort dans une prescription du chapitre « Que philosopher, c’est apprendre à mourir » : « Il ne faut rien desseigner de si longue haleine, ou au moins avec telle intention de se passionner pour n’en voir la fin » (18917). La dimension temporelle est encore plus explicite ici, et Montaigne semble signifier soit un projet mental soit sa réalisation. Le mot « haleine » consolide cette interprétation, mot qui évoque l’idée d’un projet comme quelque chose qui requiert une alimentation continue, prolongée18. La phrase qui suit nous donne plus d’information sur le sens de cette phrase un peu curieuse – Montaigne écrit qu’il voudrait que la mort le trouve « plantant [s]es chous », sans souci aucun pour la mort ou son jardin infini et imparfait.
L’image de Montaigne qui plante ses choux est généralement considérée comme faisant allusion aux principes de la vita activa, résumée dans l’exhortation « je veux qu’on agisse » (89) qu’on trouve dans le même chapitre19. Le ton de ce passage est celle d’une calme assertion : Montaigne prescrit l’action, en nous rappelant que la mort peut arriver à n’importe quel moment et qu’il faut donc se méfier de faire des projets qu’on pourrait laisser incomplets. À ce calme s’unit un élément de légèreté, par l’image d’un Montaigne qui meurt en s’occupant de ses légumes, la dernière mort (hypothétique) dans une longue liste de vraies morts improbables d’individus célèbres qu’on trouve quelques lignes plus 215haut dans le chapitre. À côté de cette imprévisibilité fondamentale, Montaigne fait aussi allusion à la qualité égalitaire de la mort : face à la mort nous sommes tous impuissants au même degré. Dans le passage où on trouve cette occurrence verbale de dessein, Montaigne accentue le rôle de la fortune, particulièrement quand elle intervient ou interfère avec les affaires humaines : il ne faut pas faire des projets ou de plans irréversibles ou prédictifs parce que, comme allait l’écrire deux siècles plus tard le poète écossais Robert Burns « the best laid schemes of mice and men go often awry » (« les plans les mieux conçus des souris et des hommes avortent bien souvent »).
L’attitude de Montaigne envers la mort était sans doute influencée par les contingences matérielles qui caractérisaient son temps, une période entachée de conflit et de violence qui se manifestaient de manière très concrète et très proche, et non seulement comme menace abstraite. On reçoit un aperçu de l’implication de cette menace de danger corporel dans « Que philosopher » quand Montaigne révèle qu’il avait écrit une note à lui-même pendant une escapade à cheval au sujet d’un souhait qu’il voulait réaliser après sa mort dans le cas où il ne serait rentré vif chez lui (nonobstant la proximité physique a son château, qui se trouvait à un lieue de l’endroit où il se promenait20). Dans cet exemple extrême, l’exhortation à l’action (« je veux qu’on agisse ! ») devient une exhortation à une action immédiate, et à une action particulière21. L’aversion que ressent Montaigne pour les desseins de « longue haleine » fait écho en outre au thème de la vanité humaine à laquelle il revient fréquemment dans les Essais. Dans le contexte de ce passage, si on s’engage à un projet de longue durée ou un plan qu’on voudrait pouvoir porter à terme ou rendre « parfait » (dans le sens de « complet »), alors on risque de penser vainement qu’on vivra assez longtemps pour les porter à terme, ou sinon qu’on restera assez engagé pour la durée de temps nécessaire à les rendre « parfaits ». « Vainement » parce que les mouvements de 216la fortune peuvent intervenir et renverser la trajectoire des desseins humains dans la force d’un seul instant.
DESSEINS CERTAINS, JUGEMENTS CERTAINS
En parlant des desseins des hommes, Montaigne a recours habituellement à la description de la façon dont la fortune peut les fourvoyer, et dont la mort est le plus fourvoyant des mouvements accidentels qui frustrent les desseins humains, y compris et surtout ceux faits pour maîtriser la mort même. La conception de dessein dont se sert Montaigne dans ces exemples tirés de « Que philosopher » et « De juger de la mort autruy » est une conception téléologique : un dessein est la formulation d’une intention de produire quelque chose (un état des choses) de matériellement concret. Dans les deux cas, Montaigne dédaigne ce type de dessein, comme on l’a vu, en adoptant une attitude généralement stoïcienne qui souligne l’imprévisibilité de la vie comme de la mort22. Pourtant, ce tableau va se compliquer un peu quand on examine le thème du jugement, car c’est là que Montaigne invoque le modèle linéaire, téléologique de dessein comme le seul modèle possible pour le succès du discours épidictique23. Prenons comme exemple un passage de « De l’inconstance de nos actions » :
Pour juger d’un homme, il faut suivre longuement et curieusement sa trace ; si la constance ne s’y maintient de son seul fondement, cui vivendi via considerata atque provisa est, si la varieté des occurrences luy faict changer de pas (je dy de voye, car le pas s’en peut ou haster ou appesantir), laissez le courre : celuy la s’en va avau le vent, comme dict la devise de nostre Talebot. (337)
Le choix de mots ici (trace, pas, voye) rappelle l’approche du « fil rouge » que j’ai analysé et déconstruit dans mon article dans le numéro précédent 217de cette revue24. L’aspect d’orientation vers un but de cette formulation de l’intention humaine (devenu action réelle) est mis encore plus en évidence dans les phrases qui suivent où Montaigne, citant Sénèque, écrit : « Ce n’est pas merveille, dict un ancien, que le hazard puisse tant sur nous, puis que nous vivons par hazard ». Le passage continue avec une métaphore artistique :
À qui n’a dressé en gros sa vie à une certaine fin, il est impossible de disposer les actions particulieres. Il est impossible de renger les pieces, à qui n’a une forme du total en sa teste. À quoy faire la provision des couleurs, à qui ne sçait ce qu’il a à peindre ? Aucun ne fait certain dessain de sa vie, et n’en deliberons qu’à parcelles. (337)
Montaigne semble vouloir dire que de même que des couleurs sont inutiles à qui n’a pas d’idée d’un sujet, il est également inutile d’essayer d’arranger ou « guider » des actions et évènements différents dans sa propre vie, si on n’a pas au moins un « maître but » auquel ils disent viser ou au moins à l’aune de laquelle ils peuvent être interprétés. Il introduit alors le jugement suivant : que les gens en vérité déterminent seulement des petites parties de leurs vies, au lieu de créer un « certain dessain » pour leur vie entière. Parfois il semble dans ce passage que Montaigne établisse une claire opposition entre le matériel et l’idéal, comme quand les ressources matérielles – les « couleurs » – sont mises en opposition au processus théoriques nécessaires pour que cette activité réussisse – le concept ou l’idée d’une peinture. Pourtant parfois il semble qu’il soit en train d’opposer la partie au tout, comme quand il dit qu’on ne peut pas considérer seulement une partie d’une vie (une « pièce ») si on ne connaît pas le dessein général ou holistique, ou la fin ultime, de cette vie. Le thème du jugement est implicite dans cette considération, en particulier l’idée qu’on ne peut pas juger des actions d’un homme sans connaître ou comprendre la totalité de sa vie. Montaigne prend ici les considérations gisant au cœur de « Que philosopher » – la mort et la fortune – et les triangule avec celle du jugement. Pour rendre plus explicite cette triangulation, il est possible de tenter une reconstruction des différents éléments du passage de la manière qui suit :
2181. Il est possible de juger de la vie d’autrui que si on connaît son dessein général ;
2. Une vie individuelle peut fourvoyer de son dessein, en raison des mouvements de la fortune ;
3. On ne peut pas connaître avec certitude le dessein d’une vie ;
4. On ne peut pas faire un jugement « complet » d’une vie25.
Le passage tiré de « De l’inconstance de nos actions » se termine par une métaphore finale, Montaigne évoque l’image d’un archer en disant qu’il faut savoir à quoi viser avant de lancer un coup d’archet : « [l]’archier doit premierement sçavoir où il vise, et puis y accommoder la main, l’arc, la corde, la flesche, et les mouvemens » (337). Montaigne fait référence ici au grand schème de la vie humaine, mais ses considérations peuvent s’appliquer de même au projet littéraire, un autre projet à large échelle, celui d’écrire les Essais. En effet, le langage de ce passage fait écho à des écrits classiques sur la composition rhétorique et l’art du décorum (« arranger ses pieces »). Montaigne avait peut-être en tête les mots de Quintilien, qui utilise l’image – très évocatrice – d’un archer dans ses arguments sur la composition rhétorique dans son Institutio oratoria :
Pourquoi donc s’imaginer que la force et la beauté sont incompatibles, quand on voit au contraire que rien ne va fort loin sans le secours de l’art, et que l’art est toujours accompagné de la beauté ? Est-ce qu’un javelot habilement lancé ne fend pas l’air avec plus de grâce ? Plus la main de l’archer est sûre, plus son attitude est belle26.
219Quintilien revient à l’image de l’archer dans le même passage du texte, en disant que « la composition est aux pensées ce que l’arc et la corde sont à la flèche ». Montaigne, lui aussi, revient à l’image de l’archer dans « De la praesumption » lors de sa discussion d’un homme auquel on aurait sauvé la vie pourvu qu’il pût prouver qu’il était habile archer :
On offroit à un excellant archer condamné à la mort de luy sauver la vie, s’il vouloit faire voir quelque notable preuve de son art : il refusa de s’en essayer, craignant que la trop grande contention de sa volonté luy fit fourvoier la main. (650)
On y trouve le mot fourvoyer, que j’avais analysé dans mon article précédent comme étant central à l’imagination visive ou « linéaire » de l’auteur des Essais. Ici le mot est impliqué comme risque de réponse involontaire à une expression de volonté. Voilà encore un exemple où la volonté humaine est soit nécessairement dirigée vers des fins, soit aussi, pour cette raison (Montaigne semble nous le dire), sujette à des fourvoiements, des déviations, des déraillements, et dans des cas extrêmes, au désastre.
LES DESSEINS DE l’AMITIÉ
Les trois fils thématiques de la mort, du jugement et de la fortune qui émergent de cette analyse de certains usages du mot dessein sont entrelacés le plus fortement dans « Qu’il ne faut juger de nostre heur, qu’après la mort », où Montaigne prend l’adage de Solon « Que nul avant mourir ne peut estre dict heureux27 » comme point départ pour une brève réflexion sur « le maistre jour », « le jour juge de tous les autres » (80). Ce sujet était notamment très populaire chez les humanistes (il avait été traité par Érasme et Louis Le Roy parmi d’autres)28, mais 220Montaigne dévie de cette tradition par une dimension fondamentale : il attribue à la fortune un rôle décisif dans le jugement rétrospectif d’une vie réalisé au moment de la mort. Montaigne utilise le mot « fortune » quatre fois (trois fois directement et une fois sous sa forme adjectivale « fortunée ») et inclut un nombre d’autres mots qui appartiennent au champ lexical de la fortune (« incertitude », « disgraces », « accidents »). Ces motifs textuels soulignent une préoccupation récurrente chez Montaigne, c’est-à-dire la fortune et les pouvoirs extraordinaires dont elle dispose pour « renverser en un moment » ce qu’on a « basty en longues années » (79). À bien des égards, ces motifs, lus à l’aune des usages de « dessein » que j’ai analysés, s’alignent avec les commentaires de John O’Brien sur Montaigne et la prudence : Montaigne retient notamment un sens fondamental des contradictions qui font que les opérations de la prudence dite « conventionnelle » demeurent un idéal impossible, et que la réponse de Montaigne est de privilégier une nonchalance et une méfiance complètement opposée à cette notion de prudence29. Enfin, à quoi sert-il de bastir, avec attention et prudence, semble nous dire Montaigne, si une mauvaise fortune peut démolir tous nos desseins ? Mais là où O’Brien voit la marque d’une méfiance montaignienne envers la raison pratique, le langage du dessein chez Montaigne révèle un versant opposé : une position caractérisée par l’espoir autant que le pessimisme, et le désir, malgré son irrationnalité, de voir s’aligner la fortune et les desseins.
C’est en ces termes que Montaigne, à la fin de ce bref chapitre, dans une addition de la troisième couche, revient à la mort de La Boétie : « [C] Je luy ay veu trancher le fil d’un progrez de merveilleux avancement : et dans la fleur de son croist, à quelqu’un, d’une fin si pompeuse » écrit Montaigne, sur un ton allusif qui est le signe d’un deuil caché, « qu’à mon avis ses ambitieus et courageux desseins n’avoient rien de si hault que fut leur interruption » (80). Cette phrase rappelle le chapitre « De l’amitié » où Montaigne imagine une comparaison contrefactuelle des écrits plus mûrs de son ami :
221Si y a il bien à dire que ce ne soit le mieux qu’il peut faire ; et si, en l’aage que je l’ay conneu, plus avancé, il eut pris un tel desseing que le mien, de mettre par escrit ses fantasies, nous verrions plusieurs choses rares et qui nous approcheroient bien pres de l’honneur de l’antiquité. (184)
Montaigne utilise dessein dans ces deux exemples pour imaginer une vie qui a déjà été vécue, ainsi qu’une vie possible qui aurait pu être vécue. Notons que dessein est impliqué dans ce passage dans un jeu temporel remarquable entre le présent de l’écriture des Essais, le passé récent de l’amitié avec La Boétie, un futur hypothétique de l’écriture de son ami, et un passé antique auquel il la compare. Mais contrairement à « De l’amitié », la vie de La Boétie est décrite dans « Qu’il ne faut juger de nostre heur » comme étant à la fleur de son croist au moment de la mort, les desseins de son ami – paradoxalement vu le mot ambitieux qui tend au futur – comme ayant déjà atteint leur apogée. Montaigne imagine la vie de son ami en termes de fil. Mais cette linéarité n’est invoquée que pour évoquer sa vulnérabilité – le fil peut être tranché (la violence de ce mot créant une dissonance désarmante avec le mot fleur dans la deuxième clause). Non seulement coupé, mais coupé au milieu, comme les mots progrez, advancement, et spécialement interruption le suggèrent. Cette interruption en soi trouve son expression textuelle dans la forme même du chapitre qui, avec trois pages de longueur dans l’Exemplaire de Bordeaux, est un des plus courts du corpus montaignien. Mais Montaigne revient à ce chapitre vers la fin de sa vie pour insérer les mots cités plus haut sur La Boétie, et pour substituer le mot « sourdement » au mot « seurement » dans le passage suivant, qui conclut le chapitre :
[B] [a]u Jugement de la vie d’autruy, je regarde tousjours comment s’en est porté le bout ; et des principaux études de la mienne, c’est qu’il se porte bien, c’est-à-dire quietement et sourdement (80).
Les desseins de Montaigne et de La Boétie se confondent à nouveau sur la page, mais contrairement au chapitre sur l’amitié, l’essayiste ne les juxtapose pas pour imaginer ce qui aurait été possible si seulement La Boétie avait « pris un tel dessein » que celui de Montaigne. Maintenant, préoccupé toujours plus par l’idée de la mort, Montagne réécrit délibérément l’arc de la vie de son ami pour la placer à côté de la sienne pour en formuler un jugement différent, en nous laissant avec une pensée 222finale, latente (« sourde », non pas « sure ») : il a vécu, est mort et a bien « desseigné ». J’espère qu’on dira pareillement de moi.
CONCLUSION
Quel est le dessein des Essais ? Montaigne semble nous le dire directement – c’est un dessein « farouche et extravagant » (385), peut-être même « monstrueux ». C’est de « mettre par escrit ses fantasies » (184), pour citer une des occurrences de dessein qu’on trouve dans « De l’amitié ». Mais Montaigne décrit le projet des Essais aussi comme un projet « sans dessein et sans promesse » (302), et souvent il caractérise son dessein en termes apophatiques, en nous disant ce qu’il n’est pas ou ne fait pas. La tentation de trouver un fil conducteur dans ces diverses occurrences du mot impose, je l’ai dit, une vision restrictive de notre interprétation des Essais et aplatit les possibilités sémantiques créées par ce mot agité, rebelle. J’estime qu’il faut, « au rebours », se demander en tant que lecteurs ce qui pourrait arriver si on adoptait un dessein tel que celui de Montaigne : un dessein qui est orienté vers les mouvements imprévisibles de la fortune, qui pèse ses implications, et qui décide de persévérer, mi-optimiste et mi-méfiant. Cela a des implications pour la compréhension du dessein textuel des Essais, et tout autant pour la manière dont ce dessein pourrait nous faire réfléchir plus activement au rôle de la fortune et à la contingence non seulement quant à la poétique des Essais, mais encore quant à l’expérience de la lecture qu’ils engendrent.
Vittoria Fallanca
New College, Oxford
1 Voir Vittoria Fallanca, « “Farouche et extravagant” : les lignes de la pensée montaignienne », BSIAM, no 73, 2021, p. 179-197.
2 La forme verbale dessiné, pourtant, apparaît dans la première édition de 1694.
3 « dessin », Dictionnaire de l’Académie Française, 5e édition, <https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/publicdicos/navigate/10/11445/> [consulté le 18/10/2021].
4 « dessin », Dictionnaire critique de la langue française, vol. 1, éd. Jean-François Feraud (1787) <https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/publicdicos/navigate/5/5470/> [consulté le 18/10/2021].
5 Dans l’édition de 1595, il y a une nouvelle occurrence du mot dans « l’Apologie de Raymond Sebond », et une autre dans « De la praesumption ». Montaigne enlève celle qui se trouvait dans « De l’utile et de l’honneste », et change une occurrence de desseigner en designer dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir ».
6 Comme le note Craig Bush, on devrait toujours se méfier un peu des concordances, mais spécialement quand il s’agit de Montaigne. Bush prend comme exemple l’idée du moi, concept qui est au centre de l’écriture montaignienne mais qui n’avait pas de référent dans la langue française à l’époque où Montaigne écrivait (voir Craig Bush, « Roy E. Leake, Concordance des “Essais” de Montaigne » (1981), Computers and the Humanities, vol. 18, no 2, 1984, p. 123-125).
7 Je renvoie ici aux remarques d’André Tournon sur la polysémie, notamment l’idée que la majorité des termes dans le langage naturel sont polysémiques dans le sens où leur utilisation ordinaire est extrêmement souple, et lié à un contexte spécifique. (Voir André Tournon, Montaigne : la glose et l’Essai, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1983, p. 109). Ce qui m’intéresse ici n’est pas la polysémie en tant que telle, mais plutôt la spécificité de la polysémie de dessein et de ses significations à la fin du seizième siècle. Il suffit pour mes objectifs dans le présent essai de constater que dessein en français moderne ne renvoie plus à une dimension concrète ou graphique.
8 Mon édition de référence est celle de Pierre Villey : Les Essais, éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, Paris, PUF, 2004. Je donne la référence entre parenthèses après chaque citation.
9 Je considère dans la section qui suit deux occurrences pour ainsi dire « personnelles », celles de « Que philosopher c’est apprendre à mourir » et « De l’amitié ».
10 Montaigne aurait certainement connu des termes et des idées artistiques à travers Le Courtisan de Castiglione (qu’il possédait dans une édition française, probablement celle de Jacques Colin de 1537), mais nous ne savons pas si sa « librairie » incluait des textes explicitement artistiques. Parmi ses livres il y en avait deux du célèbre théoricien d’art italien Benedetto Varchi, mais il s’agissait d’un dialogue sur le langage (L’Ercolano) et des lezzioni au sujet de l’amour (voir Pierre Villey, Les Essais, éd. citée, p. lxxi).
11 Comme l’écrit de façon très convaincante Neil Kenny, une langue n’est pas un pur épiphénomène – elle effectue des changements sociaux et culturels en même temps qu’elle en est impactée : N. Kenny, The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 24. Les textes littéraires font bien sûr partie intégrante de ce processus.
12 Le fait que Montaigne n’utilise jamais « dessein » par rapport aux animaux révèle le caractère nécessairement humain du dessein pour Montaigne. Même dans le célèbre passage de l’« Apologie de Raymond Sebond » où Montaigne décrit les actions des hirondelles en des termes anthropomorphiques, il n’utilise pas dessein mais jugement, deliberation, pensement, conclusion. Comme nous allons le voir, cette distinction entre les humains et les animaux fait partie aussi d’une critique et d’une déconstruction du pouvoir des desseins des hommes.
13 Sur ces thèmes dans l’écriture de Montaigne, voir (parmi beaucoup d’autres) Raymond La Charité, The Concept of Judgement in Montaigne, La Haye, Martinus Nijhoff, 1968 ; Richard Regosin, « Prudence and the Ethics of Contingency in Montaigne’s Essais », dans John D. Lyons et Kathleen Wine (dir.), Chance, Literature and Culture in Early Modern France Aldershot, Ashgate, 2009, p. 125-149 ; Alain Legros, « Montaigne Between Fortune and Providence », dans Chance, Literature and Culture, op. cit., p. 17–30 ; Hugo Friedrich, « Montaigne et la mort », dans Montaigne, Paris, Gallimard, 1968.
14 Pour une discussion de la culture de la mort en cette époque, voir Neil Kenny, « Surviving Death in the Early Modern Period », dans Death and Tenses, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 36-38.
15 La vie d’Héliogabale a été transformée en cliché pendant la Renaissance. Thomas Cooper, auteur du Cooper’s Chronicle (1549) liste la vie de l’empereur (« the vicious lyfe of Heliogabalus ») parmi une série d’exemples de la propension dont faisaient preuve les historiens de l’époque pour l’exemplarité au prix de la véracité (cité dans A. D. Cousins et Damian Grace (dir.), A Companion to Thomas More, Madison, Fairleigh Dickinson University Press, 2009, p. 115).
16 Cet aspect mérite plus d’attention que je ne pourrai lui donner dans cet article. Voir par exemple Philip John Usher, « Soldierly Masculinity in the Essais » pour une discussion de l’indétermination qui caractérise l’approche de Montaigne au regard de la masculinité, en particulier dans le contexte de la guerre (dans Philippe Desan (dir.), Montaigne et la philosophie politique, Montaigne Studies, no 28, 2016, p. 189-199). Kathleen P. Long parle de l’aspect « queer » de l’exemplarité d’Héliogabale dans le septième chapitre de son livre Hermaphrodites in Renaissance Europe, Londres, Routledge, 2006, p. 189–213.
17 Cette occurrence de desseigner est remplacée plus tard par designer dans l’édition de 1595. Les deux mots desseigner et designer possèdent la même racine latine (designo), mais la définition principale de designer, au moins selon le Dictionnaire d’Huguet, est dessiner : « Dessiner. Faire le plan de ». Pourtant Huguet renvoie le lecteur à Desseigner immédiatement après avoir donné cette définition. Voir Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, vol. 3, Paris, Didier, 1967. Cela suggère que les deux mots, desseigner et designer étaient généralement interchangeables au seizième siècle.
18 L’expression « de longue haleine » semble être déjà un lieu commun au seizième siècle : Ronsard, par exemple, utilise l’expression « poëmes de longue alaine » dans la note préliminaire « Advertissement au lecteur » qui se trouve dans ses Odes (Pierre de Ronsard, Œuvres Complètes, éd. P. Laumonier, Paris, Hachette, 1924, p. 54).
19 Le sens moderne de cette phrase est assez différent, voire presque opposé – « planter ses choux » signifie « se retirer de la vie active » (généralement à la campagne). Il est intéressant de considérer que Montaigne a influencé le développement du sens moderne, qui remplace avec une nonchalance caractéristiquement montaignienne le sens plus littéral d’activité manuelle.
20 « Quelcun, feuilletant l’autre jour mes tablettes, trouva un memoire de quelque chose, que je vouloy estre faite apres ma mort. Je luy dy, comme il estoit vray, que, n’estant qu’à une lieue de ma maison, et sain et gaillard, je m’estoy hasté de l’escrire là, pour ne m’asseurer point d’arriver jusques chez moy ». (88)
21 Voir, pour une discussion de l’importance de l’instant immédiat dans la pensée théorique de Montaigne, et en particulier dans sa relation à l’histoire, John D. Lyons « Montaigne and History » dans Philippe Desan (dir.), The Oxford Handbook of Montaigne, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 215–231.
22 L’essentiel de la pensée montaignenne sur cette notion fait écho à la 101e lettre de Sénèque à Lucilius sur la futilité de la planification.
23 Pour une analyse de ce chapitre par rapport à la rhétorique épidictique et aux notions de « jugement » et de « contradiction », voir Neil Kenny « La Part du dire dans le contredire, ou l’inconstance des paroles humaines : Léry, Montaigne, Colletet », Seizième Siecle, no 4, 2008, p. 255–87 (en particulier p. 266–277).
24 V. Fallanca, « “Farouche et extravagant” », art. cité. Un fil rouge, ou dans la métaphore employée par Virginia Woolf que j’examine dans l’article, la corde qu’il faut « suivre » si on veut lire un livre de la façon « correcte ».
25 J’ai formulé ces éléments schématiquement pour externaliser ce que je considère être les éléments constitutifs du raisonnement de Montaigne sur ces questions et pour en faire sortir plus nettement ses « conclusions ». Malgré sa détestation avouée pour les formes logiques (voir « De l’institution des enfans », (161)) Montaigne inclut des aspects de la logique scholastique dans son écriture, même si généralement il les subvertit (voir Ian Maclean, Montaigne philosophe, Paris, PUF, 1996, p. 32-35). Ma propre propension pour reconstruire ses arguments sous cette forme révèle, je crois, un aspect de la nonchalance montaignienne, qui traite des arguments complexes dans un style libre et souvent informe, sans les séparer en diverses sections. On pourrait soutenir que cette nonchalance invite à une reconstruction de la part du lecteur. Pour un précédent important de cette reconstruction schématique de la pensée montaignienne, voir le chapitre sur Montaigne dans Éric Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard NRF, « Bibliothèque des idées », 1968.
26 Quintilien, De l’institution oratoire, Tome 9, IV, 4, 8–10 < http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/quintilien/instorat9.htm#IV > [consulté le 18/10/2021]. Pour une discussion de l’importance de l’Institutio oratoria dans les Essais et la pensée montaignienne, voir Déborah Knop, La Cryptique chez Montaigne (thèse doctorale soutenue à l’Université de Grenoble, 2012).
27 Reformulé par Montaigne dans « Nos affections s’emportent au delà de nous ».
28 Jean Balsamo, « Notes et variantes », dans Les Essais, éd. Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 1355.
29 « [Montaigne] retains a keen sense of the contradictions that make the operation of conventional prudence an impossibility », et il fait preuve d’« a nonchalance and a diffidence that is the opposite of prudential action as traditionally conceived ». John O’Brien, « Aristotle’s Prudence, and Pyrrho’s », dans Ullrich Langer (dir.), Au-delà de la Poétique : Aristote et la littérature de la Renaissance, Genève, Droz, 2002, p. 44.