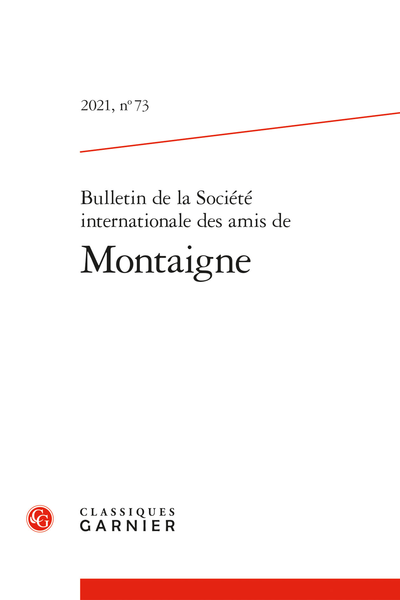
L’influence des traditions de consolation avant et dans le premier livre des Essais La phrase, le chapitre, le livre
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2021, n° 73. varia - Auteur : Ordynski (Rémi)
- Résumé : Montaigne est, comme son temps, imprégné des traditions de consolation, entendues comme pratiques sociales, philosophiques et rhétoriques. Déjà ambivalente dans les éditions des œuvres de La Boétie de 1571, cette influence l'est encore davantage dans le premier livre des Essais, et de manière spécifique. Le discours consolatoire ainsi que différentes postures et procédures traditionnelles y sont mis à l'épreuve, ce qui se manifeste à plusieurs échelles, de la phrase au livre.
- Pages : 129 à 150
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126072
- ISBN : 978-2-406-12607-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12607-2.p.0129
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Consolation, premier livre, rhétorique, La Boétie, Ambroise
L ’ influence des traditions
de consolation avant et dans
le premier livre des Essais
La phrase, le chapitre, le livre 1
Les éditions par Montaigne des œuvres de La Boétie2 instituent ce premier comme héritier des traditions de consolation. Trois gestes l’attestent : l’édition de la traduction de l’un des textes les plus emblématiques, la Lettre de consolation de Plutarque à sa femme ; l’actualisation de ce texte au vécu empirique de Montaigne, à travers l’épître dédicatoire à sa propre épouse ; enfin, dans le récit sur la mort de La Boétie, les comportements comme la manière de conduire le récit sont dans une large mesure déterminés par les codes consolatoires3. Le recueil offre ainsi un précieux témoignage des manifestations de ces traditions au xvie siècle. Issues de l’Antiquité, plusieurs fois réinventées dans une perspective chrétienne, ces pratiques reposent sur l’usage normé aux plans rhétorique et social d’un discours d’inspiration philosophique 130caractéristique, dont la ritualité se traduit par la récurrence de raisons et d’exemples topiques. Ancré dans des circonstances marquées par une affliction qui le fonde et contre laquelle il s’élève, il peut être adressé « ad præsentem » ou « ad absentem4 ». Les travaux d’A. Tarrête5, de J. Lecointe6 et ceux dirigés par C. Martin-Ulrich7, notamment, permettent de mieux comprendre plusieurs aspects de ces traditions qui parcourent tout le xvie siècle, avec deux moments importants, l’évangélisme et le néostoïcisme. Elles sont marquées par une grande hétérogénéité, qui affecte le fond et la forme. Offrant à peu près toutes les combinaisons possibles du vers et de la prose8, elles se caractérisent par une pensée généralement syncrétique. Les auteurs cherchent à combiner l’argumentaire chrétien et l’héritage païen auquel ils ne renoncent jamais totalement, et, malgré une prédilection plus ou moins marquée pour le stoïcisme, mettent en concurrence plusieurs écoles philosophiques pour parvenir à leurs fins, à savoir l’allègement de la douleur par la réfutation des opinions qui lui sont attachées. Les récentes éditions numériques par C. Noille de certains des principaux textes théoriques mettent au jour les points de continuité de ce discours qui peut s’épanouir dans des genres très différents. Dans la première moitié du siècle, Érasme dans De conscribendis epistolis9 ou Pierre Fabri dans Le grand et vray art 131de pleine rhetorique […]10 l’appliquent à la relation épistolaire, Scaliger à la poésie dans ses Poetices libri septem11de 1561. Quant à Vossius, bien après Montaigne, en 1621, il reprendra les mêmes questions rhétoriques en les destinant à une forme se rapprochant du discours public dans ses Rhetorices contractae12. Ces textes fondent la pratique consolatoire sur la recherche de l’aptum : il s’agit de régler le discours en fonction de plusieurs paramètres, le type d’affliction, le ou la destinataire (son âge, son rang, son sexe, son type d’âme), ainsi que le lien qui l’unit avec celui, ou plus rarement celle13, qui prodigue la consolation.
Montaigne, dès 1571, se situe dans l’écart par rapport à ces traditions. La traduction de la consolation de Plutarque est associée, dans le même recueil, à des textes de nature très différente, qui en relativisent l’importance. L’épître de Montaigne à sa femme propose une délégation de la parole14 dont la portée a été diversement comprise15, notamment parce qu’elle est proférée dans un registre qui ne relève pas toujours de la solennité propre au discours consolatoire16. Dans le récit de la mort de La Boétie, la volonté du personnage de Montaigne de consoler son ami, comme l’exige le rite social, se heurte à la posture de l’agonisant qui s’emploie à camper le rôle, écrit par les traditions, du sage qui parvient à inverser la relation consolatoire et à fournir à ses proches une 132consolation dont il n’a lui-même nul besoin17. Le premier livre des Essais18 se raccorde au recueil de 1571 de plusieurs façons19 : une phrase suffit à ancrer l’écriture dans un temps inauguré par la mort de La Boétie20. Un chapitre entier est consacré à l’exploration du lien qui les unit. Le livre même semble d’abord obéir à un principe de composition établissant les œuvres de La Boétie comme un élément central. L’inscription conjecturale analysée par Alain Legros21 irait également dans le sens d’un récit consolatoire commencé en 1571. Toutefois, le premier livre des Essais ne se donne pas à lire, loin s’en faut, comme une autre Consolatio ad se, modèle presque entièrement perdu qui a pourtant marqué les traditions consolatoires, et qui exerce au temps de Montaigne une réelle fascination, comme l’illustre l’affaire Sigonius autour de la fausse redécouverte du texte cicéronien22. La rhétorique consolatoire est largement mobilisée dans le premier livre, mais elle se déploie de manière déconnectée du récit que la mort de La Boétie semblait esquisser23. Loin de s’en tenir à cette source d’affliction, Montaigne les multiplie dans le premier livre : à la mort de l’autre s’ajoutent la sienne propre, la douleur, la maladie, la 133pauvreté, la défaillance de la mémoire, les calamités publiques, voire le dégoût des affaires, afflictions, traditionnelles pour la plupart, traitées de façon plus ou moins suivie, réelles ou hypothétiques, vécues au moment de l’écriture ou révolues.
La notion de tradition transparaît donc dans l’itération à travers le temps de discours, de postures et de procédures spécifiques. C’est sous cet éclairage que nous souhaitons étudier ici le premier livre des Essais. L’héritage consolatoire y est mis à mal par Montaigne, de plusieurs manières. Comme l’a remarqué Alexandre Tarrête, la consolation apparaît à l’auteur des Essais comme un « exercice […] trop cérémoniel et rhétorique à son goût24 ». Il la soumet à un examen critique qui apparaît dès la première édition, ce qui ne l’empêche pas d’y revenir régulièrement, au point de faire de ce dialogue avec elle la matière presque exclusive de deux chapitres25. L’argumentaire consolatoire est majoritairement déconnecté du grand récit qu’aurait pu constituer la mort de La Boétie, et délié en raison d’une multiplication des peines, ce qui rend impossible tout ancrage unifiant. Si la parole consolatoire peut traditionnellement s’adapter à différents genres et différentes visées (raconter, louer, exhorter, justifier, excuser…), elle est ici associée à des matériaux étrangers, ce qui conduit à s’interroger sur son mode d’insertion dans un projet qui est tout autre que consolatoire. Le traitement de cette matière par Montaigne est sujet à de nombreuses tensions, si bien que l’on peut se demander ce qu’il reste des traditions de consolation dans le premier livre : leur mise à l’épreuve aboutit-elle à une déconstruction totale ? Assiste-t-on à un rejet sans appel ou à une réinvention des traditions de consolation ? Que Montaigne essaie le discours consolatoire, il est aisé de s’en convaincre, à l’échelle de la phrase, dans plusieurs chapitres où abondent les raisons, les exemples topiques, les emprunts et références aux grandes œuvres traditionnelles. Nous nous intéresserons donc ici au degré de rayonnement de ces phrases et de ces segments, pour montrer que, par-delà l’atomisation de cette matière, certaines orientations liées à la composition, spécifiques au premier livre, peuvent être dégagées.
134Le premier livre :
lieu d’exploration du discours consolatoire
Contrairement au recueil évoqué de 1571, où Montaigne se révélait empêché dans son effort consolatoire (par lui-même dans la lettre à sa femme et par le personnage de La Boétie dans le récit adressé à son père), il s’adonne dans le premier livre des Essais à une exploration assidue, étendue dans le temps, du discours qui relève de ces traditions. En traitant de la mort, de la douleur ou de la maladie, il active un horizon d’attente dans l’esprit de ses contemporains qui lisent, disent ou écrivent des consolations. Dès les premiers chapitres, Montaigne joue avec cette attente, en thématisant dans le titre une passion (« De la tristesse », dont il s’« exempt[e]26 » dès la première phrase, mais qui n’est pas sans rappeler le Περὶπένθους de Crantor, parfois considéré comme le premier texte consolatoire, et que Cicéron traduit par « DeLuctu27 ») ou une valeur cardinale, traitée de manière expéditive et distante (« De la Constance »), chapitres finalement déceptifs au regard des traditions de consolation.
Pour évaluer le degré d’imprégnation d’un chapitre, à partir de la phrase, une étude des traditions de consolation, de l’Antiquité jusqu’au xvie siècle, permet de dégager plusieurs critères. Comme elles sont marquées par la ritualité, elles utilisent certains signes de reconnaissance qui doivent être lisibles dès le titre. Elles se consacrent à une passion, déclenchée par une source d’affliction explicite ; elles formulent l’intention d’adoucir, voire de supprimer cette passion, par les deux moyens identifiés par Cicéron dans les Tusculanes28 et attestés dans tous les traités ultérieurs : le déploiement des raisons et des exemples. Enfin, les traditions ont élaboré 135divers marqueurs, qui correspondent à des techniques argumentatives (les renversements logiques de type « mors vita, vita mors », le jeu sur les différentes échelles) ou à des traits formels (un certain usage de la citation, de la prosopopée29, par exemple). Parole adressée, que le destinataire soit nommé ou pas, elle présente des marques d’interpellation proches du discours parénétique30. Enfin, plus l’ancrage dans un temps de crise est fort, plus on s’approche du cœur de la consolation. Commençons, à titre d’exemples, par deux chapitres qui traitent occasionnellement de ces traditions. Dans « Des Menteurs », Montaigne développe au fil des éditions en la parodiant l’une des stratégies consolatoires les plus caractéristiques, qui consiste à envisager les bienfaits d’une calamité, en l’occurrence la mauvaise mémoire. Ce qui n’était qu’un exorde enfle au fil des éditions : dans les éditions avant 1588, l’auteur se borne à constater, non sans ironie, que cette défaillance le rend exceptionnel. À partir de l’édition de 1588, il commence une phrase, qui inaugure un exercice se prolongeant jusque sur l’Exemplaire de Bordeaux : « Ie me console aucunement31 ». Plusieurs propositions vont progressivement être rattachées à cet énoncé recteur, qui formulent chacune un avantage, plus ou moins sérieux, de cette tare supposée32. Ici, le matériau consolatoire traité tardivement et de manière ludique est expansé sans que le reste du chapitre en soit affecté ; l’influence disparaît dès que la question principale annoncée en titre survient. Autre exemple d’influence secondaire, dans « Du pedantisme », la consolation est abordée brièvement, en tant que tradition scolaire, mais reçoit une violente charge, rangée du côté du savoir et non pas de la sagesse, de la faiblesse et non pas de la force, contrairement aux valeurs qu’elle promeut33.
136Certes, ni le premier livre, ni aucun des chapitres qui le composent, ne se donnent à lire comme une consolation au sens strict, un texte ancré dans une situation d’affliction qui détermine l’intégralité du discours. Toutefois, deux chapitres s’en approchent (I, XIV/XL et I, XIX/XX), à tel point que nous proposons de les lire comme des chapitres « consolatoires », c’est-à-dire affiliés aux traditions de consolation34. Évoquant les déclamations35 dans leur conception initiale, ils se prêtent à une saisie consolatoire, de manière oblique. Leur titre reprend une idée qui est au cœur de l’argumentaire traditionnel et signale un dialogue avec les Tusculanes36, œuvre centrale dans notre perspective. Montaigne y met à l’épreuve la parole consolatoire, par l’examen d’arguments et d’exemples communément utilisés pour soulager des grands maux de l’existence, la mort, la douleur, la pauvreté, qu’il emprunte aux œuvres qui ressortissent à ces traditions. Certains éléments sont présentés comme propices à l’allègement de la douleur ou de la crainte ; d’autres, sont rejetés, comme une partie de l’argumentaire stoïcien sur la douleur, ainsi que l’a prouvé B. Perona37. En ce qui concerne les sources, A. Tarrête 137remarque à propos du troisième livre que Montaigne « délaisse un peu les consolations proprement dites, peut-être à cause de leur construction rhétorique trop visible », et qu’il préfère emprunter aux autres œuvres des auteurs de consolations38. La matière des deux chapitres en question, il la puise principalement dans les Tusculanes, dans le De natura rerum39, deux œuvres que Sabine Luciani a récemment relues à la lumière de ces traditions, prouvant qu’elles correspondent toutes deux à ce que David Scourfield appelle des « méta-consolations40 ». Les éléments traditionnels proviennent également des lettres de Sénèque, mais aussi de certains de ses traités, en incluant les consolations. Prenons l’exemple de la prosopopée de la nature qu’a précisément analysée B. Perona, qui montre notamment que Montaigne s’y livre à un étoffement de la prosopopée lucrécienne41. Le même procédé de la prosopopée de la nature se trouve également à la fin de la Consolation à Marcia, où la voix du consolateur se combine et se confond avec celle de la nature pour adopter un point de vue surplombant sur l’existence, en l’envisageant à l’échelle du cosmos42.
Les deux chapitres consolatoires des Essais témoignent en particulier d’un vif intérêt pour la formulation des raisons topiques. Par la citation, 138Montaigne s’approprie les pouvoirs d’une parole qui le fascine avant tout d’un point de vue esthétique, comme le prouvent ses notes de lecture sur Lucrèce dans les marges du livre III en question43. Il en explore le pouvoir pragmatique et esthétique en mettant en concurrence les raisons topiques et leur formulation en langue vernaculaire :
D’avantage cela nous doit consoler, que naturellement, si la douleur est violente, elle est courte : si elle est longue, elle est legere : si gravis, breuis : si longus, leuis. Tu ne la sentiras guere long temps, si tu la sens trop : elle mettra fin à soy, ou à toy : l’un et l’autre revient à un. Si tu ne la portes, elle t’emportera […]44.
La séquence est déjà redondante dans l’édition de 1580, ce qui traduit une recherche de la formule la plus expressive de l’argument attribué à Épicure. Sur l’Exemplaire de Bordeaux, l’apparition de la citation qui avait sans doute donné naissance à ce segment, puisqu’elle n’apporte aucune idée nouvelle, se justifie par la perfection rythmique et sonore de l’hypozeuxe cicéronien45. Montaigne continue son effort de traduction : la dernière formulation, qui se veut plus synthétique grâce aux dérivés, apparaît également sur EB, ce qui invalide l’hypothèse de l’exercice de style d’un écrivain en formation. Quant aux exemples, si importants dans les consolations, une notation faite sur le ton de la confidence s’inscrit pourtant dans une réflexion au cœur des traditions : « Mais venons aux exemples, qui sont proprement du gibier des gens foibles de reins, comme moy […]46 », écrit-il à propos des opinions qui provoquent la douleur. On retrouve l’opposition « âmes fortes / âmes faibles » qui sous-tend les préconisations d’Érasme, de Scaliger et de Vossius ; la destination des exemples aux âmes faibles, dans un débat qui parcourt les traditions, donne raison à Sénèque47, contre 139Scaliger48. Montaigne oscille entre l’essai de l’argumentaire traditionnel et la recherche d’une parole consolatoire plus personnelle. En l’absence de destinataire explicite, il fait un usage de la parole qui n’est pas unifié par la recherche de l’aptum. S’adressant tantôt à lui-même, tantôt à un fictus interlocutor caractéristique, confondant parfois les deux, il établit un ethos dont la plasticité est de plus en plus grande, de la parole du sage au ton plaisant, ouvert au prosaïsme, à l’ironie et au sourire49, qu’Érasme déconseille, sauf si elle s’apparente à une « consolation amicale » (« tam amice consolari ») dans le De Conscribendis epistolis50. Un constat s’impose avec une évidence grandissante au fil des éditions : plus Montaigne revient à ces chapitres consolatoires, plus il s’éloigne d’une consolation en bonne et due forme. Le présent se démultiplie, ce qui oblige à renoncer à un ancrage dans une énonciation et dans une affliction déterminées. Les passions, au lieu d’être affaiblies, domptées par la raison, semblent attisées par l’impression provoquée par les formules et les exemples convoqués. Montaigne exacerbe jusqu’à les dévoyer certains principes propres au discours consolatoire. La combinaison de différentes écoles philosophiques n’assure pas le retour à l’ordre auquel tend la consolatio rationis. Les différents jeux d’échelle, temporelle et spatiale, les renversements logiques, destinés à déraciner les opinions douloureuses, entraînent une incertitude généralisée51. Au lieu du triomphe de la sagesse et de la raison, nous assistons plutôt à celui de la sensibilité, jointe à l’imagination. Le travail de sape s’effectue alors de l’intérieur, dans l’essai réitéré du discours consolatoire, pour ainsi dire poussé dans ses retranchements. Ce qui, à l’échelle de la phrase, pourrait 140entrer en conformité avec la parole consolatoire, s’estompe voire s’annule quand on l’inscrit dans le chapitre.
Du De excessu fratris d’Ambroise à « De l’amitié » :
donner forme à l’inconsolable
Alors qu’il déploie l’argumentaire consolatoire dans plusieurs chapitres proches, Montaigne semble l’exclure de celui qu’il écrit sur l’ami perdu. Il prend même le contrepied des traditions quand il se présente comme inconsolable à la fin du chapitre « De l’amitié » :
Depuis le jour que je le perdy,
quem super acerbum,
Semper honoratum (sic Dii uoluistis) habebo,
je ne fay que trainer languissant : et les plaisirs mesmes qui s’offrent à moy, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte52.
Au moment de se déclarer inconsolable, Montaigne feint d’oublier jusqu’à l’existence des traditions de consolation, puisqu’il n’envisage comme expédient, pour en nier l’efficacité, que les plaisirs, au lieu de penser aux méthodes généralement plus austères de la consolatio rationis. La polyphonie dans la phrase n’introduit aucune possibilité de récupération du pathos par le logos, mais vient au contraire grever ce premier53. Dans le chapitre, le rapport avec ces traditions est toutefois plus complexe qu’un simple rejet. En réalité, l’invocation de l’ami et la conception du lien qui les unit en sont imprégnées. Pour montrer comment fonctionne cette influence dans le chapitre, un rapprochement peut être établi avec un texte ancien54, identifié par Charles Favez comme appartenant aux premières consolations chrétiennes55, le De excessu fratris141(Satyri) de saint Ambroise56. Ce discours consécutif à la mort de son frère est composé de deux livres, qui correspondent à deux moments, à deux lieux et à deux étapes de la consolation. Dans le premier, prononcé le jour des funérailles en la cathédrale de Milan, la lamentation domine ; les lumières de la consolation, païenne mais surtout divine, commencent à peine à percer, elles n’apparaîtront vraiment qu’au deuxième discours, prononcé une semaine plus tard, devant le tombeau. Du frère biologique au frère de cœur57, la distance qui sépare les deux textes mérite d’être franchie58 : l’expression d’un lien exceptionnel, qui survient moins « [d’] une fois en trois siecles59 », et des conséquences de la mort sur celui-ci, présente en effet plusieurs points de convergence. Commençons par le traitement des points les plus topiques. La lamentation conduit à confesser, comme dans l’extrait cité de Montaigne, que, depuis la mort, les plaisirs sont inopérants60. L’éloge du disparu aboutit 142dans les deux cas à une comparaison qui se fait au détriment de soi61. C’est au moment de définir la relation qui unissait les deux êtres que la ressemblance se fait plus troublante :
Nam cum omnia nobis essent nostra communia, individuus spiritus, individuus affectus […]62.
Montaigne emploie quasiment la même formule, mais il en explicite la source :
Tout estant par effect commun entre eux, volontez, pensemens, jugemens, biens, femmes, enfans, honneur et vie : et leur convenance n’estant qu’une ame en deux corps, selon la tres-propre definition d’Aristote, ils ne se peuvent ny prester ny donner rien63.
L’adjectif « individuus » ne peut manquer de rappeler la nature du lien que cherche à identifier Montaigne : « Car cette parfaicte amitié, dequoy je parle, est indivisible64 ». On peut bien sûr trouver l’expression d’une idée proche chez d’autres auteurs : Aristote signale déjà qu’elle n’a rien de rare65. Par exemple, Augustin s’en rapproche dans les Confessions quand il évoque la mort de son ami, mais dans une perspective si différente que cela renforce paradoxalement la proximité entre Ambroise et Montaigne66. Chez ces derniers, le principe d’une « âme en deux 143corps » est compris de façon presque littérale. Puisque tout est commun entre ceux que la mort a séparés, que faire, matériellement, de la part de l’autre en soi, dès lors qu’il n’est plus ?
Numquam enim totus in me fui, sed in altero nostri pars major amborum [ … ] ; in isto enim corpore, quod nunc exanimum jacet, praestantior vitae meae functio ; quia in hoc quoque quod gero corpore, uberior tui portio 67 .
Nous estions à moitié de tout ; il me semble que je luy desrobe sa part […]68.
La mort est incompréhensible parce qu’elle sépare ce qui est indivisible. Partant, l’une des solutions pour les survivants serait de mourir à leur tour, ce qu’ils formulent à la fois comme un désir et comme un phénomène en cours d’accomplissement, conséquence de la séparation. Montaigne l’exprime par le truchement d’Horace69 et de Catulle70. Ambroise l’énonce sans détour, évoquant le lieu où se trouve à présent son frère, qui a fait davantage que lui ouvrir le chemin : « […] coepi enim jam hic non esse peregrinus, ubi melior mei portio est71 ». Cette étude comparée, dont nous livrons ici une version abrégée72, met en lumière plusieurs éléments. Malgré les différences évidentes entre les deux textes73, tout se passe comme si la raison, impuissante à dépasser la douleur, finissait par l’alimenter, en cherchant à définir le lien qui les unissait. Cela correspond à la phase qui inaugure le discours consolatoire d’après les traités, à savoir celle de la lamentation : il faut exposer les raisons de la douleur avant de procéder à leur confutatio, laquelle n’aura jamais lieu dans le chapitre « De l’amitié ». Il nous 144semble tout à fait significatif que les éléments cités se trouvent tous dans le premier livre d’Ambroise et majoritairement vers la fin du chapitre « De l’amitié ». Montaigne suspend sa parole au moment où la consolation doit amorcer une conversion qui consacre le triomphe du logos ; terminant par ce qui ouvre la consolation d’Ambroise, il donne forme à ce qu’il énonce dans les mêmes lignes, à savoir le fait qu’il ne peut, ou ne veut, se consoler. L’inconsolable, chez Montaigne, n’est pas simplement une formule ou une figure, cela tend à devenir un principe de composition, par le renversement de la structure rhétorique habituelle d’une consolation.
Le passage que nous venons de proposer d’une phrase au chapitre, il convient à présent de l’effectuer du chapitre au livre. Dans les premières éditions, la fin du chapitre « De l’amitié » est censée fonctionner comme une rampe de lancement pour la lecture de l’œuvre de La Boétie que le livre est censé renfermer à une place centrale. Les projets d’insertion de la Servitude volontaire et des vingt-neuf sonnets révèlent d’abord la profonde continuité entre le premier livre et le recueil de 1571, puisque Montaigne continue son œuvre de diffusion des textes que son ami lui a confiés en mourant. Dans la fin du chapitre « De l’amitié », juste après la lamentation polyphonique, le surgissement de la voix du disparu est chargé d’opérer un basculement dans le discours, ce que suggère l’adversatif « mais74 ». Le procédé rappelle un certain usage consolatoire de la prosopopée, qui consiste à travestir la voix du consolateur pour faire résonner une dernière fois celle du défunt, technique qu’utilisent, pour prendre deux exemples très différents, saint Jérôme pour consoler Paule de la mort de sa fille Blésilla ou Antoine Héroët dans l’« Epitaphe de Louise de Savoie ». Dans les consolations, le procédé vise à renforcer la persuasion, le consolateur cherchant à rendre convenable le discours du défunt, qui semble relayer le sien propre. Ici, l’aptum est impossible à régler car Montaigne comprend le procédé à la lettre : il s’agit vraiment de la voix de La Boétie, ce que suggère l’injonction « oyons », mais d’une voix qui ne peut s’articuler avec le texte qui l’environne, en particulier avec la lamentation qui précède et, surtout, qui ne correspond pas à l’être dont on déplore la perte : un « garçon », de dix-huit (édition de 1580), puis seize ans (Exemplaire de Bordeaux), un amant, dont 145la parole « gaillard[e] », « enjoué[e] », « vi[ve] », voire « bouillant[e]75 » ne peut convenir à l’évocation dont il vient de faire l’objet, ni même à l’être que connut Montaigne76. Cette mise en scène textuelle est d’autant plus probante si l’on suit l’hypothèse de M. Magnien, selon lequel Montaigne n’aurait peut-être jamais réellement pensé à intégrer la Servitude Volontaire au premier livre77. En conservant les références au Contre Un qui ouvrent et clôturent le chapitre, en le remplaçant par un autre texte, avant d’y renoncer, Montaigne désigne certes une place vide, mais également les vains efforts pour la combler : l’ami ne peut être entendu, d’autant plus que ses « vers se voient ailleurs », le changement sensoriel étant significatif. Les traces exhibées de cette impossible prosopopée donnent une forme au caractère inconsolable de Montaigne. L’enjeu n’est pas seulement psychologique ou esthétique : à l’affliction personnelle viennent s’ajouter les calamités publiques, qui sont, nous dit l’auteur, la véritable cause de l’absence du Contre Un. Cette séquence aurait également une fonction de diversion : le montage dramatique qui fait se superposer l’histoire accidentée du livre, celle du deuil et celle des conflits religieux et politiques produit une complexification du simple récit consolatoire qui aurait pour effet d’estomper le malaise de Montaigne à l’égard de ce texte si dangereux.
De la phrase au livre : le rayonnement de la parole consolatoire en question
Puisque les matériaux relevant des traditions sont disposés de façon préférentielle dans les deux chapitres consolatoires, et à une place bien précise dans le chapitre « De l’amitié », il apparaît que leur disposition n’est pas aléatoire. Il y a bien un lien entre le surgissement de la parole consolatoire et certains éléments de composition. L’étude de la ventilation, 146dans les cinquante-sept chapitres, des différents critères que nous avons dégagés renforce cette hypothèse spécifique au premier livre, les deux suivants obstruant de plus en plus la saisie consolatoire d’un extrait, à cause de la longueur des chapitres et de titres qui ignorent à peu près totalement les traditions de consolation. Jusque dans l’Exemplaire de Bordeaux, une grande proximité apparaît entre les deux chapitres consolatoires, les seuls qui présentent l’intégralité des neuf critères78, proximité accentuée par la brièveté des chapitres qui les séparent. L’un (I, XIV) est plutôt isolé, alors que l’autre (I, XX) appartient déjà à une séquence formée par les chapitres « De la peur », « Qu’il ne faut juger de nostre heur, qu’après la mort » et, après lui, « De la force de l’imagination ». Dans cette première configuration, la majeure partie du discours consolatoire précède ainsi le chapitre « De l’amitié », comme pour court-circuiter par avance son déploiement à propos du deuil de La Boétie et souligner le fait que les remèdes adressés aux autres ne valent pas pour soi, du moins en l’espèce. Une telle approche permet d’apporter un éclairage nouveau sur la question du déplacement du chapitre xiv devenu xl dans l’édition de 1595. O. Chouchena a récemment récapitulé les différentes hypothèses qui ont été émises pour l’expliquer79. Notre contribution se situe ici dans la lignée de l’analyse de G. Defaux qui constatait déjà la création d’une nouvelle séquence composée des anciens chapitres I, 39 et 40 lesquels, en plus d’être « très personnels », ressemblent de très près au chapitre mobile « par son esprit et par les thèmes qu’il traite80 ». La présence des traditions de consolation dans ces chapitres prouve cette parenté. Toutefois, là où G. Defaux concluait, à la lumière de l’avant-propos du sixième livre de L’Institution oratoire, à la présence diffuse et implicite de La Boétie dans le chapitre en question, il nous semble important que l’ami n’y soit pas mentionné explicitement. Par ce déplacement, Montaigne ne 147renonce pas totalement à « un dispositif essentiellement architectural, monumental et symbolique81 », mais il opte pour un autre ordonnancement, où le chapitre évidé perd son statut central, mais conserve son rôle de repère : de part et d’autre de celui-ci, à sept chapitres de distance précisément, se situent à partir de 1595 deux pôles consolatoires d’une dimension à peu près équivalente, ayant chacun à sa tête, l’un des deux chapitres consolatoires82. Le nouveau chapitre I, XL étant éloigné de son pendant, l’effet de redondance, concernant notamment le discours consolatoire sur la mort, est estompé. Un nouvel équilibre est restauré, qui ne réside pas dans le foyer de tensions situé vers le centre du livre, mais s’organise à partir de lui.
Le rayonnement de la parole consolatoire est parfois minimal quand, cantonné au niveau de la phrase, le segment en question est associé à des matériaux autres, mais il peut également opérer à l’échelle du chapitre, voire du livre. Si l’on s’intéresse aux phrases qui, quel que soit l’angle abordé, jouissent du rayonnement maximal sur l’ensemble des trois livres, celles qui composent l’avis « Au lecteur », on observe là aussi une référence consolatoire particulièrement complexe :
Je l’ay voué à la commodité particuliere de mes parens et amis : à ce que m’ayans perdu (ce qu’ils ont à faire bien tost) ils y puissent retrouver aucuns traicts de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entiere et plus vifve, la connoissance qu’ils ont eu de moy83.
Par ces mots, ainsi que l’a montré Jean Starobinski84, l’ensemble des Essais est placé dans l’imminence de la mort. La « vo[cation] » de l’œuvre, nous dit Montaigne, réside dans la « considération de la per[te] », à la fois entendue comme phénomène et comme conséquence affective 148de celui-ci, que ressentiront alors ses proches. Ces deux éléments apparaissaient déjà dans les paroles adressées par La Boétie à Montaigne :
[…] & vous asseure que ce qui me fait avoir quelque soing que i’ay de ma guerison, & n’aller si courant au passage que i’ay desia franchy à demy : c’est la consideration de vostre perte, & de ce pauvre homme, & de ceste pauvre femme (parlant de son oncle & de sa femme) que i’ayme tous deux unicquement : & qui porteront bien impatiemment (i’en suis asseuré) la perte qu’ils feront en moy […]85.
Le parallèle ne concerne pas seulement les idées, mais également les mots et la syntaxe (notamment les deux subordonnées coordonnées, dont la dernière se termine par une relative enchâssée, à la formulation si proche : « la connaissance qu’ils ont eu de moy »/« la perte qu’ils feront en moy »). L’usage des parenthèses est également intéressant, puisqu’elles traduisent un écart énonciatif : dans les paroles de La Boétie rapportées par Montaigne, elles renvoient tour à tour aux explications du narrateur et aux prévisions pathétiques de l’agonisant, ce qui accentue le mélange des voix. Au seuil des Essais, elles soulignent le décalage entre le livre destiné aux proches, et un avertissement adressé au lecteur, puisque, comme La Boétie, il parle d’eux à la troisième personne. Les deux auteurs formulent une intention, celle de prendre en charge la douleur de leurs proches à l’heure de leur mort. La Boétie, celui de Montaigne du moins, fait de sa mort un livre, en manifestant non seulement de la constance pour lui-même, mais également de l’humanité et de la sensibilité à l’égard de ses proches, dernier éclat de vertu du sage. Il adopte une stratégie de consolation fondée sur la passion de l’espérance, destinée d’ordinaire aux âmes faibles. La construction que Montaigne propose est tout autre : la posture consolatoire est d’abord un simulacre temporel. Il n’est pas en train de composer sa mort comme un livre, mais son livre comme s’il était « bien tost » mort. Le livre, chargé de pallier sa propre perte, ne vise pas exactement à consoler, au sens prévu par les traditions : il ne s’agit pas d’apprendre à accepter la perte, mais bien de la nier, la « connaissance » de l’être perdu étant alors, « plus vifve (beau paradoxe !) et plus entière ». C’est bien à partir des traditions de consolation que Montaigne justifie l’originalité de son livre. Autre indice de cette influence, dans le deuxième livre, Montaigne fait 149prononcer à Sénèque, l’une de ces figures traditionnelles de sages qui meurent en consolant leurs proches, des paroles destinées explicitement à consoler son épouse, dans une formule qui est, la transposition pronominale mise à part, le calque de celle qui termine l’extrait cité de l’avis « Au lecteur ». À propos de sa propre mort, il rattache explicitement cette « cognoissance » à un moyen de « consoler » :
Parquoy m’amie, disoit-il, ne la deshonnore par tes larmes, affin qu’il ne semble que tu t’aimes plus que ma reputation : appaise ta douleur, et te console en la cognoissance, que tu as eu de moy […]86.
Sénèque parle de conformité à la sagesse stoïcienne, qu’il a lui-même incarnée de son vivant, et s’érige en exemple auprès de son épouse. Chez Montaigne, la « connaissance » s’entend tout autrement, renvoyant à la fois à la présence perpétuée par-delà la mort et à la deuxième naissance opérée par le livre. Dans l’avis « Au lecteur », la référence consolatoire fait à la fois office d’excusatio (la prise en considération des proches garantit la magnanimité et prémunit contre l’écueil de la vanité) et de lointain modèle, qui n’est pas sans rappeler la consolation épicurienne par la « recordation87 » des bonheurs passés.
L’influence consolatoire dans le premier livre des Essais s’avère aussi profonde que complexe. Montaigne ne se contente pas de se livrer à l’examen critique de ce type de discours ; il met à l’épreuve la parole consolatoire, sur un mode sérieux, léger, ou parodique, ce qui lui permet d’en explorer, voire d’en renouveler les pouvoirs esthétiques et pragmatiques. La multiplication des sources d’affliction abordées, la dissociation du discours consolatoire, lui-même éclaté, et du récit inauguré avec celui de la mort de La Boétie, ne permettent pas l’ancrage que semblait promettre le recueil de 1571, auquel le premier livre se raccorde pourtant. De manière spécifique, la matière et la manière consolatoires ne sont ni totalement déconstruites, ni convoquées de manière aléatoire. Elles fournissent la substance presque exclusive de deux chapitres où l’auteur revient inlassablement aux grandes questions qui traversent les traditions de consolation, si bien que ces chapitres méritent d’être désignés comme consolatoires, c’est-à-dire intrinsèquement affiliés aux traditions, fût-ce 150dans une grande tension avec celles-ci, tant leur imprégnation est forte. L’influence consolatoire peut survenir à des endroits stratégiques du chapitre, comme la lamentation de la fin du chapitre « De l’amitié » qui propose un renversement de la construction rhétorique traditionnelle, telle que l’on peut la trouver dans le discours d’Ambroise consacré à la mort de son frère. Par le déplacement de l’ancien chapitre I, XL, le premier livre passe d’une construction mémorielle à une organisation numériquement moins satisfaisante88, mais qui propose un agencement plus équilibré des chapitres où l’influence consolatoire est la plus nette, en deux pôles placés à égale distance du chapitre qui devait faire résonner la parole de l’ami. Ces éléments de composition reposent sur un usage très personnel et libre des traditions ; ils sont toujours susceptibles de changement et de mouvement, que ce soit à l’échelle de la phrase, du chapitre et du livre, qui ne fonctionnent pas comme des unités cloisonnées. Les traditions de consolation offrent un ensemble de modèles et de références que l’auteur se plaît à renverser, à jouer l’une contre l’autre, bref à mettre à mal, mais qui l’intéressent dans la mesure où elles autorisent la mise en récit de soi et l’élaboration d’un lien avec l’autre d’une grande intensité et d’une grande complexité, et ce dès le recueil de 1571. À l’intérieur des pratiques électives que constituent les traditions de consolation, souvent mobilisées au sein de communautés soucieuses de réaffirmer leurs valeurs en temps de crise, Montaigne opère en quelque sorte une nouvelle démarcation ; le traitement, souvent subversif, de ces traditions, pesantes car incontournables à l’époque, lui permet de se singulariser, ainsi que son livre.
Rémi Ordynski
Sorbonne Nouvelle
1 Tous les éléments abordés ici font l’objet d’un développement dans ma thèse de doctorat actuellement en cours de rédaction (« Montaigne et les traditions de consolation : “[…] pour moy, ou pour un autre […]” », Université Sorbonne Nouvelle, dir. M. Magnien, soutenance prévue pour 2022) : je suis contraint d’y renvoyer globalement, et par anticipation. Je remercie vivement M. Magnien et A. Tarrête pour leur lecture de cette communication et pour leurs conseils.
2 Nous renvoyons ici au premier volume des œuvres de La Boétie : La Mesnagerie de Xenophon. Les Regles de mariage, de Plutarque. Lettre de consolation, de Plutarque à sa femme. Le tout traduict de Grec en François par feu M. Estienne de la Bœtie Conseiller du Roy en sa court de Parlement à Bordeaux. Ensemble quelques Vers Latins et François, de son invention. Item, un Discours sur la mort dudit Seigneur, De la Boëtie, par M. de Montaigne, Paris, F. Morel, 1571.
3 À plusieurs reprises dans ce texte, La Boétie révèle à Montaigne la part qu’il prend au tourment que sa mort causera à ses proches. Malgré son état de plus en plus préoccupant, il annonce à Montaigne son intention : « […] ie les consoleray […] » (ibid., f. 123-ro). C. Blum identifie l’épître consolatoire comme l’un des modèles de ce texte (« De la Lettre sur la mort de La Boétie aux Essais : allongeail ou répétition ? », RHLF, 88, 1988, p. 937).
4 La distinction que propose cette double formule provient de la lettre également appelée « L’histoire des calamités d’Abélard », Abélard–Héloïse. Correspondance. Lettres I–VI, trad. R. Oberson, Paris, Hermann Éditeurs, 2007, p. 27.
5 Sur la consolation en général, voir notamment : A. Tarrête, « Remarques sur le genre du dialogue de consolation à la Renaissance », Bulletin de l’Association d’études sur la renaissance, l’humanisme et la réforme, No 57, 2003, p. 133-161 ; id., « La Consolation de Guillaume du Vair sur la mort de sa sœur », Les funérailles à la Renaissance, Genève, Droz, 2002, p. 499-516).
6 Voir, par exemple, J. Lecointe, « Éthos stoïque et morale stoïcienne. Stoïcisme et rhétorique évangélique de la consolation dans le De contemptu rerum fortuitarum de Guillaume Budé (1520) », Stoïcisme et christianisme à la Renaissance, textes réunis par A. Tarrête, Cahiers V. L. Saulnier, no 23, Paris, Éditions rue d’Ulm, 2006, p. 35-58.
7 Les recherches menées et organisées par C. Martin-Ulrich depuis une dizaine d’années, consacrées à la consolation de l’Antiquité à l’époque moderne, ont notamment donné lieu à la parution d’un numéro d’Exercices de rhétorique (« Sur la consolation », C. Martin-Ulrich, dir., no 9, 2017, en ligne) et permis l’élaboration d’une anthologie, à paraître aux Belles Lettres en 2022.
8 De l’usage de la citation au poème entier, en passant par le prosimètre de Boèce.
9 Érasme, « De conscribendis epistolis (1522), ch. 49-50 », C. Noille (éd.), Ph. Collé et Ch. Noille (trad.), Exercices de rhétorique, 9, 2017 [En ligne] http://journals.openedition.org/rhetorique/540 (consulté le 23/04/2019).
10 P. Fabri, Le grand et vray art de pleine rhetorique […], Paris, Denis Janot, 1534, f. Cxxxi-ro-Cxxxii-ro.
11 J. C. Scaliger, « Poetices libri septem (1561), III, 122. La consolation », Exercices de rhétorique, 9, 2017 [En ligne] http://journals.openedition.org/rhetorique/537 (consulté le 12 septembre 2020).
12 G. J. Vossius, « Rhetorices contractae (1621), II, 24. De la consolation », C. Noille (éd. et trad.), Exercices de rhétorique, 9, 2017 [En ligne] http://journals.openedition.org/rhetorique/534 (consulté le 10/12/2020).
13 Avec Marguerite de Navarre (La Navire, Dialogue en forme de vision nocturne) et Hélisenne de Crenne (Les espitres familieres), le xvie siècle fait entrer les femmes dans les traditions dans le rôle de la consolatrice, et non plus seulement de l’affligée.
14 « Mais ie laisse à Plutarque la charge de vous consoler […] vous priant de le croire pour l’amour de moy. » (La Mesnagerie […], f. 89-vo).
15 À la suite de l’analyse de cette lettre élaborée notamment par Paul J. Smith (Réécrire la Renaissance […], Amsterdam, Rodopi, 2009, p. 76-89) J. Vignes en propose une lecture rhétorique qui tient compte du statut de dédicace de ce texte, ce qui interdit de le lire avec les mêmes critères qu’une lettre privée (id., « La lettre de consolation de Plutarque à sa femme traduite par La Boétie et ses prolongements chez Montaigne, Céline et Michaël Foessel », Exercices de rhétorique 9, 2017 [En ligne] http://journals.openedition.org/rhetorique/545 (consulté le 12/09/2020).
16 Voir, en particulier, l’exorde de l’épître dédicatoire, où Montaigne réfléchit sur les liens entre mariage et galanterie (op. cit., f. 89-ro).
17 Nous interprétons ainsi, par exemple, la réaction d’opposition de La Boétie face à l’argument censément consolateur avancé par Montaigne : « La mort n’a rien de pire que cela, luy dis-je lors, mon frere : Mais n’a rien de si mauvais, me respondit-il » (ibid., f. 123-ro). Deux exemples canoniques : Socrate et Sénèque. Cette preuve de vertu est un véritable lieu commun, qu’utilise par exemple Quintilien pour illustrer le courage de son fils (Institution oratoire, « Avant-propos » du livre VI).
18 Notre édition de référence est : Les Essais, éd. J. Balsamo, M. Magnien, C. Magnien-Simonin ; « Notes de lecture » et des sentences peintes, éd. A. Legros, Paris, Gallimard, 2007 (Bibliothèque de la Pléiade, 14). Nous y renvoyons sauf mention contraire.
19 C’est l’un des axes importants de l’étude de G. Defaux (Montaigne et le travail de l’amitié […], Orléans, Paradigme, 2001, passim) qui identifie de nombreuses allusions à La Boétie, notamment dans le premier livre. Dans notre perspective, nous distinguerons entre les évocations explicites de l’ami perdu, qui opèrent un ancrage, et celles qui traitent de la mort ou de la douleur en général.
20 L’ancrage temporel opéré par la phrase commençant par « Depuis le jour que je le perdy […] » (E. I, XXVII, p. 200), est thématisé par sa place et sa fonction dans le chapitre, nous y reviendrons.
21 Voir A. Legros, Essais sur poutres, Paris, Klincksieck, 2000, p. 39-52.
22 Voir sur cette question, A. Tarrête, « La Consolation de Guillaume du Vair sur la mort de sa sœur », art. cité, p. 504-505.
23 De manière significative, le raccordement entre l’entrée en écriture et l’affliction provoquée par un événement accidentel ne se fera qu’au deuxième livre, et d’une manière voilée. À Madame d’Estissac, Montaigne confie : « C’est une humeur melancolique, et une humeur par conséquent très ennemie de ma complexion naturelle, produite par le chagrin de la solitude, en laquelle il y a quelques années que je m’estoy jetté, qui m’a mis premierement en teste ceste resverie de me mesler d’escrire. » (E., II, VIII, p. 404).
24 Id., Dictionnaire Montaigne, Ph. Desan (dir.), s. v. « Consolation », Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 383.
25 E., I, XIX/XX, « Que Philosopher, c’est apprendre à mourir » et XIV/XL, « Que le goust des biens et des maux despend en bonne partie de l’opinion que nous en avons ».
26 E., I, II, p. 35.
27 Cicéron, Académiques, II, XLIV.
28 « Duplex est igitur ratio ueri reperiendi non iniis solum quae mala, sed in iis etiam quae bona uidentur. Nam aut ipsius rei natura qualis et suanta sit, quaerimus, […] aut a disputandi subtilitate orationem ad exempla traducimus » « Cela posé, il existe deux procédés pour découvrir la vérité, et cela non seulement pour ce qui nous paraît mauvais, mais aussi pour ce qui nous paraît bon : ou nous examinons la nature de la chose en soi, son caractère et son importance, […] ou bien, renonçant aux finesses de la dialectique, on recourt à la méthode des exemples » Cicéron, Tusculanes, III, XXIII-56, trad. J. Humbert, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 34.
29 Le lien entre consolation et prosopopée est notamment établi par N. Doiron (« Poétique de la consolation classique. L’exemple du Recueil (1627) de Faret », Dix-septième siècle, PUF, 2007, 4, no 237, p. 785).
30 Voir, sur ce point, C. Martin-Ulrich, « Parénétique de la consolation : louer et exhorter dans la lettre (Philippe Du Plessis-Mornay, Guillaume Du Vair et Antoine de Nervèze) », Rivista italiana di filosofia del linguaggio, Université de Calabre, Rende, 2015, p. 130-143.
31 Essais de Michel Seigneur de Montaigne, Paris, Abel L’Angelier, 1588, p. 10-vo (éd. consultée dans la base en ligne « Corpus Montaigne » sur le site Classiques Garnier Numérique).
32 E., I, IX, p. 56-57.
33 « Nous nous laissons si fort aller sur les bras d’autruy, que nous anéantissons nos forces. Me veux-je armer contre la crainte de la mort ? c’est aux despens de Seneca. Veux-je tirer de la consolation pour moy, ou pour un autre ? je l’emprunte de Cicero : je l’eusse prise en moy-mesmes, si on m’y eust exercé. Je n’aime point cette suffisance relative et mendiée. » (E., I, XXIV, p. 143).
34 Nous distinguons entre « consolatoire » (qui ressortit aux traditions) et « consolateur » (qui est de nature à provoquer l’apaisement) : si les traditions sont massivement convoquées, le travail de subversion dans ces deux chapitres produit parfois l’effet inverse, comme l’hypotypose finale de I, XIX/XX.
35 Selon la définition qu’en donne J. Chomarat à propos d’Érasme, soit, pour résumer, un exercice d’inspiration scolaire et qui consiste à plaider une cause fictive, souvent pour et contre, pour exercer et démontrer son talent (voir J. Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Érasme, II, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 934-941). Il établit le lien entre consolation et déclamation, à partir de la Consolatio de morte filii præmature (ibid., p. 958-962).
36 S. Luciani montre que Cicéron s’est « livré dans les Tusculanes à une analyse théorique de la consolation sans pour autant perdre de vue sa double expérience de sujet souffrant et de thérapeute », qu’elle confronte à la pratique de la correspondance (« Leuatio aegritudinum. Consolation et vérité chez Cicéron », dans P. Galand et E. Malaspina (éd.), Vérité et apparence. Mélanges en l’honneur de Carlos Lévy, offerts par ses amis et ses disciples, Turnhout, Brepols, 2016, p. 269). Pour une étude consacrée à l’aspect thérapeutique des Tusculanes, voir B. Koch, Philosophie als Medizin für die Seele. Untersuchungen zu Ciceros Tusculanae Disputationes, Stuttgart, Steiner, 2006. Sur l’influence considérable des Tusculanes sur Montaigne, voir M. Magnien, « Montaigne (re)lecteur des Tusculanes », dans Ph. Ford & N. Kenny (éd.), The Library of Montaigne, Proceedings of the tenth Cambridge […], Cambridge, Cambridge French Colloquia, 2012, p. 157-182. Notons que la lecture consolatoire des Tusculanes apparaît déjà chez Pétrarque, qui dans l’une de ses Lettres Familières (XVIII, 14, t. V, Paris, Les Belles Lettres, 2005, p. 280), présente comme merveilleux les pouvoirs de chacun des livres qui composent le dialogue de Cicéron.
37 B. Perona, « “Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de notre opinion”. La recherche inquiète d’“un discours qui face pour nous” », BSIAM, 2014-1, no 59, p. 122-127.
38 A. Tarrête, « La consolation dans le livre III des Essais », Autres regards sur les Essais, Livre III de Montaigne, Paris, Atlande, 2017, p. 109-110.
39 S. Luciani, « Lucrèce et la tradition de la consolation », Exercices de rhétorique, 9, 2017 [En ligne] http://journals.openedition.org/rhetorique/519 (consulté le 19/04/2019).
40 Le terme, plus éclairant qu’élégant, a le mérite de montrer que la consolation consiste à opérer une saisie parmi un matériau plus large, qui lui préexiste et qui fonctionne comme une réserve d’arguments et d’exemples. Peuvent entrer dans cette catégorie tous les ouvrages de philosophie morale qui traitent des sources d’affliction, mais également les traités épistolaires, rhétoriques, notamment. D. Scourfield distingue entre les consolations qui relèvent d’une pratique sociale adressée, et les « méta-consolations » qui proposent une réflexion sur ce type de discours ou sur les questions généralement abordées (J. H. D. Scourfield, « Towards a genre of consolation », dans H. Baltussen (éd.) Greek and Roman Consolations, Eight studies of a tradition and its afterlife, Wales, The Classical Press of Wales, 2013, p. 20).
41 B. Perona, Prosopopée et persona à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 268-270.
42 E., I, XIX, p. 94 : « Sortez, dit-elle, de ce monde, comme vous y estes entrez. Le mesme passage que vous fistes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Vostre mort est une des pieces de l’ordre de l’univers, c’est une piece de la vie du monde. » À mettre en relation avec le consolateur qui relaie la prosopopée de la nature chez Sénèque (« Consolation à Marcia », Dialogues. Consolations, t. III, texte établi et trad. par R. Waltz, Paris, Les Belles Lettres, 1961, p. 36) : « Intraturus ex urbem diis hominibusque communem, omnia complexam, certis legibus aternisque deuinctam, indefatigata cælestium officia uolentem ». « Tu vas faire ton entrée dans la ville commune des dieux et des hommes, ville qui comprend tout l’univers, qui obéit à des lois constantes et éternelles, où les corps célestes accomplissent leurs infatigables révolutions ».
43 Dans l’une des pages de garde postérieures de son exemplaire du De rerum natura (E., éd. et trad. A. Legros, p. 1219), Montaigne écrit à propos des vers qui précèdent la prosopopée de la nature (livre III) : « Locus perelegans de vitae commoditatibus quas videmur morientes perdidisse. » « Très beau passage sur les bienfaits de la vie que nous pensons avoir perdus en mourant ».
44 E., I, XL, p. 265.
45 Cicéron, De Fin., II, XXIX.
46 E., I, XL, p. 267.
47 Sénèque, qui prend soin de justifier le recours à ce type de remèdes, dit à Marcia : (« Consolation à Marcia », II-2, Dialogues. Consolations, t. III, trad. R. Waltz, Paris, Les Belles Lettres, p. 15) : « Ad speciosa stupenti duo tibi ponam ante oculos maxima et sexus et sæculi tui exempla. » « Toi, les beaux traits t’éblouissent ; je vais te mettre sous les yeux deux exemples illustres, que m’offrent ton siècle et ton sexe ».
48 J. C. Scaliger, Poetices libri septem, éd. citée, § 4 : « Sin a vulgi opinionibus usuque maxime abhorrent ac propterea ægre animum subire valent, tum vero non tam rationibus atque argumentis fides extorquenda quam exemplorum frequentia persuasio insinuanda. » « Si au contraire ceux qu’on cherche à consoler ont la plus grande horreur des opinions et pratiques du vulgaire, et que, pour cette raison, ils sont en état d’affronter leur détresse, il ne faudra pas tant arracher leur conviction par des raisonnements et des arguments qu’insinuer la persuasion par l’usage répété d’exemples » § 4.
49 B.-R. Vasselin, « L’ironie et l’humour dans “Que Philosopher c’est apprendre à mourir” », Montaigne et l’intelligence du monde moderne. Essais, livre I, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 57-97.
50 Érasme, De conscribendis epistolis[…], Lyon, Thibaud Payen, 1557, p. 198. Pour la traduction, nous renvoyons à l’édition citée de C. Noille.
51 S. Giocanti (Scepticisme et inquiétude, Paris, Hermann, 2019, p. 403-476) démontre que le scepticisme, en particulier chez Montaigne, n’est pas incompatible avec une visée consolatrice, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Nous n’insistons pas sur ce point, puisque nous nous intéressons ici aux consolations en tant que traditions.
52 E.,I, XXVII, p. 200.
53 La citation de Virgile (Enéide, V, 49-50) se situe dans une continuité tonale et syntaxique avec la parole de l’auteur.
54 La datation n’est pas certaine : P. Boucheron propose la date de 378 (La Trace et l’aura. Vies posthumes d’Ambroise de Milan (ive-xvie siècle), Paris, éditions du Seuil, 2019, p. 39).
55 C. Favez (La consolation latine chrétienne, Paris, Vrin, 1937, p. 21) identifie ce texte à la fois comme une oraison funèbre et une consolation.
56 Nous renvoyons, pour le texte latin, à : Ambroise, « In libros duos de excessu fratris satyri » (De exc.), Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi. Opera omnia, Patrologiae latinae, Tomus 16, éd. originale, Paris, 1845, réimpression anastatique par Brepols, 1993, p. 1302 ; pour la traduction française, Sur la mort de son frère, trad. M. Bonnot, Paris, Migne, 2002.
57 Montaigne et La Boétie s’interpellent à plusieurs reprises comme des frères dans l’extrait de lettre qui clôt le recueil de 1571. On sait que dans « De l’amitié », le lien de fraternité est distinct de l’amitié ; néanmoins, dans le montage final de citations de Catulle, le mot « frater » apparaît trois fois (E., I, XXVII, p. 201).
58 Contrairement à Jérôme, à Paulin de Nole et à Augustin (dans le chapitre qui précède « De l’amitié » notamment), Ambroise n’est ni cité, ni mentionné dans les Essais. À défaut de pouvoir le prouver, quelques éléments rendent plausible le fait que Montaigne connaissait ce texte. Les œuvres complètes d’Ambroise avaient fait l’objet d’une édition par Érasme en 1529, puis 1539 chez C. Chevallon à Paris. Le […] de excessu fratris sui Satyri a ensuite été édité parmi les Opera D. Ambrosii Mediolanensis episcopi […], à Paris, chez C. Guillard et G. Desboys, en 1549-1550. En suivant cette hypothèse, Montaigne ne serait pas le premier à se souvenir d’Ambroise en pleurant un ami mort prématurément. Ainsi Pétrarque ayant perdu Tommaso Caloiro (Fam., IV, 10, trad. A. Longpré, t. II, Paris, Les Belles Lettres, p. 2002, p. 66-67) : « Hanc acerbissimam fati vim deflere mecum et profundissimo simul vulneri meo paria, si possum, adhibere remedia meque ipsum meil literis et iusto volumine consolari, propositum est michi. Fecit hoc primus in morte dilectissime filie Marcus Cicero, divino ille quidem et inaccessibili quodam stilo ; fecit idem multis post seculis in morte fratris Ambrosius ». « Je me propose de pleurer ce dur coup du sort, d’appliquer en même temps à ma blessure, si je le peux, des remèdes qui lui conviennent et de me consoler en écrivant des lettres et un livre adapté au sujet. C’est ce qu’a fait Cicéron, le premier de tous, avec son style divin et incomparable, à l’occasion de la mort de sa fille chérie ; c’est ce qu’a fait de même Ambroise plusieurs siècles après lui à l’occasion de la mort de son frère […] ».
59 E., I, XXVII, p. 190.
60 « Etsi esset quod hic delectare non posset : et si quando voluissemus impense vitam producere, jam tamen sine te esse nollemus. » (De exc., I, 34, p. 1301) « Même s’il y avait ici-bas des choses susceptibles de nous plaire, je ne pourrais sans toi éprouver de plaisir, et si, quelquefois, nous avions ardemment voulu prolonger notre vie, nous ne voudrions plus désormais qu’elle dure sans toi. » (Sur la mort de son frère, p. 36). Voir la citation du chapitre « De l’Amitié » placée au début de ce développement.
61 « Labore inferior, sed amore conjunctior : non tam mea virtute habilis, quam tua patientia tolerabilis, qui pio semper sollicitus affectu latus meum tuo latere sepiebas […]. » (De exc., I, 8, p. 1293) « J’étais moins résistant à la tâche, mais bien joint à toi dans l’amour, non tant capable par mes qualités propres que capable d’endurer grâce à ta patience, toi qui, toujours en souci à cause de ton affection fidèle, protégeais mon flanc par le tien […] » (Sur la mort de son frère, p. 23). À mettre en relation avec Montaigne (E., I, XXVII, p. 198) : « […] de mesmes qu’il me surpassoit d’une distance infinie en toute autre suffisance et vertu, aussi faisoit-il au devoir de l’amitié ».
62 De exc., I, 39. « Car alors que tout nous était commun, que nous avions un seul esprit, une seule âme, […] ». Sur la mort de son frère, p. 38.
63 E., I, XXVII, p. 197.
64 Ibid., p. 198.
65 Aristote, Éthique à Nicomaque, IX, 8, 2e.
66 Dans les Confessions (IV, 4.9), le deuil de l’ami anonyme est intégré à une séquence marquée par différentes formes d’erreurs, et débouche sur la crainte de la mort, contrairement à Ambroise ou Montaigne.
67 De exc., I, 6, p. 1292. « Car je n’ai jamais été tout entier en moi-même, mais la plus grande part de chacun de nous était placée en l’autre […] ; dans ce corps qui gît maintenant inanimé, l’accomplissement de ma vie est en effet plus grand car, dans le corps dont je suis chargé, la part qui te revient est la plus féconde » (Sur la mort de son frère, p. 22).
68 E., I, XXVII, p. 200.
69 Horace, Odes, II, XVII, 8-9. « Ille dies utramque / Duxit ruinam » « Ce jour a entraîné notre ruine à tous deux ».
70 Catulle, LXVIII, 24. « Tecum una tota est nostra sepulta anima ». « [A]vec toi tout entière mon âme a été ensevelie ».
71 De exc., I, 6, p. 1292. « Je commence à ne plus être étranger là où se trouve la meilleure partie de moi-même. » (Sur la mort de son frère, p. 22).
72 Voir le chapitre 3 de notre thèse, « L’ami. De La Boétie aux Essais : premier récit consolatoire ».
73 Outre le contexte historique, la perspective idéologique, c’est également la nature du texte qui diffère : Ambroise prononce un discours qui implique la communauté présente ; Montaigne parle en son nom propre.
74 « Mais oyons un peu parler ce garson de seize ans ». (E., I, XXVII, p. 201)
75 Ibid., p. 201-202.
76 Cette inadéquation entre l’être et les mots qu’il a laissés est une source d’affliction pour Montaigne-éditeur, sur laquelle il insiste encore davantage que sur la perte elle-même. Voir, par exemple, l’épître dédicatoire à Paul de Foix des Vers François […].
77 M. Magnien, s. v. « Discours de la servitude volontaire », Dictionnaire Montaigne, op. cit., p. 507-513.
78 Les critères sont ceux que nous avons énumérés au début de cette communication (intention, raisons, exemples, passions, sources d’affliction, interlocution, marqueur, ancrage, titre). Voir le chapitre 5 de notre thèse « Les deux chapitres intrinsèquement consolatoires des Essais » et les annexes 1 et 2 pour plus de détails.
79 O. Chouchena, « Conjectures sur le déplacement du chapitre i, 14/40 dans les Essais de Montaigne », Montaigne Studies An Interdisciplinary Forum (MS), no 32, 2020, Montaigne, la maladie et la médecine, p. 203-214. Les hypothèses vont de la taille des chapitres au rapport qu’ils entretiennent avec tel auteur, en l’occurrence Cicéron.
80 G. Defaux, « Montaigne, La Boétie, les Essais », MS, XI, no 1-2, 1999, p. 194.
81 Ibid., p. 185.
82 Une remarque importante au sujet du deuxième pôle que nous venons de délimiter. La présence, à l’intérieur de celui-ci, du nouveau chapitre XXXIX, peut surprendre : si notre hypothèse est exacte, pourquoi ne pas avoir placé le chapitre juste après « De la Solitude », beaucoup plus proche des traditions ? La réponse est dans la première phrase de « Consideration sur Ciceron », présente dès 1580 : « Encor’un traict à la considération de ces couples » (ibid., p. 253), en l’occurrence Cicéron et Pline le Jeune d’une part, Epicure et Sénèque de l’autre. Les deux chapitres paraissent difficilement séparables.
83 E., « Au lecteur », p. 27. M. Simonin propose une interprétation de cette phrase en lien avec les Lois de Platon (« Rhetorica ad lectorem : lecture de l’avertissement des Essais », MS, no 1, 1989, p. 65-67).
84 J. Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1993, p. 78-80.
85 « Extraict de la lettre à son père », La Mesnagerie […], op. cit., f. 123-vo.
86 E.,II, XXXV, p. 786.
87 Nous paraphrasons E., III, V, p. 883.
88 Voir, sur ce point, A. Legros, « Le “livre premier” et la protohistoire des Essais », BSIAM, no 53-1, 2011.