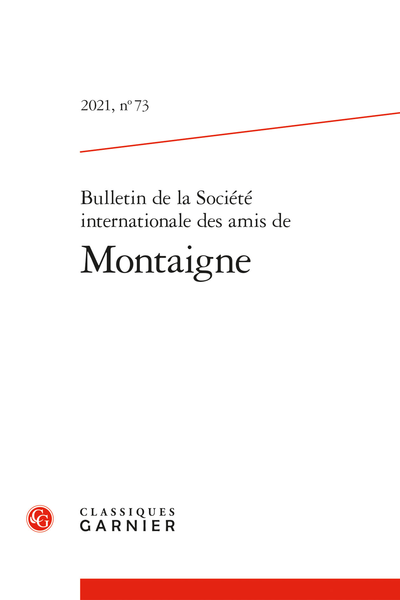
Le régime du visuel chez Montaigne
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2021, n° 73. varia - Auteur : Sautin (Luc)
- Résumé : La dimension visuelle de l’écriture de Montaigne n’est pas une simple métaphore. Le regard fournit l’exemple d’une relation dynamique et complexe entre l’œil et l’objet de son attention, relation qui rend compte, pour peu qu’on en note la spécificité, de certains usages de l’image dans les Essais. L’analyse rhétorique de ces traces visuelles ne rend pas toujours compte de leur valeur heuristique et solipsiste. L’image est ici abordée en termes de vertu thérapeutique ou de fascination macabre.
- Pages : 107 à 128
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126072
- ISBN : 978-2-406-12607-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12607-2.p.0107
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : visuel, hypotypose, méditation, peinture, subjectivité
Le régime du visuel chez Montaigne
Tel qu’il se présente dans l’avis « Au Lecteur », le projet d’écriture des Essais adopte explicitement pour modèle cette technique de représentation visuelle qu’est la peinture : « c’est moi que je peins ». Dans le même ordre d’idée, les deux récits qui rendent compte de l’origine de l’entreprise recourent à des termes visuels pour en indiquer les moyens et la finalité : se « portraire au vif » est donné comme condition de réalisation du projet (« Or madame, ayant à m’y pourtraire au vif » : II, 8, 85-61) ; il s’agit d’autre part de « mettre en rôle » les « chimères et monstres fantasques » dont accouche l’esprit oisif de l’auteur, pour « en contempler (…) l’ineptie et l’étrangeté » (I, 8, 154). Tant du côté de sa production que de celui de sa réception, le texte, est-il suggéré, peut être appréhendé comme le serait un artefact plastique ou graphique, comme un portrait à contempler. La métaphore, qui attribue à la démarche « enquérante » la forme et la consistance d’un regard – regard au vif porté par l’auteur sur lui-même, relayé par un regard second, posé sur le produit de la représentation –, est suffisamment insistante à travers l’œuvre pour qu’on se sente fondé à en parcourir les ramifications sémantiques et en nourrir l’interprétation qu’on peut faire du texte. Si, comme nous le supposons, du « visuel » est à l’œuvre dans les Essais, il faut rendre compte de la productivité de ce regard intérieur, des mouvements concertés ou irréfléchis qui caractérisent son activité, et suivre à travers les couches du texte le développement d’une conscience critique qui se laisse ou non déborder par le bouillonnement des fantaisies visuelles.
Le parcours dans les Essais et le Journal de Voyage que nous proposons ne s’appuie pas d’emblée sur un relevé lexical : les occurrences de termes ayant trait à un usage plus ou moins métaphorisé du regard sont 108trop nombreuses2 ; il s’agit plutôt de sélectionner « qualitativement » certains passages du texte qui rendent compte des facettes différentes de cette vue intérieure qui se déploie dans et par l’écriture – ou, plus précisément, qui rendent compte de la façon dont la pensée, lorsqu’elle s’identifie au travail du regard, réagit aux objets qui se présentent à son attention ou les construit. L’activité de ce régime visuel occasionne-t-elle des phénomènes textuels repérables ? Infléchit-elle le progrès d’un discours rompu aux usages de l’éloquence ? Ce surgissement du visible dans la prose sert-il un dessein argumentatif précis ? Accouche-t-il d’un sens « imprémédité et fortuit » que l’auteur pourrait ultérieurement reconnaître et énoncer ? Telles sont les questions qui nous préoccupent. Il ne s’agira pas de résoudre à tout prix les problèmes qu’elles soulèvent mais de faire surgir des zones de turbulence dans la pratique et la théorie de cette vision intérieure (qu’on l’appelle imagination ou fantaisie) lorsqu’elle est mise à l’écrit dans l’essai. Les outils de l’analyse littéraire ne permettent peut-être pas d’assigner un sens univoque à ces phénomènes que le discours ne peut circonscrire, car ce qui se joue dans ces processus textuels de maîtrise ou de déprise visuelle dépasse les préoccupations techniques des arts de la parole : la place que prend dans les Essais ce régime visuel témoigne nous semble-t-il d’un progressif basculement ontologique, qui nous conduit du « sujet » du discours ou de la peinture – son prétexte – vers une subjectivité qui trouve là les moyens de son expression, en des termes et des dispositifs picturaux.
Avant même d’étudier comment la prose déploie des effets d’ordre visuel, il faut rendre compte de la façon dont un auteur du xvie siècle conçoit le fonctionnement physiologique de son propre regard. Pour un aperçu des conceptions courantes, prenons les considérations que livre la fin du chapitre « De la force de l’imagination ». Le regard a en effet partie liée à la faculté imaginative puisqu’il constitue la source des impressions dont elle assure la compréhension. « L’ancienneté a tenu de certaines femmes en Scythie, qu’animées et courroucées contre quelqu’un, elles le tuaient du seul regard. Les tortues, et les autruches couvent leurs œufs de la seule vue : signe qu’ils y ont quelque vertu éjaculatrice » (I, 21, 109253). Suivent le rappel tout aussi topique des difformités congénitales produites chez les femmes enceintes par les « fantaisies » qu’induisent chez elle la contemplation d’images frappantes et l’extension aux animaux de ce mécanisme d’influence visuelle, puisqu’eux aussi sont susceptibles d’hypnotiser ou d’être hypnotisés par le regard. Ces exemples, dont la véracité n’est d’ailleurs pas prise en charge par Montaigne, qui renvoie ces histoires « sur la conscience de ceux » à qui il les emprunte, peuvent faire sourire aujourd’hui ; elles relèvent de ce que Carl Havelange a appelé un « ordre ancien du regard », fondé sur des théories médicales et optiques antiques et médiévales. L’un des débats majeurs qui traverse l’Antiquité et le Moyen Âge porte justement sur cette intromission ou extramission du regard – sa « vertu éjaculatrice ». Les exemples extraordinaires de Montaigne reposent sur une conception efficace du regard : pour schématiser, disons que les corps dégagent des « fluides visifs » d’une légèreté telle qu’ils peuvent traverser instantanément l’espace physique d’un point à un autre, transiter par l’œil du regardant et, en tant que fluide, agir sur sa fantaisie en se mêlant à son sang3 ; ce transit de puissance s’exerce dans les deux sens, l’œil pouvant être la source ou le réceptacle de cette force agissante qui associe profondément, dans un rapport quasi charnel, le regardant et le regardé4.
A priori, la pensée de Montaigne n’est pas fermée à de telles conceptions « anciennes » du regard : nous pouvons en déceler les traces dans certains passages des Essais, comme par exemple les trois récits qui inaugurent le premier chapitre du premier livre. Dans ces trois récits, les chefs de guerre, lorsqu’ils prennent la place forte qu’ils ont assiégée, au lieu de punir les habitants comme ils en avaient le dessein, se laissent fléchir par un spectacle de courage qui s’offre à leurs yeux. C’est à chaque fois un phénomène d’« amollissement » physiologique des cœurs qui se produit : le spectacle de bravoure des gentilshommes français « rebouche » 110la pointe de colère du prince de Galles ; celui du soldat prêt à se battre « arrête sus bout » la « furie » de Scanderberch ; enfin, le spectacle des femmes nobles de Weisberg portant leur famille sur le dos fait pleurer l’Empereur Conrad qui assiégeait la ville, et « amortit » l’aigreur qu’il avait contre leur maître. Entre la sensation visuelle et la volonté de celui qui l’éprouve, entre l’extériorité du spectacle et l’intériorité du spectateur une influence s’exerce, qui entraîne celui qui se laisse toucher à des comportements inattendus. Montaigne reprend, sans les discuter, les notations visuelles qu’il trouve chez Froissart, Jove et Bodin. Mais la multiplication d’exemples divergents, voire contraires5, au sein du même chapitre, conduit à nuancer l’idée selon laquelle le régime de la vue chez Montaigne relève d’un « ordre ancien ». Le modèle mécanique des « sympathies » oculaires, s’il n’est pas évacué totalement, est suffisamment mis à distance pour laisser du champ à une explication plus « psychologique » des comportements humains, qui suppose que les êtres affectés par ces spectacles sont des sujets singuliers, des « particuliers », différents les uns des autres, mus par des affects qui ne sont pas quantifiables – ce qui explique par ailleurs qu’il soit si « malaisé d’y fonder jugement constant et uniforme » (I, 1, 124). Le rôle du regard en est profondément modifié : il n’est plus le véhicule d’une puissance agissante qui fait ployer la volonté des hommes comme par magie mais la simple condition de perception d’un spectacle devant lequel le sujet a le pouvoir, le devoir même peut-être, de définir une position éthique6. 111Cette subtile modification implique une prise de recul du spectateur par rapport au spectacle qui l’affecte, elle suggère l’élaboration d’un espace critique, entre la sensation visuelle et la réaction qu’elle provoque, une « arrière-boutique » toute personnelle, d’où le spectacle est contemplé comme le serait une image, un reflet de la réalité, qui ne s’y substitue pas mais la représente – espace de l’imagination où justement, quelque chose comme un « sujet » peut s’élaborer par rapport à ces images qui lui sont soumises7. On passe d’une conception passive et abstraite d’une imagination que traversent et emportent des « fluides visifs » à une conception plus active de celle-ci et de ses opérations, par laquelle elle se dote d’une consistance propre, à la couture entre l’âme et le corps. Le regard s’infléchit au-dedans de l’individu et lui découvre l’espace de sa subjectivité8.
Le Journal est un texte particulièrement intéressant pour dégager la façon dont ce « régime visuel » opère chez l’auteur : au « registre de durée » des Essais se substitue un registre de choses vues, au jour le jour, en fonction d’étapes que les entrées du journal distinguent les unes des autres. C’est avant tout par le regard que l’énonciateur – secrétaire ou Montaigne, peu importe ici – a parcouru l’espace que déroulent les routes ou que les villes compartimentent autour de lui ; quant à son écriture, elle cherche à retranscrire le plus fidèlement possible l’ensemble des choses vues, dans l’ordre où elles se sont présentées, sans volonté expresse de les interpréter. Or, on peut en faire l’hypothèse, le caractère immédiat d’une écriture d’usage privé, qui n’est pas destinée à la 112publication, laisse transparaître comme au vif des habitudes de regard riches pour nous d’enseignements anthropologiques et psychologiques qui peuvent, dans un second temps, servir de modèle d’appréhension pour les objets abstraits dont traitent les Essais. Le parti-pris d’objectivité laisse transparaître chez le scripteur des structures mentales sous-jacentes, qui conditionnent la façon dont il rend compte d’expériences visuelles. Une garantie de cette objectivité, c’est l’expression d’une relativité assumée du regard : n’est inscrit sur la page que ce qui a été vu, les paysages et les scènes urbaines sont décrits depuis le seul point de vue dont le voyageur puisse témoigner9. Rares en effet sont les extrapolations visuelles, il n’y a guère de reconstructions globalisantes de lieux par la raison ou l’imagination10. La subjectivité assumée de la description est la condition de l’objectivité testimoniale11. Il est tentant de considérer que l’exclusion du journal de tout ce qui n’a pas fait l’objet d’une expérience de première main relève de l’influence culturelle d’un paradigme perspectif d’origine pictural, dont on sait l’importance qu’il assigne au point de vue assigné au spectateur. « En somme, le lieu réel est dans le Journal moins un objet de la vue, qu’un instrument optique, moins ce que l’on voit que ce qui nous sert à voir ; en vertu du caractère autoréférentiel de la perspective, le paysage montre et révèle la structure du regard qui le voit, il est un prospect comme dit le Journal12 ». Ce regard d’encre, ainsi amarré au corps, rend seulement compte de ce qui a été vu et l’organise en fonction d’habitudes visuelles que la peinture rend 113sensibles. Mais ce que le lecteur perd d’un côté (un sentiment par exemple de compréhension globale – quoique fictive – du monde décrit), il le gagne de l’autre : ce que nous découvrons de ce monde c’est ce qui a été jugé digne d’être noté, ce qui s’est hissé à la hauteur d’un intérêt personnel. Le paysage décrit, qu’il soit naturel ou urbain, révèle en filigrane, par les choix qui s’y lisent, les intérêts, les goûts et les désirs de celui qui y a promené son regard : comme l’écrit Olivier Guerrier, « le Journal se donne plutôt comme un foyer perceptif dense, où se logent des affects spontanés13 ». L’étude de l’image visuelle nous paraît donc un point de départ pertinent pour sonder les mécanismes (voire les stratégies) qui animent l’enquête subjective de soi sur soi.
D’après l’hypothèse que nous avons élaborée, le traitement des sensations visuelles par l’imagination est susceptible de dépendre des passions de l’âme, passions qui contribuent à brouiller l’ancienne transitivité qui liait intimement la chose regardée à la personne qui la regardait. Une « étrange passion » comme la peur affecte la perception visuelle, elle « engendre de terribles éblouissements », fait voir des créatures fantastiques, « tantôt les bisaïeux sortis du tombeau enveloppés en leur suaire, tantôt des Loups-garous, des Lutins, et des chimères » où il n’y a rien du tout ; ou bien elle métamorphose du tout au tout les objets perçus, changeant par exemple « un troupeau de brebis en escadron de corselets » ou « des roseaux et des cannes en gens d’armes et lanciers » (I, 18, 211), provoquant une série de comportements déraisonnables que le chapitre énumère et qui culminent, dans un ajout de l’EB, sur les « terreurs Paniques ». Ce qui induit en erreur, c’est la déformation « pathologique » de l’image mentale, et la croyance individuelle ou collective qui s’y attache. La vue et ses dérèglements sont le signe d’un dérèglement plus profond des passions et des humeurs. Ces inquiétantes métamorphoses ne sont pas sans rappeler les « chimères et monstres fantasques » engendrés par l’esprit de Montaigne au chapitre « De l’oisiveté » (I, 8, 154) ; si, dans ce dernier cas, elles ne sont pas induites par la peur, elles conservent l’aspect visuel qui caractérise les productions de l’imagination ; elles sont l’indice inquiétant d’un dérèglement de l’esprit qui ne parvient 114pas, pour des raisons inconnues, à « s’entretenir soi-même, s’arrêter et rasseoir en soi ». L’opération de l’auteur consistera justement à consigner ces symptômes qu’il désigne, faute de mieux, par le nom de créatures au caractère très visuel, pour mieux en saisir le caractère fantastique, et détacher – par un sentiment rétroactif de « honte » – sa crédulité de leur prolifération débilitante.
L’imagination – c’est en tout cas l’espoir qu’exprime ce chapitre – peut faire l’objet d’une relative maîtrise, qui soulagerait le patient des angoisses provoquées ou révélées par ces visions. L’écriture se fixe pour but de les saisir sinon pour en exorciser la charge émotionnelle, du moins pour se familiariser avec leur emprise et s’exercer à n’y voir, justement, que des images. Les Essais fantasment ainsi à plusieurs reprises la scène d’agonie, « l’acte à un seul personnage » (III, 9, 282) où trouve à s’exercer un « savoir-mourir » (III, 12, 384). Le caractère macabre de cette préoccupation correspond à un goût personnel de l’auteur : « il n’est rien de quoi je m’informe plus volontiers, que de la mort des hommes : quelle parole, quel visage, quelle contenance ils y ont eu, ni endroit des histoires, que je remarque si attentivement14 » – un goût qui, il le constate des années après dans un ajout de l’EB, se donne à lire dans son œuvre : « il y paraît à la farcissure de mes exemples : et que j’ai en particulière affection cette matière. Si j’étais faiseur de livres, je ferais un registre commenté, des morts diverses » (I, 20, 232). La fin du chapitre « Que philosopher c’est apprendre à mourir » distingue l’agonie telle qu’elle est vécue « parmi les gens de village et de basse condition » et telle qu’elle s’éprouve dans les autres milieux sociaux, plus élevés.
Une toute nouvelle forme de vivre : les cris des mères, des femmes et des enfants : la visitation de personnes étonnées, et transies : l’assistance d’un nombre de valets pâles et éplorés : une chambre sans jour : des cierges allumés : notre chevet assiégé de médecins et de prêcheurs : somme tout horreur et tout effroi autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterrés (I, 20, 240-241A).
L’approche de la mort impressionne d’autant plus qu’elle se pare d’atours funéraires élaborés : le mourant aura donc soin d’ôter le masque des apparences funèbres qu’on agite autour de lui pour « passer sans peur », 115comme le font valets et simples chambrières. L’image du masque, faux visage qui recouvre ici « le visage de la mort », ancre le travail de déprise philosophique dans une ontologie du faux-semblant qui trouve des termes visuels pour se dire. Mais plus encore, les indications sensibles et surtout visuelles qui dressent la scène d’agonie en tant que telle (« Une toute nouvelle forme de vie … ensevelis et enterrés ») – notations simplement juxtaposées les unes aux autres, sans logique décelable ni constructions rythmiques ou sonores flagrantes, comme s’il s’agissait de coups d’œil désordonnés de part et d’autre –, ces indications construisent l’équivalent verbal d’un tableau, d’une scène de genre, où la lumière des cierges éclaire ces visages éplorés ou chafouins de familiers et d’anonymes qui peuplent l’ombre de la chambre mortuaire. Le passage peut être décrit comme une hypotypose, figure macro-structurelle du discours, qui consiste à représenter verbalement un objet pour donner l’impression à l’auditeur ou au lecteur qu’elle est « placée sous ses yeux » – toutes les définitions de la figure, de Cicéron à Dupriez, en passant par Quintilien et Fontanier, insistent sur la qualité visuelle de la sensation intellectuelle visée. En d’autres termes, l’hypotypose désigne la description détaillée d’une action et les circonstances dans lesquelles elle prend place, sans toutefois prétendre à une exhaustivité descriptive qui relèverait d’un programme concerté – elle privilégie plutôt les notations incidentes, rapides, comme sur le vif15. Dans la section du texte que nous considérons, l’absence de verbes conjugués, les brisures de la ponctuation, la non-continuité thématique des propositions produisent un effet d’asyndète qui correspond à cette notion d’hypotypose. Ces procédés, qui concernent l’appréhension générale du texte, touchent au versant de l’elocutio qui jouxte la dispositio ; ils sont redoublés chez les orateurs par l’utilisation d’autres procédés, inséparables quant à eux de l’actio, destinés à donner l’impression aux auditeurs d’être inclus dans la situation décrite dans et par l’énonciation : ici, en particulier, un usage mobile de la première personne du pluriel, qui bascule insensiblement d’une position argumentative stable, typique d’un discours d’exhortation (« ce sont ces mines et appareils effroyables, de quoi nous l’entournons, qui nous font plus 116de peur qu’elle » : l’usage de la première personne du pluriel englobe dans une même temporalité l’énonciateur et ceux à qui il adresse son discours), à une autre position qui, si elle participe peut-être d’un programme argumentatif plus étendu, cesse d’être d’abord explicitement argumentative pour n’être plus qu’une fiction de l’imagination (« notre chevet… autour de nous » : détachées de la situation d’énonciation par l’absence de verbe conjugué, les marques de première personne du pluriel perdent de leur cohérence, leur pluralité se scinde en une infinité de singularités, chacun est renvoyé à son propre destin mortel, à sa propre agonie vécue de façon solitaire). Si l’on considère la fonction rhétorique de l’hypotypose, on pourra rattacher le décrochage énonciatif qu’elle opère au mouvement plus général d’une argumentation. Il suffira de dire que ce passage si singulier donne force et éclat au discours en ce qu’il suscite dans l’esprit des auditeurs des « apparitions » mentales qui contribuent à rendre les esprits captifs et assurent le pouvoir de l’orateur. Reste à se demander si cette configuration oratoire est véritablement la plus pertinente pour adresser la singularité du texte.
La focalisation particulière que nous venons de décrire, qui confie à une première personne du pluriel la prise en charge d’indications visuelles d’un naturalisme frappant, assigne au lecteur la position du mourant qui, lui-même, n’est plus que le spectateur d’une agitation qui se déploie autour de son lit : double spectacle en quelque sorte, puisque le dispositif « littéraire » redouble le dispositif mortuaire évoqué, en donnant à un sujet particulier, lecteur ou mourant, une place spécifique. Mais la gravité du sujet et l’angoisse qu’elle soulève incite à voir dans ce dispositif autre chose qu’une stratégie rhétorique ou une mise en abyme virtuose : dans les deux cas on oublie la spécificité des motivations qui président à l’élaboration des Essais et le rôle que joue l’écriture dans la vie psychique de l’auteur. Il faut notamment garder en mémoire la place qu’occupe ce petit tableau, et ce dès l’édition de 1580 : il est placé à la suite d’une longue prosopopée, véritable tour de force rhétorique, qui prête sa voix à une Nature personnifiée chargée de convaincre les humains d’accepter leur condition mortelle16. Après avoir 117remarqué que, dans la plus pure tradition rhétorique, cette prosopopée aurait fort bien pu, en tant que péroraison, clore le chapitre, Olivier Guerrier montre que l’appendice introduit par la conjonction adversative « or » est le lieu d’une confrontation entre les enseignements tirés de la prosopopée et le cérémonial mortuaire tel qu’il a pu être vu, en tant que spectateur, par l’auteur. L’effet de la fiction du discours de Nature est de dissiper les leurres d’une imagination aux prises avec des angoisses macabres : paradoxalement, « il aura fallu passer par les ressources de l’imaginaire littéraire pour corriger les dérives de l’imagination » : « face à cela reste l’évènement dans sa neutralité, brut et banal une fois arraché son masque déplorable17 ». Lorsque les chimères de l’imagination anxieuse ont été dissipées par le discours de la fiction, ne reste plus que l’image nue de l’agonie réelle, celle-là même que Montaigne se plaît à entendre décrire et imaginer. La figure de l’hypotypose, par-delà la description qu’elle permet de faire des phénomènes textuels que nous avons rencontrés, implique une mise en œuvre stratégique de procédés persuasifs. Mais dans quelle mesure la « neutralité », la « brutalité » et la « banalité » de la scène démystifiée de l’agonie peuvent-elles être rattachées à une stratégie « littéraire » ? Il nous semble que la puissance proprement visuelle de cette scène contraste trop radicalement avec la volubilité fictionnelle du discours de Nature pour relever d’un même régime expressif. La rhétorique apprivoise l’image et la dresse à suivre des motivations qui lui sont extérieures et qui, de plus, visent à une efficacité elle-même extérieure au discours ; l’image de l’agonie, elle, ne se laisse pas si aisément domestiquer, elle marque à chaque fois qu’elle est réactualisée la résurgence d’une obsession intime, que toute l’éloquence du monde – en l’occurrence l’éloquence d’une Nature qui emprunte sa verve aux auteurs favoris de Montaigne – ne parvient pas à apaiser : ce n’est pas dans l’extériorité du discours déployé par les arts de la parole qu’il faut chercher à interpréter ces « visions » mais dans le repli d’un discours que l’auteur « couche » sur lui-même ou mieux, en lui-même, pour reprendre la fameuse expression qu’il emploie dans « De l’exercitation » (II, 6, 76).
La scène de l’agonie est à nouveau évoquée dans « De la vanité », cette fois du point de vue explicite d’un spectateur extérieur qui assiste 118à la « presse » qui entoure le mourant. Montaigne remarque avec une ironie amère :
J’ai vu plusieurs, mourants bien piteusement, assiégés de tout ce train : Cette presse les étouffe. C’est contre le devoir, et est témoignage de peu d’affection, et de peu de soin, de vous laisser mourir en repos : L’un tourmente vos yeux, l’autre vos oreilles, l’autre la bouche : il n’y a ni sens, ni membre, qu’on ne vous fracasse (III, 9, 281).
Les gestes des assistants sont saisis de l’extérieur par ces petits croquis de prose, qui prélèvent les traits les plus saillants du spectacle de l’agonie ; le malheureux patient des soins importuns est désigné par « vous », personne de l’interlocution, plaçant ici encore le lecteur dans la position virtuelle du moribond. Par contraste avec le magistral tableau des paysans malades de la peste dans le chapitre « De la physionomie », où la distance entre le regardant et le regardé reste infranchissable (« Voyez ceux-ci » intime le texte, qui déplore l’impossibilité à être comme eux), les vignettes de la mort nobiliaire – celle-là même que peut s’attendre à connaître, sauf accident soudain18, l’auteur et son lecteur putatif – mettent en scène un évènement d’une importance capitale, qu’on le considère comme le « but » ou le « bout » de la vie. Dans les micro-récits qu’en donne Montaigne, l’évènement peut se regarder à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, comme spectateur ou comme patient : la qualité visuelle des évocations est le gage d’une transition instantanée d’une position à une autre. L’écriture – et la lecture – des Essais s’apparentent alors à un exercice de projection fantasmatique qui permet de faire l’essai des ressorts de sa propre personne par le détour de la fiction. Double mise en perspective donc, tant visuelle que morale : les virtuosités perspectivistes des peintres italiens rejoignent ici la pratique projective des exercices spirituels. D’un côté, la perspective picturale, telle qu’elle peut être pratiquée par un Mantegna19 ou un Parmigiano20 par exemple, qui permet de représenter non tant un spectacle à regarder que le spectacle d’un regard qui 119s’incarne dans la toile, en intensifiant pour le spectateur l’impression de participer à la scène par l’emploi de raccourcis perspectifs hardis, et en y encodant les déformations propres à la vue naturelle (une manière, comme dans le cas particulier et extrême de l’anamorphose, de problématiser la position du spectateur). De l’autre, une projection morale, puisque nous sommes, en tant que lecteurs, instamment invités à faire l’expérience mentale d’une telle scène pour nous entraîner, à l’avance, à ne voir, sous ces apparences lugubres, qu’un spectacle qui ne nous concernera plus. Ce type de projection est selon Olivier Pot un trait distinctif de l’écriture à la première personne à la Renaissance, qui n’est « ni une remémoration du passé ni même un reflet du présent vécu par le moi, mais (…) tout entière une expérimentation de scénarios ou de stratégies diverses tendus vers le futur, focalisés par le projet ou la projection existentielle du moi empirique que détermine le souci de soi21 ». Cette projection existentielle prend chez Montaigne la forme de « visions » qui, lorsqu’elles sont mises en rôle, conservent sous leur forme verbale les caractéristiques de leur nature visuelle, qui se lisent dans le lexique employé et la disposition en tableau des éléments les plus frappants. Ainsi pourrions-nous dire que Montaigne détourne les procédés de l’hypotypose de leur usage strictement rhétorique puisqu’il s’agit moins pour lui de déployer une éloquence qui chercherait à persuader son lecteur d’une thèse donnée (« n’ayez pas peur de la mort puisque ce n’est qu’un spectacle ») que de trouver un sens qui satisfasse et apaise son esprit soumis à l’irruption de pensées inquiétantes et déstabilisantes (« puisqu’elle n’est qu’un spectacle, pourquoi la mort me préoccupe-t-elle tant ? »). Ces tentatives ne sont jamais certaines d’aboutir et ce qu’elles acquièrent, une pacification intérieure momentanée, est toujours susceptible d’être renversé par des affects extérieurs à la sphère de l’écriture ; mais en passant ainsi au crible les productions de l’imagination, elles affutent la conscience de soi et cultivent des forces morales qui peuvent, le cas échéant, servir à parer les paniques de l’imaginaire. Elles sont l’équivalent imaginaire de ces exhibitions macabres de cadavres (« anatomies sèches ») que les anciens Égyptiens pratiquaient lors de leurs banquets – une pratique qui marque suffisamment Montaigne pour qu’il la mentionne par deux 120fois, dans le même chapitre, sur deux strates différentes du texte22. Elles relèvent surtout des « exercices spirituels » des sagesses antiques que Pierre Hadot a étudiés, comme de ce que Michel Foucault décrit sous le nom de « méditations » :
Dans la méditation, le sujet est sans cesse altéré par son propre mouvement ; son discours suscite des effets à l’intérieur desquels il est pris ; il l’expose à des risques, le fait passer par des épreuves ou des tentations, produit en lui des états, et lui confère un statut ou une qualification dont il n’était point détenteur au moment initial. Bref, la méditation implique un sujet mobile et modifiable par l’effet même des événements discursifs qui se produisent23.
Les spectacles visuels que nous avons repérés et désignés sous le nom d’« hypotyposes » nous semblent participer à ce mouvement méditatif d’un sujet « mobile et modifiable » : ils sont ces « effets » suscités par le discours qui altèrent celui qui les produit au fur et à mesure qu’il épouse les contours des figures qu’il rencontre. La vertu thérapeutique de l’exercice, la promesse d’une transformation bénéfique, passe par cet usage libre d’un regard intérieur qui s’attache à des représentations mentales pour se familiariser avec la réalité qu’elles désignent24.
Chez Montaigne, ces « projections existentielles » ne sont pas toujours orientées vers l’irréel d’un futur espéré ou craint ; l’auteur, entraîné par sa fantaisie, peut tout aussi bien se laisser happer par des épisodes 121de l’histoire antique ou moderne, qui apparaissent alors sous forme d’anecdotes dans la prose. Ces récits historiques sont sélectionnés en fonction du programme qu’instaure le titre de chaque chapitre (sélection verticale, opérée selon une logique de composition raisonnée, qui accroît la cohérence thématique du chapitre) ou par association d’idées (sélection horizontale, qui relève d’un vagabondage de l’imaginaire et peut contribuer à diluer l’unité globale du chapitre). Or, certains de ces récits sont particulièrement ramassés, et leur intérêt ne réside pas tant dans l’enchaînement d’une succession de faits que dans une scène en particulier, détachée de son contexte historique et politique, où quelque chose de particulièrement frappant se donne à voir. Nous voudrions à présent montrer à partir de deux exemples précis que ce phénomène textuel tire son efficacité de la représentation plastique et picturale et que cette puissance visuelle des vignettes historiques peut aller jusqu’à dérouter le cours argumenté d’une prose d’idées.
Prenons pour premier exemple le récit de la mort de Caton, qui clôt « De juger de la mort d’autrui ». Le chapitre énumère un certain nombre de morts fameuses avec l’idée, selon la notice établie par A. Tarrête, « d’utiliser la mort d’autrui comme un miroir, une approximation possible de la mort propre25 ». Nous retrouverions ainsi cette même démarche « projective » que nous avons dégagée de l’étude des récits d’agonie. L’exemple final, à la fois dans l’ordre du chapitre et dans le degré de vertu qu’il illustre, s’énonce parallèlement à une réflexion explicite sur la puissance évocatoire de sa représentation plastique :
Voilà des morts étudiées et digérées [à propos des récits présentés dans le chapitre]. Mais afin que le seul Caton pût fournir à tout exemple de vertu, il semble que son bon destin lui fit avoir mal en la main, de quoi il se donna le coup : pour qu’il eût loisir d’affronter la mort et de la colleter, renforçant le courage au danger, au lieu de l’amollir. Et si c’eût été à moi, à le représenter en sa plus superbe assiette, c’eût été déchirant tout ensanglanté ses entrailles, plutôt que l’épée au poing, comme firent les statuaires de son temps. Car ce second meurtre fut bien plus furieux, que le premier (II, 13, 408).
Le récit que donne Montaigne de cette mort extraordinaire, tiré à la fois du De Providentia de Sénèque et des Vies Parallèles de Plutarque, opère une synthèse remarquable de ces deux sources principales. Le récit de 122Plutarque dans la traduction d’Amyot26 est sobre et factuel, il décrit les deux étapes du suicide sans pour autant témoigner d’une quelconque préférence pour l’une ou pour l’autre ; la seconde fait d’ailleurs l’objet d’un développement moins conséquent que la première, et n’en constitue pour ainsi dire que l’appendice. Chez Sénèque27 la gradation méliorative est très clairement marquée, l’accent est mis sur le second geste suicidaire de Caton, qui plonge sa main dans ses entrailles. Les dieux du De Providentia sont évacués du texte des Essais, mais la place qu’ils occupaient demeure, c’est-à-dire celle de spectateurs et de juges, devant une scène où se joue l’acte vertueux. Si en effet le suicide de Caton est exemplaire, ce ne sont pas les raisons qui l’ont poussé à se tuer, ou son 123comportement durant les heures qui précèdent qui importent28, mais son caractère éminemment spectaculaire. C’est cela qui est mis en avant dans le récit de Sénèque, qui cherche à convaincre Lucilius que ce que nous prenons pour des maux sont en réalité des occasions pour les hommes de prouver leur valeur morale. On trouve chez Plutarque la mention de la statue de Caton réalisée après sa mort29, mais elle n’est plus chez Montaigne qu’un témoignage plastique possible de l’évènement dans une sorte de concours macabre destiné à produire l’image la plus impressionnante, non plus pour les dieux mais pour les hommes. Il faut se demander ce qu’apporte cette irruption du visuel, explicitement désigné comme tel, au mouvement général du chapitre. Remplit-il une fonction didactique comme chez Sénèque, ou bien purement testimoniale, comme chez Plutarque ?
Si effectivement les morts énumérées et commentées dans le chapitre ne sont pas du même acabit que cette dernière, superlative, c’est qu’elles sont « étudiées et digérées » (II, 13, 407). Le « mais » adversatif qui introduit le dernier récit marque un seuil que tout ce qui a été mentionné avant ne peut prétendre dépasser : il ouvre en fin de chapitre le domaine d’une inattingible exemplarité, qui ne se laisse plus ni « étudier » ni « digérer », ni par le commun des mortels, si sage soit-il, en train de faire l’expérience de la mort, ni par celui qui, par le biais d’une projection fantasmatique, cherche à se représenter cette expérience par la réflexion verbale. Rien ne peut familiariser avec une telle mort, elle constitue un au-delà de cette pensée « enquérante » que l’essai incarne. Cette altérité redoutable et fascinante se cristallise en une image si frappante qu’elle ôte à la réflexion toute possibilité de se poursuivre : les exemples supplémentaires ajoutés dans l’édition de 1588 et sur l’EB seront déportés en amont du chapitre. En ce sens, l’image n’apporte rien de plus au chapitre, elle le clôt, l’achève, elle en désigne la limite.
Le second exemple que nous voudrions analyser au prisme de cette rencontre entre visible et dicible est récit de la mort des Ignatius à la fin de « La fortune se rencontre souvent au train de la raison » (I, 34, 420-1 B). Spectacle effroyable, placé exprès à la fin du chapitre en 1588 (et 124maintenu ainsi sur l’EB, puisqu’un long récit est interpolé juste avant), qui constitue une réécriture d’un passage des Guerres Civiles d’Appien. L’étude des sources révèle que l’épisode s’est étoffé au fil du temps : tenant en deux phrases brèves et factuelles dans le texte d’Appien30, il s’allonge et se charge d’une tonalité pathétique nouvelle dans la traduction de Claude de Seyssel, publiée de façon posthume en 1544, et qui est vraisemblablement la source sur laquelle Montaigne s’appuie31. La version des Essais surenchérit encore sur cette dernière : le cours du récit est à nouveau étiré et intercalé de précisions supplémentaires qui rehaussent la qualité visuelle de la scène et sa puissance pathétique. Certes, le lien avec ce qui précède est clairement marqué d’un point de vue rhétorique (la charnière « pour la fin » est très singulièrement soulignée), mais aussi grammatical et logique : la référence à la fortune, au centre du chapitre, est réactualisée par l’usage anaphorique du déterminant possessif « sa faveur », qui renvoie au terme « fortune » en position thématique dans la dernière phrase de la couche A, et l’auteur a pris soin de placer le terme-clef en même position logique dans l’ajout interpolé de l’EB. Mais à y regarder de plus près, la puissance visuelle de la scène, sans commune mesure avec les autres récits dont se compose le chapitre, fait sortir celui-ci de ses gonds. La force pathétique que dégage cette image du double suicide nous semble secondaire par rapport à la puissance de fascination qu’elle exerce sur l’auteur : le pathos est un effet collatéral de cette irruption du visible dans le progrès de l’écriture. La violence physique et symbolique que représente l’image, ou plutôt, qui émane d’elle, nous semble plutôt rendre caduque l’armature argumentative dans laquelle elle est insérée : sans aller jusqu’à affirmer qu’elle soit ironique, l’interronégative « se découvre-il pas une bien expresse application de sa faveur, de bonté et piété singulière » nous semble quelque peu discordante au regard de l’exemple qu’elle introduit, qui déborde soudain 125toutes les attentes ménagées par ce qui précède. Cette « singularité » de l’anecdote est en effet si monstrueuse qu’elle dépasse toute tentative de la faire entrer dans une série probante. La vision macabre des deux corps agonisants, baignés d’un même sang et noués l’un à l’autre dans une étreinte troublante (n’est-elle pas en même temps incestueuse et cannibale ?) est véritablement envoûtante : le « noble nœud », mi père, mi fils, est, au sens propre comme au figuré, une chimère. Sous l’effet de cette fascination, l’image – dont on ne voit plus guère comment elle peut encore illustrer quelque leçon sur la fortune que ce soit – se dégage de son statut d’exemple et prend une autonomie singulière. Il nous semble que l’image s’émancipe du rôle qui lui était assigné par la tradition rhétorique sous la forme d’images mnémotechniques (imagines agentes) : si la Rhétorique à Herennius conseille à l’orateur d’employer des images frappantes pour aider à imprimer un discours dans la mémoire, il demeure que l’image reste subordonnée au discours qu’elle est censée rappeler, comme un index rerum ou nominum. Le modèle rhétorique, pour assurer sa puissance et son efficacité, doit maintenir cette hiérarchie au profit du logos. Or il semble, dans le cas précis que nous analysons, que l’image a acquis une puissance de fascination telle qu’elle ne puisse plus servir d’aide-mémoire : elle coupe court aux discours qui précédaient, déforme la leçon qui s’y élaborait, déploie une fiction qui ne vaut plus que pour le sentiment d’étrangeté et d’horreur qu’elle produit32. L’amplification quantitative et qualitative du récit fait mesurer la puissance inspirante de cette vision intérieure qui a présidé à sa traduction verbale, somme toute secondaire.
Ce n’est sans doute pas par hasard qu’une telle puissance visuelle se dégage de ce récit. La représentation picturale des massacres perpétrés par les Triumvirs fait l’objet d’une véritable mode dans les années 1550-156033. On compte plus d’une vingtaine de tableaux et plusieurs gravures qui reprennent le sujet et les grands traits « conventionnels » de sa mise 126en scène : une disposition éclatée de petits groupes humains mêlant bourreaux et victimes dans un décor urbain, qui produit l’impression d’une multitude de mouvements désordonnés, éparpillés en perspective jusque dans les profondeurs d’un horizon barré d’édifices. En 1561 on apporte trois grands de ces tableaux à la cour de Charles IX34. C’est l’époque à laquelle Montaigne fréquente la cour : Géralde Nakam, qui aborde la question par son versant historique et politique se demande d’ailleurs s’il a pu voir ces toiles au Louvre ou à Fontainebleau35. Toutes les versions reprennent les mêmes anecdotes macabres tirées des Guerres Civiles d’Appien, qu’elles redistribuent savamment sur le plan perspectif pour produire l’impression d’un désordre : l’œil du spectateur passe d’un groupe à l’autre, de supplice en supplice, et finit invariablement par tomber sur ces deux corps enlacés, décapités, plus ou moins sanguinolents selon les œuvres où elles figurent36. La scène constitue ainsi un sous-élément topique de la peinture d’histoire et, en tant que tel, une représentation visuelle relativement stable, aisément reconnaissable et disponible dans l’imaginaire individuel et collectif. Par le travail des peintres et des graveurs et leur large diffusion, ce moment précis de l’histoire romaine acquiert une dimension visuelle dont on a montré comment elle pouvait faire l’objet d’une exploitation politique37. Mais si Montaigne choisit de traiter ce sujet et d’en faire la conclusion d’un chapitre sur la fortune, ce n’est sans doute pas pour sa dimension polémique : l’allusion au Triumvirat, si elle est d’actualité en 156138, ne l’est plus en 1588, au moment où l’ajout est publié dans les Essais. Tout 127au plus, pourrait-on y voir une allusion désolée et non-partisane aux guerres civiles qui ravagent le pays. Il ne reprend pas non plus l’ensemble du dispositif globalisant de la représentation, qui rassemble dans la simultanéité d’un espace urbain unifié par la perspective des évènements distincts les uns des autres, procédé qui permettrait de déployer une vision surplombante, éminemment politique, des troubles qui agitent la place publique. Au contraire, il se focalise sur un seul élément des massacres, un crime particulier, détaché de la trame historique qui pourrait en assurer une compréhension politique, qui ne vaut plus que par la seule intensité de la violence qu’elle fait surgir. Le recours à une anecdote chargée d’une si grande puissance visuelle, amplifiée selon des modèles fournis par l’art pictural fonctionne dès lors comme un seuil de non-retour, qui court-circuite en bout de course toute la construction argumentative que le chapitre avait ébauchée.
Cette étude n’a fait qu’effleurer quelques-uns des lieux où se révélait, sous des formes variées mais avec une insistante obstination, cette tension singulière entre ce que la prose des Essais donne à lire et les images visuelles qui la hantent, cette fluctuation constante et irrésolue entre ce qui relève d’une part de la lisibilité du texte, en assure la clarté et l’intelligibilité, et d’autre part une visibilité plus inquiétante, instable et incertaine, qui s’infiltre sourdement dans le déploiement verbal de la prose d’idées, la teinte et la déforme. Ces fêlures dans la patine du discours traversent l’ensemble de l’ouvrage au point, nous semble-t-il, de constituer un élément essentiel de la productivité textuelle de l’entreprise montaignienne. Le Journal a quant à lui sa propre façon d’articuler cette tension puisque l’écriture y est, par principe, entièrement au service d’une description de choses vues, extérieures à l’esprit du scripteur, fraîchement tirées de la mémoire et déposées sur le papier jour après jour. Pour ce qui est des Essais, nous voudrions suggérer qu’un tel agencement du lisible et du visible, effectif dès les premières phases d’élaboration du texte et encore à l’œuvre dans les campagnes de relecture et d’écriture sur l’EB, dégage une force qui inspire, soutient et relance le discours tout en constituant, en même temps (ou mieux, à l’improviste, par rencontre), une puissance de déformation qui affecte l’intégrité des modèles traditionnels de la production discursive. C’est là, nous semble-t-il, une façon de prendre au sérieux les déclarations de l’auteur concernant sa 128« peinture » que de faire de celle-ci un facteur capable de déstabiliser l’ordonnancement du texte et de générer des configurations textuelles inédites. Nous faisons l’hypothèse que la composition troublée des Essais, qui oscille semble-t-il dès l’origine entre une volonté expresse de bâtir un édifice discursif – forteresse, mausolée ou même haras – et un désir non moins pressant d’échapper aux limites qu’implique une telle édification, cette oscillation fondamentale qui fait le charme et la difficulté de l’interprétation des chapitres du livre n’est pas étrangère à ce trouble qui résulte du brouillage des rôles communément assignés par les pratiques de l’éloquence aux régimes du lisible et du visible. Pour donner du poids à cette hypothèse de travail, nous serons amenés à croiser voire à confronter l’interprétation rhétorique des choix stylistiques de l’auteur avec des considérations plus phénoménologiques et, osons le mot, existentielles. La question de la puissance visuelle de la représentation picturale ne peut être dissociée d’une réflexion approfondie sur le rôle qu’elle joue dans la cohérence thématique, structurelle et idéologique de l’œuvre, et doit inciter à réfléchir au sens que l’auteur lui-même lui assigne dans sa quête, thérapeutique, philosophique, et peut-être même « littéraire », de cohésion intime. L’appréhension complexe du visible par l’écriture dans l’essai participe pleinement au processus de subjectivation auctoriale à l’œuvre dans et par les Essais. Cette approche doit permettre d’élaborer une grille d’interprétation permettant d’éclairer, par un « lustre inusité », des passages de l’œuvre ayant déjà fait l’objet de nombreux commentaires.
Luc Sautin
Université Toulouse Jean Jaurès
Il Laboratorio (EA 4590)
1 Nous citons le texte des Essais de Montaigne dans l’édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya et Alexandre Tarrête, Paris, Gallimard, 2009.
2 Il y a environ 200 occurrences du verbe « regarder » et environ 700 du verbe « voir » (Alice E. Leake, David B. Leake, Roy E. Leake, Concordance des Essais de Montaigne, Genève, Droz, 1981).
3 Voir Havelange, De l’œil et du monde : une histoire du regard au seuil de la modernité, Paris, Fayard, 1998, chapitre 1. Voir aussi Philippe Hamou, Voir et connaître à l’âge classique. Stuart Clark évoque la ruine d’un modèle « représentationnel » de la vision qui coïncide avec l’époque prémoderne (S. Clark, Vanities of the Eye, Oxford, OUP, 2007, p. 20).
4 Le récit biographique au début de ce même chapitre est de ce point de vue éclairant : le jeune Montaigne est incité à fréquenter un vieillard malade pour que ce dernier puisse aspirer par les yeux et la pensée une partie de sa jeunesse. La construction plaisante du récit – avec un effet de suspension qui révèle à la dernière phrase la conséquence néfaste du traitement pour le jeune homme – n’est accompagnée d’aucune remise en question, explicite ou implicite, du bien-fondé d’un tel traitement (I, 21, 242-243).
5 Le chapitre se clôt en 1580 (I, 1, 124-125) sur le récit de la liquidation du siège de Gaza par Alexandre qui, « le plus hardi des hommes, et si gracieux aux vaincus » reste néanmoins insensible devant la bravoure du commandant de la place qu’il fait torturer cruellement ; un second récit, ajouté sur l’EB, renchérit sur cette insensibilité inexplicable du Macédonien (des hypothèses sont proposées, mais aucune n’emporte l’assentiment de l’essayiste).
6 C’est sans doute dans cette perspective qu’il faudrait étudier en détail la fameuse description des arènes de Rome qui se trouve au cœur du chapitre « Des coches » (III, 6, 177-179). Les arènes sont en effet une formidable machine à produire du spectacle, séparées qu’elles sont d’un monde extérieur dont elles mettent en scène, sur le mode fantaisiste d’une prolifération réglée, les monstres et les merveilles. Le texte de Montaigne, qui s’appuie principalement sur un ouvrage illustré de Juste Lipse, le De Amphitheatro Liber (dont il nous semble que les gravures représentant des plans de coupe architecturaux peuvent avoir joué un rôle non négligeable sur les descriptions des mises en scènes), révèle une compréhension très fine du pouvoir de ces spectacles sur les personnes qui y assistent, surtout si l’on rapproche ce texte des remarques dans le chapitre « Des mauvais moyens employés à bonne fin » (II, 23, 512) qui soulignent, non sans une certaine amertume, la vertu édifiante de ces spectacles violents. Le contraste dans « Des coches » entre ces représentations fictives de la violence et la violence réelle des conquêtes espagnoles en Amérique mériterait une étude fine des ressources visuelles engagées dans une prose à visée polémique ; la question de la vue, qu’elle soit physiologique ou philosophique, est en effet au cœur du chapitre.
7 Voir le très riche chapitre d’Olivier Pot consacré à cette question à la Renaissance : « De l’aliénation topique à la topique du sujet », in Émergence du sujet. De l’Amant vert au Misanthrope, Genève, Droz, 2005.
8 Il faudrait ainsi étudier la façon dont le regard est étendu (de façon tout à fait topique) au sens d’une lucidité morale qui permet de voir dans les cœurs (pensons au mythe de Momus tel que Lucien le raconte dans Hermotimus et que La Boétie le rappelle dans le Discours de la servitude volontaire : ce personnage de bouffon à la cour de l’Olympe regrette que les hommes n’aient pas été dotés d’une petite fenêtre dans leur poitrine qui permette de voir leurs pensées secrètes). Ce type de regard, attribut du sage ou du roi, participe à la construction idéale d’une société de transparence morale, en ce qu’elle permet de dépasser les masques d’un langage trompeur : le regard est alors assimilé à un crible, qui s’exerce et s’affine par l’écriture dans la privauté de la librairie.
9 Voir à ce propos l’article de Laura Willett, « Montaigne’s Italian Prospects », Montaigne Studies, no 15, 2003, qui relève combien les descriptions dans le Journal sont sensibles à la question des distances des objets par rapport à la position de l’observateur, aux effets de plongée ou de contre-plongée et, plus généralement, aux effets de perspective déroutants.
10 Quelques exceptions, sous la forme de généralisations d’un motif observé, sont néanmoins signalées par Olivier Pot dans « Lieux, espaces et géographie dans le Journal de voyage », Montaigne Studies, no 15, 2003, p. 79.
11 On pourrait rapprocher cette éthique de la description viatique de ce qu’André Tournon rappelle, dans un article sur « La poétique du témoignage dans Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné », (Réforme, Humanisme, Renaissance, 2019, no 89), à propos des conditions d’acceptabilité du témoignage en contexte judiciaire : « le tribunal soumet à sa délibération rationnelle et sanctionne par son jugement les phénomènes dont les témoins ont perçu et présenté les données sensibles » (p. 121). On rapprochera ces considérations de ce que Montaigne lui-même dit de la qualité variable des témoins dans « Des cannibales » (I, 31, 395-396). Ainsi, le Journal pourrait avoir eu pour fonction d’enregistrer des témoignages sensibles, avant tout visuels, pour servir ultérieurement de fondement pour des réflexions plus abstraites.
12 Olivier Pot, « Lieux, espaces et géographie dans le Journal de voyage », op. cit., p. 85.
13 Olivier Guerrier, « “Corps du lieu” : sur les paysages dans le Journal de voyage en Italie de Montaigne », Poésie et paysage, Volume d’hommage à Jean Nimis, Revue de l’Écrit, Il Laboratorio, Toulouse, 2020, no 18, p. 27-36.
14 Pensons aussi l’Extrait d’une lettre que Monsieur le Conseiller de Montaigne écrit à Monseigneur de Montaigne, son père, concernant quelques particularités qu’il remarqua en la maladie et mort de feu Monsieur de La Boétie.
15 Voir la thèse de doctorat d’Agnès Rees, soutenue devant l’Université de Reims le 12.12.2011, sous la direction de Jean Balsamo, La poétique de la vive représentation et ses origines italiennes à la Renaissance (1547-1560), p. 44, qui cite Quintilien : « minus est tamen totum dicere quam omnia » (« on dit moins en indiquant l’ensemble qu’en donnant les détails »).
16 Pour une analyse détaillée de cette prosopopée et de son ancrage dans le chapitre i, 20 ainsi que de celle (dite « de la gravelle ») qui se trouve au chapitre iii, 13, voir le chapitre de Blandine Perona, « Consentir à la prosopopée pour suivre Nature », in Prosopopée et persona à la Renaissance, Paris, Garnier, 2013, p. 247-300.
17 Olivier Guerrier, Quand les poètes feignent, Paris, Champion, 2002, p. 139.
18 Ce type de mort fait lui aussi l’objet d’un développement fantasmatique spécifique (voir par exemple les fantaisies macabres évoquées en III, 9, 271).
19 Mantegna, Andrea, Lamentation sur le Christ mort, vers 1480, 68x81 cm, Milan, Pinacothèque de Brera.
20 Le Parmesan, Autoportrait dans un miroir convexe, vers 1524, 24,4x 24,4 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.
21 Olivier Pot, « De l’aliénation topique à la topique du sujet », in Émergence du sujet. De l’Amant vert au Misanthrope, op. cit., p. 103.
22 I, 20, 228 (A) et 232 (C).
23 Michel Foucault, « Mon corps, ce papier, ce feu » inDits et Écrits (I), Paris, Gallimard, 2001, p. 1125.
24 Nous n’avons pas la place ici d’aborder le cas des récits biographiques clairement présentés en tant que tels, où la mise en ordre narrative agence des fragments mémoriels qui se présentent sous la forme de brèves descriptions sensitives, en particulier visuelles. Curieusement, un certain nombre de ces récits font d’un certain usage de la vue la justification centrale de leur inclusion au sein d’un chapitre : pensons par exemple aux deux récits à la fin du chapitre « De la physionomie », qui insistent sur les effets produits par l’air franc d’un visage, ou encore au célèbre récit de l’accident de cheval qui constitue le cœur du chapitre « De l’exercitation ». Ces souvenirs personnels, souvent marqués par une proximité avec la mort, sont constellés de notations visuelles : plus que d’un « effet de réel », il s’agit peut-être de la trace d’une prolifération désordonnée de fragments mémoriels qui peuvent, à certains endroits, prendre le pas sur le dessein strictement argumentatif du propos : comme nous l’avons étudié dans les exemples d’hypotyposes, le potentiel renversement en termes de subordination de l’exemple à l’argument ne va pas sans remettre en question une description rigoureusement logique du fonctionnement de l’essai.
25 Essais II, p. 759.
26 « Aussitôt que Butas eût le dos tourné il dégaina son épée, et s’en donna un coup au-dessous de l’estomac : toutefois pour l’inflammation qu’il avait à la main il ne put pas frapper si grand coup qu’il en trépassât soudainement : ains en tirant à la fin il tomba de dessus son lit et fit bruit en tombant, par ce qu’il renversa une table Géométrique qui était joignant son lit, tellement que ses serviteurs qui en ouïrent le bruit s’écrièrent incontinent : et aussitôt son fils et ses amis entrèrent en la chambre, là où ils le trouvèrent tout souillé de sang : et la plupart de ses boyaux sortant hors du corps, combien qu’il fût encore en vie et qu’il les regardât. Si furent tellement outrés de douleur, qu’ils ne surent de prime face que dire ni que faire : mais son médecin s’approchant voulut essayer de remettre les boyaux qui n’étaient point entamés et recoudre la plaie : amis quand il se fut un peu revenu d’évanouissement, il repoussa arrière le médecin, et déchirant ses boyaux avec ses propres mains ouvrit encore plus sa plaie, tant que sur l’heure il en rendit l’esprit », Plutarque, Les vies des hommes illustres, Paris, Michel de Vascosan, 1565, p. 549v.
27 Selon le texte édité et traduit par René Waltz : « Liquet mihi cum magno spectasse gaudio deos, dum ille vir, acerrimus sui vindex, alienae saluti consulit et instruit discedentium fugam, dum studia etiam nocte ultima tractat, dum gladium sacro pectori infigit, dum viscera spargit et illam sanctissimam animam indignamque quae ferro contaminaretur manu educit. Inde crediderim fuisse parum certum et efficax vulnus : non fuit diis immortalibus satis spectare Catonem semel ; retenta ac revocata virtus est, ut in difficiliore parte se ostenderet : non enim tam magno animo mors initur quam repetitur. Quidni libenter spectarent alumnum summ tam claro ac memorabili exitu evadentem ? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui timent laudant. » [Je ne doute pas que les dieux n’aient vu avec une joie profonde ce grand homme, si ardent à son propre supplice, s’occuper du salut des autres et tout organiser pour leur fuite, consacrer sa nuit suprême à l’étude, plonger l’épée dans sa sainte poitrine, puis répandre ses entrailles et délivrer de sa main cette âme auguste, qu’aurait déshonorée la souillure du fer. Voilà sans doute pourquoi le coup mal assuré manqua d’abord son effet : les dieux immortels ne se contentèrent pas d’avoir vu Caton paraître une fois dans l’arène ; ils y retinrent, ils y rappelèrent son courage, afin de le contempler dans une épreuve plus difficile encore : car il faut moins d’héroïsme pour aller à la mort que pour la chercher à nouveau. Comment n’eussent-ils pas pris plaisir à voir leur nourrisson opérer une si belle et si glorieuse sortie ? La mort est une apothéose, lorsqu’elle force l’admiration de ceux même qu’elle épouvante]. Sénèque, « De la providence », Dialogues (t. 4), Paris, Les Belles lettres, 2003, p. 14.
28 Ces informations sont présentes chez Sénèque comme chez Plutarque et font l’objet d’un court développement chez Montaigne dans le chapitre « Du dormir » (I, 44, 486).
29 « Ornant son corps magnifiquement, et lui faisant un convoi de funérailles le plus honorable qu’ils purent, l’inhumèrent sur le rivage de la mer, là où il y a encore aujourd’hui une sienne statue tenant une épée en la main. » Plutarque, op. cit., 550r.
30 Ἐγνάτιοι δέ , πατὴρ καὶ υἱός , συμφυέντες ἀλλήλοις διὰ μιᾶς πληγῆς ἀπέθανον · καὶ αὐτῶν αἱ κεφαλαὶ μὲν ἀπετέτμηντο , τὰ δὲ λοιπὰ σώματα ἔτι συνεπέπλεκτο [Les deux Egnatius, le père et le fils, se tuèrent du même coup, en se tenant étroitement embrassés. On leur coupa la tête à l’un et à l’autre, et leurs troncs ne furent point séparés.], Appien, Guerres Civiles, IV, 21 (traduction Philippe Remacle).
31 « Ignatius aussi le père & le filz de mesme nom, coururent les espees nues lun contre lautre, tellement qu’ilz se occirent, & en mourant sembrasserent si estroict, que apres quon leur eut couppé les testes demeurerent les corps encore embrassez, blessez chascun dun seul coup », Appian Alexandrin, Des Guerres des Romains, Livres XI, traduit en Francoys par feu M. Claude de Seyssel, Lyon, Antoine Constantin, 1544, p. 482.
32 La fascination qu’exerce l’image sur l’énonciateur fait dérailler le cours construit de son propos, elle menace la stabilité de la production textuelle, parce qu’elle demande une réponse qui, justement, met à mal l’ordre du texte. Rappelons ce qu’écrit Mariah Loh à propos du registre de l’horreur à l’époque prémoderne : « horror is a confrontation with representation, with an image that is placed before the spectator’s gaze, a fiction whichnevertheless demands an embodied and even visceral response from de viewer as if it were real ». (“Introduction : Early Modern Horror”, Oxford Art Journal, 34, 2011, p. 329).
33 Valérie Auclair, « L’œil médusé. Perspective et interprétation des Massacres du Triumvirat d’Antoine Caron (1566) », Communications, 2009/2 (no 85), p. 79-101.
34 Géralde Nakam, Montaigne et son temps, Paris, Gallimard, 1993 [1982], p. 128.
35 Ibid. p. 149.
36 Dans un Massacre des triumvirs de 1562 (125x138 cm) longtemps attribué à Antoine Caron (mais réattribué depuis 1945 à Nicolo dell’Abbate, qui travailla en France entre 1552 et 1571), conservé au Musée de l’Oise à Beauvais, les cous coupés du couple filial vomissent des fontaines de sang l’un sur l’autre, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des représentations.
37 À propos du tableau de Caron, Valérie Auclair note que « les scènes de tuerie sans lien entre elles sont dispersées sur la toile de Caron, mais elles s’organisent en fonction de la perspective, grâce à laquelle le peintre articule de manière rigoureuse les rapports de causalité entre tyrans et massacres et renforce l’interprétation du tableau comme manifestation du mauvais gouvernement » (art. cité, p. 89).
38 On évoque traditionnellement le « triumvirat catholique » pour désigner l’alliance de circonstance entre le connétable de Montmorency, Jacques d’Albon de Saint-André et le duc de Guise visant à contrecarrer la politique de tolérance religieuse menée par Catherine de Médicis. Valérie Auclair rappelle combien l’utilisation de cette appellation relève d’une stratégie polémique de la part du Prince de Condé (art. cité, p. 95).