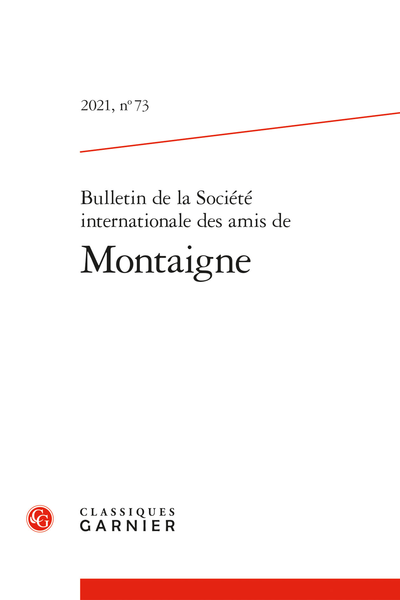
La conception du Nouveau Monde d’après la critique de la loi naturelle chez Montaigne
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2021, n° 73. varia - Auteur : Castañeda (Felipe)
- Résumé : La conception montaignienne du Nouveau Monde contraste avec celle des penseurs scolastiques du XVIe siècle, pour qui la notion de « loi naturelle » structurait les justifications et réflexions sur la domination espagnole en Amérique. Dans quelle mesure la critique de cette conception jusnaturaliste du droit a-t-elle pu conditionner l’approche de la réalité amérindienne par Montaigne ?
- Pages : 337 à 355
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126072
- ISBN : 978-2-406-12607-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12607-2.p.0337
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Loi naturelle, jusnaturalisme, Thomas d’Aquin, Conquête de l’Amérique par l’Espagne, loi chez Montaigne, coutumes, lois de conscience
La conception du Nouveau Monde d ’ après la critique de la loi naturelle chez Montaigne
La ressemblance ne faict pas tant un comme la difference faict autre.
Montaigne, III, XIII, 10651.
Les juristes et le Nouveau Monde
Les discussions espagnoles sur la légitimité de la conquête et de la colonisation de l’Amérique sont supposées ne pas seulement avoir essayé de montrer comment il y avait accord ou contradiction entre les valeurs morales et religieuses élémentaires alors en vigueur et l’entreprise belliqueuse de domination des peuples récemment découverts, mais aussi avoir tenté de rendre compte de toute cette situation nouvelle. Ainsi donc, la tâche consistant à décrire et valoriser ce monde nouveau a impliqué une réflexion sur les principes et les catégories élémentaires qui devraient servir d’instruments conceptuels pour la mener à bien. Les controverses portant sur le fait de savoir si les Indiens devaient être considérés comme esclaves par nature ou non, s’il s’agissait de peuples barbares et en quel sens, si on pouvait les considérer comme les véritables propriétaires de leurs terres ou si le pouvoir de Rome atteignait les limites de la juridiction séculière, notamment, rendent compte de tous ces aspects. Toutefois, malgré la grande complexité résultant de la diversité d’attitudes et de nuances, il ressort que lorsque l’on étudie, par exemple, des positions aussi différentes que celles de 338Bartolomé de las Casas et de Juan Ginés de Sepulveda, en passant par celles de Francisco de Victoria, la notion de « loi naturelle » joue un rôle prépondérant pour chacun d’eux. Il s’agissait en effet d’un concept fondamental pour pouvoir parler de guerre juste, et par conséquent d’une notion implicite dans la façon de concevoir la portée et le contenu des droits, aussi bien des Espagnols que des Indiens2. Ainsi, on pourrait affirmer que la conception du Nouveau Monde fut en quelque sorte une construction d’experts en lois naturelles et en lois divines, c’est-à-dire une construction de juristes.
Comme on sait, Montaigne étudia lui aussi le droit ; il exerça une profession juridique3 et écrivit sur ce monde « que l’on venait de découvrir ». Pourtant, sa vision diffère clairement de celle de ces théologiens juristes espagnols. Ceci peut tenir à plusieurs raisons, comme, par exemple, son scepticisme pyrrhonien, sa critique de la situation d’instabilité et de guerre civile d’alors, sa capacité à penser l’Amérique sans les compromissions et les conditionnements d’un Espagnol de la seconde moitié du xvie siècle, son attitude plutôt réaliste en matière politique, ses conceptions éthiques et morales visant à une revalorisation de la sensibilité et à l’absence de douleur, notamment. Cet article cherche à examiner une autre possibilité : sa critique de la notion de loi naturelle4.
Certaines remarques s’imposent sur la portée et les limitations de cette approche : il n’y a, de la part de Montaigne, aucune critique explicite des penseurs scolastiques espagnols impliqués dans les débats sur la conquête, alors qu’en principe ils étaient proches de lui temporellement 339et par la langue latine qu’ils pratiquaient5. En dehors de la référence aux obligations naturelles dans « Des Coches », il n’y a pas non plus de mention de textes légaux ou de lois spécifiques qui auraient été utilisés pour argumenter sur la guerre juste, afin de justifier la conquête. Toutefois, à plusieurs endroits des Essais, Montaigne ne parle pas seulement des fondements de la loi, de sa relation avec la coutume et de sa variété nécessaire, il aborde aussi la loi naturelle, assimilable en un sens à celle de la scolastique, comme on le verra, malgré les multiples nuances que pouvait avoir cette notion6. Dans un passage, qui plus est, il suggère un certain type de relation entre Thomas d’Aquin et Sebond7 :
je m’enquis autrefois à Adrien Turnebus, qui sçavoit toutes choses, que ce pouvoit estre de ce livre [celui de Sebond] ; il me respondit qu’il pensoit que ce fut quelque quinte essence tirée de Saint Thomas d’Aquin : car, de vray, cet esprit là, plein d’une erudition infinie et d’une subtilité admirable, estoit seul capable de telles imaginations (II, XII, 440).
Ainsi, d’emblée, sont affirmées certaines caractéristiques de la loi naturelle qui conditionneront la compréhension du Nouveau Monde. La présente recherche s’appuie essentiellement sur le Traité de la loi de Thomas d’Aquin8 puisqu’il s’agit de la référence obligée des scolastiques espagnols mentionnés. Par la suite, seront exposées les différentes critiques de Montaigne concernant cette conception traditionnelle de la loi naturelle ; et seront laissées de côté ses indications sur ce que pourrait 340être un sens acceptable de cette notion9 ou sur la façon dont on peut comprendre la notion de nature dans sa relation à la loi10. On montrera enfin comment cette critique a pu conditionner l’approche du Nouveau Monde par Montaigne.
L’humain universel, nécessaire et rationnel
Dans l’« Apologie de Raimond Sebond », Montaigne confronte la philosophie et les philosophes au rôle de cohésion que joue la religion11. Y apparaissent une série de remarques sur la loi et la justice, où il affirme notamment :
pour donner quelque certitude aux loix, ils [les philosophes] disent qu’il y en a aucunes fermes, perpetuelles et immuables, qu’ils nomment naturelles, qui sont empreintes en l’humain genre par la condition de leur propre essence (II, XII,579-580).
Il n’est malheureusement pas possible de savoir avec certitude à quels philosophes, penseurs ou théologiens Montaigne se réfère, bien qu’il fasse allusion à l’une des définitions scolastiques les plus traditionnelles de la loi naturelle. On s’appuiera donc ici sur Thomas d’Aquin, source à laquelle s’est abreuvée et dans laquelle a été baignée une grande partie des théologiens juristes espagnols de l’époque de la Conquista.
Selon l’Aquinate, l’être humain agit comme tel dans la mesure où il le fait rationnellement ; ce qui suppose qu’il soit en capacité d’œuvrer par lui-même, et en fonction de fins. L’autonomie dans l’action repose sur la volonté comme capacité à se déterminer librement c’est-à-dire en dehors de toute coercition, en fonction de ce qui est considéré bon 341et désirable. Ce qui est supposé bon et désirable, les fins, est à son tour proposé par l’entendement, capable de rendre compte de la réalité, de la connaître et de l’apprécier. Cela dit, cet usage de la rationalité pour déterminer l’action fonctionne de manière syllogistique : la raison pose une série de règles ou de normes qui déterminent en général ce qu’il convient de faire et d’éviter, ainsi que ce qui est permis ou indifférent ; l’entendement rend compte des situations concrètes auxquelles l’être humain est exposé ; la raison pratique compare les normes et les faits, donnant lieu à des jugements pratiques où se fixe le cap de l’action particulière.
Cependant, toutes les normes dont se sert la raison pratique n’ont pas le même degré de certitude. Il y en aurait en effet qui seraient évidentes par elles-mêmes et qui pourraient fonctionner comme les principes pratiques de base ; et grâce à ceux-là, on arrive à une première approche de la notion de loi naturelle :
les préceptes de la loi naturelle étaient, par rapport à la raison pratique, ce que les principes premiers de la démonstration sont par rapport à la raison spéculative ; les uns et les autres sont en effet des axiomes évidents par eux-mêmes12.
Ainsi donc, par « loi naturelle », on peut comprendre un principe pratique évident et rationnel, équivalent par exemple à des principes comme celui de non-contradiction ou celui d’identité. Selon Thomas, le premier de tous les principes pratiques serait ainsi défini : « C’est donc le premier précepte de la loi qu’il faut faire et rechercher le bien, et éviter le mal. C’est sur cet axiome que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle13 ».
C’est un pas décisif dans l’argumentation : il peut sembler évident que le bien soit désirable et qu’il faille éviter le mal, puisque la notion même de bien suppose celle du désirable, et la notion de mal, celle de l’évitable. Il s’agirait de répondre à la question de savoir ce qu’il faut entendre plus concrètement par bien et par mal. Thomas d’Aquin s’en rapporte ici aux inclinations naturelles. Tout être humain se sent poussé, motivé, porté à atteindre certaines fins. Cette inclination n’a pas besoin d’apprentissage ; elle est naturelle. Elle serait fondée sur l’essence même 342de l’être humain. Il s’agit de ce en quoi l’homme serait pleinement et parfaitement réalisé. Ainsi, lorsque l’homme perçoit ces fins, il perçoit en même temps ce dont la possession rendrait son être achevé, et par conséquent son propre bien :
l’esprit humain saisit comme des biens, et par suite comme dignes d’être réalisées toutes les choses auxquelles l’homme se sent porté naturellement […]. C’est selon l’ordre même des inclinations naturelles que se prend l’ordre des préceptes de la loi naturelle14.
Comme on peut le voir, pour ce qui concerne les besoins humains fondamentaux, le premier principe rationnel pratique se concrétise : le bien qu’il faut chercher, c’est celui que fixent les inclinations naturelles qui montreraient l’action nécessaire à suivre, afin que l’être humain puisse se réaliser pleinement comme tel, selon son essence.
De là découlent les lois naturelles spécifiques : dans la mesure où la raison humaine appréhende ces biens naturels, elle les présente comme des choses qu’elle doit naturellement désirer, ou, à l’opposé, qu’elle doit éviter. Puisqu’une première inclination la motive, selon Thomas, à se maintenir dans l’existence, la première loi naturelle consisterait à faire tout son possible pour se maintenir en vie. Pour cette même raison, le précepte « Tu ne tueras pas » serait lui aussi de l’ordre de la loi naturelle, et donc une condamnation du suicide. Toutefois, puisqu’il est indispensable, pour se maintenir en vie, d’avoir accès à la nourriture, la domination sur tous les êtres pouvant être considérés comme aliments serait également de l’ordre de la loi naturelle. Mais pas seulement : l’inclination fondamentale à s’accrocher à l’existence peut conduire à justifier l’idée que toute la création est à la disposition de l’homme par cette même loi naturelle. C’est ce qu’expriment des principes tels que « le moins parfait est pour le plus parfait », ou bien « l’homme est la fin de la création ».
Pour en revenir à la définition de la loi naturelle, on peut affirmer qu’il s’agit de principes pratiques, fixés par la raison, de caractère évident, dans lesquels sont déterminés les biens humains fondamentaux, assumés comme les fins en lesquelles l’être humain atteint sa pleine réalisation, la perfection selon son essence ou sa nature.
343Puisque l’essence humaine représente sa forme, au sens de ce qui la définit, au sens de ce composant de son être qui fait qu’il est ce qu’il est, la loi naturelle établit, en principe, ce sans quoi un être humain ne saurait être ce qu’il est. La loi naturelle détermine, si l’on veut, ce qui est assumé comme nécessairement humain en termes pratiques, c’est-à-dire les biens que l’homme doit chercher et atteindre s’il veut être considéré comme tel, et les maux à éviter s’il ne veut pas perdre sa nature. Par conséquent, la loi naturelle est supposée être un ensemble de normes universellement applicables, au sens où tout être humain sans exception doit en principe s’y conformer, indépendamment de sa culture ou de son histoire.
Or, comme l’inaccomplissement de la loi naturelle implique de ne pas pouvoir atteindre les biens humains fondamentaux en lesquels s’accomplit sa perfection, il suppose une faillite de la réalisation humaine. De même, cette imperfection signifie un éloignement de l’humain en général, si l’on veut : un certain degré de dégénérescence. Celui qui enfreint la loi naturelle se déshumanise ; d’une certaine manière, il tend à se bestialiser.
Mais ce n’est pas tout ; la loi naturelle se conçoit comme une norme que tout être humain ayant l’usage de la raison est capable de comprendre comme évidente. Il en est ainsi puisque, en principe, tout être humain présente les mêmes inclinations naturelles, puisqu’il partage une même essence et une même nature. La norme naturelle génère donc une obligation elle aussi naturelle. Suivre ses préceptes n’est pas facultatif ; ils se présentent comme un devoir. C’est pourquoi y contrevenir n’a pas seulement pour effet une dégénérescence de l’être même, mais signifie une sorte d’affront, d’injure à l’humanité. La personne qui ne les respecte pas devient un délinquant naturel, un criminel à un certain degré à l’égard du bien humain.
Rappelons que la loi naturelle ne génère pas uniquement des obligations individuelles, mais également sociales et politiques. Pour Thomas d’Aquin, l’être humain est par nature un être social qui s’organise politiquement. Cela se manifeste par une inclination naturelle à vivre avec d’autres et à engendrer des formes de gouvernement garantissant et favorisant le bien commun. C’est pourquoi il est dans l’ordre de la loi naturelle, non seulement de vivre en société, mais aussi de fonder et de maintenir des pouvoirs qui la régulent. Ainsi donc, l’individu n’a pas seulement des devoirs naturels individuels, mais aussi collectifs 344et politiques. Pour cette même raison, un corps social doit aussi se conformer à la loi naturelle dans la détermination de ses lois positives, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, et ce même corps social peut éventuellement être considéré comme une sorte là encore de « délinquant » naturel lorsqu’il impose des normes qui portent atteinte à l’idéal de perfection humaine.
La loi naturelle pose donc des critères qui fixent aussi bien les minima de l’humanité que la hauteur de son éventuelle perfection. Tout peuple, toute personne tombent en principe sous cette aune. Certains seront plus éloignés de cet accès aux biens humains, d’autres en seront plus proches ; certains, éventuellement, s’égareront en chemin. Quoi qu’il en soit, à partir de cet ensemble de normes naturelles, on peut établir une cartographie des peuples en fonction de leur proximité avec un idéal supposé de réalisation humaine. La similitude s’impose : une même essence, une même nature, un même devoir d’humanité. On peut tolérer la différence dans la mesure où il s’agit d’itinéraires alternatifs conduisant à la même fin ultime que constitue le bien humain. Les autres possibilités sont condamnées comme contre nature, comme voies de dégénérescence et d’illicéité allant à l’encontre de la justice naturelle.
L’illusion d’universalité de la loi naturelle
S’il existait des lois naturelles15 inscrites dans le cœur de chaque être humain, tendant à soutenir normativement leur propre réalisation, on devrait s’attendre à ce qu’en général tout peuple et toute personne non seulement reconnaissent les mêmes lois naturelles fondamentales, mais aussi les approuvent. Pour Montaigne cependant, cela ne semble pas être le cas :
Quelle verité que ces montaignes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au delà ? […] Et, de celles-là [les lois naturelles], qui en fait le nombre de trois, qui de quatre, […] ils sont, dis-je, si miserables [les philosophes] que de 345ces trois ou quatre loix choisies il n’en y a une seule qui ne soit contredite et desadvoëe, non par une nation, mais par plusieurs. Or c’est la seule enseigne vraysemblable, par laquelle ils puissent argumenter aucunes loix naturelles, que l’université de l’approbation (II, XII, 579-580).
Le constat de la non-approbation universelle d’un même ensemble fondamental de lois naturelles est un argument qui suppose que l’on attribue une valeur toute particulière aux faits culturels et historiques que l’on peut vérifier. Ce sont les pratiques réelles des personnes dans leurs situations concrètes qui permettent d’établir quels codes sont réels ou non. Ainsi, si une norme tend à être valable en toute nation, en tout lieu et en tout temps, on doit pouvoir vérifier qu’elle est en vigueur partout. Il pourrait y avoir des exceptions si l’on se référait à des situations dans lesquelles on pourrait appliquer quelque chose comme la « raison d’État » ; mais en tout cas, il n’y aurait pas de sens à parler de la réalité de la loi naturelle si l’on découvrait des nations entières vivant normalement sous des législations contradictoires avec celles d’autres peuples16.
Dans la pensée juridique thomiste, on trouve plusieurs types d’explications qui pourraient justifier une ambigüité et le manque de validité de la loi naturelle17. Il convient ici de reprendre brièvement certaines d’entre elles, afin de souligner les points de distance avec la position de Montaigne.
Tout d’abord, on peut expliquer l’ignorance de la loi naturelle par des conduites vicieuses, aussi bien individuelles que collectives, qui finissent par troubler, obscurcir, déformer une perception adéquate de l’inclination naturelle. En effet, si l’on entend par vice une habitude qui empêche de réaliser correctement ce que l’on doit être par nature, une disposition du corps social, ou des facultés personnelles propices à un développement imparfait de l’essence propre, alors le vice empêcherait 346une perception appropriée des biens humains fondamentaux. Cela pourrait conduire à une formulation défectueuse ou erronée de la loi naturelle. C’est ainsi que des auteurs comme Sepúlveda auraient très bien pu affirmer qu’en bonne partie, les lois « contre nature » de certains peuples américains étaient dues à leur ancestrale condition de perdition sur le plan des coutumes.
Une autre explication, très discutée dans des controverses comme celle de Valladolid, pourrait venir de l’argument selon lequel tous les êtres humains ne disposent pas d’une égale capacité rationnelle. Dans cette perspective, certains êtres humains, par nature, seraient esclaves, et d’autres, maîtres. La différence résiderait essentiellement dans la capacité à prévoir l’avenir, dans le fait d’être vraiment doué de raison et dans la prudence. Or, comme la reconnaissance de la loi naturelle suppose une raison suffisamment habile pour reconnaître des jugements évidents qui servent de principes pour arriver à des conclusions pratiques, s’il y a des êtres humains qui, en raison de leur constitution naturelle, n’en sont pas capables, ils présenteront des lacunes dans la connaissance et dans le suivi des préceptes naturels.
Troisièmement, on peut affirmer, surtout en cette période féroce de conflits religieux, que la lutte entre le bien et le mal ne se situe pas seulement entre les peuples, mais aussi au niveau de Dieu et de ses anges contre le diable et ses démons. L’idolâtrie de peuples comme ceux du Nouveau Monde, qui adoraient Dieu notamment au moyen de sacrifices humains, peut être lue comme une victoire partielle du démoniaque sur l’un des fronts de cette guerre transcendante. Quoi qu’il en soit, l’idolâtrie des peuples sans contact avec le christianisme catholique aurait brouillé leur interprétation de l’idée fondamentale du bien, et peut-être aussi faussé une compréhension adéquate de la loi naturelle.
Enfin, il est clair que la loi naturelle se manifeste de bien des façons grâce à un ensemble de normes dans lesquelles elle est inscrite, ce qui peut produire une illusion de diversité. En effet, certains préceptes naturels peuvent être substitués à d’autres : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » peut avoir une signification similaire à « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais également, à partir de certains préceptes naturels, on peut en déduire d’autres, qui rendent compte de l’ensemble du droit des gens. Et en principe, toutes ces normes ont une même validité, ce qui génère une prolifération 347normative qui peut donner l’illusion de la diversité, de l’équivoque, voire de l’inconsistance. D’autre part les lois naturelles, dans leur application concrète, sont régulées par les lois positives. La nécessaire multiplicité et diversité de codes peut finir par se projeter sur la loi naturelle elle-même, ce qui pourrait expliquer son apparent manque d’unité.
Pour en revenir à sa critique, Montaigne s’attache à l’importance du donné, et au constat de sa diversité et de sa multiplicité. S’il n’y a pas d’uniformité dans la formulation des lois naturelles fondamentales, s’il n’y a pas de consensus quant à leur validité, alors il est insensé de parler de lois naturelles fondées sur une supposée essence humaine. Par conséquent, le fait juridique de la prolifération de lois prétendument naturelles, pour ainsi dire, ne doit pas être relativisé sur la base de distinctions présumées entre peuples vicieux et peuples vertueux, entre barbares, esclaves par nature des civilisés et maîtres naturels, défenseurs de la véritable religion face à des idolâtres ou hérétiques possédés par le démon, et encore moins par des discussions d’herméneutique juridique. S’il existe donc bien quelque chose comme des lois naturelles, elles doivent être écrites dans le même langage pour tout être humain, et doivent pouvoir être lues, interprétées et observées peu ou prou de la même manière. S’il existait des explications valables de la raison pour laquelle ce n’est généralement pas le cas, cela porterait précisément atteinte à leur caractère naturel. Montaigne écrit :
Car ce que nature nous auroit veritablement ordonné, nous l’ensuivrions sans doubte d’un commun consentement. Et non seulement toute nation, mais tout homme particulier, ressentiroit la force et la violence que luy feroit celuy qui le voudroit pousser au contraire de cette loy (II, XII, 580).
La coutume et la loi
Comme on l’a déjà noté, pour des auteurs comme Thomas d’Aquin, la loi naturelle se fonde sur la raison : le premier principe de la loi naturelle suppose que l’entendement sain est toujours capable d’établir que la notion de bien inclut en soi celle du désirable, et que par conséquent les propositions : « Le bien est ce qui suscite le désir » et « Le bien évite le 348mal » renferment une vérité évidente et incontestable. Or, si le fondement de la loi naturelle est la raison dans sa capacité à saisir l’évidence de ce type de vérités, il est alors clair que la loi naturelle ne se fonde pas sur la coutume. C’est un point que souligne expressément Thomas : « La loi naturelle n’est pas un habitus. En effet, il a été dit précédemment que la loi naturelle est établie par la raison, de même qu’une proposition est aussi l’œuvre de la raison18 ». Francisco de Vitoria donne ce commentaire : « Il pose [Thomas d’Aquin] une conclusion dans laquelle il dit, si l’on parle d’habitude précisément, que la loi naturelle n’est pas habitude, parce que l’habitude est quelque chose qui se fait par la raison, comme la loi, qui est un arrêt et un jugement19 ».
Ce qui précède n’empêche pas que, depuis la scolastique, on puisse établir quelque relation entre coutume et norme. Les pratiques répétées qui se révèlent socialement et politiquement utiles peuvent être sanctionnées par la loi. La coutume serait alors le fondement de la norme. Toutefois il s’agirait de conduites qui doivent être en accord avec la loi naturelle elle-même. Ainsi, bien que la législation humaine et positive puisse être fondée sur les coutumes, si ces dernières contredisent les préceptes naturels ou s’y opposent, la loi humaine devrait elle-même être remise en question du fait de son fondement vicieux et non pas la loi naturelle20. Face à cette tradition, le point de vue de Montaigne surprend :
Les loix de la conscience, que nous disons naistre de nature, naissent de la coustume : chacun ayant en veneration interne les opinions et mœurs approuvées et receues autour de luy, ne s’en peut desprendre sans remors, ny s’y appliquer sans applaudissement (I, XXIII, 115).
Et pour cette même tradition scolastique qui nous occupe, l’être humain en tant qu’agent moral ne se comprend pas seulement comme sujet pouvant agir par lui-même rationnellement, mais aussi et très spécifiquement comme une sorte de juge de lui-même. La raison pratique lui indique le chemin à suivre selon les lois naturelles, en même temps qu’elle contrôle s’il suit effectivement le chemin indiqué. Ce contrôle, selon des auteurs comme Thomas d’Aquin, est inévitable dans 349la mesure où il s’agit de personnes morales. Tout se passe au sein de la conscience ; c’est là que chacun sait, sans possibilité de mensonge ni de faux témoignages, dans quelle mesure sa conduite s’ajuste au devoir, punissant ou récompensant avec la mauvaise ou la bonne conscience. Ce n’est évidemment possible que si l’on dispose d’une notion claire et manifeste de ce que sont le bien ou le mal liés à l’obligation. Et ceci supposerait alors une autre fonction, une autre dimension de la loi naturelle21 : non seulement elle signale ce qu’est le bien ou le mal, mais, d’une certaine manière, elle force et motive leur exécution, ce qui évite que l’infraction soit indifférente à l’agent moral. Intérieurement, on l’assume comme ordre et comme ce qui est susceptible de recevoir récompense ou punition. Pour des auteurs comme Thomas, il y a, en amont, la volonté de Dieu qui, en quelque sorte, par le biais de sa providence, inscrit dans le cœur humain la notion de devoir22.
Montaigne accepte qu’il y ait des lois de la conscience. La personne morale, en effet, est capable de remords ou d’estime de soi en fonction de sa conduite. Cela se produit dans sa propre intériorité, indépendamment du jugement extérieur et sans la possibilité d’être manipulé à volonté par la personne elle-même. Cependant, Montaigne remet en question son origine naturelle, c’est-à-dire le fait que ce serait des lois naturelles de la conscience. C’est une remarque fondamentale, car si les lois de la conscience ne sont pas proprement naturelles, et si elles sont intimement liées à celles qui sont traditionnellement considérées comme des lois naturelles, alors, la critique de l’origine supposément naturelle des lois de conscience peut aussi s’appliquer aux prétendues lois naturelles en général.
Il est à noter que, dans ce passage, ce à quoi Montaigne se réfère précisément lorsqu’il parle d’une prétendue origine « naturelle » des lois de conscience n’est pas clair. On pourrait penser à des approches supposant que ces normes sont imprimées dans la conscience comme le sont les instincts chez les animaux, et même chez l’homme ; c’est-à-dire 350comme partie de sa dotation naturelle, sans que celle-ci soit le fruit d’une acquisition par l’éducation ou par la culture. Mais on pourrait aussi penser qu’il fait allusion à un sens du terme naturel se référant simplement à l’origine rationnelle non viciée de ces lois de conscience. Dans ce cas, la saine raison possède par nature certaines aptitudes qui, lorsqu’elles sont correctement exercées, donnent lieu à des résultats inhérents à son agir naturel ; c’est pourquoi elles sont considérées comme « naturelles ». Quoi qu’il en soit, la critique de leur prétendue origine naturelle s’appuie sur une affirmation beaucoup plus claire et percutante : elles n’ont pas une origine naturelle, parce qu’elles tirent leur origine de la coutume ; pour Montaigne, elles ne sont donc pas issues de la rationalité humaine. Il convient de s’arrêter sur ce qui peut être considéré comme un questionnement très profond vis-à-vis du cœur même de la notion traditionnelle de loi naturelle dont nous traitons ici.
S’il fallait mentionner quelque chose qui obsède particulièrement Montaigne au sujet des coutumes, ce serait sûrement leur grande diversité et leur multiplicité. Tout comme il y a celles qui nous sont propres et connues, qui servent de référent identitaire particulier, il y a en a de plus étranges, à peine imaginables, même par l’imagination la plus débordante. Ainsi, si les lois ont leur origine en ce vaste et insaisissable horizon de possibilités, il peut alors également y avoir des lois de tous genres. Montaigne écrit :
mais d’autres opinions y en a il de si estranges, qu’elle n’aye planté et estably par loix és regions que bon luy a semblé ? […] J’estime qu’il ne tombe en l’imagination humaine aucune fantasie si forcenée, qui ne rencontre l’exemple de quelque usage public, et par consequent que nostre discours n’estaie et ne fonde (I, XXIII, 111).
Il n’est chose en quoy le monde soit si divers qu’en coustumes et loix (II, XII, 580).
Et ceci est tout à fait remarquable, si l’on revient aux lois de la conscience : il y a en principe bien des façons de définir d’articuler une conscience morale. En d’autres termes, il serait absurde et très réducteur de penser que chaque être humain se juge lui-même en son for intérieur de la même manière. Tout dépend du lait nourricier qu’il aura bu au cours de son éducation habituation particulière. Mais les coutumes ne présentent pas seulement un grand éventail de possibilités ; le fait que 351l’une ou l’autre s’installe dépend de facteurs difficilement contrôlables à volonté. Le lieu et le moment où l’on vit peuvent décider à la longue du type de religion, et par conséquent, de la loi morale fondamentale : « Nous sommes Chrestiens à mesme titre que nous sommes ou Perigordins ou Alemans » (II, XII, 445). Cela suggère le caractère relatif des lois fondamentales structurant un sujet en tant que personne morale, du fait de la possibilité de grandes différences entre des êtres humains appartenant à des peuples divers. Toutefois, bien que les coutumes puissent être extrêmement variées, elles ne sont pas toutes également enracinées. La coutume naît de conduites que la répétition rend habituelles. Avec le temps, l’habitude s’instaure, s’alimentant elle-même de sa propre répétition. Néanmoins, pour reprendre la métaphore de Montaigne, cela ne rend compte que de la longueur de la rivière, que de la longévité de l’habitude, de sa transmission des uns aux autres, du caractère invétéré de la tradition. Le débit du fleuve, ce serait le taux de participation des familles, de la communauté, du réseau des peuples qui pourraient éventuellement partager ce même mode de vie. C’est dans ces deux facteurs que résident en grande partie la solidité et la résistance de la coutume. Ainsi, comme pour les cours d’eau, en remontant vers la source, son bien-fondé peut paraître vain et fragile si l’on constate un faible débit, et une source jeune et récente. De même, à certains moments, la force de la coutume se concrétise principalement en fonction du nombre de personnes qui en font leur propre nature, croyant que ce fut toujours et qu’il en sera toujours ainsi. Tous ces aspects affectent les lois, y compris la force des lois tutélaires des sociétés :
Les loix prennent leur authorité de la possession et de l’usage ; il est dangereux de les ramener à leur naissance : elles grossissent et s’ennoblissent en roulant, comme nos rivieres : suyvez les contremont jusques à leur source, ce n’est qu’un petit surion d’eau à peine reconnoissable (II, XII, 583).
Ce passage peut également indiquer que les lois dites « naturelles » sont tout simplement des règles qui ont été normalisées avec le temps, de telle sorte que les peuples qui les suivent les assument comme si elles étaient valides toujours et partout, c’est-à-dire comme si elles faisaient partie intégrante de l’ordre naturel lui-même. Un peu comme s’il s’agissait d’un fleuve sans source et sans embouchure connues.
Toutefois, si la force de la loi est dans son ancienneté, pour le dire rapidement, alors elle n’est pas dans le fait qu’elle soit juste : « […]352les loix se maintiennent en credit, non par ce qu’elles sont justes, mais par ce qu’elles sont loix. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont poinct d’autre. » (III, XIII, 1072). Pour souligner le fossé qui sépare ici Montaigne de la pensée scolastique, il faut mentionner que, pour celle-ci, la loi naturelle traditionnelle, en principe, fait office de critère de base de la justice pour toute loi humaine. La loi naturelle est alors le référent même de justice, servant de pilier pour que quelque autre type de loi proposée ou promulguée par l’homme puisse être comprise comme telle. C’est assez remarquable parce que cela suppose qu’en grande partie, pour ce jusnaturalisme, le fondement de la loi humaine réside précisément dans la possibilité qu’elle puisse être considérée comme juste. Thomas d’Aquin, citant saint Augustin écrit :
Il ne semble pas qu’elle soit une loi, celle qui ne serait pas juste. C’est pourquoi une loi n’a de valeur que dans la mesure où elle comporte de la justice. Or, dans les affaires humaines, une chose est dite juste du fait qu’elle est droite, conformément à la règle de la raison. Mais la règle première de la raison est la loi de nature […]23.
Par conséquent, Thomas semble cautionner l’idée qu’un peuple puisse licitement entrer en insubordination si les lois du gouvernant s’opposent à la loi naturelle, ce qui engendrerait une sorte d’injustice naturelle. Pour Montaigne, cela n’aurait pratiquement pas de sens : la force du courant du fleuve est le fondement de l’obéissance, sans qu’importe vraiment si l’on est d’accord ou pas avec la direction dans laquelle nous entraîne le courant des coutumes. Et cela est aussi valable pour les lois qui aspirent à passer pour naturelles : on obéit non pas parce qu’elles incarnent la justice en soi, ou parce qu’il existe une sorte d’intérêt moral comme le dira Kant, mais par la relation de domination effective qu’elles présupposent.
Vers un autre monde hors de la loi naturelle
Comme on l’a déjà noté, la loi naturelle n’a pas seulement servi d’instrument conceptuel dans la construction des justifications de 353la Conquista et de la colonisation, mais aussi de facteur déterminant du prisme à travers lequel une conception du Nouveau Monde a été élaborée, du moins dans le cas de nombreux penseurs scolastiques ibériques de l’époque. Le droit naturel cherche donc à établir ce qu’est l’être humain d’un point de vue essentiel, ce qu’il doit devenir, quelle est sa nature réelle. Et par conséquent, quelle devrait être la manière de procéder dans la rencontre entre Espagnols et Indiens, en fonction de cette normativité : ce qu’il faudrait respecter ou détruire, comment procéder et comment envisager la nouvelle interrelation. Or, si pour Montaigne cela n’avait aucun sens de parler de lois naturelles, cela a dû malgré tout affecter sa façon de concevoir et d’interpréter cette nouvelle réalité, sa façon de la voir.
Un premier aspect concerne la remise en cause des prétentions à l’universalité de ses propres points de vue, de sa conception des choses et de ses croyances. Montaigne n’hésite pas à écrire :
chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ; comme de vray il semble que nous n’avons autre mire de la verité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la parfaicte religion, la parfaicte police, perfect et accomply usage de toutes choses (I, XXXI, 205).
C’est tout à fait significatif : on juge et on apprécie nécessairement les choses à partir du tissu de coutumes dans lequel on s’inscrit. Il en est ainsi car la pensée, la sensibilité et jusqu’à la raison elle-même sont façonnées par les habitudes et les pratiques. Ainsi, son propre monde, tant qu’il jouit d’une certaine normalité, tend à être le monde parfait, car c’est celui que l’on peut difficilement voir comme différent, car c’est celui qui est identifié à ce qui est naturel et nécessaire. D’où une prédisposition à considérer ce qui est différent comme « barbare » : on part du principe que ce qui est propre doit être valable dans n’importe quel domaine et dans n’importe quelle circonstance ; on essaie de subsumer ce qui est différent sous ces « loix de la ceremonie [qui] attachent là leur devoir » (III, V, 369) ; et le résultat ne peut être autre que la disqualification de ce qui n’est pas compatible, de ce qui ne réaffirme pas sa propre identité.
Ainsi, la critique de la prétention à l’universalité de la loi naturelle avertit d’abord que ses propres formes d’évaluation des choses ont une 354compétence limitée, et que l’on ne saurait les appliquer indistinctement à n’importe quelle autre réalité. Et cela est nécessairement lié à une recommandation morale et juridique qui a sans doute aussi des implications herméneutiques : « Car c’est la regle des regles, et generale loy des loix, que chacun observe celles du lieu où il est » (I, XXIII, 118).
S’il n’existe pas de justice universelle, de consensus de tous les peuples sur ce qu’il faut faire et éviter, si tout ce dont on dispose réellement, ce sont les règles en vigueur dans chaque lieu, alors il n’y a pas d’autre justice que celle qui est effective et donnée, c’est-à-dire celle qui est particulière et limitée au « lieu où il est ». Ainsi, « ce que nostre raison nous y conseille de plus vray-semblable, c’est generalement à chacun d’obeir aux loix de son pays » (II, XII, 578).
Ce qui ne veut pas dire que des guerres, des conflits et tous types de violence ne peuvent pas se produire. Mais en tout cas, ce ne sera pas avec la prétention soi-disant raisonnable de s’abriter sous le manteau d’un devoir d’humanité, ni d’être le dépositaire et le gardien des valeurs et des biens humains suprêmes. Cela peut expliquer pourquoi Montaigne note dans un passage de l’essai « Des coches »que le Nouveau Monde se serait mieux porté s’il avait finalement été conquis non pas par des Espagnols mais par des Romains ou des Grecs de l’Antiquité. En effet, le violateur d’une loi naturelle peut finir par être considéré comme un criminel contre l’humanité, tandis que celui qui ne viole que la loi positive d’un État donné, finalement équivalente à celle de n’importe quel autre, est considéré comme « ennemi juste24 ».
Revenons à la règle des règles : cette norme supérieure invite à une connaissance descriptive des codes étrangers. Cela n’a pas de sens d’établir en quoi le comportement de l’autre est en contradiction avec mes propres valeurs afin de déterminer le degré de disqualification qui lui sera appliqué, comme pourrait le faire une sorte de juge universel. Que l’on pense, par exemple, aux différents types de barbares et de barbarie proposés par José de Acosta25. Il est plus raisonnable d’entrer dans les coutumes de l’autre et d’essayer de comprendre ses lois, puisqu’en principe on n’a pas la compétence pour les juger. Évidemment, dans le cas particulier de Montaigne, ce souci de compréhension cela s’ajoute à 355son attitude pyrrhonienne, qui est en elle-même encline à la suspension des jugements, y compris ceux de valeur, ainsi qu’à une sorte d’obsession pour la description des coutumes de toutes sortes, pour générer des collections de particularités dans les différentes manifestations de l’humanité.
Cependant Montaigne, très clairement, ne se contente pas de remplir ses étagères avec des souvenirs de comportements exotiques collectés dans ses voyages littéraires, réels ou fictifs. La question ici porterait sur le type d’attitude que l’on peut avoir lorsque l’on prend conscience que personne n’est détenteur de la vérité absolue, ni de la justice ; que le problème de la différence entre les codes et les normes n’est pas principalement une affaire de raison, puisque le fondement de la norme dépend de toutes sortes de facteurs autres que la capacité de l’entendement à établir des jugements évidents, ou à déchiffrer la volonté de Dieu imprimée dans le cœur de tout homme. Tout cela est exposé dans un contexte de transition, celui d’un Nouveau Monde que l’on découvre à peine et qui pourtant se trouve déjà dramatiquement affecté par l’Ancien Monde, ce Nouveau Monde dans lequel semblent être habituelles des pratiques aussi extrêmes que le cannibalisme. Et c’est justement dans ces circonstances que s’ouvre un espace, non seulement pour la comparaison des coutumes et donc aussi des lois, mais pour une autocritique ainsi que pour une interpellation de l’autre, ce pour donner un avis sur soi. Il est raisonnable de tenter de comprendre l’étranger comme un point d’appui afin de voir dans quel état on est soi-même, s’il est reconnu comme un interlocuteur valable pour compléter la vision de soi-même avec le point de vue autre qu’il offre. L’autre a la possibilité unique de laisser ouvertes des questions sur soi, qui mettent en évidence ce qui est propre à l’inachevé :
[…] quelqu’un en demanda leur advis, et voulut sçavoir d’eux ce qu’ils y avoient trouvé de plus admirable : ils respondirent trois choses, d’où j’ay perdu la troisiesme, et en suis bien marry… (I, XXXI, 213).
Felipe Castañeda
Département de philosophie
Université des Andes, Colombie
1 Les paginations renvoient systématiquement à l’édition Villey : Michel de Montaigne, Essais, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
2 Voir, par exemple, la façon dont est formulé le problème principal de la controverse de Valladolid : « Sa Majesté a ordonné l’an dernier, en l’an mille cinq cent cinquante, de faire une assemblée de savants, théologiens et juristes dans la ville de Valladolid, pour se réunir au Conseil royal des Indes afin de discuter et de déterminer si les peuples de ces royaumes pouvaient légalement et justement faire des guerres contre les peuples de ces royaumes […] guerres qui sont appelées conquêtes », Bartolomé de las Casas, Tratados I y II, México D. F., Fondo de Cultura Económica, [1552] 1997, p. 223.
3 André Tournon, “Justice and the Law : On the Reverse Side of the Essays”, The Cambridge Companion to Montaigne, édition de Ullrich Langer, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2005, p. 96.
4 Des approches comme celles de Vicente Raga Rosaleny vont dans le même sens : « C’est un tel scepticisme [celui du rejet des autorités traditionnelles] qui permet à Montaigne […] de remettre en cause le postulat selon lequel la raison détermine les lois naturelles dans un univers téléologiquement structuré », Vicente Raga Rosaleny, « Cultura y naturaleza : Montaigne en América », Alpha 37, 2013, p. 93.
5 Pour Hamlin, il est fort probable que Montaigne ait eu connaissance d’une partie de l’œuvre de Las Casas (William M. Hamlin, The Image of America in Montaigne, Spenser and Shakespeare : Renaissance Ethnography and Literary Reflection, New York, St. Martin’s Press, 1995, p. 40 et suivantes).
6 « À la fin du xvie siècle, on pouvait choisir parmi une grande variété d’interprétations et d’interprètes [en lien avec la loi naturelle]. Pomponazzi (un rationaliste padouan), Charron (un disciple de Montaigne), Suárez (un néo-thomiste jésuite) et Du Vair (un “stoïcien chrétien”), tous croyaient en la loi naturelle, mais leurs conceptions de la raison droite n’étaient guère identiques ni même compatibles » (Robert Ornstein, “Donne, Montaigne, and Natural Law”, The Journal of English and Germanic Philology, 55, 2, 1956, p. 221).
7 Sur les éventuelles influences de Sebond, Ramón Pou les inscrit davantage dans une tradition d’origine augustinienne plutôt que thomiste, par l’intermédiaire de Saint Bonaventure et de Raymon Lull (Ramón Pou, « La antropología del Liber creaturarum de Ramón Sibiuda », en ligne, consulté le 17 / 04/ 2021, p. 219. [http://www.icatm.net/bibliotecabalmes/sites/default/files/public/analecta/AST_42/AST_42_211.pdf]).
8 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Paris, Éditions du Cerf, 1984, 1-2, q. 90, p. 1197 et suivantes.
9 Daniel Machado Gomes, « Lei natural, lei positiva e os tupinambás nos Ensaios de Michel Montaigne », III Encontro de Internacionalizacao do Conpedi, Madrid, Conpedi Law Review 13, vol. 1, 2016, p. 187-201.
10 Celso Martins Azar Filho, « Natureza e lei natural nos Ensaios de Montaigne », Princípios (UFRN), Natal, vol. 4, 1996, p. 51-71 ; Maryanne Cline Horowitz, « Montaigne “Des Cannibales” and Natural Sources of Virtue », History of European Ideas, vol. 11, 1989, p. 427-434.
11 Cf. Essais, II, XII, p. 579.
12 Thomas d’Aquin, op. cit., 1-2, q. 94, a. 2, p. 1217.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Pour une description succinte des critiques de diverses natures sur l’approche des lois naturelles, voir Vittorio Possenti, 1996, « La idea de la ley natural », in El iusnaturalismo actual, Edición de Carlos I, Massini-Correas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 281-287.
16 Todorov face à la critique que fait Montaigne du droit naturel écrit : « […] l’argument sceptique selon lequel si une chose n’est pas universellement présente elle ne peut être vraie (juste) n’est pas probant : l’injustice existe, elle aussi ; ce qui est universel n’est pas la présence d’actes (ou de lois) justes, mais notre capacité même de distinguer justice et injustice […] », Tzvetan Todorov, Nous et les autres. Paris, Seuil, 1989, p. 57-58.
17 Sur ce thème, à partir des positions jusnaturalistes, voir Ralph McIneny, « El conocimiento de la ley natural », in El iusnaturalismo actual, op. cit., p. 237-249 ; et Sebastián Contreras, « La ley natural y su falta de determinación. Apuntes sobre la teoría clásica de la determinación del derecho natural », Boletín mexicano de derecho comparado, 141, N. S., année 47, 2014, p. 839-866.
18 Thomas d’Aquin, op. cit., 1-2, q. 94, a.1, p. 1216.
19 Francisco de Vitoria, La ley, Madrid, Tecnos, 1995, p. 29.
20 Thomas d’Aquin, op. cit., 1-2, q. 91, a. 3, p. 1203.
21 « Cette lumière de la droite raison est ce qu’on entend par loi naturelle ; c’est ce qui déclare, dans la conscience des hommes de bien, ce qui est bon et juste, et ce qui est mauvais et injuste, et cela non seulement chez les chrétiens, mais chez tous ceux qui n’ont pas corrompu la droite nature par de mauvaises habitudes », Juan Ginés de Sepúlveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 67.
22 Thomas d’Aquin, op. cit., 1-2, q. 91, a. 2, p. 1202.
23 Thomas d’Aquin, op. cit., 1-2, q. 95, a. 2, p. 1223.
24 Carl Schmitt, El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del « Ius publicum europaeum », Granada, Editorial Comares, 2002, p. 100sq.
25 José d’Acosta, De procuranda indorum salute, Madrid, C. S. I. C, 1984, p. 59-69.