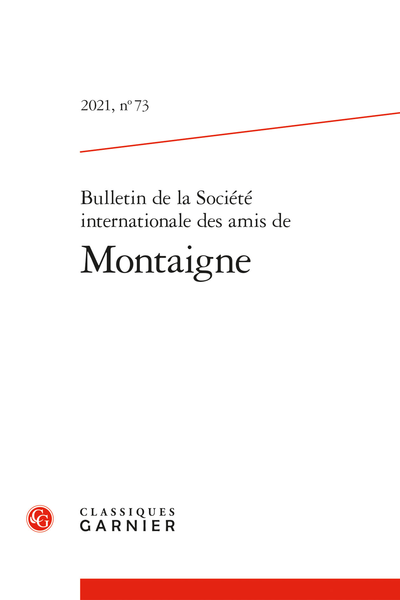
« Il les a, de bonne foy, renoncez et quittez » La bonne foi comme reconnaissance de l’ignorance dans les Essais
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2021, n° 73. varia - Auteur : Beuvier (Clément)
- Résumé : Cet article étudie le fonctionnement de la « bonne foy » dans les Essais, en analysant son association à l’acte de reconnaissance entendu comme aveu d’ignorance, et en cherchant à montrer, à travers un détour par le champ du droit, que la notion est moins à comprendre dans le paradigme de la fides, dans le discours sur la fidélité à la parole donnée, que sur le plan de la gnoséologie et de l’éthique de la « conférence » que l’œuvre dessine.
- Pages : 87 à 105
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126072
- ISBN : 978-2-406-12607-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12607-2.p.0087
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Montaigne, bonne foi, reconnaissance, droit, présomption, ignorance
« Il les a, de bonne foy,
renoncez et quittez »
L a bonne foi comme reconnaissance
de l ’ ignorance dans les Essais
Cette étude se propose de mettre en évidence un fonctionnement textuel de la « bonne foy » dans les Essais, en cherchant à montrer que la manière dont Montaigne utilise cette notion ne rattache pas directement celle-ci au thème – central par ailleurs – de la fidélité à la parole donnée, mais est plutôt à comprendre sur le plan de la gnoséologie de l’œuvre, au sein du rapport au savoir et au langage que l’œuvre dessine1. L’analyse des occurrences est appuyée sur celle des usages juridiques de la « bonne foy » au xvie siècle, partant du postulat que le sens juridique de la notion est une donnée essentielle, qui distingue sémantiquement la bona fides de la fides dont elle est issue, y compris lorsqu’elle est utilisée hors du champ du droit.
La désignation des Essais comme « un livre de bonne foy » dans la première phrase de l’avis « Au lecteur » est souvent rapportée à l’importance fondamentale que Montaigne accorde dans l’œuvre au respect de la parole donnée, à la condamnation du mensonge qu’il y prononce de part en part2. Dans son article « Montaigne ou la parole donnée3 », Antoine Compagnon rapproche ainsi cette affirmation 88liminaire de la thématisation de la fides dans l’œuvre, du traitement que fait Montaigne, sur le plan de l’énoncé, du motif de la parole donnée. La « bonne foy » du livre est ainsi décrite comme le signe de la rhétorique « fondée sur la bonne foi, la dictorum constantia et veritas, sur la parole donnée4 » qui caractériserait les Essais. Rattachée à ce discours sur la fides, la « bonne foy » se trouve alors comprise dans une logique de la promesse, conçue comme la clause d’un engagement, la marque d’une parole que l’œuvre donnerait sur son seuil. Dans l’écart, plusieurs fois noté par les spécialistes, entre le renoncement des Essais à atteindre une vérité fixe et l’exposition répétée des dommages causés par le mensonge et l’infidélité5, c’est de ce dernier côté qu’est le plus souvent localisée la bonne foi, l’exigence de constance sur laquelle elle reposerait étant perçue comme une possible limite à la « métaphysique mobiliste et relativiste6 » des Essais.
Nous essaierons de montrer ici que ce rapprochement, incontestable, de la « bonne foy » et de la fides peut être complété par une autre approche, attentive à ce qui sépare ces deux notions plutôt qu’à ce qui les relie ; attentive à ce qui fait, dans et hors des Essais, la singularité de la bonne foi. Cette dernière est en effet dotée d’une relative autonomie conceptuelle vis-à-vis de la fides dont elle est issue, notion centrale de la culture latine7, désignant notamment mais non exclusivement la parole donnée, la loyauté de celui qui donne cette parole, ou la confiance que cette parole cherche à produire chez celui à qui elle est donnée8. La bona fides est, quant à elle, au départ, une formule spécifiquement juridique, qui apparaît entre le ive et le 89iiie siècle avant J.-C. dans le droit romain9, et est conceptualisée dans le droit savant médiéval et renaissant. Au xvie siècle, cette spécificité juridique demeure une donnée centrale de la notion, y compris dans ses usages non techniques, ainsi que dans les usages vernaculaires de la « bonne foy », qui conserve hors du champ du droit une partie des traits qu’elle y a acquis.
Si la signification juridique de la bonne foi peut intéresser une lecture des Essais, c’est entre autres parce que celle-ci repose sur un rapport singulier au savoir et au langage. Comme nous le verrons à travers un rapide parcours juridique, qui constitue la première étape de ce travail, la parole de bonne foi n’est pas d’abord, dans le droit, la parole de la promesse, la parole tenue après avoir été donnée : il s’agit, d’une part, de la parole de celui qui ignore, mais est excusable de son ignorance, d’autre part de la parole de celui qui ne joue pas sur les mots, ne s’empêtre pas dans des subtilités langagières mais privilégie au contraire, dans le rapport à l’autre, l’intention sur les formules contractuelles, l’esprit sur la lettre. Ces deux traits font que la bonne foi fonctionne dans et hors du droit comme l’expression d’une forme de méfiance envers une interprétation trop stricte des paroles, là où le discours philosophique sur la fides insiste davantage, au contraire, sur le caractère contraignant des paroles, sur la force obligatoire des mots par lesquels on s’engage. Il y a alors entre bonne foi et fides, et entre les deux discours que ces notions suscitent, non pas une équivalence, mais une complémentarité, les deux notions n’étant pas porteuses des mêmes exigences.Quand Montaigne emploie ces termes de « bonne foy » dans les Essais (où ils apparaissent à dix reprises au total10), ce n’est ainsi pas d’abord au sein du paradigme de la fides, pour souligner comme il le fait ailleurs l’importance capitale que revêt le respect de 90la parole donnée, mais sur le plan gnoséologique du rapport au savoir que l’œuvre dessine, et dans l’éthique de la « conférence » qu’elle pratique et appelle de ses vœux. La bonne foi, nous le verrons, n’est ainsi pas opposée au mensonge ou à la tromperie, mais à la présomption et à l’opiniâtreté.
Par cette référence au champ juridique, l’analyse qui suit s’inscrit dans le sillage des travaux d’André Tournon, qui a montré l’intérêt heuristique qu’il y avait à rapprocher, autour du problème de la « validité de la parole11 », la langue des Essais de la langue du droit. En ce qui concerne plus particulièrement cette notion de « bonne foy », c’est Michel Simonin qui en a rappelé l’origine juridique, pour en proposer, dans son article « Rhetorica ad lectorem : lecture de l’avertissement des Essais12 » (1989), une analyse que l’on peut qualifier de contractuelle : faisant écho à la bona fides du droit romain des contrats, et Montaigne étant « latiniste précoce et formé aux études juridiques13 », la « bonne foy » de l’avertissement fixerait les termes d’un contrat passé avec le lecteur. Quatre ans plus tard, dans une note à son article « L’essai : un témoignage en suspens14 » (1993), André Tournon reprenait cette analyse qu’il reposait dans une perspective non plus contractuelle mais testimoniale, dans la continuité des hypothèses développées dans La glose et l’essai : cette « bonne foy » liminaire serait moins à comprendre comme une clause contractuelle – puisque « si le livre présenté en cet avis est “de bonne foi”, c’est précisément dans la mesure où il ne propose pas le contrat usuel d’échange15 » – que comme une qualité propre au témoin devant assurer le juge de sa crédibilité, de la véridicité de son témoignage16. Dans la mesure où le présent travail ne porte pas 91directement sur l’occurrence de l’avis « Au lecteur », qu’il s’emploie à mettre en perspective avec les autres apparitions de la « bonne foy » dans l’œuvre, nous insisterons sur d’autres logiques juridiques que celles du contrat et du témoignage, qui s’inscrivent néanmoins dans le cadre élaboré par ces analyses.
Nous commencerons par présenter quelques traits juridiques de la notion, non pas pour en tirer une définition correspondant à l’usage qu’en fait Montaigne, mais pour mettre évidence ce par quoi la bona fides/bonne foi se distingue de la fides ; pour justifier, par ailleurs, les rapprochements qui seront établis par la suite entre les différentes occurrences de la notion dans l’œuvre, ainsi qu’entre ces occurrences et les phénomènes textuels plus larges que sont le modèle gnoséologique et l’éthique de la parole que l’œuvre met en place.
Aspects de la bonne foi dans le droit savant (xiie-xive siècle)
Dans les quatre parties du Corpus iuris civilis, codification tardive du droit romain qui est l’objet principal des commentaires des jurisconsultes médiévaux et renaissants, la bona fides recouvre trois acceptions principales, qui peuvent se recouper théoriquement mais correspondent à la résolution de cas spécifiques. Il peut s’agir d’abord de la bonne foi conçue généralement, comme contraire de la fraude et du dol, de la tromperie. Cette bonne foi, qui est requise dans tout contrat17, et qui consiste, comme l’écrit Hugues Doneau dans la seconde moitié du xvie siècle, « à faire et à ne pas faire18 », c’est-à-dire à ne rien simuler ni dissimuler à celui avec qui l’on forme un contrat, désigne un état d’esprit proche du fair play, que les dictionnaires juridiques du xvie siècle circonscrivent au moyen d’expressions variées : il s’agit de « négocier loyalement et dans un esprit de droiture », de « s’appliquer à la négociation sans dol 92et sans fraude19 », d’agir « sans la moindre feinte20 », « sans duperie, astuce ni malice21 ».
De portée générale, cette première acception est toutefois la moins représentée, dans les textes du Corpus iuris civilis eux-mêmes autant que dans les commentaires auxquels ils donnent lieu, entre la renaissance du droit savant à la fin du xiie siècle, et la fin du xvie siècle. La notion se rencontre beaucoup plus fréquemment dans une forme plus restreinte, spécifique au cas du « possesseur de bonne foi » (possessor bonæ fidei), qui se trouve en possession d’un bien qu’il a acquis avec la conviction que celui qui le lui a vendu en était bien le propriétaire, ou était bien en droit de le lui vendre (en qualité, par exemple, de tuteur ou de mandataire22). La bonne foi désigne alors la croyance erronée mais non répréhensible que peut avoir quelqu’un en la régularité juridique de la situation dans laquelle il se trouve. Répandue dans le droit coutumier autant que dans le droit savant au xvie siècle23, cette forme de la bona fides est la plus riche de conséquences dans la procédure ; désignant une ignorance excusable – proche de l’ignorance « invincible » de la théologie morale24 – sa fonction est de faire reconnaître les effets d’un acte juridique en dépit de l’illégalité de celui-ci, en faisant accéder le possessor bonæ fidei à une série de droits, à commencer par la jouissance des fruits de la possession, et, surtout, le droit de prescription acquisitive, c’est-à-dire d’acquisition de la propriété d’un bien possédé depuis un certain temps, droit auquel ne peut prétendre le possesseur de mauvaise foi (possessor malæ fidei)25. C’est 93en vue de ces effets, écrit Alciat dans son commentaire du De verborum significatione, « qu’il importe grandement de savoir quand est-ce qu’un possesseur est de bonne foi26 ».
La bona fides connaît enfin une troisième acception, dans la dénomination d’un certain type d’actions en justice, les « actions de bonne foi » (actiones bonæ fidei), que les Institutes de Justinien distinguent des « actions de droit strict » (actiones stricti iuris)27. Dans la formule de ces actions (qui sont au nombre de dix-sept, découlant de dix-sept types de contrats parmi lesquels figurent par exemple le contrat de vente, de dépôt ou de prêt à usage), le magistrat romain ajoutait une clausule telle que ex bona fide, qui autorisait le juge, nous dit le texte des Institutes, à « estimer librement ce que le demandeur doit au défendeur », suivant « ce qui est bon et équitable », sans être rigoureusement tenu, comme dans les actions « de droit strict », par les termes exacts du contrat ayant donné lieu au litige. Mentionné par Cicéron dans le De officiis28, ce dernier sens de la bonne foi est, des trois, le seul qui pose un réel problème d’interprétation aux commentateurs médiévaux et renaissants : si tous les contrats exigent qu’on s’y applique « de bonne foi », loyalement, comment comprendre cette liste par laquelle les jurisconsultes romains distinguent une catégorie de contrats dits « de bonne foi », dans laquelle tous n’entrent pas ? Cette catégorie des « contrats de bonne foi » signifierait-elle qu’il existerait des contrats dans lesquels la bonne foi ne serait pas exigée, ou le serait, du moins, à moins forte raison ?
94Bien que rapidement résolue, cette difficulté est cruciale dans la progressive conceptualisation que connaît la bonne foi entre le xiie et le xvie siècle, car elle va pousser les jurisconsultes à rapprocher la bonne foi du concept d’équité. Voici ce qu’écrit par exemple Azon dans sa glose des Institutes, qui explicite le problème posé par ce passage et y apporte une solution, après avoir fidèlement reproduit la liste des dix-sept actiones bonæ fidei :
Mais il faut chercher en quoi les actions énumérées ci-dessus sont qualifiées « de bonne foi » plus que toutes les autres, qui sont de droit strict. Est-ce parce que dans ces dernières, le dol peut être employé impunément, mais ne peut pas l’être dans les actions de bonne foi ? Je réponds que non : il n’est aucun contrat dans lequel le dol peut être commis impunément ; bien au contraire, celui-ci est purgé dans l’action de bonne foi comme dans celle de droit strict […]. [Ces actions] sont en effet qualifiées « de bonne foi » […] car le juge, dans celles-ci, a tout pouvoir pour faire observer ce qu’exige l’équité ou la bonne foi, et ce, même si les contractants n’en n’avaient pas convenu, ou même s’il n’y avaient pas pensé29…
La bona fides dont il est question dans ce paragraphe des Institutes est donc relative au pouvoir d’appréciation dont le juge dispose dans l’interprétation des contrats, et non à la bonne foi des contractants, qui est attendue dans ces contrats de la même manière que dans tous les autres. La distinction apparaît ici nettement entre le plan de formation du contrat et celui de son interprétation par le juge : c’est sur ce second plan qu’est positionnée la bonne foi, qui est associée à l’æquitas et est donc définie comme un critère d’interprétation auquel le juge doit se référer. Ce critère est relatif à la marge de manœuvre dont le juge dispose dans l’évaluation des obligations contractuelles ayant donné lieu à l’action, et lui permet de faire observer aux contractants des obligations ne figurant pas stricto sensu dans la lettre du contrat. Dans les commentaires suscités par ce paragraphe des 95Institutes30, la bonne foi se trouvait ainsi détachée de la seule idée de loyauté requise par ceux qui contractent, pour devenir, opposée au droit strict, un des instruments de l’équité.
Ce glissement de sens dans la notion fait qu’au xvie siècle, c’est la plupart du temps dans ce cadre de l’équité que les jurisconsultes comprennent la bonne foi. Dans ses Commentariorum Iuris Civilis, le jurisconsulte parisien François de Connan (1508-1551), formé à Bourges, clôt ainsi le chapitre qu’il consacre à l’équité par un rapprochement avec la bonne foi, en considérant que « ce qu’on nomme l’équité dans l’interprétation des lois, s’appelle, dans les contrats, la bonne foi31 ». Un des textes fondateurs de l’humanisme juridique, les Annotations sur les Pandectes de Guillaume Budé (1508), joua certainement un grand rôle dans l’explicitation de cette analogie, dans la mesure où ces contrats de bonne foi sont un des exemples cités par Budé pour justifier le parallèle qu’il opère entre la formule bonum et æquum du droit romain et l’epikeia aristotélicienne32. Quand Jean de Coras commentera les Institutes en 1555, il considérera ainsi comme des quasi synonymes ces trois concepts de bona fides, bonum & æquum et epikeia33.
Ce progressif appariement de la bonne foi à l’équité a ainsi pour conséquence de détacher la bonne foi des enjeux liés à la fides, à la fidélité à la parole donnée. Parce qu’il a pour objectif de faire observer des obligations « non convenues » ou « tacites », pour reprendre les formules d’Azon, le critère de la bona fides déborde le champ de ce qui a été explicitement promis. On comprend pourquoi les juristes furent amenés, dans ce but, à distinguer fides et bona fides, cette dernière tentant de circonscrire des obligations qui, parce que non stipulées, échappaient nécessairement au cadre de la première : tenir la parole donnée, respecter les engagements formulés, les exigences de la fides96relèvent du droit strict plus que de la bonne foi. Dans son commentaire du paragraphe Actionum autem des Institutes, en 1581, Hugues Doneau écrivait ainsi :
Et combien y a-t-il d’éléments, dans les contrats de bonne foi, qui sont observés eu égard au bonum et æquum, au sujet desquels rien n’a été auparavant promis ou même absolument dit, et donc où aucune parole [fides] n’a été donnée34 ?
Attachée aux deux idées d’ignorance excusable et d’équité, la bonne foi est donc l’expression dans le droit d’une forme de méfiance envers une interprétation trop stricte des paroles. Elle permet de faire reconnaître les droits de celui qui ignorait que le contrat qu’il a formellement passé était illégal, ou bien de faire observer des obligations échappant à ce que le contrat stipule explicitement. La bonne foi est pensée et utilisée par le droit comme un instrument permettant de faire primer l’esprit sur la lettre du contrat, un outil de remédiation pour échapper aux pièges dans lesquels pourrait conduire une interprétation au pied de la lettre des clauses stipulées.
« Bonne foy »
et reconnaissance dans les Essais
C’est ainsi par le rapport au savoir et au langage qu’elle instaure que se caractérise la notion, qui cherche à prendre en charge les limites de la connaissance humaine d’une part (ignorance excusable), les limites inhérentes à toute parole d’autre part (dans le cadre de l’équité), qui permet au juge de s’écarter des clauses explicitement stipulées pour faire prévaloir l’esprit de l’engagement sur la lettre et le formalisme du contrat. Ces traits conceptuels par lesquels la bonne foi se singularise vis-à-vis de la fides (dans et hors du droit) en font une notion heuristique féconde pour une lecture des Essais et du modèle gnoséologique et 97éthique qu’ils déploient, duquel participent une partie des occurrences de la « bonne foy » dans l’œuvre. En suivant ces occurrences, on observe en effet que ce n’est pas d’abord dans le paradigme de la fides, à propos du respect de la parole donnée, que Montaigne la mobilise, mais sur deux autres plans : celui de la critique pyrrhonienne des prétentions de la raison humaine à atteindre la vérité d’une part, celui de l’éthique de la « conférence » que l’œuvre met en place d’autre part. Ce n’est ainsi pas au mensonge, à la tromperie ou à la déloyauté que la notion se trouve opposée, mais à ces deux vices de la raison et du discours que sont la « présomption » et l’« opiniâtreté », contre lesquels s’élaborent la gnoséologie et l’éthique des Essais. Face à ces formes viciées de la sagesse et de l’art de conférer, la bonne foi apparaît comme la marque d’un remède commun, consistant en la faculté de la raison et du discours à reconnaître leurs limites et leurs erreurs.
Le verbe « reconnaître » est ici employé à dessein, car la bonne foi se trouve en effet associée dans le texte, lexicalement parfois, sémantiquement le plus souvent, à la notion de reconnaissance, dont Olivier Guerrier a montré comment elle ouvrait sur la pratique heuristique et éthique élaborée par les Essais. Les analyses qui suivent se situent ainsi dans le sillage de ses travaux sur cette notion35. Au fil de ses occurrences, la « bonne foy » semble venir modaliser, sur les deux plans de la recherche de la connaissance et de la pratique de la conférence, le geste du reconnaître, dans l’un des sens identifiables dans les Essais, qui associe la reconnaissance à l’aveu, à la confession, à la concession pourrait-on dire, au fait d’admettre nos limites, d’admettre que nous étions dans l’erreur ou qu’un autre était dans le vrai36. Cette association entre bonne foi et reconnaissance lexicalise ainsi le rapport de la bonne foi à l’ignorance, ainsi que la défiance qu’elle exprime vis-à-vis d’un rapport trop étroit au langage, du goût trop prononcé de la littéralité dont doit se garder la parole consciente de sa précarité, capable d’admettre ses erreurs voire de parler contre elle-même. La notion relève ainsi de la sagesse socratique qu’exprime la thématique de la « reconnaissance de l’ignorance », si fréquente dans l’œuvre qu’elle peut apparaître, comme l’écrit Olivier Guerrier, « comme une des clés de voûte du livre37 ».
98Cette convergence des deux notions a d’abord lieu dans « De la præsumption », où la « bonne foy » vient préciser l’acte de reconnaissance, l’appareillage des deux constituant ce qui serait pour Montaigne un des gestes philosophiques par excellence :
La philosophie ne me semble jamais avoir si beau jeu que quand elle combat nostre presomption et vanité, quand elle reconnoit de bonne foy son irresolution, sa foiblesse et son ignorance. Il semble que la mere nourrise des plus fauces opinions et publiques et particulieres, c’est la trop bonne opinion que l’homme a de soy38.
Ce jugement sur la philosophie dérive dans l’essai du constat que fait Montaigne de sa tendance à dévaloriser ses propres actions du seul fait qu’elles sont siennes, tendance que confirment et attisent, nous dit-il, ses goûts en matière de lectures philosophiques, puisqu’il prise d’abord « celles qui nous mesprisent, avilissent et aneantissent le plus39 ». La bonne foi, qui se signale ici comme garde-fou à la philautie, réside dans l’aveu d’ignorance qui doit guider la philosophie dans la recherche de la sagesse, dans la conscience de ses propres limites que doit avoir la raison humaine dans son exercice.
Rien de surprenant donc, à ce que la notion apparaisse à propos de Pyrrhon dans l’« Apologie de Raimond Sebond », pour figurer ce même geste du reconnaître entendu comme geste philosophique, bien que ce dernier verbe soit lexicalement absent du passage :
Les privileges fantastiques, imaginaires et faux, que l’homme s’est usurpé, de regenter, d’ordonner, d’establir la vérité, il les a, de bonne foy, renoncez et quittez40.
À propos de Pyrrhon, la phrase met en scène le même geste philosophique de retrait, de renoncement aux présomptions de la raison humaine. C’est dans ce geste en lui-même que semble résider la bonne foi, dans cet aveu, ce suspens symptomatique du renoncement pyrrhonien à atteindre une vérité fixe.
Liée à la reconnaissance de l’ignorance, la bonne foi participe également dans ce passage d’un jeu de l’esprit et de la lettre. L’extrait 99cité s’inscrit en effet dans une défense de Pyrrhon, dans la réfutation d’une critique à son encontre, que Montaigne a exposée plus haut en soulignant qu’elle se caractérise par une manière de prendre abusivement Pyrrhon au mot, d’interpréter au pied de la lettre sa philosophie pour prendre les pyrrhoniens au piège de leur propre doctrine :
Quiconque imaginera une perpetuelle confession d’ignorance, un jugement sans pente et sans inclination, à quelque occasion que ce puisse estre, il conçoit le Pyrronisme. […] Quant aux actions de la vie, ils sont en cela de la commune façon. Ils se prestent et accommodent aux inclinations naturelles, à l’impulsion et contrainte des passions, aux constitutions des loix et des coustumes et à la tradition des arts. Non enim nos Deus ista scire, sed tantummodo uti voluit41. Ils laissent guider à ces choses là leurs actions communes, sans aucune opination ou jugement. Qui fait que je ne puis bien assortir à ce discours ce que on dict de Pyrrho. Ils le peignent stupide et immobile, prenant un train de vie farouche et inassociable, attendant le hurt des charretes, se presentant aux precipices, refusant de s’accommoder aux loix. Cela est encherir sur sa discipline. Il n’a pas voulu se faire pierre ou souche ; il a voulu se faire homme vivant, discourant et raisonnant, jouïssant de tous plaisirs et commoditez naturelles, embesoignant et se servant de toutes ses pieces corporelles et spirituelles en regle et droicture. Les privileges fantastiques, imaginaires et faux, que l’homme s’est usurpé, de regenter, d’ordonner, d’establir la vérité, il les a, de bonne foy, renoncez et quittez42.
La bonne foi joue ici à deux niveaux : dans l’aveu d’ignorance pyrrhonien (dans le geste du « reconnaître de bonne foi »), mais aussi dans la défense qu’en fait Montaigne, défense qui consiste à faire primer l’esprit de la doctrine sur sa lettre, pour ne pas déduire de l’épochè pyrrhonienne le portrait sarcastique de Pyrrhon que dépeignent ses détracteurs. Ces derniers, en effet, « [enchérissent] sur sa discipline » ; la brièveté de la proposition, succédant à l’énumération des traits de la caricature, met en évidence le malin plaisir qu’ils se font à prendre au mot l’enseignement de Pyrrhon, pour en tirer des conséquences en réalité contraires à l’esprit de celui-ci. La progression du texte et la place qu’y occupe la « bonne foy » peut être rapprochée de la défiance exprimée à plusieurs reprises par Montaigne vis-à-vis des interprétations trop littérales des discours, 100les nôtres ou ceux d’autrui, ou bien de la manière qu’il a d’anticiper les conséquences qui pourraient être tirées d’une lecture trop stricte de son propre texte, pour désamorcer celles-ci en les admettant par avance. C’est par exemple le cas lorsqu’il évoque son plaisir de voyager, dans « De la vanité » :
Je sçay bien qu’à le prendre à la lettre, ce plaisir de voyager porte tesmoignage d’inquietude et d’irresolution. Aussi sont ce nos maistresses qualitez et praedominantes. Ouy, je le confesse, je ne vois rien, seulement en songe et par souhait, où je me puisse tenir ; la seule varieté me paye, et la possession de la diversité, au moins si aucune chose me paye43.
Le motif de la reconnaissance « en bonne foi » joue ainsi dans la représentation par Montaigne de la réception de son propre discours, où il s’articule à la question de l’interprétation « à la lettre44 ».
Le « reconnaître de/en bonne foy » figure ainsi sur le plan gnoséologique des Essais un geste de renoncement aux présomptions de la raison humaine ; l’aveu d’ignorance sur lequel il repose est également thématisé, dans une logique plus proprement discursive, au sein de l’éthique de la « conférence » que l’œuvre met sur pied. La reconnaissance des limites de la raison correspond en effet à la reconnaissance des limites de la parole et à la faculté que doit avoir celle-ci d’admettre ses erreurs, de parler contre soi. Montaigne en fait démonstration à propos de lui-même dans « De l’expérience », lorsqu’il tourne en dérision les prétentions scientifiques de la médecine :
Pour Dieu, que la medecine me face un jour quelque bon et perceptible secours voir comme je crieray de bonne foy, Tandem efficaci do manus scientiæ45.
Bien que ce soit sur le mode de l’ironie, la bonne foi modalise encore ici l’aveu d’une parole capable de se dédire, lorsqu’elle se trouve confrontée à la preuve de son erreur. La forme viciée de cette reconnaissance serait ainsi le maintien d’une parole envers et contre tous, niant l’évidence du vrai alors même qu’il se présente à elle.
101Voilà certainement pourquoi l’opiniâtreté et la chicane46 sont présentées par Montaigne comme deux des pires écueils de l’art de conférer :
Il est impossible de traitter de bonne foy avec un sot. Mon jugement ne se corrompt pas seulement à la main d’un maistre si impetueux, mais aussi ma conscience47.
Cette sottise à laquelle la bonne foi est inaccessible correspond à l’opiniâtreté engendrant les disputes où le discours se dissipe dans ses propres formes, ne repose plus sur aucune adhésion du locuteur à ses paroles :
Mais quand la dispute est trouble et des-reglée, je quitte la chose et m’attache à la forme avec despit et indiscretion, et me jette à une façon de debattre testue, malicieuse et imperieuse, dequoy j’ay à rougir apres48.
Dans cette forme viciée de la conversation, que l’on pourrait rapprocher du rejet du marchandage par Montaigne49, le dialogue s’empêtre dans des subtilités langagières où finit par disparaître le vrai qu’il s’agissait d’atteindre, en convainquant ou en étant convaincu :
Nous n’aprenons à disputer que pour contredire, et, chascun contredisent et estant contredict, il en advient que le fruit du disputer c’est perdre et aneantir la verité50.
102À l’inverse, la bonne foi évite à la conférence de tourner en chicane, puisque le locuteur de bonne foi s’avère capable de reconnaître qu’il avait tort, d’admettre les raisons de l’autre, sans s’employer à maintenir formellement les siennes dans le seul but de ne pas se désavouer. Dans le tableau presque épique qu’il dresse de la dispute dans « De l’art de conférer », Montaigne souligne ainsi les méfaits d’une trop grande valeur accordée à ses propres paroles par celui qui « compte ses mots, et les poise pour raison », qui « ne voit rien en la raison, mais […] vous tient assiegé sur la closture dialectique de ses clauses et sur les formules de son art51 ». En contrepoint à ce nuisible apprentissage de l’art de contredire, la confession est présentée dans « De l’institution des enfans » comme « un effet de jugement et de sincérité » : « se raviser et se corriger, abandonner un mauvais party sur le cours de son ardeur, ce sont qualitez rares, fortes et philosophiques52 ».
On peut pour finir renvoyer à l’exemple que nous donne le Journal de Voyage53 d’une de ces situations de conférence pour lesquelles Montaigne ne cesse de répéter son goût et de définir des règles. Dans la partie rédigée de sa main, le Journal rapporte en effet une conversation qu’il eut à Rome, autour d’un dîner en compagnie d’un ambassadeur français, de Marc-Antoine Muret et d’« autres savants54 ». La discussion se porte alors sur la traduction de Plutarque par Amyot, qui est l’objet d’un désaccord entre Montaigne et les autres participants :
…contre ceux qui l’estimaient beaucoup moins que je ne fais, je maintenais au moins cela : que, où le traducteur a failli le vrai sens de Plutarque, il y en a substitué un autre vraisemblable et s’entre-tenant bien aux choses suivantes et précédentes55.
103Si le verbe « maintenir » campe le locuteur sur ses positions, celui-ci commence de s’en déloger par la concession qu’introduit la locution adverbiale « au moins », concession qui se trouve confirmée, dans la suite du texte, par l’apparition du « reconnaître en bonne foi » :
Le grec, disent-ils, sonne […]. Au lieu de ce sens clair et aisé, celui que le traducteur y a substitué est mol et étrange. Par quoi, recevant leurs présuppositions du sens propre de la langue, j’avouai de bonne foi leur conclusion56.
Dans le cadre de la conférence et du rapport au savoir et au langage qu’elle doit mettre en œuvre, la bonne foi permet ainsi, par-delà les formalités du langage et l’amour de soi qui peut empêcher un locuteur d’admettre une opinion dont il est pourtant intérieurement persuadé, une forme de « venue à la raison », conditionnée par la bonne volonté57, et dont le geste discursif de la reconnaissance constitue l’acte privilégié58.
Ainsi, la « bonne foy » n’est pas d’abord employée dans les Essais, de même que dans le Journal, comme revers du mensonge ou de la tromperie, mais bien de la présomption et de l’opiniâtreté ou de la chicane, sur le double plan du rapport au savoir et au langage que l’œuvre élabore. Par l’aveu d’ignorance sur lequel elle repose, et par l’attention qu’elle porte à ce que les mots ne suscitent pas d’interprétation qui outrepasse ou dévie leur intention, la notion occupe ainsi une position singulière au sein du décalage entre la gnoséologie pyrrhonienne dont les Essais sont l’expression et l’intransigeance de Montaigne dans sa condamnation du mensonge59. Le fonctionnement qui se dégage des quelques occurrences étudiées montre comment, sur le plan de la recherche de la vérité 104(menée seul ou de pair avec l’autre dans la conférence), la bonne foi confère une positivité à l’acte de se dédire, aux antipodes du discours que tient Montaigne au sujet du « démentir » ou de la tromperie, sur le plan de la parole donnée. Envisagée hors du modèle de la fides, elle apparaît comme l’expression d’un rapport à la vérité qui est sans doute à rapprocher de l’usage qui est fait de la figure de Démade dans « Du repentir » : « Tant y a que je me contredits bien à l’adventure, mais la verité, comme disoit Demades, je ne la contredy points60 ».
Concluons d’un mot sur l’avis « Au lecteur », et sur la « bonne foy » que Montaigne prédique de son livre dans la première phrase61. L’analyse des autres occurrences de la notion dans l’œuvre conduit à une lecture de l’Avis qui, tout en identifiant le premier point d’application de cette « bonne foy » dans l’aveu de faiblesse formulé par les trois phrases qui suivent, souligne néanmoins la portée de celle-ci à l’échelle de l’œuvre entière. Cette lecture s’inscrit dans la continuité de celle proposée par André Tournon, qui refuse de « restreindre la portée de cette revendication de véracité au seul “avertissement” dissuasif qui déclare l’ouvrage stérile62 », ainsi que de celle d’Antoine Compagnon, dans l’article cité en introduction du présent travail : en ce qui concerne la portée de l’affirmation liminaire de « bonne foy », l’analyse attentive à ce qui dissocie la bonne foi et la fides aboutit aux mêmes conclusions que l’analyse qui voit dans la bonne foi un avatar de la fides63. Si l’Avis participe à coup sûr d’une d’une rhétorique paratextuelle traditionnelle, d’une captatio benevolentiæ proche de l’ecusatio propter infirmitatem64, il n’en 105reste pas moins que la désignation du « livre de bonne foy » recourait d’entrée de jeu, et dès 1580, à une notion consubstantielle au mouvement gnoséologique et éthique de l’œuvre. L’invitation paradoxale à ne pas lire adresse aussi une demande au lecteur, celle de ne pas prendre trop au pied de la lettre une parole qui vaut parce qu’elle est « sans dessein et sans promesse65 ».
Clément Beuvier
Doctorant, Université de Tours /Centre d’études supérieures
de la Renaissance
1 Cette communication est issue d’un travail de thèse en cours sur les usages de la notion de bonne foi au xvie siècle (Université de Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance), co-dirigé par Stéphan Geonget et de Laurent Gerbier.
2 Voir en particulier, pour la parole donnée, I, 5 (« Si le chef d’une place assiégée, doit sortir pour parlementer »), I, 6 (« L’heure des parlemens dangereuse ») ou III, 1 (« De l’utile et de l’honneste ») ; pour le mensonge, I, 9 (« Des Menteurs ») et II, 18 (« Du Démentir »).
3 Antoine Compagnon, « Montaigne ou la parole donnée » dans F. Lestringant (éd.), Rhétorique de Montaigne, Paris, Champion, 1985, p. 9-19. Cet article analyse le motif de la parole donnée dans la perspective du rapport des Essais à la rhétorique.
4 Ibid., p. 19. La formule latine est tirée de la définition de la fides comme dictorum conventorumque constantia et veritas que donne Cicéron dans le De officiis (I, vii, 23), souvent citée au xvie siècle.
5 Sur cet écart voir notamment, dans des perspectives différentes : Antoine Compagnon, art. cité, p. 13-14 et 18-19 ; Olivier Guerrier, Rencontre et reconnaissance, Paris, Garnier, 2016, p. 167-169 ; Gisèle Mathieu-Castellani, Montaigne ou la vérité du mensonge, Paris, Droz, 2000, p. 20-23.
6 Antoine Compagnon, art. cité, p. 14.
7 Voir en particulier Pierre Boyancé, « Les Romains, peuple de la fides », dans Bulletin de l’Association Guillaume Budé, no 23, décembre 1964, p. 419-435 ; Joseph Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des parties politiques sous la République, Paris, Les Belles Lettres, 1972.
8 Sur les différents sens de la fides dans la culture romaine, voir en particulier GérardFreyburger, Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu’à l’époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986 ; J. Hellegouarc’h, op. cit. ; Roberto Fiori, « Fides et bona fides. Hiérarchie sociale et catégories juridiques », dans Revue historique de droit français et étranger, vol. 86, no 4, octobre-décembre 2008, p. 465-481.
9 Roberto Fiori, op. cit., p. 473. Comme le montre Roberto Fiori, s’il est abusif de considérer que la formule n’apparaît pas hors du champ juridique dans la littérature latine, comme a pu le soutenir Luigi Lombardi (Dalla « fides » alla « bona fides », Milan, A. Giuffrè, 1961), celle-ci constitue néanmoins la « déclinaison [de la fides] presque uniquement dans le contexte du droit privé » (p. 473).
10 Une première fois dans l’avis « Au lecteur », puis en II, 10 (417A, 419A), II, 12 (467B, 505A), II, 17 (634A), II, 32 (626A), III, 6 (910B), III, 8 (925C) et III, 13 (1079B). Nos références aux Essais renverront à l’édition de P. Villey et V.L. Saulnier, Paris, PUF, 1992.
11 André Tournon, Montaigne. La glose et l’essai, édition revue et corrigée, précédée d’un Réexamen, Paris, Champion, 2000, p. vi.
12 Michel Simonin, « Rhetorica ad lectorem : lecture de l’avertissement des Essais », dans Montaigne Studies, vol. I, Hestia Press, novembre 1989, p. 61-72.
13 Ibid., p. 63.
14 André Tournon, « L’essai : un témoignage en suspens », dans Jules Brody et al., Carrefour Montaigne, Pise/Genève, Edizioni Ets/Slatkine, 1994, p. 117-145.
15 Ibid., p. 143, note 21.
16 On peut également mentionner l’analyse plus récente de Michael Randall, qui envisage quant à lui la « bonne foy », comme Antoine Compagnon, au sein du discours montaignien sur l’utile et l’honnête, à partir de l’étude d’un commentaire de François Douaren sur la fides dans les pactes : Michael Randall, « Montaigne et des juges véreux », Les Dossiers du Grihl[en ligne], 2017-02 : https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6778 (consulté le 12/03/2021).
17 Voir en particulier C. 4. 37. 3, le titre du Code cité par les juristes pour souligner l’exigence universelle de bonne foi dans l’exercice contractuel.
18 Hugues Doneau, Opera omnia, Lucques, Giovanni Riccomini, 1762-1770, vol. VII, col. 829 : « Consistit autem bona fides in faciendo, & in non faciendo ».
19 Jacob Stoer, Lexicon iuridicum…, Genève, Jacob Stoer, 1607, p. 154 : « sincere, et ex animi integritate negocia tractare », « sine dolo & fraude versari ».
20 Jakob Spiegel, Lexicon iuris civilis…, Bâle, Johann Herwagen, 1554, fol. h ro : « citra ullum figmentum facere ».
21 Joannis Calvini alias Kahl, Lexicon iuridicum, Genève, Petrus Balduinus, 1622,p. 119-120 : « Bona fides alias contraria est fraudi, dolo, astutiis, malitiæ ».
22 D. 50. 16. 109.
23 Voir par exemple Jacques d’Ableiges, Le grand coustumier de France…, Paris, Jean Houzé, 1598, p. 235 ; Antoine Loisel, Institutes coustumieres…, Paris, Abel l’Angelier, 1607, p. 62-63.
24 Sur ce point voir Jean-Pierre Massaut, « Les droits de la conscience erronée dans la théologie catholique moderne », dans H. R. Guggisberg, F. Lestringant et J.-C. Margolin (éd.), La liberté de conscience (xvie-xviie siècles), Genève, Droz, 1992, p. 237-255.Je remercie Stéphan Geonget de m’avoir indiqué cette référence.
25 Nous laissons ici de côté l’apport décisif du droit canon à ce cas de la possessio bonæ fidei. Le droit romain ménageait en effet des exceptions à l’impossibilité d’acquérir par prescription pour le possesseur de mauvaise foi. La loi et la doctrine prévoyaient, d’abord, certains cas dans lesquels ce dernier pouvait acquérir par prescription après trente ans de possession de la chose, là où le possesseur de bonne foi le pouvait après dix ans (voir notamment la Novelle 110. 7), selon un principe qui se retrouve d’ailleurs dans les Institutes de Loisel (éd. citée, p. 62). La prescription acquisitive, ensuite, ne requérait la bonne foi qu’au commencement de la possession, c’est-à-dire qu’il suffisait au possesseur d’avoir été de bonne foi au moment de l’acquisition, eût-il appris par la suite que le vendeur n’était en réalité pas en droit de lui vendre le bien en question (voir par exemple D. 41. 10. 4). Dès le xiiie siècle, les autorités canoniques ont levé ces deux conditions, en élargissant l’exigence de bonne foi dans la prescription. On peut citer comme exemple le canon Quoniam omne de 1215 (reproduit dans les Décrétales, X. 2. 26. 20), qui suspend la possibilité de la prescription avec mauvaise foi, et le canon Veniens de 1212 (X. 2. 26. 19), qui étend l’exigence de bonne foi à toute la durée de la possession, et non seulement au commencement de celle-ci.
26 André Alciat, De Verborum significatione, Lyon, Sébastien Gryphe, 1530, p. 169 : « Multum interest scire, quando quis bonæ fidei possessor sit. Is enim & fructu lucratur, & longo tempore præscribit. »
27 Inst. 4. 6. 28.
28 III, xv, 61.
29 Azon, Summa azonis, locuples iuris civilis thesaurus, Bâle, Johann Herwagen, 1563, fol. Cc 3 ro, col. 1151, no 41 : « Sed & illud quærendum est, quare superiores magis dicuntur bonæ fidei, quam aliæ omnes quæ sunt stricti iuris. Nunquid enim illæ dicuntur magis bonæ fidei quam aliæ, quia in aliis impune committitur dolus, sed non committitur impune in his, quæ sunt bonæ fidei ? Respondeo non : in nullo enim contractu impune committitur dolus, imo purgatur in actione bonæ fidei, & stricti iuris. ut nota.in sum. C. de dolo.§.nunc autem. » « Dicuntur enim bonæ fidei […] : quia in eis pleniorem iudex habet potestatem ad omnia exequenda, quæ suadet æquitas vel bona fides, licet de eis non convenerint, vel cogitaverint… »
30 Un chapitre de notre thèse est consacré au développement théorique de la bona fides que ce paragraphe suscite entre le xiie et le xvie siècle.
31 François de Connan, Commentariorum Iuris Civilis, Bâle, Nicolaus Episcopius, 1557 [1538], p. 73, no 12 : « Quæ vero in legibus explanandis æquitas nominatur, in contractibus bona fides appellatur… »
32 Guillaume Budé, Annotationes in quatuor et viginti pandectarum libros, Paris, Josse Bade, 1508, fol. l ro.
33 Jean de Coras, In Titulum Iustiniani de actionibus, Commentariolus, Lyon, Antoine Vincent, 1555, p. 121 : « Indeque tractum, ut naturalis æquitas, & simplicitas ab omni iuris subtilitate, & stricta ratione distincta, quam Græci ἐvιexeiam, nos bonum & æquum, dicimus : in iure nostra, Bonæ fidei verbo, plerunque significetur. »
34 Hugues Doneau, op. cit., vol. VI, col. 764 : « At quam multa sunt in contractibus bonæ fidei, quæ servantur ex æquo & bono, de quibus prius nihil promissum aut dictum etiam omnino est, eoque ubi nulla fides est data ? » Je remercie Daniel Saulnier de son aide pour la traduction de ce passage.
35 Olivier Guerrier, Rencontre et reconnaissance, op. cit.
36 Ibid., p. 217-219.
37 Ibid., p. 218.
38 II, 17, 734A.
39 Ibid.
40 II, 12, 505A.
41 « Car Dieu a voulu que nous ayons non pas la connaissance mais seulement l’usage de ces choses » (Cicéron, De divinatione, I, 18).
42 II, 12, 505A/505C.
43 III, 9, 988B.
44 Cette analyse fait l’objet d’un développement dans notre travail de thèse en cours.
45 III, 13, 1079B. La citation latine provient des Épodes d’Horace (XVII, 1) : « Enfin, je donne les mains à une science efficace ! »
46 La notion de chicane désigne dans le droit une « difficulté que l’on soulève dans un procès sur point mineur pour embrouiller l’affaire » (définition TLF). Montaigne utilise à plusieurs reprises cette notion dans sa critique de la procédure judiciaire (II, 12, 564A, II, 657A ; III, 9, 947B ; III, 10, 1019B ; III, 13, 1067B). Nous employons aussi cette notion pour souligner la portée juridique de la notion de « conférence », récemment rappelée par Stéphan Geonget : « Les enjeux juridiques du terme de “conférence” (III, 8) », dans Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, no 65, 2017-1, p. 49-64.
47 III, 8, 925C.
48 Ibid., 925B.
49 Dans le sillage des analyses de Philippe Desan dans Les Commerces de Montaigne (Paris, Nizet, 1992), en particulier dans les chapitres iii, v et vi, qui montrent comment Montaigne rejette le marchandage comme figure du rapport à l’autre, on peut songer notamment à ce passage de I, 14 : « J’excepte les payements où il faut venir à marchander et conter, car si je ne trouve à qui en commettre la charge, je les esloingne honteusement et injurieusement tant que je puis, de peur de cette altercation, à laquelle et mon humeur et ma forme de parler est du tout incompatible. Il n’est rien que je haisse comme à marchander. C’est un pur commerce de trichoterie et d’impudence : apres une heure de debat et de barquignage, l’un et l’autre abandonne sa parolle et ses sermens pour cinq sous d’amandement » (I, 14, 63B). Le marchandage est ici décrit dans des termes similaires à ceux par lesquelles Montaigne décrit la « dispute » dans « De l’art de conférer ».
50 Ibid., 926C.
51 Ibid., 926B.
52 Ibid., I, 26, 155A/155C : « Qu’on luy face entendre que de confesser la faute qu’il descouvrira en son propre discours, encore qu’elle ne soit aperceue que par luy, c’est un effet de jugement et de sincérité, qui sont les principales parties qu’il cherche ; que l’opiniatrer et contester sont qualitez communes, plus apparentes aux plus basses ames ; que se raviser et se corriger, abandonner un mauvais party sur le cours de son ardeur, ce sont qualitez rares, fortes et philosophiques. »
53 Étant prises un certain nombre de précautions vis-à-vis de ce texte ; voir la note d’Alain Legros sur le site du programme MONLOE : https://montaigne.univ-tours.fr/journal-voyage/ (consulté le 01/06/21).
54 Montaigne, Journal de voyage, édition Fausta Garavini, Paris, Gallimard, 1983, p. 214.
55 Ibid.
56 Montaigne, Journal de voyage, éd. F. Garavini, Paris, Gallimard, 1983, p. 214-215.
57 On peut mentionner, à propos du rapport entre bonne foi et bonne volonté, cette phrase de « Des livres », où Montaigne décrit l’attitude de son jugement s’en prenant à soi-même de ne pas goûter la lecture de l’Axioche de Platon, plutôt que de remettre en question l’intérêt de l’œuvre et les appréciations mélioratives qu’en ont donné « tant d’autres famaux jugemens anciens » : « il se contente de se garentir seulement du trouble et du desreiglement ; quant à sa foiblesse, il la reconnoit et advoüe volontiers » (II, 10, 410A ; cité par Olivier Guerrier, op. cit., p. 218).
58 À l’entrée « Raison, Ratio » de son dictionnaire, Robert Estienne donne ainsi comme exemple « Venir à la raison & à bon compte », qu’il associe au latin « Agnoscere bonæ fidei » (Dictionnaire François latin, Paris, Robert Estienne, 1549, p. 518).
59 Comme le formule Olivier Guerrier dans Rencontre et reconnaissance, « celui qui a renoncé à toute prise sur la vérité objective, universelle et définitive, ne cesse d’affirmer dans son livre les méfaits du mensonge » (op. cit., p. 168).
60 III, 2, 805B. Montaigne détourne ce propos de Démade, qui ne porte pas, dans la Vie de Demosthenes dont il est issu, sur la vérité, mais sur la chose publique (Plutarque, Vie de Demosthenes, Les vies des hommes illustres, Grecs & Romains, comparees l’une avec l’autre par Plutarque de Chæronee, translatées premierement de Grec en François par maistre Jacques Amyot lors Abbé de Bellozane, & depuis en ceste seconde edition reveuës et corrigees en infinis passages par le mesme translateur, Paris, Michel de Vascosan, 1565, 586B-586K).
61 Dans une perspective différente, qui inscrit davantage la bonne foi dans la problématique de l’écriture du moi, voir l’analyse d’Yves Delègue dans le premier chapitre de Montaigne et la mauvaise foi, Paris, Champion, 1998, p. 15-33, en partie reprise dans « L’écriture de la “bonne foy” dans les Essais : peinture et poésie » dans Nouveau Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne, vol. 5, 2009, p. 33-40.
62 Art. cité, p. 144, note 23.
63 Voir en particulier la conclusion d’Antoine Compagnon, art. cité, p. 19, que nous reprenons ici en en déplaçant certains termes.
64 Voir Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 192-194 (la première phrase de l’avis « Au lecteur » est cependant citée par Genette comme exemple de la « fonction préfacielle » de véridicité, et non de la fonction de modestie à laquelle il rattache l’excusatio propter infirmitatem).
65 I, 50, 302C.