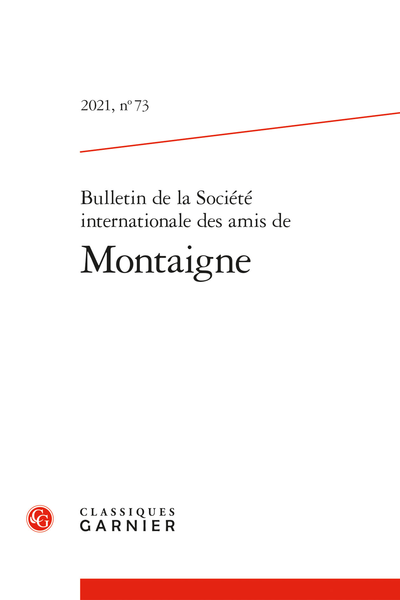
Héritages cannibales Oswald héritier de Montaigne et vice versa
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2021, n° 73. varia - Auteur : Ceppas (Filipe)
- Résumé : À partir des enjeux de l'héritage et de l'autoportrait, nous proposons une évaluation de la place des cannibales dans les Essais. Ensuite, nous revisitons la question de la bonne ou de la mauvaise nature des indigènes selon Montaigne, afin de réévaluer son importance dans les spéculations anthropophagiques d’Oswald de Andrade. Enfin, nous faisons quelques commentaires généraux sur les questions de genre concernant l'héritage cannibale de Montaigne et la critique du patriarcat chez Oswald.
- Pages : 413 à 429
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406126072
- ISBN : 978-2-406-12607-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12607-2.p.0413
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Anthropophagie, Oswald de Andrade, Montaigne, héritages, patriarcat
Héritages cannibales
Oswald héritier de Montaigne et vice versa
À Hubert Vincent.
Filiation. Le contact avec le Brésil Caraïba. Où Villegaignon print terre. Montaigne. L’homme naturel. Rousseau. De la Révolution française au Romantisme, à la Révolution Bolchevique, à la Révolution surréaliste et au barbare technifié de Keyserling. Nous avons marché.
Oswald de Andrade1
À propos des héritages – Présentation
Parlons d’héritage, d’héritage et de filiation. De quoi Oswald de Andrade hérite-t-il exactement de Montaigne ? Est-ce vraiment un héritage ou plutôt une appropriation « sauvage » ? Et quel serait l’intérêt de renverser la relation et de faire de Montaigne l’héritier d’Oswald ? Je commence par cette dernière question, qui n’a apparemment ni queue ni tête. Deux interrogations aident à en adoucir l’inconfort éventuel.
– Ne serait-ce pas un truisme de dire qu’un classique n’a de sens et de valeur que par la manière dont la tradition le lit et l’interprète2 ?
414– Est-il possible aujourd’hui de lire tout ce que Montaigne a écrit sur les peuples originels d’Amérique sans tenir compte de ce que des auteurs comme Oswald ont hérité de lui et des rebondissements de cet héritage ? (Mais de quel Montaigne ont-ils hérité ? Comme s’il y en avait un).
En ce qui concerne le premier point, bien entendu, il ne s’agit pas de truisme, mais d’un problème, sur lequel je ne m’étendrai pas ici3. La deuxième question a un sens peut-être plus précis. Dire qu’il n’est plus possible aujourd’hui de lire ce que Montaigne a écrit sur les Amérindiens en ignorant ce qu’Oswald a écrit sur Montaigne n’est valable que dans le contexte de « nos préoccupations », en relation avec « notre Montaigne », c’est-à-dire, avec ce qui fait partie de notre héritage colonial ; l’héritage d’une collectivité qui, attentive à la référence aux indigènes dans les Essais, comprend que sa lecture est indissociable d’un questionnement sur le colonialisme et sur les usages et les abus de la figure du « cannibale ». En ce sens, il ne s’agit pas seulement de relire Montaigne à partir d’Oswald, par exemple, mais de reconnaître (tâtonner, explorer, répéter, laisser parler, comprendre) la structure complexe d’un ou plusieurs héritages, héritages errants (des destinerrances, ou plutôt des errantages, pour évoquer déjà un autre héritage, celui de Derrida, qui ne restera que spectral tout au long de ce texte), ou ce que nous pourrions appeler un « héritage cannibale ».
Montaigne, notre frère cannibale
Tout commence par une collection de « grotesques4 », et un en particulier, dans lequel apparaissent les « frères » Michel de Montaigne et Oswald de Andrade, unis par le désir d’embrasser le monde, dévorant obsessionnellement toutes les coutumes, tout le dit et tout l’écrit, toute l’histoire de l’humanité5. Frères et héritiers l’un de l’autre, il reste donc à savoir ce que sont ces héritages et comment ils se produisent.
415Il est des peuples […] Où les enfants ne sont pas heritiers, ce sont les freres et nepveux ; et ailleurs les nepveux seulement, sauf en la succession du Prince. […][Il est des peuples] Où pour reigler la communauté des biens, qui s’y observe, certains Magistrat souverains ont cherge universelle de la culture des terres et de la distribution de fruits, selon le besoing de chacun6.
Tout tourne autour de l’héritage et du partage, et autour des magistrats souverains comme image paradigmatique de la justice. Pour Oswald, le grand geste de Montaigne a été d’annoncer le cannibale contre les rois, ces mangeurs de vivants :
Montaigne qui a su annoncer le cannibale. Aux mangeurs de personnes vivantes, c’est ainsi qu’il classait les puissants de son temps, il opposait les mangeurs de morts, comme une chose meilleure (Andrade 1976, p. 111, je souligne).
Ici, Oswald se réfère au célèbre passage dans lequel Montaigne compare le cannibalisme amérindien au cannibalisme omophagique7 prétendument commis lors des guerres de religion de son temps8. Anthropophagie contre omophagie, donc (nous reviendrons sur cette annonce/énonciation). 416En un mot, le Montaigne d’Oswald serait un révolutionnaire, ou du moins le seul penseur à annoncer, au xvie siècle, une révolution qui deviendrait inévitable, inéluctable, nécessaire et imminente dans les années 1950 : la révolution anthropophagique du barbare technicisé ! – et cela ne pouvait être annoncé, perçu, prévu, prophétisé, que grâce au cannibale que Montaigne a pu comprendre et qui lui a donné la règle, le carré, la jauge pour, à l’aube du capitalisme, analyser son mécanisme principal de (re)production : le maintien des inégalités économiques et sociales.
“Yardstick” est le terme choisi par Robert Launay pour parler de l’importance de la culture ancienne avec laquelle Montaigne « se mesure lui-même et le reste du monde », par opposition à l’époque précédente, où l’incarnation du Christ servait « comme moment déterminant de l’humanité9 ». Mais c’est plutôt un dialogue, et non une opposition, qui régit les contrastes, les approches et les distances que les Essais ne cessent de tracer entre la culture antique et le christianisme, en ajoutant la centralité que notre Montaigne attribue au cannibale, en tant que règle et boussole, sinon pour se mesurer et pour mesurer le reste du monde, du moins pour les relativiser de manière radicale. Dans ce dialogue, l’incarnation du Christ comme moment déterminant de l’humanité n’est pas exactement, chez Montaigne, un thème mineur ou une perspective à surmonter.
Revenons au « tableau » des différentes coutumes, à partir duquel Montaigne situe la diversité des héritages. Le passage évoqué plus haut, à propos des successions et des magistrats souverains, est au milieu d’un tourbillon d’exemples, de « grotesques », qui prouvent la diversité des coutumes et justifient le relativisme défendu un paragraphe auparavant :
Les miracles sont selon l’ignorance en quoy nous sommes de la nature, non selon l’estre de la nature. L’assuefaction [l’accoutumance]10 endort la veuë de nostre jugement. Les barbares ne nous sont de rien plus merveilleux [surprenants], que nous sommes à eux, ny avec plus d’occasion [cause] : comme chacun advoüeroit, si chacun sçavoit, apres s’etre promené par ces nouveaux exemples, se coucher sur les propres [appliquer son esprit sur ses propres exemples, sa propre expérience], et les conferer [comparer] sainement. La raison humaine est une teinture infuse environ de pareil pois [qui participe à peu près dans 417une même proportion] à toutes nos opinions et mœurs, de quelque forme qu’elles soient : infinie en matiere, infinie en diversité11.
Comme le sait tout lecteur attentif de Montaigne, ce relativisme à usage personnel n’a pas le dernier mot. Force est de reconnaître le discernement ou le jugement comme étant plus important12. Au début du chapitre « De l’amitié », Montaigne écrit :
Considérant la conduite de la besongne d’un peintre que j’ay, il m’a pris envie de l’ensuivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroy [mur], pour y loger un tableau élabouré de toute sa suffisance [capacité, talent] ; et, le vuide tout au tour, il le remplit de crotesques, qui sont peintures fantasques, n’ayant grace qu’en la varieté et estrangeté. Que sont-ce icy [que sont ces essais ?] aussi, à la verité, que crotesques et corps monstrueux, rappiecez de divers membres, sans certaine figure [sans forme déterminée], n’ayants ordre, suite ny proportion que fortuité ? Desinitt in piscem mulier formosa superne13. Je vay bien jusques à ce second point avec mon peintre, mais je demeure court en l’autre et meilleure partie : car ma suffisance ne va pas si avant que d’oser entreprendre un tableau riche, poly et formé selon l’art. Je me suis advisé d’en emprunter un d’Estienne de la Boitie, qui honorera tout le reste de cette besongne14.
418Il y a ici deux points clés : tout d’abord, Montaigne affirme la valeur du tableau principal comme la meilleure partie, c’est à dire comme la valeur même de « l’audace » attendue pour faire un « tableau riche, poly et formé selon l’art », et deuxièmement, en l’absence apparente d’une œuvre de sa propre paternité, il choisit celle dont il a hérité de son meilleur et seul véritable ami, La Boétie. Cette absence d’œuvre issue de sa propre main n’est qu’apparente, rhétorique, si nous savons reconnaître, émergeant de la montagne des grotesques, le tableau suffisamment riche et assez poly, bien que multiforme, déformé (monstrueux !), de Montaigne lui-même (« car c’est moy que je peins »), ou plutôt le portrait du mouvement de son jugement, sa recherche constante de discernement. En supposant que la recherche du bon jugement soit le portrait central, au-delà de la rhétorique – alors que le mouvement de ses grotesques (excessivement ou apparemment aléatoire, souvent contradictoire) empêche l’émergence d’une structure fixe et cohérente, comme l’auteur lui-même le dit à plusieurs reprises – c’est au lecteur de l’identifier, de le classer et de le juger.
Mais la valeur et le sens de cette « place vide » du portrait recherché, stratégiquement occupée par le texte de l’ami, apparaît à d’autres moments avec une qualification précise : celle du cannibale. C’est le livre lui-même, dès le début, de bonne foy, qui met en garde les lecteurs sur la nature du seul portrait qui puisse dominer tous les autres portraits possibles :
Je veus qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention [effort, recherche] et artifice : car c’est moy que je peins. Mes defauts s’y liront au vif, et ma forme naïfve [manière d’être naturelle], autant que la reverence publique ma l’a permis. Que si j’eusse esté entre ces nations qu’on dict vivre encore sous la douce liberté des premieres loix de nature, je t’asseure que je m’y fusse tres-volontiers peint tout entier, et tout nud15.
Antinomie incontournable de la peinture naturaliste, l’écriture d’un soi dans sa nature radicale : peindre ou écrire sans effort et sans artifice. Outre l’artifice, un autre obstacle : la décence publique. Montaigne présente donc une hypothèse, et une seule, pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Une seule condition, celle d’un « Montaigne cannibale », serait en mesure de surmonter la barrière de la révérence publique et de fournir son portrait entier et tout nu – dans le conditionnel « si j’eusse esté entre ces nations … », la certitude (« je 419t’asseure que … ») et le doute (la condition même de tout conditionnel) sont simultanément énoncés. Je laisse la question de savoir pourquoi la nudité pourrait annuler l’artifice du portrait (ce n’est pas le cas, et il n’est pas souhaitable qu’il le soit16). Le fait irréfutable est que notre Montaigne, selon ses propres termes, ne pouvait se projeter dans une simplicité pleine, totale, dans un naturel plein et total, au-delà de la simple conformité à la révérence publique, qu’en se reflétant dans le cannibale – et il le fait même, subrepticement, lorsqu’il choisit le « tableau de La Boétie » pour remplacer le sien, comme nous le verrons plus loin.
Dans ce passage d’ouverture des Essais, comme Launay l’a indiqué à juste titre, « Le cannibale – Montaigne le suggère avec espièglerie – est son alter ego17 ». On pourrait contester cela en disant qu’une seule tirade ludique ne fait pas le printemps ; bien que ce soit la seule manière que Montaigne ait trouvé pour qualifier son portrait possible, dans ce passage qui est l’avertissement au lecteur relativement à la nature même du livre – et c’est le livre lui-même qui nous en met en garde, de bonne foy, le livre dans son intégralité ou dans sa version finale. Voici les premiers mots des Essais, écrits après que l’écriture du livre soit définitivement achevée (même si elle ne l’a jamais vraiment été) : « C’est icy un livre de bonne foy, lecteur. Il t’advertit dès l’entrée, que je ne m’y suis proposé … ». On pourrait objecter que la présence du conditionnel à propos du « Montaigne cannibale » (« si j’eusse esté entre ces nations »), au début du livre, dans cet avertissement au lecteur, n’implique pas nécessairement un privilège accordé à l’image du cannibale dans les Essais. Cette exclusivité possible pourrait être interprétée de multiples façons, ce qui nécessite de l’évaluer au sein de la ronde des autres références aux « cannibales » dans l’œuvre. En acceptant ce défi, le privilège est confirmé, comme nous le verrons ci-dessous, avec l’aide du Montaigne en mouvement de Starobinski, qui ne peut être accusé d’exagérer le rôle des habitants du Nouveau Monde dans les Essais (Starobinski mentionne le sujet un peu plus d’une demi-douzaine de fois). Si la faible référence aux natifs du Nouveau Monde pourrait impliquer qu’il s’agisse d’un thème mineur, d’un simple exemple de la diversité des êtres et des coutumes, le critique suisse reconnaît son importance, sinon sa centralité sur des 420points fondamentaux, au milieu de la relation complexe que Montaigne établit entre le portrait de soi, son époque et la culture classique.
Pour commencer, on pourrait dire, avec Starobinski, que, dans tous les cas où la référence indigène apparaît dans les Essais, la vertu vient d’en bas, du plus naturel, du plus proche de l’animal, de la simplicité, du sensible. Mais, d’autre part, et simultanément, lorsqu’elle apparaît par rapport à la vie civilisée, à l’art et à la raison, cette référence rend explicite la perception d’une injustice et inverse la perspective, désormais vue d’en haut, d’une supériorité intellectuelle et morale :
La sympathie, forme expansive du sentir, inscrit l’exigence morale d’universalité au niveau élémentaire, là même où les effets de l’art et de la raison sont encore inexistants. La connivence sensible de Montaigne […] s’étend aux animaux (au cerf aux abois, au chien qui fête son maître, à la chatte qui « se joue » de lui), aux cannibales d’Amérique, aux paysans et aux « pauvres gens », à l’enfant que tourmente le pédant, à tous ceux que l’on opprime au nom d’une connaissance outrecuidante. Montaigne ne s’en tient pas à la compassion pour ces êtres « inférieurs » ; il est prêt à reconnaître, par-delà les jeux humanistes du paradoxe, leur supériorité intellectuelle et morale […]18.
Mais c’est par rapport à la santé du corps que Starobinski nous rappelle d’abord l’importance ou la centralité de la référence aux indigènes dans les Essais, et il est curieux que, quelques pages plus loin, autour du même thème, il semble vouloir la relativiser, affirmant qu’une telle référence ne fait que renforcer l’attachement de Montaigne à une solution médicale alternative tirée de l’Antiquité19. Voici le passage crucial dans lequel Starobinski met côte à côte la référence aux indigènes et le modèle de l’Antiquité classique, pour enfin dire qu’ils incarnent « toute l’envergure éthique et politique » de la critique culturelle de Montaigne :
421L’éloignement temporel et spatial autorise le jugement à prendre un plus vaste essor. Pour commencer, l’élargissement du spectacle offre le prétexte d’une critique intellectuelle […]. Montaigne y trouve ensuite l’occasion d’une critique culturelle […] ; et le faste des Américains n’avait rien à envier, à bien des égards, aux splendeurs de l’Antiquité. Sur ce plan, l’avantage est accordé aux autres, contre nous. Mais la critique ne s’arrête pas là : en parlant des empereurs romains, elle s’en prend, plus généralement, à la prodigalité des princes qui puisent dans les ressources du peuple pour briller par leurs largesses publiques ; elle s’attaque surtout à la brutalité des conquérants de l’Amérique. C’est alors seulement que la critique prend toute son envergure éthique et politique20.
Par la suite, Starobinski attire notre attention – et ce moment me semble décisif – sur le rapprochement radical entre les cannibales et La Boétie, son unique ami, son « frère », auteur de la « peinture riche et poly » que Montaigne dit n’avoir aucun talent pour jouer :
Parlant de son amitié avec La Boétie, Montaigne, on s’en souvient, écrit : « Nous estions à moitié de tout ». Et voici, de son entretien à Rouen avec trois sauvages d’Amérique, l’un des propos que Montaigne a retenus : « Ils ont une façon de langage telle, qu’ils nomment les hommes moitié les uns des autres21 ».
Dans la critique des inégalités et de l’abus des puissants, écrit Starobinski, La Boétie et les cannibales se rejoignent comme deux moitiés de (ou dans) Montaigne. Gardons ce point à l’esprit : c’est à la hauteur de cette fraternité que se pose la question de la centralité du « sauvage » chez Montaigne22. Mais ce n’est pas tout. Lestringant nous amène à penser que, si l’affiliation entre La Boétie et les cannibales donne à ceux-ci une importance disproportionnée par rapport à leurs rares apparitions dans les Essais, c’est parce qu’elle va au-delà de la dénonciation. Cette affiliation revendique un autre élément sans lequel 422on ne la comprendrait pas : la dimension politique de la critique contre les inégalités et les abus des puissants est indissociable de la question de l’Eucharistie comme centre des conflits religieux entre catholiques et protestants23. Il est possible de considérer que le radicalisme virtuel de la critique des puissants dans laquelle La Boétie et les cannibales se rencontrent dans les Essais semble contradictoire avec un certain conservatisme de Montaigne, dont la devise la plus récurrente serait que nous devons obéir aux lois et coutumes de notre ville ou de notre pays, conservatisme également associé à son apparemment « sincère et infranchissable catholicisme24 ». En tout cas, l’inséparabilité de la critique politique et de la question de l’Eucharistie dans la trame des Essais semble essentielle pour évaluer la figure du cannibale chez Montaigne. Cela dit, revenons à Oswald, pour relever un autre problème, relatif à la bonté des Indiens brésiliens chez Montaigne.
De la Révolution française
au « mauvais sauvage » et au-delà
Un texte important d’Afonso Arinos de Melo Franco, admiré par Oswald de Andrade, serait la preuve savante de l’un des aphorismes les plus inspirés du Manifeste Anthropophage : « Sans nous, l’Europe n’aurait même pas sa pauvre déclaration des droits de l’homme25 ». Selon Oswald et Afonso Arinos, Montaigne aurait été le fil conducteur principal de l’idée du bon sauvage, l’homme naturel qui aurait inspiré la Révolution française. 423Dans son livre, Afonso Arinos a cherché à démontrer comment l’idée de Rousseau de la bonté naturelle avait son origine et sa continuité dans cette assimilation européenne de l’indigène brésilien (comme s’il n’y avait qu’un indigène brésilien). En résumant ses recherches savantes, l’auteur écrit :
Nous avons considéré l’idée de bonté naturelle dans trois sens différents, avec lesquels elle a été introduite successivement, aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles. Dans le premier, son contenu était d’un principe philosophique et moral ; dans le second, celui d’une doctrine juridique ; dans le troisième, celui d’une théorie politique […]. En tant que concept philosophique, il visait la réforme des hommes, l’amélioration des âmes. En tant que doctrine juridique, [il visait] l’évolution pacifique des institutions, leur adaptation aux nouveaux besoins, définis par la raison scientifique. En tant que théorie politique, cependant, il ne pouvait manquer de faire ce qu’il a fait. C’était un appel à la violence, pour rejoindre les innombrables autres qui se sont levés. C’était plus une flamme pour le feu, plus un filet d’eau pour épaissir le cours puissant du torrent. Ce n’était plus un essai de réforme ou une tentative d’évolution. C’était déjà une question de révolution, c’est-à-dire de propagation d’un mythe par les masses et de leur soulèvement, afin de renverser l’appareil d’État, en exaltant directement le pouvoir politique26.
Dans la conception franchement conservatrice de l’écrivain et homme politique brésilien, l’assimilation du bon sauvage dégénère en un « mythe » qui augmente la violence, et dont l’origine idéologique se retrouve chez Montaigne, lecteur de Jean de Léry : « Montaigne était, à une certaine époque, la semence idéologique elle-même, c’était le principe animateur des conjectures de Rousseau sur l’homme naturel, avec son essai sur le sauvage du Brésil27 ». Oswald, dans les années 1950, dans un texte intitulé « La découverte de Vespucci », désireux de souscrire à la contribution scientifique d’Afonso Arinos, écrit :
L’un des meilleurs documents qui a produit une phase de la littérature moderniste de 2228, la phase qui a été appelée « anthropophagique », était le beau livre d’Affonso Arinos intitulé O Índio brasileiro e a Revolução Francesa29.
424Oswald ne cite de ce livre que trois brefs passages qui confirmeraient sa thèse sur l’importance sans précédent de Vespucci, parce qu’il [Vespucci] « a découvert et annoncé l’homme naturel30 ». Selon Oswald :
Le succès des lettres de Vespucci n’était pas seulement un succès de divulgation. Ce sont ces petites images du nouveau monde qui ont déclenché un mouvement intellectuel de premier ordre. Elles ont créé des utopies31.
Et, comme pour le démontrer, Oswald cite le texte d’Afonso Arinos :
Concernant la nature des habitants [du Brésil], [Vespúcio] dit qu’elle était pleine de cordialité et d’innocence. Ils vivaient dans un régime de communisme absolu, car ils ignoraient la propriété, la monnaie, le commerce et s’entendaient donc très bien. Entièrement libres, ils n’avaient ni rois ni chefs, chacun étant roi de soi-même. Cette liberté sociale était complétée par une liberté morale absolue, car ils n’avaient aucune religion et ignoraient les temples et les idoles32.
Contre le bilan d’Afonso Arinos, qui critiquera férocement ce portrait comme une projection culturelle européenne ayant servi aux caractérisations diverses et inexactes du Nouveau Monde à partir des récits des voyageurs considérés comme trop fantaisistes, Oswald s’approprie ces petites images du nouveau monde comme fil conducteur d’une utopie révolutionnaire renouvelée « contre le patriarcat occidental ». Et l’héritage du noble (et, en ce sens, du bon) cannibale de Montaigne sera fondamental dans la prose poétique de cette utopie anthropophage. Comment comprendre, cependant, que ce bon sauvage devienne soudain un « mauvais sauvage » ? C’est ce que l’on verra ensuite.
425Dans son roman de 1945, Marco Zero II, Chão, Oswald parle par la bouche de l’un de ses alter egos, Jack de São Cristóvão :
– Les origines intellectuelles de l’anthropophagie sont à Montaigne, à Rousseau ! s’exclama Jack – C’est l’exaltation de l’homme naturel, avec une différence, pas l’éloge du « bon sauvage » mais du mauvais, du réel33.
Et dans le texte « Descoberta da África », écrit dans les années 1950, Oswald décrète :
Jean-Jacques n’est plus subversif. […] la figure de ce réformateur social est presque idyllique. Au moins son Indien, le bon Indien, est parfaitement utopique. […] C’est que tous les Indiens, conformes et mignons comme sur des cartes postales et des paquets de biscuits, étaient issus de Rousseau. Le romantisme s’en est servi à volonté et le bon Indien s’est répandu ici, bercé par la douce contrefaçon d’Alencar et de Gonçalves Dias. Auparavant, cependant, un autre Français, celui-là un esprit humaniste puissant et cultivé, avait brillamment défini le secret barbare de l’Indien34.
Le texte se poursuit avec la description de la rencontre mythique de Montaigne avec les Indiens à Rouen, avec sa dénonciation de l’inégalité sociale et de l’absurdité pour un adulte d’obéir à un enfant. Haroldo de Campos, se référant à ce texte de 1950, souligne : « L’Indien oswaldien n’était pas le “bon sauvage” de Rousseau, mais un “mauvais sauvage” (…) inspiré du sauvage brésilien de Montaigne35 ». Pourtant, si les textes antérieurs à 1950 parlent déjà d’un « mauvais sauvage », Oswald ne semble pas encore l’identifier au « cannibale de Montaigne ». À le lire attentivement, le premier passage cité ci-dessus, tiré du roman de 1945, Marco Zero, l’indique : Rousseau et Montaigne auraient loué le 426« bon sauvage », et il serait maintenant nécessaire de contrecarrer le « mauvais ». Et un autre texte de la même époque, Le chemin parcouru, de 1944 affirme : « … Pau-Brasil[un livre de poèmes d’Oswald] irait dans le sens de notre primitif, le “bon cannibale” de Montaigne et Rousseau36 ». On peut donc conclure, avec une certaine assurance, que ce n’est qu’en 1950 que la question du contraste entre le bon et le mauvais sauvage se précise pour Oswald : le mauvais sauvage est le cannibale de Montaigne, mais « mauvais » dans un sens positif. Le « mal » se traduirait par la « guerre noble », à laquelle est lié le rituel anthropophage – ceci est le « secret barbare » révélé par l’humaniste français, en contraste avec les « bons et conformes » indiens du romantisme, inspirés du bon sauvage de Rousseau. L’Indien brésilien de Montaigne serait quand même un barbare, un cannibale, un anthropophage, mais en même temps un noble guerrier qui mange son prochain pour se venger ; et c’est ce côté « noble » qui permet à Montaigne de radicaliser sa critique de la dévoration, encore plus barbare et infiniment plus cruelle, des européens, otages du fanatisme religieux.
En résumé, dans le puzzle de l’appropriation par Oswald du « sauvage » assimilé dans la tradition européenne, la critique des puissants faite par l’Indien brésilien de Montaigne revêt une perspective politique qui dans les Essais, comme nous avons tenté de l’indiquer plus haut, n’a rien de révolutionnaire. L’Indien brésilien de Montaigne reste un barbare, cannibale, anthropophage – c’est à dire, un « mauvais sauvage ». Sans aucun doute, l’une des plus grandes vertus de ce « mauvais sauvage » réside dans sa capacité à constituer une critique assimilée à la critique des inégalités sociales faite par La Boétie, « dans toute son envergure éthique et politique ». C’est-à-dire que sa vertu serait confondue avec le fait de pouvoir nous élever jusqu’à la recherche du jugement sur la justice sociale auquel Montaigne lui-même nous invite. Il ne serait pas plus « révolutionnaire » ou « conservateur » que le jugement même de Montaigne sur cette question (conclusion qui pourrait éventuellement être renforcée par le caractère fictif de la rencontre de Rouen). Concernant Oswald, c’est toujours l’incidence des « petites images » indiquées plus haut, des images paradisiaques de l’homme naturel, dans Vespucci, Montaigne et Rousseau, qui est la plus éloquente, en tant que puissance révolutionnaire d’une vie utopique saine, d’une vie de loisir opposée à 427la vie des affaires (o ócio contra o negócio), du communisme primitif, d’un « réalité sans complexes, sans folie, sans prostitution et sans pénitencier du matriarcat de Pindorama », ainsi qu’il achève, avec grand style, son Manifeste anthropophagique de 1928, en outrepassant évidemment tout usage que Montaigne fait du cannibale brésilien.
L’héritage matriarcal
Bien heureux es tu, Lecteur,
si tu n ’ ez pas d ’ un sexe
qu ’ on ait interdit de tous les biens 37 .
Qui sont nos amis, alliés, frères, sœurs (« O mes amis, il n’y a nul amy38 ») ? Qui sont nos parents, neveux, fils et filles ? De qui héritons-nous et à qui laissons-nous notre héritage ? L’anthropophagie (comme s’il n’y en avait qu’une) serait-elle un « bon héritage » pour les temps sombres, pleins de discours de haine, de misogynie, de sexisme, de fanatisme religieux et idéologique associés à un gouvernement d’extrême-droite ? Dans un pays où les attaques barbares contre les peuples autochtones sont régulièrement répétées, par les assassinats de leurs dirigeants, l’invasion et l’exploitation de leurs terres, insister sur l’anthropophagie, n’est-ce pas pervertir leur héritage et construire une fausse alliance de sympathie et d’amitié, en renforçant les préjugés sous prétexte de les combattre ? Et que peut-on revendiquer comme héritage, dans ces relations si rares que l’on imagine et ressasse abstraitement, dans ces conversations (des)incarnées et infiniment multipliées dans l’écriture, dans des textes, des textes et encore textes ? Y a-t-il vraiment une présence, de chair et de sang, du « sauvage anthropophage » dans tout ce que nous avons conçu plus haut ? Est-ce là l’héritage que nous recherchons ? Notre héritage ? 428De quoi héritons-nous d’Oswald et de Montaigne, de Montaigne via Oswald et d’Oswald via Montaigne ? Quelle responsabilité portons-nous avec notre (in)fidélité sans fin aux textes, dans nos commentaires greffés sur eux, surtout ceux qui ne sont pas encore apparus, innombrables, et que le texte lui-même réclame ?
En passant en revue les différentes vertus des cannibales, Montaigne déclare :
Ils s’entr’appellent generalement, ceux de mesme aage, freres ; enfans, ceux qui sont au dessoubs ; et les vieillards sont peres à tous les autres. Ceux-cy laissent à leurs heritiers en commun cette pleine possessions de biens par indivis, sans autre titre que celuy tout pur que nature donne à ses creatures, les produisant au monde39.
Commentant ce passage, F. Lestringant déclare :
Le tableau de cette société obéit à un modèle patriarcal, guère inattendu dans un contexte d’utopie régressive. Il s’inscrit en outre dans le droit fil de l’éloge de l’amitié, cette amitié à laquelle Montaigne a consacré l’un des plus vibrants chapitres des Essais et qui tient une place fondamentale dans l’utopie politique de La Boétie40.
Oswald, plus soucieux de s’approprier l’image d’un communisme primitif, n’a prêté aucune attention à cet aspect et à d’autres du texte de Montaigne, apparemment incompatibles avec l’hypothèse d’une prétendue nature matriarcale des sociétés amérindiennes. Les enjeux de l’amitié et de la fraternité comme thèmes centraux, qui rapprochent Montaigne, La Boétie et les cannibales ; la question des femmes et de l’amour sexuel comme exclus de ce jeu ; ainsi que la question de la différence sexuelle dans les Essais ; l’amitié de Montaigne avec la « première féministe » d’Europe, Marie de Gournay, auteure de l’« Égalité des hommes et des femmes », en 1622, et rédactrice de la version 1595 des Essais, pour laquelle elle a écrit la « Préface sur les Essais de Michel Seigneur de Montaigne par sa Fille d’Alliance » ; et toute l’histoire de la réception de cette version de 1595, surtout l’effacement total de son nom en dehors du cercle des spécialistes de Montaigne, particulièrement au Brésil (jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas la traduction portugaise de cette 429préface) : il faudrait enquêter sur toutes ces questions qui peuvent être directement ou indirectement liées à (l’im)possible affiliation virtuelle entre les Essais de Montaigne et l’anthropophagie matriarcale d’Oswald ; et peut-être aussi à partir de l’analyse pénétrante de Derrida sur la question de l’amitié chez Montaigne, dans son livre Politiques de l’amitié41.
À partir de la lecture de Montaigne, entre autres, Oswald a avancé des hypothèses qui, par la suite, pourraient acquérir un sens plus « scientifique ». Comme nous l’avons déjà exploré ailleurs42, la question de la division sexuelle du travail chez les Amérindiens se laisse difficilement traduire (du moins quand leurs cultures sont plus ou moins à l’abri de l’invasion occidentale) par la domination patriarcale. Dans le bouillon de la plate-forme dialectique oswaldienne, même la signification du christianisme pour les peuples autochtones indiquerait la prédominance du matriarcat :
Ceci est mon corps, Hoc est corpus meum (sic). Le Brésil indien ne pouvait s’empêcher d’adopter un dieu qui n’était fils que d’une mère et qui, de plus, satisfaisait pleinement les gloutons ataviques. Catholiques romains43.
Alternativement à Montaigne qui oppose la noble anthropophagie des peuples indigènes à la terrible omophagie des Européens, dans les horreurs de laquelle les êtres humains sont poussés par le fanatisme religieux d’une société fortement inégale, Oswald, bien qu’il identifie dans cette opposition la grande contribution de l’essayiste français à une possible « nouvelle sociologie et une nouvelle philosophie44 », la dilue dans le melting-pot brésilien, au nom de son utopie matriarcale anthropophagique.
Filipe Ceppas
Université Fédérale
de Rio de Janeiro (UFRJ)
1 Manifeste anthropophage, trad. Jacques Thériot, in Anthropophagies, Paris, Flammarion, 1982, p. 269.
2 Italo Calvino : « Les classiques sont ces livres qui nous viennent avec les marques des lectures qui ont précédé les nôtres et derrière eux les traces qu’ils ont laissées dans la ou les cultures qu’ils ont traversées… ». Por que ler os clássicos, São Paulo, Cia. das Letras, 2007, p. 11.
3 « Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques sur lui-même, mais les repousse continuellement », Ibid., p. 12.
4 À la Renaissance, le grotesque désignait un style ornemental utilisant des motifs ridicules, bizarres, risibles, et parfois inquiétants (NdT).
5 Les deux autant innovateurs l’un que l’autre en matière d’écriture, bousculant les règles des genres textuels dans leurs contextes historiques respectifs. En ce qui concerne « l’appétit dévorant » de leurs intelligences, cependant, il y aurait beaucoup à dire sur des proximités et des différences significatives, en tenant compte du fait que, pour les deux, cette métaphore n’a pas un rôle purement figuratif, mais englobe, de manière explicite, des aspects importants, éthiques et politiques, de leurs conceptions de la connaissance. Sur la question de l’alimentation et de la cuisine chez Montaigne, voir surtout le chapitre « De l’expérience », Essais, III, 13, Paris, Quadrige/PUF (édition Villey), 1998 [Toutes les références aux Essais seront de cette édition]. Sur la relation entre ce sujet et la question de la connaissance dans les Essais, voir David B. Goldstein, “Eats Well with Others : Culinary Skepticism in As You Like It and Montaigne’s « Of Experience »”, Criticism, vol. 59-4, 2017, p. 639-660.
6 « De la coustume et de ne changer aisément une loi receüe », Les Essais, I, 23, 112.
7 L’omophagie consiste à manger de la chair crue (NdT).
8 « Des cannibales »,I, 31, 209. Dans l’ensemble de son œuvre, Oswald fait référence à Montaigne un peu plus d’une douzaine de fois et, au moins quatre fois exclusivement pour faire l’éloge du seul [le vrai] humaniste français qui, entre autres vertus, a su non seulement comprendre l’étonnement des indigènes face à l’inégalité économique et sociale européenne de son temps, dans « l’épisode de Rouen », mais aussi percevoir toute la signification, pour ainsi dire, planétaire, politique et utopique de cet événement (Oswald de Andrade, « Sobre o romance », Ponta de lança, São Paulo, Globo, 2000, p. 87). Sur la rencontre mythique de Montaigne et des Amérindiens, voir Souza Filho « Rouen pour Bordeaux : hypothèses pour expliquer une énigme littéraire », Publications numériques du CÉRÉdI, 2013. Sur la véracité ou non, factuelle et/ou symbolique, du cannibalisme européen évoqué par Montaigne, cf. Frank Lestringant, Le cannibale. Grandeur et Décadence, Genève, Droz, 2016, ch. vi et vii, et Une sainte horreur ou Le voyage en Eucharistie, Genève, Droz, 2012.
9 Robert Launay, Savages, Romans, and Despots. Thinking about Others from Montaigne to Herder, Chicago, The University of Chicago Press, 2018, p. 38.
10 Entre crochets, les paraphrases en français moderne par Villey.
11 « De la coustume… », I, 23, p. 167-168.
12 En fait, tous les lecteurs ne le savent pas. Outre les lectures plus superficielles, telles que celles de Tzvetan Todorov, dans Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine,Paris, le Seuil, 1989 (voir Frank Lestringant, « À espera do outro. Nota sobre a antropologia da Renascença. Um desafio ao espírito de sistema », in Adauto Novaes (dir.), A outra margem do Ocidente, São Paulo, Cia das Letras, 1999, p. 33sq), l’excellent texte de Robert Launay sur Montaigne (Savages, Romans, and Despots, op. cit.) finit par souscrire à la dépréciation constante de son propre jugement chez Montaigne, pour conclure que l’auteur “condemns himself, with the twin beacons of the cannibals and the ancients, to mediocrity” (Launay, op. cit., p. 51). Launay semble sous-estimer le caractère rhétorique du topos de l’autodépréciation dans les Essais. La valeur et la difficulté, voire parfois l’impossibilité d’établir un jugement correct, ne sont pas à confondre avec la dépréciation rhétorique du jugement lui-même, ressource à laquelle Montaigne fait plusieurs fois appel. Même dans sa phase sceptique la plus radicale, il n’est pas difficile de reconnaître la valeur incontestable du discernement ou du jugement chez Montaigne. Sur cette question, voir Hubert Vincent, Éducation et scepticisme chez Montaigne ou Pédantisme et exercice du jugement, Paris, L’Harmattan, 1997, et Raymond La Charité, The concept of judgment in Montaigne, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968.
13 « C’est le corps d’une belle femme, que finit une queue de poisson » (Horace, Art poétique, 4.). Il n’est pas sans importance que, dans ce passage, pour illustrer le caractère monstrueux de son tas de crotesques, Montaigne choisisse précisément la figure anthropophage de la sirène.
14 « De l’amitié », I, 28, 183 (C’est nous qui soulignons).
15 « Au lecteur », 3.
16 Sur cette question, voir Jean Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1993, p. 192sq et p. 266sq.
17 Robert Launay, Savages, Romans, and Despots, op. cit., p. 43.
18 Jean Starobinski, Montaigne en mouvement, op. cit. p. 469-470.
19 « Pour disqualifier la médecine des universités et le langage doctoral des “savants”, Montaigne ne fait que reprendre de très classiques objections anti-techniciennes. Il fait appel à un discours dûment transmis par la culture – apologie de l’“apathie” comme prévention de la maladie, éloge de l’automédication instinctive – afin de jeter le doute sur les bienfaits illusoires de la culture. Attribuer, par exemple, la santé des indigènes du Brésil à la “tranquillité et serenité de leur ame”, plutôt qu’aux avantages de l’air, ce n’est pas s’écarter du langage médical : c’est faire un choix entre deux des catégories causales établies par la médecine elle-même […], parmi les “six choses non-naturelles” dont le bon usage constitue l’hygiène », Ibid., p. 308-309.
20 Ibid. p. 239-240.
21 Ibid. p. 471.
22 F. Lestringant attire également l’attention sur cet aspect : « La question du Cannibale d’Amérique, avec Montaigne, ouvre à celle du politique. L’auteur des Essais transporte au Nouveau Monde le paradoxe de la Servitude volontaire cher à son ami La Boétie. Le scandale du mort que l’on mange fait place à celui, plus insupportable encore, des vivants que l’on dévore », Le cannibale… op. cit. p. 29. Ce lien entre les cannibales et La Boétie (annoncé à nouveau à la page 178 de ce livre) sera développé avec plus de détails dans le chapitre viii (l’un des textes les plus importants écrits sur Montaigne et les cannibales, intitulé « Un cannibale qui crache »), dans une section intitulée précisément, Frères cannibales.
23 Frank Lestringant, « Montaigne et le miracle de l’hostie », Une sainte horreur…, op. cit.
24 C’est un sujet complexe et controversé que le supposé conservatisme politique et religieux de Montaigne. Loin d’être un spécialiste de l’auteur, et de la dimension politique de sa pensée en particulier, j’aimerais explorer ce problème à l’avenir. Il est curieux, par exemple, que le pèlerinage à Lorette ait causé tant de scandale parmi les lecteurs de Montaigne au xviiie siècle. Au moins à la surface du texte, malgré toutes les critiques que Montaigne adresse aux superstitions et aux fables des religions, y compris de la religion catholique, il démontre toujours, et à des moments stratégiques (voir les citations de saint Augustin dans « l’Apologie de Raymond Sebond » par exemple), un apparent attachement inconditionnel aux dogmes chrétiens. Sur cette question du supposé conservatisme de Montaigne, il convient de mentionner l’intéressante analyse de Costa Lima, Limites da voz. Montaigne, Schlegel, Kafka, Rio de Janeiro, Rocco, 1993, p. 36sq.
25 Andrade, Manifeste Anthropophage, op. cit. p. 269.
26 Afonso Arinos de Melo Franco, O índio brasileiro e a Revolução Francesa, as origens brasileiras da teoria da bondade natural, São Paulo, Topbooks. 2000, p. 266.
27 Ibid. p. 275.
28 Oswald se réfère ici à la Semaine de l’art moderne de 1922, dont il fut l’un des principaux organisateurs et qui marqua le début du mouvement moderniste brésilien à São Paulo.
29 Oswald de Andrade, Obras completas VI, Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972, p. 214. Dans sa chronique journalistique du 12 août 1947, intitulée « Civilisation », avec beaucoup de liberté poétique, Oswald caractérisait Afonso Arinos comme « un prophète de “l’anthropophagie” » (Telefonema, São Paulo, Globo, 2007, p. 325). Le livre d’Afonso Arinos date de 1937, tandis que la « phase anthropophagique » du mouvement moderniste s’est déroulée de 1928 à 1930. Dire qu’Afonso Arinos est « un prophète de l’anthropophagie » ou, au contraire, qu’il s’est inspiré du mouvement anthropophagique pour écrire son livre, sont des affirmations absurdes car le livre d’Arinos vise à nier toute valeur positive à ce « mythe du bon sauvage », en imputant son origine à des lectures erronées et fantaisistes des voyageurs et des missionnaires. Tout cela montre qu’Oswald a lu le livre d’Afonso Arinos d’une manière très particulière, c’est le moins qu’on puisse dire.
30 Andrade, Obras completas VI, op. cit., p. 210.
31 Ibid. p. 213, c’est nous qui soulignons.
32 Andrade, Obras completas VI, op. cit. p. 215. Ce passage se trouve dans Franco, O índio brasileiro e a Revolução Francesa, op. cit. p. 53.
33 Andrade, Marco Zero II. Chão, São Paulo, Globo, 1971, p. 320.
34 Andrade, Obras completas VI, op. cit. p. 226, nous soulignons. Le texte se poursuit par la description de la rencontre mythique de Montaigne avec les Indiens à Rouen, avec sa dénonciation des inégalités sociales et l’absurdité d’un adulte obéissant à un enfant, le roi Charles IX. Dans un autre texte de 1950, Oswald fait référence à la « sociologie du pique-nique » de Rousseau : « ”l’homme primitif” refait surface aujourd’hui avec la somme de ses droits et conceptions, non pas à l’image romantique de Rousseau qui a produit une sociologie pique-nique, mais dans la vision saine de Montaigne qui sut mieux que toute autre annoncer le cannibale. Aux mangeurs de personnes vivantes, c’est ainsi qu’il catégorisait les puissants de son temps, il opposait les mangeurs de morts, comme une meilleure chose », Obras Completas X, Telefonema, op. cit. p. 111.
35 Haroldo de Campos, « Uma poética da radicalidade », in Andrade, Poesias reunidas, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971, p. 49-50.
36 Andrade, Obras completas VI, op. cit. p. 95.
37 Marie de Gournay, « Préface sur les Essais de Michel Seigneur de Montaigne par sa Fille d’Alliance », Preface to the Essays of Michel de Montaigne by his adoptive daughter, Marie Le Jars de Goumay, translated, with supplementary annotation, by Richard Hillman & Colene Quesnel from the edition prepared by François Rigolot, Arizona, Medieval & Renaissance texts & studies, 1998, p. 34.
38 « De l’amitié », I, 28,190.
39 « Des cannibales », I, 31, 210.
40 Frank Lestringant, Le cannibale, op. cit. p. 185.
41 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994.
42 Filipe Ceppas, « Oswald contra o Patriarcado. Antropofagia, matriarcado e complexo de Édipo », in A. Parente & L. Silveira, Freud e o patriarcado : leituras para os nossos tempos, São Paulo, Hedra, 2020.
43 Andrade, « Schema ao Tristão de Athayde », Revista de Antropofagia, Anno 1, n.5, septembre 1928, p. 5.
44 Andrade, « A marcha das utopias », Obras completas VI, op. cit. p. 192.