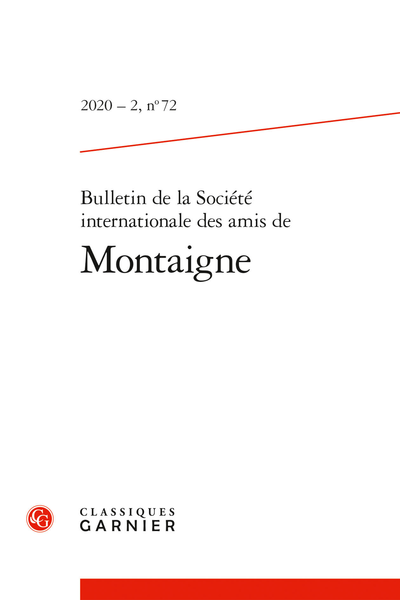
La philosophie soldate de Pierre de Lostal
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Demonet (Marie-Luce)
- Résumé : Avec ses Discours philosophiques de 1579 le jeune calviniste Pierre de Lostal (1559 ?-1621 ?), offrait un compendium de métaphysique et d’éthique guidé par une visée politique qui contredit Bodin. Il s’illustre avec le Soldat françois (1604) qui argumente dans un style très énergique en faveur de la guerre contre l’Espagne. Les sources communes aux Discours et aux Essais sont notamment Plutarque, Cicéron et Sénèque, mais son néoplatonisme et son baroquisme affectif l’éloignent de Montaigne.
- Pages : 181 à 206
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0181
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Montaigne, Pierre de Lostal, philosophie, Bodin, politique
La philosophie soldate
de Pierre de Lostal
Les Discours philosophiques de Pierre de Lostal ont intéressé quelquefois les lecteurs de Montaigne, surtout à cause des rapprochements que Pierre Villey avait proposés dans son édition : l’éminent critique n’en inférait pas, toutefois, que Montaigne avait lu cet auteur, comme il avait pu le faire pour certains contemporains également promoteurs d’une philosophie française et en français (La Primaudaye ou Guy de Bruès)1. Lostal, né en Béarn et fidèle à la maison de Navarre, pourrait pourtant faire partie d’un cercle très large de relations politiques et régionales de Montaigne sans qu’on leur connaisse d’échanges particuliers. À ce stade de mes recherches, je suppose que leurs chemins ont dû se croiser, et que leurs lectures communes les réunissent et les distinguent assez nettement. Comme rien de ce qui se rapporte au milieu bordelais et gascon autour de Montaigne n’est étranger à Alain Legros, je propose d’examiner ici quelques éléments de similitude ou de contraste, qui ne constituent qu’une ébauche.
Des Discours académiques au grand deuil du roi
Auteur de Discours philosophiques […] Esquels est amplement traitté de l’Essence de l’Ame, & de la Vertu Morale, publiés en 1579 alors qu’il n’avait que vingt ans, « en l’avril de son âge » comme il le dit dans un quatrain final en citant Maurice Scève ou Desportes2, Lostal est aussi connu par 182des écrits politiques et polémiques qui l’opposeront après 1600 aux jésuites, à la Contre-Réforme, au parti espagnol et même à d’autres fidèles d’Henri IV. Aucune notice ne lui est attribuée dans les deux volumes du Dictionnaire des lettres française (Grente), que ce soit pour le xvie ou pour le xviie siècle, et j’ai dû renoncer à établir une bibliographie exhaustive de textes d’authenticité douteuse. Du quatrain on déduit qu’il a dû naître en 1559-1560, presque trente ans après Montaigne et, comme il affirme qu’il vient de passer neuf années auprès des Muses, il devait avoir terminé son cursus dans un collège puis dans une faculté des arts, à Paris comme le laisse penser son épître-dédicace « au Roy », c’est-à-dire Henri II de Navarre : elle est datée de Paris, du 13 août 1579. Lostal disparaît des registres après 1621.
Montaigne peut avoir lu les Discours philosophiques puisqu’ils ont été publiés à Paris un an avant les Essais, chez Jacques Du Puy et Pierre Borel, et imprimés par Pierre Chevillot qui est, pour cet ouvrage, titulaire du privilège royal et qui signe les bandeaux d’un « P C ». Bien qu’il ne se soit pas tourné vers des libraires parisiens pour la première édition des Essais, il l’avait fait pour sa traduction de la Théologie, respectivement chez Gilles Gourbin (édition partagée avec Michel Sonnius et Guillaume Chaudière) pour 1569, avant Guillaume Chaudière (dans la même association) pour 15813. Chevillot est l’imprimeur que Jean Balsamo et Michel Simonin ont pensé être celui des Essais de 1588, sans certitude, à partir du matériel typographique et notamment le fameux bandeau à la tête de bouc placé en haut de la préface « Au lecteur », si fréquemment copié4. Cela ne rend pas les deux Gascons cousins pour autant. Si Montaigne peut être dit gascon par son origine bordelaise –et il se dit « Gallus vasco » sur son ex-voto de Notre-Dame de Lorette5– le château de Montaigne se trouve en Guyenne, alors que Lostal est 183originaire de Saint-Palais dans un Pays Basque intégré au royaume de Navarre, lequel étendait son autorité jusqu’en Périgord. La famille de Montaigne possédait un bénéfice au village de La Hontan en Béarn, à une dizaine de lieues de Saint-Palais, dans un petit état jadis autonome auquel Montaigne attribue une « police » si pure qu’on n’y a longtemps connu ni avocat ni médecin (Essais, II, ch. 37).
Leur apparentement intellectuel et politique viendrait de leur commune proximité de la maison de Navarre, et d’un possible voisinage dans leur formation littéraire et juridique. L’auteur de la courte biographie de Lostal, Arnaud Communay (1884), donne quelques indications sur ce qui a conduit ce petit-fils, par sa mère, d’un bien plus célèbre vice-chancelier de la maison de Navarre, Mathieu Du Pac, à vouloir suivre le même destin que son aïeul. Lostal est lui-même devenu vice-chancelier en 1596 auprès d’Henri IV, auquel il semble vouer depuis sa jeunesse une admiration et une dévotion sans limite, exprimées dans une prose exaltée6. Il a dû naître et rester calviniste, religion de ses père et grand-père, autour de la maison d’Albret, et il ne s’est apparemment pas converti au catholicisme en même temps que son roi.
Dans le Soldat françois paru en 1604 (sl, sn)7, Lostal a préconisé d’une façon véhémente et argumentée la guerre contre l’Espagne en conseillant au roi de rompre une paix de lâches : l’Espagne avait annexé la haute-Navarre en 1512 et, malgré la paix de Vervins, ne renonçait pas à en faire autant de l’autre côté des Pyrénées. Le danger n’était pas imaginaire, mais les nombreuses réactions négatives de tout bord ont donné lieu à des échanges de publications presque toutes anonymes qui 184ont duré jusqu’en 1607 au moins. Leur relation avec les perspectives philosophiques des Discours paraît bien lointaine.
Pierre de l’Estoile éprouve toutefois une sorte de sympathie pour cet engagement violent et pour la cause défendue par Lostal, sans nommer celui-ci car le Soldat est paru d’abord sans nom d’auteur. Il ne pouvait pas savoir que le magistrat n’était pas militaire :
Année 1604. En ce mois de Janvier & le quatorze d’icelui, je reçus des lettres de la Rochelle de M. de. Plom mon bon ami, en datte du premier de cet an 1604, avec un petit Livret intitule : Le Soldat François, duquel il me fit cas par ses lettres, comme d’une piece élegante & diserte digne (ce me mande-t’il) d’être gardée parmi mes raretez, & de laquelle il me prie de lui écrire mon jugement, & si les plumes Huguenotes de Guyenne sont de bonne trempe & bien acerées.
Ma réponse a été, après l’avoir assez lu exactement & d’un bout à l’autre, que ledit Livre est un vrai discours d’un Soldat bravasche Gascon, ayant de belles pointes & rencontres a la mode du Pays, duquel si l’épée est d’aussi bonne trempe & aussi bien aceree qu’est sa plume, avec le courage qu’il a & le zele qu’il fait paroître avoir comme bon François au service de son Roy, est capable d’en faire un bon à Sa Majesté, laquelle se resolvant d’entrer en guerre avec l’Espagnol, auroit bon besoin de tels Soldats en effet que l’Auteur lui en propose en papier & en peinture, pour recouvrer à la pointe de son épée, ce qui justement lui appartient puisque le droit y en git-là aujourd’hui8.
L’objectif des Discours diffère tellement de ces publications ultérieures que Haag doute que ce soit le même Lostal qui ait écrit les premiers. Plusieurs des pamphlets lui sont seulement attribués et il faudrait les regarder tous de près : la Biographie de Michaud en recense quinze jusqu’en 1631 sans se prononcer sur leurs auteurs et Marie-Madeleine Fragonard a décrit une sorte de résurrection de la veine burlesque dans ces échanges qui mettent aux prises un soldat, désireux d’en découdre, avec un maître Guillaume pacifiste ; le va-t-en-guerre est aidé par une Mathurine en armure9. Ces deux personnages, qui portent les noms des bouffons du 185roi et de la reine, s’illustrent avec bien d’autres figures satiriques dans les décennies qui précèdent les Mazarinades10. La caricature de soldat fanfaron identifié à Lostal pourrait même avoir nourri le personnage de la comédie classique par ses rodomontades11. Pourtant, si le ton est polémique, le Soldat françois ne peut pas être qualifié de « libelle », avec ses 335 pages, contrairement aux pochades plus ou moins sérieuses qui le contredisent. Le sujet on ne peut plus grave qui préoccupait Lostal était central au genre délibératif, la nécessité ou non de s’engager dans la guerre, une décision soutenue sur le ton des Catilinaires et du blâme contre l’Espagne : sans être à l’ordre du jour dans les Discours antérieurs à la Ligue, ce choix politique me semble préparé par eux.
Comparés à ses écrits postérieurs, les Discours marquent une certaine sagesse et une pondération largement dépassées par la suite, malgré un goût précoce pour les comparaisons et les métaphores à la fois ordinaires et recherchées. Frais émoulu au sortir de l’école, et bien moulu aux écrits des philosophes anciens et modernes, et surtout de Cicéron qu’il considère comme un philosophe politique autant que métaphysique, il n’a pas encore, vu son jeune âge, de responsabilités civiles. Les quelques lignes qui lui sont consacrées reprennent les jugements défavorables du cardinal Du Perron et de Joseph Juste Scaliger : le premier s’est moqué de sa prose et de ses vers encombrés de mythologie et d’érudition, notamment dans l’Avant-victorieux (1609), sorte de biographie partiale du roi, et dans la Navarre en dueil (1610), 152 pages de lamentations épouvantées par l’état du royaume aux prises avec le « vinaigre de la discorde », vraie « syncope de la raison12 ». Ses périodes interminables 186sont tissues de paronomases et d’anaphores indignées, rythmées de points d’exclamation et d’interjections doloristes. Dans ce panégyrique au ton de philippique bien au-dessus des escarmouches des années précédentes, il se courrouce sans cesser pour autant de raisonner et d’argumenter à grands coups de rapprochements historiques et de citations classiques en latin, dont il farcit les marges : Sénèque, Plutarque et Cicéron sont les auteurs qui reviennent le plus souvent13. Il avait déjà procédé ainsi dans l’Avant-Victorieux, dans les mois qui ont précédé la mort du grand vainqueur vaincu. On lui reprochait surtout les derniers paragraphes qui tambourinaient son désir de lancer, en capitales répétitives, sa « PLUME EN L’AIR », équivalent littéraire d’une charge sabre au clair.
À ma connaissance et en dehors de Communay, on ne dispose pas d’étude globale sur ce personnage et son œuvre, chaque spécialiste étant intéressé par un aspect différent de ses publications que l’on peut répartir en trois domaines : métaphysique, moral et politique, les trois étant liés dans les Discours par une même volonté de convaincre et par un goût prononcé pour la discussion. J’avais remarqué qu’il était l’un des premiers, sinon le premier, à intituler un recueil de philosophie française « Discours philosophiques », avant même Louis Le Caron (1583) et Pontus de Tyard (1587), associant ainsi un genre rhétorique, le « discours » de contours assez vagues, à une définition large de la philosophie dont il livre une sorte de compendium personnel14. L’équivalent d’un traité de l’âme et de métaphysique (Discours i à vi)15 fonde une éthique, qui elle-même s’étend sur les Discours vii à xiv. Un autre titre confirme cette première orientation de morale en réduction : « Discours philosophiques de P. de Lostal, sieur d’Estrem, contenans une succincte explication de 187la Morale » (p. 1). Les Discours examinent les opinions soutenues dans les « sectes » classiques (Platon, Aristote, les stoïciens, les académiciens, les néoplatoniciens) et présentent favorablement, parfois de façon assez audacieuse, des modernes comme Cardan et Paracelse. L’ensemble se termine par des développements sur les quatre vertus cardinales qu’il appelle « morales » (Prudence, Justice, Magnanimité, Tempérance), mais la métaphysique et la morale sont complétées par un traité politique dont la cible est notamment Bodin (le « Platon françois »), afin de proposer une philosophie prudentielle qui se verra à l’œuvre dans la suite de sa carrière, y compris dans ses conseils apparemment imprudents. On sait que Montaigne appelle parfois « discours » ses Essais, dont le titre est traduit en italien à l’époque par Discorsi16. Ceux de Lostal sont loués par un seul personnage, Jean Pallet, médecin saintongeais qui avait publié l’année précédente chez l’Angelier une traduction de Firenzuola, Le Discours de la beauté des dames, titre qui a peut-être inspiré celui que Lostal s’est choisi.
Les Discours sont donc orientés vers le bien public, comme si le jeune artien et apprenti juriste allait immédiatement convertir sa formation toute neuve en philosophie appliquée à sa charge future. Il ne fait pas mystère de ce qui l’attend, le chemin est tout tracé, et, alors que l’hypothèse que les Essais de Montaigne aient pu être conçus pour sa carrière suscite des objections, elle pourrait s’appliquer plus proprement à ce coup d’essai du Béarnais. Les Discours de Lostal ont une visée politique, surtout développée dans les Discours xiv, « De la Prudence », et xv, « De la Justice17 ». L’édition (unique) en numérote dix-neuf, mais en fait il n’y en a que dix-huit, comme l’indique la table. Le Discours xv, qui compte plus de cent pages, est suivi du Discours xvii, « De la magnanimité », comme si l’auteur avait songé à scinder le chapitre précédent.
188En outre, à partir de ce petit traité « De la Justice » et de sa longue réfutation de Bodin, la nature des notes marginales se diversifie : alors que jusque-là elles n’étaient constituées que de studieuses références, à partir de la page 249, elles contiennent aussi des « lieux » ou sous-titres qui permettent de situer l’originalité du propos. La toute première pose le problème : « Justice, Harmonique, composee de l’Arithmetique et de la Geometrique » et plusieurs autres signaleront l’« erreur de Bodin ». Elles ne sont pas identiques aux notabilia répertoriés dans la « Table alphabetique des choses notables contenues en ce Livre », et placés entre une page offrant un « Quadrain [sic] de l’Autheur » accompagné d’un autre quatrain anonyme, et le premier Discours. Elles ponctuent, malgré leur apparence scolaire, une rhétorique maîtrisée, qui laisse la place aux objections.
L’escrime de la vertu
Ce texte n’est pas l’œuvre d’un calviniste militant, car il expédie la question du libre-arbitre en choisissant Érasme contre Luther (p. 146), et celle de la prédestination en suivant un thomisme des causes premières et secondes, de la remontée des effets vers les causes (p. 149). En néoplatonicien docile, il dit croire à l’existence des démons et il renvoie l’astrologie à la médecine (p. 6). Pourtant, il connaît bien le milieu protestant du Sud-Ouest lié à Genève : trois ans après les Discours, il offre un sonnet et deux quatrains liminaires aux éditions augmentées de la Semaine de Du Bartas, éditées et commentées par Simon Goulart, deux auteurs avec lesquels il est certainement en relation. Dans l’édition de l’Angelier et Thimothée Jouan (Paris, 1582), imprimée aussi par Chevillot, Lostal se trouve en compagnie de personnalités huguenotes plus ou moins connues : Jean de Serres (le collaborateur du Platon d’Henri Estienne, professeur et ministre à Nîmes, et le frère d’Olivier), Anne (Johannes) Rulman père (régent du collège de Nîmes), I. D. CH. (Joseph Du Chesne, de Lectoure), Simon de Campagnan (ministre à Nîmes), Jacques Pineton de Chambrun (également ministre à Nîmes), Benoît Alizet (ministre à Genève)18. Ses poèmes, 189ni plus ni moins flagorneurs que ceux des autres, ne figurent pas dans l’édition genevoise de Jacques Chouet, ni dans l’autre édition parisienne de Gadouleau et Février en 1582. En revanche, la réédition genevoise de 1583 les inclut et l’édition L’Angelier-Jouan de 1583 (à nouveau imprimée par Chevillot) ajoute à la première liste d’autres auteurs « d’escorte », Théodore de Bèze, Du Touret de Roque-Martine, Buissay au Maine, et Lostal y figure toujours. Le jeune avocat bientôt procureur ne semble pas avoir été sollicité pour les éditions de la Seconde semaine parues à partir de 1584, où figurent Del Bene, Claude de La Trémouillle et Dorat, à côté de Bèze. Il a peut-être joui d’une certaine estime comme poète et fait circuler des odes et sonnets avant les Discours, car il y insère quelques vers sans grand relief qu’il revendique comme siens19.
L’exemplaire conservé à la bibliothèque municipale d’Orléans, à partir duquel l’édition numérique est en cours de publication, montre trois ex-libris des récollets de cette même ville et une mention finale qui semble tracée de l’une des mains franciscaines : « Bien souvent les livres sont catholicques dont les autheurs sont haereticques ». Comme les récollets ne se sont installés à Orléans qu’en 1619, cette remarque confirmerait le maintien de Lostal dans la religion réformée encore à cette date et même après, et la bonne opinion que des religieux pouvaient avoir sinon de l’auteur, du moins de ses Discours. Après la publication de ce qui s’apparente à un estimable mémoire de fin d’étude, on constate une longue éclipse qui dure jusqu’au Soldat françois et à la publication peu opportune de l’Avant-victorieux. Sauf si l’on tient compte d’un texte anonyme qui pourrait être de lui, l’Anti-Guisart (1586), réquisitoire serré contre les Guises et plaidoyer éloquent en faveur d’un nouveau concile et de la réunion des États-Généraux : cette attribution, si elle était confirmée par une analyse précise et par d’autres documents, modifierait le portrait que l’on peut dresser de Lostal.
Un autre texte, qui renchérit sur le Soldat françois deux ans plus tard, le Chevalier françois, lui est redevable, malgré l’attribution à mon avis erronée à Jean Pilieu (Peleus), un parlementaire catholique angevin qui aurait fort bien imité le style aussi combatif qu’érudit du Gascon20. Le 190fait que certains exemplaires de l’Avant-victorieux offrent une préface « À la France », où l’auteur avoue avoir publié les deux textes polémiques et situe son éloge outré d’Henri IV dans leur continuité, me semble un argument décisif21.
Le lieu de ses études supposé rapproche Lostal de Montaigne, malgré la différence d’époque : le collège de Guyenne. A. Communay n’indique pas l’année où le premier y est envoyé et ne cite pas d’archives précises, affirmant sa présence à l’instar des autres enfants de petits nobles et bourgeois du pays basque. Selon Ernest Gaullieur, les écoliers et étudiants s’étaient divisés en 1561 en quatre « nations », dont une basque/gasconne et une navarraise, qui se querellaient avec les clercs de la Bazoche à coup de moralités et de farces, mais aussi lors d’un tumulte armé que le futur beau-père de Montaigne, le président au Parlement La Chassaigne, eut à apaiser22. Ce Parlement, que soutenait la Bazoche, se situait majoritairement du côté catholique mais la jurade de Bordeaux, de laquelle dépendait le collège, était plus ouverte aux idées de réforme. Le principal Mongelos (le chanoine basque Hirrigaray) s’en est inquiété, d’autant plus que des disputes théologiques publiques opposaient un professeur de dialectique, Jacques Martin, aux franciscains de Bordeaux qui, dominés par la rhétorique du régent, ont demandé l’interdiction de ces controverses et obtenu le renvoi du professeur, remplacé par un prêtre.
Même si sa fréquentation du collège de Guyenne était confirmée, Lostal aurait été trop jeune pour avoir connu ces troubles : lui-même a dû y étudier entre 1568-1570 et 1576, alors que l’institution n’était plus 191aussi « florissante » qu’au temps de Montaigne, du temps des Gelida, Gouvéa, Sainte-Marthe, Cordier, Muret, Buchanan, Guérente, Grouchy… Certes Élie Vinet, principal depuis 1562, avait réussi à lui redonner de l’éclat après le départ de Mongelos et jusqu’en 1570, malgré les remous provoqués par l’adhésion (manifeste ou non) de nombreux élèves à la Réforme. Vinet est rappelé par les jurats pour être à nouveau principal en 1573, au moment où l’institution commençait à être en butte à la concurrence des jésuites soutenus par Henri III, et à connaître des difficultés financières qui rendaient difficile le recrutement des régents. Lostal avait-il eu comme maître Jacques Peletier du Mans, brièvement principal en 1572 ? ou Simon Millanges, qui y professait au moins depuis 1568 (ou même 1562) avant de s’établir comme libraire et imprimeur en 1572 ? ou le brillant professeur de philosophie Puget de Saint-Marc, que Vinet finit par arracher des griffes des jésuites en 157623 ? Dans ses Epigrammata publiés chez Millanges en 1574, Martial Monnier qui étudiait aussi au collège dessine le tableau d’une petite société où, si l’on remarque la présence de Vinet, ne figurent pas de représentants du « venin de Genève24 » ; parmi les dédicataires on lit les noms de Thomas du Ram, « arbitre de la nation gasconne » et Arnaud Pontac, président de la même nation, qui sont connus pour leurs positions ultra-catholiques. Quoi qu’il en soit, l’influence d’une bonne formation dialectique est sensible dans les Discours, par la confiance revendiquée envers une raison mise au service de la vertu morale et politique.
Puisqu’il est reçu avocat au Parlement de Bordeaux en 1583, selon A. Communay, il a dû adresser au maire Michel de Montaigne quelques bonnetades respectueuses, et on peut supposer qu’entre 1579 et 1583 il a commencé ou poursuivi des études de droit25. Il ne semble pas avoir exercé au Parlement, car il devient tout de suite procureur-général à Saint-Palais, sa ville natale. Le Parlement de Navarre envoyait des délégués à Bordeaux et peut-être a-t-il été brièvement l’un d’eux. Si pour Montaigne 192on suppose des études juridiques à Toulouse, la ville n’était guère, dans ces années-là, une université fréquentable par un protestant. Mathieu Du Pac, qui y avait enseigné dans les années 1530, avait été brûlé en effigie au temps d’Étienne Dolet (son élève) et de Boysonné. Lostal aurait-il été étudiant en droit à Orléans, comme La Boétie (1553) ? Mais les années 1550-1560, où l’université accueillait les réformés (Calvin et Bèze, et bien d’autres) et se préparait à devenir huguenote, connaissait, après une interruption des cours entre 1562 et 1567, une reconquête catholique hostile à toute présence de l’autre confession. Quant à l’université de Bourges, si elle avait bénéficié de la protection de Marguerite de Navarre (duchesse de Berry), de Jeanne d’Albret et des Bourbons, elle avait subi la même mise au pas. Valence serait une autre possibilité : cette université avait accueilli en 1570 Joseph Juste Scaliger, ancien élève du Collège de Guyenne, qui allait y écouter les cours de Cujas (1567-1575) avant que celui-ci ne retourne à Bourges (1575-1590).
Dans une lettre du 23 juin 1617 au Maréchal de La Force, où il réclame un « honneste surcroit de gages », Lostal dit qu’il est depuis trente-trois ans officier du roi, ce qui ramène à 1584, et depuis vingt ans vice-chancelier de Navarre puisqu’il a hérité de la charge de son beau-père, occupée précédemment par son grand-père maternel26 : le compte à rebours correspond à 1596, comme en témoigne aussi un document d’archive27. Il se considère comme l’héritier de Mathieu Du Pac en philosophie et en politique, et il l’évoque à deux reprises : dans l’épître au roi de Navarre (f. ã[5]r) d’abord, et lorsqu’il reprend en les traduisant les éloges par Charles de Sainte-Marthe d’un héros du savoir (p. 329)28. Professeur de droit formé à Padoue, Du Pac avait embrassé assez tôt le calvinisme et osé contester les impôts supplémentaires 193décrétés par François Ier lors de son entrée à Toulouse (le 1er août 1533), un bon exemple peut-être pour Lostal lorsqu’il recommande au souverain idéal de limiter l’imposition de ses sujets29. Du Pac avait aussi publié la dispute sur le Concordat entre Boysonné et Politi, et ses engagements lui ont valu de devoir fuir en Béarn pour se mettre au service et sous la protection de la maison de Navarre. Lostal devait se rappeler que son parent avait échappé au bûcher alors qu’il aurait pu être brûlé comme d’autres « tous vifz comme harans soretz » selon le narrateur du Pantagruel (1542, ch. v). Il a vu en ce courageux ancêtre un modèle associant savoir et efficacité politique, non sans risque.
Lostal entend aussi suivre les pas de son père Jean Lostal, qui avait maté selon lui la sédition des catholiques Béarnais contre le changement confessionnel imposé par Jeanne d’Albret à Oloron-Sainte-Marie30. À diverses reprises dans les Discours, il dit se méfier de la « populace », approuvant Montmorency d’avoir réprimé avec une « juste rigueur » la rébellion de « quelques Gascons » contre la gabelle (p. 223).
Politiquement baroque
Les jugements négatifs sur Lostal concernent surtout les pièces postérieures à 1600. Le plus connu est celui du cardinal Du Perron :
M. de la Brosse apporta [au cardinal] un discours fait par cet homme de Béarn, intitulé l’Avant-Victorieux, après en avoir entendu lire quelque chose, il dit : « Jamais je ne vis livre plus maniaque que celui-là, c’est un fou qui devrait être enchaîné, c’est le plus impertinent qu’il est possible de trouver. [Pierre] Mathieu pourtant est encore plus insupportable, et a les métaphores plus impures que lui. Notre langue s’en va perdue, puisque de telles gens trouvent qui leur applaudissent ; j’ai toujours dit que la langue française ne durerait pas, ni ne viendrait à sa maturité ; nous allons entrer en une grande barbarie31.
194L’Avant-victorieux est effectivement un opuscule de prose épidictique, excentrique et ampoulée, que Claude Faisant avait qualifiée à juste titre de « baroque », d’exemple de ce style « Nervèze » à la mode au temps d’Henri IV, fort peu malherbien et fustigé par la France protestante :
Rien de plus insupportable que les fades louanges, les ridicules gasconnades, les hyperboles outrées dont ces trois volumes abondent, si ce n’est le style pompeux, recherché, presque inintelligible, dans lequel ils sont écrits […]32.
Les Discours, bien qu’ils soient assez « épais en figures », comme dirait Montaigne, se situent encore dans la postérité d’un Ronsard amplifié par Du Bartas, plus maniéristes que baroques. Le jugement de Joseph Juste Scaliger est nuancé : s’il parle bien de « ce fou de Lostaut », il ne lui reproche rien de particulier et signale la publication d’une remontrance au roi contre la Compagnie de Jésus (malheureusement sans date), en racontant que les (riches) jésuites d’Agen ont payé une lamproie deux écus, à quoi le père Richeome n’avait pas répondu. L’expression de « fou » (reprise par Bayle) peut aussi renvoyer aux personnages des bouffons royaux endossés par ses contradicteurs ou ses partisans. Il est vrai que l’auteur des Discours avait lancé deux piques énigmatiques contre le fils de Jules César Scaliger en disant qu’« en la reprehension des choses de nulle importance [il] se detraque encore ordinairement du sentier de modestie & de verité » (p. 13) et qu’il mériterait de figurer avec Henri Estienne parmi les « escrivains inutiles » et les personnes « moins facetieuses à brocarder » (p. 119-120).
D’autres auteurs exploitent directement les Discours comme Guillaume Bouchet dans les Sérées, ce qui confirme sans le dire leur relative célébrité33. La Croix du Maine avoue ne connaître que cette œuvre, sa Bibliothèque française étant publiée en 1584 :
Il a mis en lumiere quelques siens discours Philosophiques, n’estant pour lors âgé que de vingt ans, imprimez à Paris chez Pierre Cheuillot l’an 1579. 195auquel temps il florissoit, ie ne sçay s’il est encores viuant. I’ay opinion qu’il aura peu depuis ce temps là composer plusieurs autres beaux œuures, desquels ie n’ay pas cognoissance pour le iourd’huy34.
Antoine Du Verdier, dans sa propre Bibliothèque parue l’année suivante, montre sa considération en reproduisant entièrement le Discours vi, « Des effets des trois facultez de l’ame, & des perturbations, vrais surgeons de la partie sensuelle », comme il le fait pour les Essais en recopiant le chapitre I, x, « Des Livres35 ». Mieux renseigné que La Croix du Maine sur les auteurs du Sud de la France, il n’assortit pourtant son extrait d’aucun détail ni commentaire. Le choix de ce chapitre est intéressant dans la mesure où y est condensé le platonisme stoïco-académique de Lostal, alors consensuel, et duquel Montaigne est sensiblement éloigné.
L’un des emprunts de Bouchet permet de tester la chaîne des sources, et notamment le rapport étroit et critique que Lostal entretient avec la République de Bodin (parue en 1576 chez le même éditeur que les Discours), tout comme Montaigne. Qui a emprunté à qui ? Soit le fameux passage sur la coutume de Guzila, ce peuple qui, selon le récit de Léon l’Africain, élit le premier venu pour exercer la justice :
Et quant à la puissance de commander, que les hommes populaires veulent esgaler, il y a moins encores d’apparence que aux biens, car la sagesse et prudence, n’est pas esgalement donnee à tous et faut par necessité choisir en l’estat populaire des plus suffisans magistrats pour commander, et distribuer la justice. Et qui plus est, où il n’y a forme aucune de souveraineté, ny de Republique, le peuple est contraint de faire un Magistrat, ou capitaine pour commander, et faire justice : comme en Afrique au païs de Guzula, où il n’y a ni Roy, ni forme quelconque de Republique, le peuple aux jours de foire eslist un capitaine pour faire justice, et asseurer le cours de la traffique : et aux frontieres du Royaume de Fez les habitans de la montaigne de Magnan, qui n’ont point aussi de forme de Republique, arrestent les passans par force, pour recevoir d’eux justice36.
Lostal le suit de près :
196Et tout ainsi qu’vn corps ne peut subsister sans teste : Semblablement il n’y a forme de Republique, qui n’ait besoing de quelque magistrat, pour veiller sur tous les affaires, comme en Afrique au pays de Guzula, la populace crée vn Iusticier aux iours de foire, pour asseurer le cours de la traffique : Et aux lisieres du Royaume de Fez, les habitans de la montagne Magnan arrestent les passans pour receuoir Iustice d’eux. (f. A[3]v-A[4]r).
Là où Bodin écrit « frontières », Bouchet met « lisières », comme Lostal son intermédiaire. La confrontation avec le même passage cité et commenté par Montaigne dans « De l’experience » met en évidence la différence d’approche :
Nature les [les lois] donne tousjours plus heureuses que ne sont celles que nous nous donnons. Tesmoing la peinture de l’aage doré des poëtes, et l’estat où nous voyons vivre les nations qui n’en ont point d’autres. En voylà qui, pour tous juges, employent en leurs causes le premier passant qui voyage le long de leurs montaignes. Et ces autres eslisent le jour du marché quelqu’un d’entre eux, qui sur le champ decide tous leurs proces. Quel danger y auroit-il que les plus sages vuidassent ainsi les nostres, selon les occurrences et à l’œil, sans obligation d’exemple et de consequence ? A chaque pied son soulier. (III, 13, éd. Villey, p. 1066 ; 1588-EB, f. 479r)
Alors que Bodin et Lostal insistent sur la nécessité d’avoir un chef, et un chef compétent chez Bodin, Montaigne évoque les mêmes exemples pour demander si l’on ne peut pas se passer d’un chef permanent, capable ou non. Pierre Villey renvoyait à Bouchet qui s’inspire selon lui de Bodin et de Lostal : par conséquent, si Bouchet a emprunté à Lostal et que Montaigne a emprunté à Bouchet, Montaigne aurait emprunté (sans le savoir et en infléchissant la portée de l’exemple) à Lostal, lequel s’inspire étroitement de Bodin. L’écheveau des emprunts est délicat à démêler.
La rouille de l’âme
La philosophie défendue par Lostal s’appuie sur une société bien organisée et obéissante, grâce à la fusion entre platonisme et aristotélisme qui suit l’enseignement éclectique (et hétérodoxe) de Fox Morcillo37, 197mentionné plusieurs fois, et du lecteur royal Jacques Charpentier (mort en 1574). L’auteur fait aussi rapidement l’éloge de Ramus dont il évoque le « souvenir » avec émotion (p. 190), alors qu’il n’a sûrement pas connu le philosophe assassiné à la Saint-Barthélemy. Fidèle alors à la vision austère des calvinistes en accord avec le stoïcisme sur ce point, il insiste à plusieurs reprises sur le mépris de la chair qui lui fait accepter sans réserve la conception de Platon (le corps comme tombeau de l’âme) sans renoncer complètement à celle d’Aristote (l’instrument), en restant assez proche d’un Jean de Serres. Son platonisme exclut la métempsycose et la réminiscence, et s’il croit à l’existence réelle des Intelligences, ce n’est pas le cas pour les Idées ou « fantasies » de Platon (p. 69), ce qu’il prend peut-être à Melanchthon.
Selon Françoise Joukovski, qui a étudié l’influence du philosophe du mouvement dans les Discours, « Héraclite apparaît à P. de Lostal comme un philosophe qui capitule devant l’illimité et l’indéfini38 ». En effet, Lostal corrige Platon et Héraclite par un Aristote universitaire et pragmatique, par le Cicéron des Académiques, et croit en la raison mise à « l’équerre de la vérité », laquelle peut être saisie par une âme locataire malgré elle de ce corps encombrant. L’exercice du jugement y mène nécessairement, sans qu’il se sente toujours obligé de trancher. Pour l’âme universelle, l’auteur semble tenté par ce qu’en disent Cardan –comme l’avait remarqué Henri Busson– et Hermès Trismégiste, lu dans la traduction de Foix-Candalle sans doute : il renvoie toutefois la question aux théologiens, et s’il parle souvent de Dieu comme Entité, il se garde bien d’empiéter sur un domaine réservé39. De même, il envisage « une certaine âme » des bêtes sans aller jusqu’à leur reconnaître des facultés comme le fait Aristote, et au Discours x il admet que le problème n’est pas résolu (p. 164 sqq.).
Moraliste tout rempli des bons préceptes inculqués par ministres et régents, il exprime sa méfiance envers la paresse et l’oisiveté, cette « fetardise » (de festa) que l’on traduirait aujourd’hui en termes de recherche de jouissance sans peine, insistant sur une éthique chrétienne 198qui tient à corriger l’esprit « affetardy40 ». L’âme ne doit rien au corps et, s’il admet du bout de la plume que la connaissance s’appuie sur les sens, Lostal construit ses discours sur les Intelligences et l’innéisme, sans croire pour autant à l’oubli des connaissances antérieures à la « dommageable et peccamineuse » incorporation : la connaissance est « ennee » en l’ame, mais celle-ci est « rouillée » par le corps comme une vieille épée (p. 62). Il ne cesse de recommander une maîtrise aussi ferme que possible du corps et des passions, afin de dominer ce qui provient de notre « bourbier » sensuel. En quoi il est assez loin de Montaigne pour qui le corps mérite attention et sollicitude en permettant de borner l’insatiable curiosité de notre esprit et les extravagances de la raison. Ce sont ces passions sensuelles qui font que les rois deviennent tyrans, alors que Montaigne n’en rend pas le corps responsable. En magnifiant la vertu qui permet de tempérer la partie charnelle de l’homme, Lostal a pu être considéré comme un représentant du néostoïcisme calviniste avec Duplessis-Mornay et Pierre de La Primaudaye41.
Un autre exemple de source commune concerne l’utilisation par les deux auteurs des Dialogues de Guy de Bruès, dans des emprunts étudiés par Henri Busson et Jean Céard notamment. Le rapprochement avec un passage très semblable de Montaigne est effectué par Pierre Villey (sur la p. 546), mais il n’est pas repris dans les éditions récentes des Essais qui ne renvoient qu’à Bruès, lequel, effectivement, donne les mêmes lignes issues des Académiques I de Cicéron (II, xxxix, 124) et de Diogène Laërce (III, 67)42. Cette longue énumération est familière aux lecteurs de « L’Apologie de Raymond Sebon » :
Et partant qu’il n’y a qu’une ame laquelle par une seule faculté ratiocine, se souvient, comprend, juge, desire & exerce toutes ses autres operations par 199divers instrumens du corps : tout ainsi que le Nocher gouverne son navire selon l’experience qu’il a, ores tendant & laschant une corde, ores haussant l’entenne, & ores prenant l’aviron, sans qu’il ait qu’une mesme ame de laquelle procedent toutes ses actions, non pas par ce qu’elle a diverses puissances, mais bien par ce qu’elle s’aide de divers instrumens du corps, selon qu’ils sont aptes à executer ce qu’elle proiette. (p. 78)
Si l’influence malheureuse du corps sur l’âme n’est pas niée, si elle loge probablement au cerveau pour Montaigne qui trouve que cette opinion est « la plus vraisemblable43 », il n’est pas question pour Lostal d’attribuer à l’âme une quelconque corporéité, et les astres ne sont influents que sur les corps. En bon néoplatonicien il admet que le corps subtil des démons peut posséder les « rustiques », leur faire parler « tout langage » avant que des « imprécations » appropriées ne les en fassent sortir (p. 137-138)44. En bon aristotélicien il admet les quatre éléments, mais les complète sans les remplacer par ceux qu’il a trouvés chez Paracelse (sans doute par l’intermédiaire de Joseph Du Chesne), le mercure, le soufre et le sel, que nous pouvons « toucher à la main » grâce à une prétendue évidence empirique, ce qu’il affirme dans une digression de médecine alchimique qui met dans le même sac d’ignorance Platon, Aristote et Galien (p. 18-19)45.
La farce du roi d’Aragon
L’originalité de son propos ne se situe pas dans cet éclectisme. Bien qu’il le recopie parfois littéralement, comme d’autres de ses sources, l’étudiant Lostal s’oppose à Bodin sur la question de la souveraineté. 200Apparemment, il penserait que la monarchie doit être absolue si l’on s’en tient à ses déclarations de la préface au « roi » Henri de Navarre : manquer de révérence envers le monarque revient à se déclarer athée. Mais la philosophie lui fournit cette fameuse « équerre de la raison » pour analyser les modes de gouvernement, et les fondements d’une éthique stricte qui aide à dominer les passions, chez les rois en particulier.
Royaliste et loyaliste, il est néanmoins proche en théorie du monarchomaque François Hotman car sa comparaison entre les trois formes de gouvernement, « ces descriptions de police » que Montaigne trouvait oiseuses, est loin de favoriser l’absolutisme monarchique. Sa longue discussion sur les proportions mathématico-politiques chez Bodin (lu de près), diagrammes à l’appui, montre autant son opposition à une interprétation autoritaire de la loi du monde appliquée à la loi des hommes pour favoriser le pouvoir absolu, que la nécessité d’être ferme face aux séditions populaires. L’exemple du grand-père résistant à l’autoritarisme de François Ier se devine aussi dans au moins deux analyses : lorsqu’il déconseille au roi de trop imposer ses sujets, on l’a vu, et lorsqu’il discute longuement l’analyse du gouvernement monarchique par Bodin. La menace du tyran caché sous un monarque qui ne tient pas compte de ses conseillers affleure également et c’est François Ier qui est visé lorsque Lostal critique la formule « Tel est notre plaisir » « sans produire aucune raison en avant » (p. 287).
Lostal se permet de corriger Bodin dans sa distribution des proportions de la justice, qui conditionne l’appréciation du meilleur gouvernement. Contrairement à l’auteur de la République qui associe la proportion harmonique à la monarchie, Lostal en fait au contraire le principe du gouvernement aristocratique, qui « approprie les peines et loyers à leur état », « tient la bride au Tyran & à la confusion populaire », ajoutant ce qui le rapproche de La Boétie et peut-être de Montaigne : « selon que l’on peut voir en la Republique de Venise, qui est la plus fleurissante de l’Europe » (p. 267). Un peu plus loin, il déclare que la monarchie doit être tempérée par le respect des lois, l’accommodation aux lieux et aux temps et par la réunion des états.
Son discours serait-il seulement « philosophique » sans viser expressément la France et le gouvernement d’Henri III ? La monarchie ne convient pas aux hommes libres comme le sont les Français, et le berger n’est pas de la même nature que son troupeau : sans vouloir en 201dire plus, il renvoie à un « brave politique » de son temps (p. 269) qui conviendrait à ce que laisse voir le protestant Jean de La Taille, auteur d’un « Prince nécessaire » rédigé juste avant la Saint-Barthélemy46. Lostal raisonne à l’inverse de Bodin, qui part de la situation française pour décider que ce type de gouvernement harmonique est le meilleur pour ce pays puisque « l’Estat Royal, est celuy qui se servant de la Justice Arithmetique, authorise diversement les subjects, & qui admet inegalité de dignitez entre les personnes auparavant egales en chevance & en honneur » (p. 271). Au contraire, pour Lostal il faut proportionner les punitions aux revenus et au forfait, ne privilégier ni les nobles ni le peuple. Il consent à ce que les peines soient moins pénibles pour les premiers, à cause des mérites passés et il rentre même dans des détails de justice pénale : il faut conserver la décapitation pour les nobles, la corde pour les roturiers, mais trouve injuste la disproportion entre l’amende honorable pour les uns et le fouet pour les autres. Il s’emporte contre la corruption des magistrats et l’impunité des nobles, causes des révoltes, et déclare que le mérite est indépendant des richesses et de la noblesse, comme pour Mathieu Du Pac qui, issu « de mediocre lieu (noble neantmoins de race & d’esprit) », est devenu chancelier d’Antoine de Bourbon (p. 329). Il ne faut pas pour autant, comme à Venise, donner des charges importantes à des roturiers et encore moins s’inspirer de Thomas More, dont il méconnaît le caractère fictif de l’utopie, ni du communisme des anabaptistes, ce qui ne l’empêche pas de faire l’éloge des Crétois et des Lacédémoniens (p. 335). Il s’attaque même au droit d’aînesse absolu et conseille de le proportionner à l’ordre de naissance (les aînés doivent prendre soin des puînés), et ainsi les différences et inégalités forment une harmonie, comme la « copulation » des consonnes et des voyelles forment une parole (p. 342).
Lostal encouragerait donc une monarchie aristocratique fondée sur le mérite, contrairement à la démocratie qui élit n’importe qui, et à la royauté qui se prétend au-dessus des lois. Même si le consentement populaire n’est pas du tout nécessaire, il est clair que pour lui le droit est supérieur à l’institution monarchique et il fait allusion à la célèbre « farce » du roi d’Aragon, où l’allégorie du Droit avait rappelé ses devoirs 202au souverain : cette mise en scène avait été destinée à expliquer au roi espagnol la nécessité de respecter la loi, même inique. Lostal emprunte cette fable à la Franco-Gallia de François Hotman, presque dans les mêmes termes, en indiquant l’auteur et le titre dans la marge47 :
A ceste cause les Espagnols voulans créer vn Roy en l’assemblee generale des Estats d’Aragon, pour rendre l’action plus memorable, faisoient venir un homme desguisé, comme estans en deliberation de jouer une farce, auquel ils imposoient le nom de Droict d’Aragon, & declaroient qu’il estoit par l’ordonnance du peuple plus grand & plus puissant que le Roy, finalement ils s’addressoient au Roy mesmes qu’ils auoient esleu soubs certaines loix & conditions, & luy disoient en ces termes, Nos qui valemos tanto comme [sic pour como] vos, y podemos mas que vos, vos elegimos Rey comme [sic pour con] estas y estas conditiones : intra vos y nos, un que manda mas que vos, Qui vaut autant à dire comme, Nous qui valons autant comme vous, & qui pouvons plus que vous, nous vous elisons Roy, avec telles & telles conditions : entre vous & nous, vn commande qui est plus que vous. (p. 280-281)
Cet exemple qui met pour une fois en valeur les Espagnols est important dans la discussion entre les monarchomaques et Bodin sur la souveraineté. Mais, ajoute Lostal, ce principe doit être souple, et le roi peut corriger la loi si c’est dans l’intérêt du peuple, et on peut la laisser dormir si besoin est, comme Montaigne le rappelle aussi. Ébloui par la grandeur et les succès de « son » roi de Navarre redoutable foudre de guerre, une fois Henri IV vainqueur des ligueurs et solidement installé sur le trône, Lostal soutiendra bien davantage l’autorité du monarque tout en adoptant avec une certaine insolence la posture d’un conseiller militaire : un général qui se laisse aller aux délices de Capoue risque d’encourager l’agressivité des ennemis et de perdre l’estime des ses sujets.
203Potirons d’une nuit
Dans les Discours, Lostal emploie le mot « politique » surtout dans le sens de « législateur » mais dans la « Prudence » il décrit un « état politique » imprégné d’esprit machiavélien : comme le peuple est une bête, il faut le flatter par de belles paroles, distribuer festins et danses, se ranger à la coutume, et, tout en restant dans le juste milieu, il ne désapprouve pas ce qu’il appelle la « prudence populaire » d’Aristote, qui pratique « le croc en jambe aux meschans » (p. 142).
Plus hardiment, l’auteur de l’Anti-Guisart est prêt à sacrifier « quelques mutins », en l’occurrence les Guises, pour sauver le royaume, bien loin du respect que Montaigne vouait à cette maison. Les exemplaires de la première édition (La Rochelle, Pierre Haultin, 1586), sont très rares mais la pièce a été maintes fois reprise dans le Premier Recueil contenant les choses plus mémorables advenues sous la Ligue (1586) et dans les Mémoires de la Ligue (1598) de Simon Goulart. C’est sur un exemplaire du Recueil conservé à la Bibliothèque nationale qu’une main attribue l’Anti-Guisart à Lostal48. Si l’on n’y trouve pas encore le ton du panégyriste excessif de l’Avant-Victorieux et de la Navarre en dueil, la façon d’argumenter renvoie l’image d’un calviniste proche des « Politiques » du temps des guerres de la Ligue.
L’Anti-Guisart signe effrontément son texte de l’anagramme « Bon heur de bon roy » (Henry de Bourbon), soulignant la légitimité royale et la nécessité d’appliquer la loi salique, coutumière, d’autant plus qu’entre-temps François d’Alençon est mort (1584) et qu’Henri de Navarre est devenu l’héritier. Lui aussi reproche aux tyrans de prendre leurs propres affects pour des lois : ainsi les Guises font-ils fi du droit, qui ne sert que leurs passions lorsqu’ils prétendent restaurer la noblesse et le clergé dans leurs prérogatives, au nom de l’ancienneté de leur race, alors que ce ne sont que des « potirons venus d’une nuit » (p. 582, p. 635). Quant au souverain, dont il ne conteste pas la puissance, il doit se rendre aussi à la raison :
204[…] il faut que le cours de la raison arreste la puissance du Prince, comme fait le Soleil, lequel, lorsqu’il est plus haut eslevé en la partie Septentrionale, chemine plus lentement, rendant son cours plus asseuré par la tardité. (p. 658)
Il donne plusieurs motifs à cette conduite politique : l’impossibilité de forcer les consciences, l’inefficacité de la violence et les bons exemples des souverains qui ont toléré sur leurs territoires d’autres religions que la leur (l’empereur Auguste, Charles Quint, le Sultan), exemples que l’on retrouve dans le Chevalier françois. Dans la dernière partie (à partir de la p. 655), une « prière au roi » qui suit une prière à Dieu, il fait parler la France avec des accents albinéens (« mes propres enfants me percent les flancs, m’arrachent les entrailles », p. 656) et déploie une éloquence digne de la harangue de d’Aubray (écrite par Pierre Pithou) dans la Satyre ménippée. On y lit une expression rabelaisienne (« de même pain soupe ») et une autre que Montaigne utilisera plus tard précisément dans « De l’utile et de l’honnête » pour désigner les profiteurs : « pêcher en eau trouble ». Dans l’un de ses manuscrits, Pierre de l’Estoile recopie le texte de cette prière, qu’il n’a pas publiée et dont il ne connaît pas non plus l’auteur49.
Lostal et l’Anti-Guisart montrent une certaine verve, portée jusqu’à l’excès dans les publications tardives. Comme le remarque Jean-François Courouau, ni Montaigne ni Lostal ne mettent en avant la nécessité d’écrire en gascon : contrairement à Du Bartas qui pratique une modeste muse gasconne, ces magistrats ont adopté la langue du pouvoir et de l’administration, le français, en se laissant une certaine liberté dans son usage, y compris pour les emprunts au gascon chez Montaigne50. Chez Lostal en revanche, pour qui le français est la « langue de toutes la plus recommandable » (Discours, p. 21), c’est la créativité néologique et son style fleuri qui le distinguent. Il devait connaître sinon pratiquer une 205troisième langue, le basque, dont il ne dit rien alors que les ministres et prédicateurs protestants avaient très tôt évangélisé dans cette langue51. S’il sait recopier des citations latines, ce qu’il ne fait pas encore dans les Discours, il ne semble pas avoir composé ni publié en latin, ni même fait semblant d’être helléniste. En revanche, il use de termes rares alors en français, non seulement des calques (des notions ennees) mais aussi des composés utiles (et sans grand avenir) pour enrichir la prose métaphysique française à l’aide de termes construits à la manière de de Ronsard (contre-garder, contre-imiter) ou d’autres comme surjonner, mistionner, acertener ou le plus rare acertiorer. Non sans quelque ambiguïté toutefois pour nous car il traduit parfois Ens par « Entité » et non par « étant », comme l’avait fait Le Caron, de façon à le distinguer du terme d’« être » substantivé, plus courant alors et utilisé par Montaigne52. L’une de ses créations supposées, l’adverbe abstractement, est considérée par les lexicographes comme une première attestation sans postérité, comme un « hapax d’auteur » selon le Trésor de la Langue Française qui donne la référence à Lostal53.
Le contexte d’apparition de ce mot mérite attention car l’auteur expose, dans sa prose argumentative complexe et plus souvent imagée qu’abstraite, l’opinion des stoïciens qui tiennent à une vertu naturelle alors que lui-même entend promouvoir aussi la vertu acquise par exercice, comme l’habileté de l’escrimeur et l’expertise du maquignon :
Que s’il me failloit necessairement adherer à l’opinion d’une de ces deux sectes pour le regard de ceste dispute, je dirois pour l’approbation du dire des Stoiciens que le Philosophe s’imagine tousjours les qualitez en quelque Individu, alors qu’il les veut considerer abstractement comme l’on dit, & qu’elles sont du tout semblables au nombre auquel l’on ne peut rien adjouster ny en retrancher sans la mutation de l’espece, & que partant le plus ny le moins ne competent point aux qualitez, veu que la cause d’iceux consiste en divers degrez de la permixtion de deux contraires, ce qui symbolise proprement au subject non pas à la qualité, ny par consequent au vice : Mais quant à moy […] (p. 169)
206L’enjeu porte sur la perfectibilité de l’homme à partir d’une vertu naturelle et innée (position des stoïciens) modulant la position aristotélicienne fondée sur le mélange des contraires, de l’inné et de l’acquis. La discussion, assez abstruse, penche plutôt pour la solution d’Aristote tout en maintenant le principe d’une vertu « intérieure », un débat qui devait avoir souvent lieu aux écoles. Son irénisme philosophique ne lui interdit pas d’effectuer plus tard des choix politiques beaucoup moins abstraits, au nom de l’honneur et de la vertu.
Les destinées de Montaigne et de Lostal sont à la fois parallèles et décalées, et leurs livres ne se nouent que dans leurs lectures. Lostal, ce farouche serviteur de la France et de la Navarre, se révèle assez peu « philosophe » comme homme d’action, se montre plus bagarreur que conciliant et la colombe ratiocinante et politique de ses débuts, le platonicien contemplatif des Intelligences, semble s’être converti en mousquetaire enthousiaste. Si les Discours font état de questionnements et de doutes à la manière des Académiciens, ils n’ont pas incité leur auteur à suspendre son jugement, à « soutenir » en attendant les coups : il ne dit pas « je ne bouge », il va de l’avant. L’avenir lui donnera raison : si Henri IV et Louis XIII ont évité une nouvelle guerre contre l’Espagne, si la haute-Navarre est restée encore longtemps espagnole, Louis XIV relèvera le défi, en Soleil plus luisant de passions que ralenti par la raison. À Lostal revient l’éloquence délibérative enflammée comme la paille, à Montaigne l’essai qui fait long feu.
Marie-Luce Demonet
Centre d’Études Supérieures
de la Renaissance
Université de Tours
1 Michel de Montaigne, Les Essais, Paris, Presses Universitaires de France, 1965.
2 Pierre de Lostal, sieur d’Estrem, Les Discours philosophiques […] Esquels est amplement traitté de l’Essence de l’Ame, & de la Vertu Morale, Paris, Jacques Du Puy, 1588, p. 399. L’exemplaire suivi pour lequel je prépare une édition numérique est celui de la Bibliothèque Municipale d’Orléans (C 191), dont le fac-similé est en ligne sur le site des Bibliothèques Virtuelles Humanistes depuis 2011 (http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=780 ; consulté le 29/10/2020).
3 Le privilège est à nouveau au nom de Gilles Gourbin, mais l’imprimeur semble différent.
4 Jean Balsamo, « Édition de 1588 », article du Dictionnaire Montaigne, dir. P. Desan, Paris, Champion, 2004, p. 304-306.
5 Montaigne, Journal de voyage, édité par F. Rigolot, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 139 ; transcription en ligne sur le site des Bibliothèques Virtuelles Humanistes, « Nouvelle transcription de la copie Leydet d’un “Extrait des Voyages de Montagne” », par Alain Legros, mise en ligne le 29 mai 2015, f. 64v. Vasco peut être traduit par « gascon » ou par « basque ».
6 Arnaud Communay, « Pierre de Lostal, vice-chancelier de Navarre », Revue de Gascogne, 25, 1884-1, p. 330-337. Le projet ANR AcroNavarre (Université de Pau et des Pays de l’Adour) fournit des renseignements sur ce milieu grâce notamment aux recherches de Dénes Harai. Ce Pierre de Lostal ne doit pas être confondu avec son homonyme de la même famille, ministre protestant de la génération précédente, assassiné par les catholiques béarnais révoltés contre Jeanne d’Albret en 1569 (Nicolas de Bordenave, Histoire de Béarn et Navarre, éd. Paul Raymond, Paris, J. Renouard, 1973, p. 222) : un événement auquel l’auteur des Discours fait référence (f. A[5]v) pour souligner le rôle joué par son père dans la défense du protestantisme (Eugène et Émile Haag, La France protestante, Paris et Genève, Joël Cherbuliez, 1857, VII, p. 83-84). Une mutinerie catholique avait déjà eu lieu à Oloron en 1563 contre le bris des images (Histoire de Béarn et Navarre, op. cit., p. 119).
7 Paru sans lieu ni nom d’éditeur. Sur la page de titre de l’exemplaire de la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux (H 8099) la date de 1604 est accompagnée de la mention « dernière édition ». Le Soldat françois est réédité plusieurs fois, jusqu’en 1617.
8 Pierre de L’Estoile, Journal du règne de Henri IV, La Haye, les Frères Vaillant, 1741, III, p. 151-152. Dans La Société béarnaise au dix-huitième siècle (Pau, Léon Ribaut, 1876, p. 283), anonyme, l’auteur commet plusieurs erreurs, attribuant à Lostal un Soldat suédois (sic).
9 Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, C. Desplaces, 1858, XX, p. 28. Marie-Madeleine Fragonard, « Obscurs, sans grade, fous et diffamés : les voix du peuple des pamphlets », dans Devis d’amitié. Mélanges en l’honneur de Nicole Cazauran, éd. Jean Lecointe, Catherine Magnien, Isabelle Pantin, Marie-Claire Thomine, Paris, Classiques Garnier, 2002, p. 867-885 (p. 867-868). Prosper Marchand, dans son Dictionnaire critique (La Haye, Pierre de Hondt, 1758, I, p. 56-57) avait établi une liste de ces échanges assez vifs et mentionné la réaction mitigée d’Henri IV à l’égard du Soldat François.
10 Dans sa Bibliographie de la littérature française du seizième siècle (Paris, Klincksieck, 1969), Alexandre Cioranesco recense plus de soixante libelles qui se réclament du personnage-type de Maître Guillaume (voir à ce nom).
11 Serge Brunet, « Perceptions identitaires et nationales dans la France de la première modernité : de la francité et de l’hispanité des Gascons », dans Mikhaïl-V. Dmitriev et Daniel Tollet (éd.), Confessiones et nationes. Discours identitaires nationaux dans les cultures chrétiennes, Moyen Âge-xxe siècle, Paris, Champion, « Bibliothèque d’étude des religions du monde », 2013, p. 57-125 (p. 107-108).
12 La Navarre en dueil, [Orthez, 1610], Rouen, Jean Petit, 1611, p. 7. Jacques-Davy Du Perron, dans Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pithoeana et Colomesiana, édités par Pierre Des Maizeaux, Amsterdam, Covens et Mortier, 1740, I, p. 320 ; Joseph Juste Scaliger, ibid., II, p. 433.
13 Verdun-L. Saulnier, « L’oraison funèbre au xvie siècle », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, no 10, 1948, p. 124-157. Sans en dire davantage, l’auteur situe La Navarre en dueil parmi les « exposés d’apparat » (p. 127, note 5).
14 Les Questions diverses et discours de Le Caron sont publiés en 1579. Sylviam Bokdam a aussi noté cette chronologie (« La question astrologique chez Tyard, de Mantice aux Homilies », dans Pontus de Tyard, poète, philosophe, théologien, Paris, Champion, 2003, p. 279-298 (p. 280)). Les « discours » de Pontus de Tyard publiés séparément en 1556 et 1557 ne portent pas encore le titre générique de « discours philosophiques ».
15 I. De la composition humaine ; II. Si nos ames se perfectionnent par la copulation du corps, ou non, et de l’immortalité et mortalité d’icelles. III. De la cognoissance de l’Ame, apres qu’elle s’est associee avec le corps. IV. Que l’ame n’est ny corps, ny qualité d’iceluy. V. Des facultes de l’ame, de l’accord discordant d’icelle, et du lieu qu’elle obtient en nous. VI. Des effects des trois facultez de l’ame, et des perturbations, vrais surgeons de la partie sensuelle.
16 Discorsi Morali, Politici et Militari, traduits par Girolamo Naselli, Ferrare, Benedetto Mammarello, 1590.
17 Le discours sur la Prudence a attiré l’attention de Francis Goyet dans Les Audaces de la prudence – Littérature et politique aux xvie et xviie siècles (Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 227) : « Or pour le xvie siècle la prudence est d’abord, comme chez Aristote ou Thomas d’Aquin, la vertu propre du prince. Le mouvement est descendant : on va de gouverner la Cité à se gouverner soi-même, et non l’inverse. Comme le dit un Pierre de Lostal en 1579 : nous sommes prudents en ce que nous sommes “les rois de nous-mêmes et de nos familles” ». Valérie Dionne rapproche sur ce point Montaigne de Lostal dans Montaigne, écrivain de la conciliation, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 137.
18 Guillaume Salluste Du Bartas, La Semaine, Paris, Abel l’Angelier et Thimothée Jouan, 1582. Les initiales TH.G.A. et L.P.A. ne semblent pas avoir été déchiffrées.
19 Jean Pallet est surtout connu pour son Diccionario muy copioso de la lengua espanola y francesa (1604), à tel point que certains catalogues le pensent espagnol. Il exerçait à Saint-Jean-d’Angély, au service du prince de Condé.
20 Le Chevalier françois, s.l., 1606 (sur l’exemplaire numérisé de la Bayerische Staatsbibliothek). Comme il prend la défense du Soldat françois, il ne peut être daté de 1600 comme la notice de l’exemplaire de l’Arsenal l’indique. Jules Mathorez avait indiqué la page (136) du Chevalier où Jean Peleus s’attribuait le texte, mais elle n’y renvoie pas (« À propos d’une campagne de presse contre l’Espagne », Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, juillet 1913, (I) p. 313-329 et (II) p. 365-385).
21 « À la France », f. Ar. Dans « L’extravagance gasconne dans Le Gascon extravagant : un déguisement “pour parler librement de tout” » (Les Dossiers du Grihl, 2007-01, consulté le 05 août 2020), Jean-Pierre Cavaillé considère comme acquis que l’auteur du Chevalier françois est Peleus, et qu’il est gascon, suivant l’ancienne attribution de Jacques Lelong (Bibliothèque historique de la France, Paris, Gabriel Martin, 1719, p. 439) ; il reproduit un intéressant jugement de Guillaume Colletet dans sa Vie des Poètes gascons sur les « périodes fougueuses » des deux traités, bien loin des douceurs de ce qui s’écrit entre Seine et Loire (éd. Philippe Tamizey de Larroque, Paris, Auguste Aubry, 1866, p. 32).
22 Ernest Gaullieur, Histoire du Collège de Guyenne, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874, p. 257 (les nations Vasconica, Francia, Navarra, Provincia). Le service d’ordre du collège était assuré par des Basques, assez brutaux. Au début du xviie siècle les nations se divisaient encore en Gascons, Basques, Limousins, Bretons et Poitevins (ibid., p. 409).
23 Gaullieur, op. cit., ch. xviii, xix, xx. Saint-Marc offre une synthèse des recherhes sur l’auteur du Pimandre au début de la traduction par Foix-Candalle (Bordeaux, Millanges, [1574], 1579, f. A[5]r-v). Le collège de Nîmes pourrait être une alternative, étant donné la présence importante de régents nîmois dans l’édition de la Semaine de 1582.
24 Martial Monnier, Epigrammata, Bordeaux, Simon Millanges, 1574, poème 94. Originaire de Limoges, Monnier devait appartenir à la nation Vasconica.
25 Le 7 septembre 1583, Montaigne signe l’approbation pour la publication de la Schola Aquitanica éditée par Élie Vinet (Bordeaux, Simon Millanges).
26 A. Communay, article cité, p. 336-337. Document d’archive : Ouverture de la consultation des États de Béarn sur la réception de « Lostau, d’Oloron, seigneur de Maucor » aux États de Béarn, mercredi 27 juin 1584 (AD 64, C 694, fol. 288v). Différentes quittances témoignent des activités de Lostal auprès du marquis de La Force (1601, 1606, 1612, 1613, 1616) (documents retrouvés par Dénes Harai aux Archives départementales des Pyrénées Atlantiques).
27 « Provisions de vice chancellier de Navarre, en faveur de Pierre de Lostal, cy devant procureur general de Bearn ; -du 26 decembre 1596 » (« Extraits des registres du conseil souverain de Pau, du Parlement de Navarre et de la chambre des comptes de Pau », Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, no 35, 1907, p. 77).
28 Charles de Saint-Marthe, In obitum incomparabilis Margaritae, Paris, Regnault Chaudiere, 1550, p. 81.
29 Mikel Du Pac de La Fitte, « Mathieu Du Pac, Président du Conseil du Roi de Navarre », Bulletin du Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais, 47, juin 2010, p. 9-13.
30 Épître liminaire, f. A[5]r. La famille Lostal était en fait originaire d’Oloron, où Jean de Lostal était un « bourgeois et marchand » anobli, selon Armand de Dufau de Maluquer, Armorial de Béarn, Monein, PyréMonde-Princi Negue, 2005, entrée « Pac (du) », I, p. 195.
31 Perroniana, op. cit., I, p. 320.
32 Claude Faisant, Mort et résurrection de la Pléiade, Paris, Champion, 1998, p. 84. Haag, La France protestante, op. cit., p. 83-84. Charles Sorel n’est pas plus indulgent envers ces métaphores « grotesques » appréciées « de la commune » : « Les Livres d’Amour ne sont pas les seuls qui sont remplis de galimathias & d’autres stiles extravagans. Le Soldat françois, l’Avant-Victorieux, et d’autres beaux ouvrages tiennent icy leur partie. » (Remarques sur Le Berger extravagant, dans Le Berger extravagant, Paris, Toussaint du Bray, 1628, p. 449).
33 Pour les emprunts cachés de Bouchet à Lostal, voir les patientes recherches d’André Janier dans Les Serées (1584-1597-1598) du libraire-imprimeur Guillaume Bouchet (1514-1594), texte revu et corrigé par Jean-Claude Arnould, Paris, Champion, 2006, p. 520-521.
34 François Grudé de La Croix du Maine, Le Premier livre de la Bibliotheque Françoise, Paris, Abel L’Angelier, 1584, p. 404.
35 La Bibliothèque d’Antoine Du Verdier, seigneur de Vauprivas, Lyon, Jean d’Ogerolles pour Barthélemy Honorat, 1585, p. 1027-1033.
36 Jean Bodin, Les six livres de la Republique, Paris, Jacques Du Puys, 1576, p. 682. Guillaume Bouchet, Les Serées, édition C. E. Roybet, Paris, Alphonse Lemerre, 1873, II, 9e Serée, p. 149-150 (et dans A. Janier, op. cit., p. 520-521).
37 On a longtemps cru qu’un traité de Sebastian Fox Morcillo portait la signature de Montaigne, qui s’est avérée l’œuvre du faussaire Libri.
38 Françoise Joukovski, Le feu et le fleuve, Héraclite et la Renaissance française, Paris, Champion, 1991, p. 84.
39 Henri Busson, Le rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1533-1601), [1922], Paris, Vrin, 1957, p. 393-396. Jean Céard, La Nature et les prodiges. L’insolite au xvie siècle, Genève, Droz, 1977, p. 222.
40 Le Politique françois, qui renvoie dos à dos les partisans d’une reconquête de quelque « petite grange au-delà des Pyrénées » et ceux qui sont séduits par les « doublons d’Espagne », reprend ce terme de « fetardise » que les premiers voudraient appliquer au souverain (Le Politique françois. Pour reprimer la fureur au Pseudo-pacifique, ou Censeur françois, par B. D. N.), Rouen, Thomas Daré, 1604, p. 68). Denise Carabin attribue ce texte à Lostal (Les Idées stoïciennes dans la littérature morale des xvie et xviie siècles (1575-1642), Paris, Champion, 2004, p. 54).
41 Denise Carabin, Les Idées stoïciennes, op. cit., p. 631-637.
42 Guy de Bruès, Les Dialogues […] contres les nouveaux Academiciens, Paris, Guillaume Cavellat, 1557, p. 79. Les Essais [édition de 1595], dir. J. Céard, Denis Bjaï, Bénédicte Boudou et Isabelle Pantin, Paris, Pochothèque, 2001, II, xii, p. 850 ; –, éd. Jean Balsamo, Catherine Magnien-Simonin, Michel Magnien et Alain Legros, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 1606.
43 « la plus vray-semblable de leurs opinions est, que c’est tousjours une ame qui, par sa faculté, ratiocine, se souvient, comprend, juge, desire et exerce toutes ses autres operations, par divers instrumens du corps (comme le nocher gouverne son navire selon l’experience qu’il en a, ores tendant ou lachant une corde, ores haussant l’antenne ou remuant l’aviron, par une seule puissance conduisant divers effets) ; et qu’elle loge au cerveau » (Essais, II, 12, éd. Villey, p. 546)
44 Il se réfère en marge à Cornelius Gemma (De divinis naturae characterismis) pour réfuter l’explication médicale soutenue notamment par Juan Huarte dont l’Examen de los ingenios avait été publié en espagnol en 1575. Lostal n’emploie jamais le mot « diable ».
45 François Secret lui consacre une brève notice dans « Littérature et alchimie. […] V. Pierre de Lostal et l’alchimie », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, no 40, 1978, p. 301-316.
46 Marie-Luce Demonet, « Le Politique “nécessaire” de Montaigne », dans Montaigne politique, dir. P. Desan, colloque de l’Université de Chicago à Paris 2005, Paris, Champion, 2006, p. 17-37.
47 François Hotman, La Gaule Françoise [Francogallia, 1573], traduction française de Simon Goulart [1574], texte transcrit par Christiane Frémont, Paris, Fayard, « Corpus des œuvres de philosophie en langue française », 1991, p. 99. Pour la discussion (notamment avec Bodin) autour de ce serment du xiiie siècle, voir Paul-Alexis Mellet, Les Traités monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite (1560-1600), Genève, Droz, 2007, p. 350-352 et 410-412.
48 Note du catalogue de la BnF : « Attribué à Pierre de Lostal par une note ms. figurant sur l’ex. conservé à la Bibliothèque nationale [cote non indiquée] de : “Premier volume du Recueil contenant les choses memorables advenues soubs la Ligue…”, [La Rochelle, Jérôme [sic] Haultin] 1587, dans lequel ce texte est rééd. aux p. 681-790 ».
49 « Priere ardente de l’Eglise », dans Fragments des Recueils de Pierre de l’Estoile, édition critique du manuscrit de la Kenneth Spencer Research Library de l’université du Kansas, par Isabelle Armitage, University of Kansas Humanistic Studies, 1976, [f.10v], p. 57, p. 87-92. Ce manuscrit ne contient que la fin du texte, et ne reproduit pas l’attaque en règle contre les prétentions des Guises. Dans sa recension de l’édition, Jacques Pineaux en salue l’« éloquence grave et foudroyante », parfois proche d’un d’Aubigné comme le dit l’éditrice (Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1974, p. 645). Contrairement aux autres pièces du Recueil, cette « prière » ne peut être postérieure à l’assassinat d’Henri III, puisqu’elle était déjà publiée en 1586.
50 Jean-François Courouau, « Les écrivains d’expression occitane et la couronne de Navarre (1554-1611) », Annales du Midi, 2002, 114-238, p. 155-182.
51 Bordenave, op. cit., p. 311.
52 Sur Louis Le Caron et ses néologismes philosophiques, voir Frédéric de Buzon et Marie-Luce Demonet, « Du latin au français », dans L’Encyclopédie Philosophique Universelle, IV, dir. Jean-François Mattei, « Les Discours philosophiques », Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 1068-1181.
53 Le terme avait été relevé par Achille Delboulle dans « Notes lexicologiques », Revue d’Histoire littéraire de la France, 1894, p. 178-185 (p. 182).