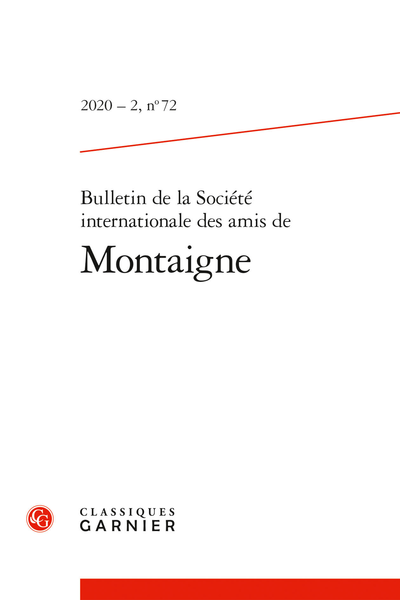
La joyeuse dissémination d’un savoir rigoureux
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Roussel (François)
- Résumé : Rendre hommage à A. Legros, à sa recherche, à sa parole singulière, c’est reconnaître l’importance de ses travaux majeurs : Essais sur poutres, Montaigne manuscrit, ses recherches génétiques concernant l’écriture et les repentirs des Essais. C’est aussi prêter attention à des livres plus « vagabonds » : Montaigne aux champs et plus encore Fricassée, qui offrent le plaisir de chemins de traverse parcourant les Essais en d’autres sens, avec un œil topographique autant que génétique ou généalogique.
- Pages : 49 à 61
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0049
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : essai, philosophie, bêtes, diversité, fortune, plaisir
La joyeuse dissémination
d’un savoir rigoureux
Pour qui a eu la chance et le plaisir de le rencontrer avant ou, le plus souvent, après avoir lu tel ou tel de ses travaux (livres, articles, interventions, esquisses d’analyses en chantier…), il est difficile de séparer la parole et l’écriture d’Alain Legros dans ses différents registres, entre savoir très rigoureux et éclats plus malicieux quoique nourris de ce savoir auquel ils apportent une autre forme de saveur et de vigueur. Ce constat n’est pas sans résonance avec l’une des remarques introductives de son petit recueil abécédaire, Fricassée1, concernant la « couture », « jointure » ou « contexture » entre l’âme et le corps telle qu’elle s’entend dans l’écriture incarnée de Montaigne, judicieusement et poétiquement qualifiée de « parole cousue au papier » : « Réduire son texte à des idées ou n’en célébrer que le style, c’est toujours passer à côté de cette incarnation : “je parle au papier”, “je vais de la plume comme des pieds” » (p. 25).
C’est en raison d’une incarnation de même tonneau que, laissant à d’autres le soin de dire combien importent et apportent les cheminements au long cours d’A. Legros dans Essais sur poutres et Montaigne manuscrit, ou encore le minutieux travail d’analyse génétique du chapitre « Des prières » (I, 56) – travail qui s’étend par bribes jusqu’à la composition hypothétique des Essais en diverses phases et cherche également à éclairer la genèse d’« un philosophe imprémédité et fortuit(e) » (Essais, II, 12) –, je m’attarderai davantage sur d’autres réflexions tout aussi riches et précises mais sur un registre qui pourrait paraître mineur – ce qui serait une réelle erreur d’appréciation. Comme l’auteur le suggère lui-même, ces cheminements buissonniers relèvent plutôt du genre « Parerga et paralipomena » rendu plus familier par Schopenhauer, ou encore des Miettes philosophiques à la manière ironique de Kierkegaard, dont la saveur doit être pleinement goûtée.
50De Fricassée, hapax des Essais2 qu’A. Legros a pris comme épigraphe et point d’appui pour ciseler ce « Petit alphabet hédoniste de Michel de Montaigne », on peut tout retenir – ou du moins je retiens tout, depuis les articles qui semblent s’imposer presque sans discussion, jusqu’à des choix moins attendus voire facétieux mais toujours éclairants. Dans la première catégorie, on trouve : « Aime (j) » (sur les attraits et dégoûts de Montaigne, des plus corporels aux plus intellectuels et moraux) ; « Bêtes » (sur notre « cousinage » avec elles) ; « Divers » (associé au substantif « diversité », l’adjectif ouvre et ferme les Essais dans leur première version, avant l’« allongeail » du livre III, et il est disséminé partout, notamment dans des intitulés de certains chapitres) ; « Essai(s) » (le terme est plurivoque, tout comme le verbe « essayer » jusque dans sa forme pronominale ; et le choix finalement retenu d’en faire le titre générique du livre le maintient dans son ouverture et sa relance continuelle : « Et combien y ai-je épandu d’histoires qui ne disent mot, lesquelles qui voudra éplucher un peu ingénieusement, en produira infinis Essais ») ; « Fortuite » (relié à « fortune » et « fantaisie », l’adjectif indique la place cardinale du hasard dans les pensées et les actions humaines, là où la référence et déférence à la « Providence » était plutôt attendue sinon exigée des lecteurs et censeurs théologiens des Essais) ; « Humain(e) » (nature et condition) ; « Je » (contre la réaction de Pascal substantivant « le » moi pour le déclarer « haïssable », il faut entendre l’injonction de Montaigne de « savoir être à soi » non comme un narcissisme complaisant mais comme le souci de mieux se saisir, là où tout appelle à nous fuir au dehors : « chacun regarde devant soi ; moi je regarde dedans moi ») ; « Naïf » (relié au substantif « naïveté », cet adjectif en éclaire le sens particulier désignant quelque chose de « natif », « naturel », sans « artifice ») ; « Philosopher » (comment devenir philosophe en ne le cherchant pas ?) ; « Que sais-je ? » (peu sans doute, mais non pas rien, dès lors que se maintient la capacité de questionner ses certitudes ou convictions les plus consistantes, sans en conclure pour autant qu’il faudrait systématiquement y renoncer) ; « Sexe » (à faire silence sur ce chapitre, sinon à le mépriser ou en être dégoûté sous prétexte de déchéance pécheresse ayant « dénaturé » ou corrompu notre « humaine condition », « nous déchirons un homme tout vif », là où il faut plutôt décrire ce « vif » 51dans sa vigueur parfois excessive mais aussi ses défaillances) ; « Temps » (relié à la peinture du « passage » à tous les sens du terme) ; « Un » (synonyme d’« entier » et anagramme de « nu », il ouvre sur d’autres sens et perspectives, y compris et à rebours sur celle du « dissemblable » et de la « discordance »).
Dans la seconde catégorie des entrées de cette Fricassée, plus surprenante mais tout aussi éclairante, on rencontre alors : « Couture » (celle de l’âme et du corps, ou celle qui ravaude les « pièces décousues » des Essais : « la science que j’y cherche, y est traitée à pièces décousues, qui ne demandent pas l’obligation d’un long travail, de quoi je suis incapable ») ; « Grotesque » (Montaigne dit « crotesque » mais la modernisation de l’orthographe autorise ce petit subterfuge qui permet d’évoquer les nombreux croisements entre peinture et écriture, au-delà même de la célèbre formule : « Je ne peins pas l’être. Je peins le passage… », et qui suggère une assimilation des Essais à ce registre pictural : « Que sont-ce ici aussi, à la vérité, que crotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaine figure, n’ayant ordre, suite ni proportion que fortuite ? ») ; « Ici » (préféré aux incontournables « imagination » ou « ignorance », ce petit mot revient souvent dans les Essais, à commencer par l’adresse au lecteur : « C’est ici un livre de bonne foi », qui joint l’espace, hic, et le temps, nunc, dans le présent d’une lecture) ; « Melon » (là aussi malicieusement préféré à « mort » ou à « mémoire », ce fruit fait insensiblement passer des diverses préférences gustatives à la confection des plats – à laquelle Montaigne assimile parfois son travail d’écriture telle une « farcissure », une « fricassée » ou un « pastissage » – puis à l’importance littérale et métaphorique de la digestion qui mélange les aliments aux savoirs à réellement s’approprier, jusqu’au transit intestinal qui voit les Essais être dérisoirement ramenés aux « excréments d’un vieil esprit ») ; « Ombrages » (terme renvoyant là aussi à un travail pictural d’effets par suggestion, et rattaché au verbe « adombrer », seule manière d’approcher une vérité dont l’affirmation trop éclatante risque le plus souvent d’éblouir illusoirement au lieu d’éclairer plus humblement) ; « Ravit ravage » (verbes évoquant les effets puissants du souffle poétique : « rapt », « ravissement », « arrachement », et dont Montaigne affirme, à propos de Lucrèce décrivant les transports amoureux de Mars et Vénus : « je ne dis pas que c’est bien dire, je dis que c’est bien penser ») ; « Vive » (les deux « v » en vibration associant « vertu » et « volupté », y compris 52lorsque cette volupté est celle de la « foi » la plus vive) ; « Wiclef » (seul mot commençant par « w » dans les Essais et évoquant, à travers cette allusion à un théologien, le danger des « nouvelletés » religieuses) ; « Zon » (cette « verge poétique » empruntée à Marot rappelle que les Essais ne sont pas exempts d’une virulence et parfois d’une violence qu’ils permettent de « dégorger » au moins « sur le papier » plutôt « qu’en la chair vive »).
À l’essai
Ces quelques indications en écho à divers articles ne donnent qu’un pâle aperçu de l’allegro soutenu de ce Petit alphabet hédoniste. Et puisqu’il faut tout de même choisir dans ce qui est déjà un choix attentionné et des plus savoureux, je prélève seulement quelques pépites qui prolongent, relancent et précisent tel ou tel élément (thème, vocable, idée, conte …) évoqué selon l’occasion dans les Essais. Sans respecter l’ordre abécédaire choisi à titre de règle du jeu pour la confection de cette Fricassée – mais qui laisse au « Lecteur » (autre entrée) le soin de plier cette « règle de plomb » à son humeur et fantaisie, on peut commencer par les rappels et suggestions de l’article « Essai(s) ». Prolongeant, à destination d’un plus large lectorat que celui des « doctes », quelques travaux plus « savants », A. Legros caractérise à juste titre Montaigne comme « essayeur » plutôt que comme « essayiste », ce qui permet de rappeler très utilement certains sens du terme « essai » démarqués de celui qui a fini par prédominer dans les acceptions communes aujourd’hui :
–l’essai comme « prédégustation » (désignant une pratique commune mais aussi plus singulière concernant la méfiance des puissants et leur crainte d’être empoisonnés), idée à laquelle A. Legros donne son extension maximale en y assimilant l’ensemble des Essais comme « recueil des prédégustation de leur auteur », avant que le lecteur ne les goûte à son tour, à ses risques sinon à ses périls.
–l’essai comme tentative « à blanc » si l’on peut dire, comme un exercice d’école et d’apprentissage susceptible d’être évalué par une autorité dont la légitimité est reconnue du même geste que sont 53–pointées les limites imposées par cette autorité à une allure plus « franche » voire débridée (tel ce « cheval échappé » évoqué dans « De l’oisiveté »). A. Legros rappelle à juste titre que Montaigne a qualifié, dans ce sens spécifique du terme « essai », le Discours de la servitude volontaire écrit par La Boétie en son adolescence, marquant par là une certaine réserve qui sera confirmée par l’abandon définitif de la publication projetée de ce Discours au cœur du premier livre des Essais (même si c’est pour d’autres raisons plus directement politiques).
–l’essai comme « évaluation et pesée », autrement dit l’exercice du jugement entendu tout autrement que comme un « arrêt » ou une « sentence » judiciaire. « S’essayer » en ce sens, c’est s’éprouver, mettre en mouvement une capacité à soupeser et à jauger les opinions les plus diverses qui circulent entre les humains et qui les traversent ou s’y ancrent plus ou moins obstinément, à commencer par soi-même. À une « science » toute faite, il faut donc toujours préférer « l’essai du sens », c’est à dire un effort constant de « discernement » sans autre fin que le désir de réduire notre ordinaire errance et ignorance ; effort qui est donc constamment à relancer dans l’écriture : « Qui ne voit, que j’ai pris une route, par laquelle sans cesse et sans travail, j’irai autant qu’il y a d’encre et de papier au monde » (« De la vanité », III, 9).
Bêtes et plantes
Dans les choix finalement retenus de cette Fricassée, l’article « Bêtes » offre lui aussi matière à quelques rappels importants et bienvenus : à l’énumération des animaux fort nombreux et divers qui peuplent les Essais, A. Legros ajoute judicieusement celle de plantes en tous genres, combinant ainsi la curieuse jubilation des listes – que Montaigne pratique volontiers à l’occasion sur divers sujets – avec la continuité postulée entre hommes, animaux et végétaux. C’est bien ce à quoi invite un passage significatif du chapitre « De la cruauté » (II, 11) auquel ne manque pas de se référer cet article de l’abécédaire. Montaigne y évoque 54en effet, pour la faire sienne, l’opinion d’une commune appartenance, d’une étroite « ressemblance » et d’un « commerce » que les hommes sont dits avoir avec les bêtes. Et ce faisant, il l’élargit à l’ensemble des êtres vivants, de même que le sentiment de « respect » qui en découle :
Mais quand je rencontre parmi les opinions les plus modérées les discours qui essayent à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges ; et avec combien de vraisemblance on nous les apparie ; certes j’en rabats beaucoup de notre présomption ; et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle (« De la cruauté », II, 11).
Dans l’une de ses remarques concises et précises qui vont bien au-delà d’une paraphrase par ailleurs assumée sans le mépris ordinaire visant ce registre de discours, A. Legros ponctue fort bien cet intérêt et cette attention de Montaigne qui prend volontiers appui sur les traités de Plutarque pour nourrir nombre de réflexions sur ce « cousinage » entre les hommes et les autres animaux : « la bête est un levier, apte à soulever et culbuter l’énorme masse de prétention qui conduit l’homme à se croire maître absolu du monde ». Et la conclusion à peine interrogative de cet article vaut, encore et toujours, d’être notée, retenue, relancée : « Est-il bien philosophe, celui que ne hante ni bêtes ni plantes ? Est-il homme ? ». La réponse va presque de soi, même si elle prend à contrepied une opinion dominante dans le champ philosophique, ou du moins une certaine doxa dont on attribue souvent sinon la naissance, du moins la consistance et la persistance à Descartes, non sans quelques raisons.
De « l’âne » et de quelques âneries
Dans la joyeuse et impressionnante liste des « bêtes » qui traversent les Essais et y reviennent ou y stationnent parfois de manière plus insistante, 55il faut peut-être faire un sort particulier à l’âne. Car à la différence de beaucoup d’autres, cet animal n’échappe pas chez Montaigne à une certaine « maltraitance » symbolique, ordinairement plus fréquente en philosophie que dans les évocations poétiques (contes et légendes). C’est du moins ce que fait entendre cette remarque du chapitre « De l’art de conférer » (III, 8) à propos de l’opiniâtreté : « L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise. Est-il rien certain, résolu, dédaigneux, contemplatif, grave, sérieux comme l’âne ? ». De même, en référence à une fable d’Ésope, un autre passage des Essais rabaisse cet animal qui n’en demandait pas tant à une condition « singeresse » (dont Montaigne s’accuse d’ailleurs lui-même à l’occasion), confirmant par là sa « bêtise » supposée : « J’ai vu souvent en usage ces libertés contrefaites et artificielles, mais le plus souvent sans succès. Elles sentent volontiers à l’âne d’Ésope, lequel, par émulation du chien, vint à se jeter tout gaiement à deux pieds sur les épaules de son maître ; mais autant que le chien recevait de caresses, de pareille fête, le pauvre âne en reçut deux fois autant de bastonnades » (III, 1, « De l’utile et de l’honnête »).
Que d’âneries n’a-t-on pas dites sur ce « pauvre âne » ? aurait pu écrire Montaigne en s’incluant bien évidement lui-même dans la série, comme il fait d’ailleurs volontiers sur d’autres sujets. Au moins l’a-t-il exempté de symboliser, presque à l’inverse de son « opiniâtre » obstination (ou en la confirmant alors par l’absurde), le lieu commun de l’indécision mortifère popularisé par une référence (apocryphe) à Buridan (qui visait les animaux en général et non exclusivement l’âne comme emblème négatif). Lorsque Montaigne évoque les apories de la réflexion philosophique sur l’idée d’un « libre » choix entre deux motifs, « appétits » ou « envies » d’égale force, il s’agit bien de l’esprit humain ; et il n’y a alors nul détour par une animalisation dévalorisante car « abêtissante » : « C’est une plaisante imagination de concevoir un esprit balancé justement [également] entre deux pareilles envies. Car il est indubitable qu’il ne prendra jamais parti, d’autant que l’application [l’inclination] et le choix porte inégalité de prix ; et qui nous logerait entre la bouteille et le jambon, avec égal appétit de boire et de manger, il n’y aurait sans doute remède, que de mourir de soif et de faim » (II, 14, « Comme notre esprit s’empêche soi-même »).
Qui sait ? On peut s’autoriser à imaginer que n’avoir pas retenu l’âne pour incarner ce lieu commun serait peut-être un (rare) repentir 56de Montaigne à l’égard de cet animal trop communément dévalorisé par les philosophes de profession. À moins que ce ne soit plus probablement le souvenir, au moins indirect, d’un passage d’Aristote (Du ciel, 295 b 32-35) où cette « fiction » de pensée (« imagination » ou « fantaisie » selon les termes plus volontiers mobilisés dans les Essais) est déjà allusivement évoquée comme une aporie récurrente, sans qu’il soit question d’un animal et encore moins de l’âne injustement abêti par une image dont l’attribution à Buridan remonte fort probablement à Spinoza et prendra valeur de lieu commun, à propos de l’indécision absurdement logique, avec Bayle et Leibniz.
Un et nu
L’article « Un » offre un autre exemple significatif de la manière d’A. Legros dans cette Fricassée : en indiquant d’entrée de jeu que « un » est synonyme d’« entier » et anagramme de « nu », cet article met en œuvre, à l’encontre de la règle de l’abécédaire, l’une des petites « tricheries » reconnues et avouées comme inévitables. Mais en sollicitant d’autres termes qui auraient pu figurer pour d’autres entrées, il s’agit malgré tout de jouer cartes sur table : car ces deux termes associés à « un » font notamment écho à l’adresse de Montaigne au lecteur : « C’est ici un livre de bonne foi », en lui spécifiant d’entrée de jeu son désir de se peindre « tout entier, et tout nu » – désir seulement contenu ou retenu par souci de la « révérence publique ». D’autres analyses d’A. Legros montrent d’ailleurs l’évolution de l’écriture de Montaigne à cet égard, prenant davantage d’assurance et osant plus, du fait d’une première réception accueillante de ce livre singulier, dire sans fard les choses ordinairement et pudiquement tues.
Mais la précision donnée ensuite dans l’article sur ce que recouvre également cet « un » est aussi très éclairante : il ne s’agit pas d’insister sur une singularité sans pareil, l’unique exemplaire, mais bien plutôt sur une ressemblance, une égalité, une équivalence, comme on l’entend dans la formule : « tout m’est un » qui renvoie inévitablement à la pesée, à la balance, à l’équivalence ordinaire des raisons, selon un sens qui 57finalement se renverse en soi : rien n’est « entier », tout est « dissemblable », et d’abord soi à soi-même :
Je ne peins pas l’être. Je peins le passage ; non un passage d’âge en autre, ou, comme dit le peuple, de sept en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut accommoder mon histoire à l’heure. Je pourrai tantôt changer, non de fortune seulement, mais aussi d’intention. C’est un contrerolle [registre] de divers et muables accidents et d’imaginations irrésolues. Et, quand il y échoit [le cas échéant], contraires : Soit que je sois autre moi-même, soit que je saisisse les sujets par autres circonstances, et considérations (III, 2, « Du repentir »).
Comme le soulignent les analyses attentives d’Alain Legros, ces réflexions concernent donc les Essais dans leur ensemble, au fil des ajouts, réécritures, recompositions partielles, ou parfois plus consistantes et conséquentes, de tel ou tel passage. « Mon livre est toujours un » finit par dire Montaigne avec « l’alongeail » du troisième livre venu s’ajouter en 1588 aux deux premiers ; mais la phrase suivante du chapitre « De la vanité » (III, 9) rappelle aussitôt : « ce n’est qu’une marqueterie mal jointe », autre métaphore ouvrageante mais non forcément dépréciative, quoique moins savoureuse à coup sûr qu’une « fricassée ». Dans un souci très différent de celui des rudes spéculations platoniciennes sur les mélanges entre « le même » et « l’autre », il s’agit bien de ne pas homogénéiser ni rehausser la peinture de soi, comme si l’on avait affaire à une sorte d’autoportrait en majuscule et en majesté : « … quiconque s’étudie bien attentivement trouve en soi, voire et en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je n’ai rien à dire de moi, entièrement, simplement, et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot. Distingo est le plus universel membre de ma Logique » (II, 1, « De l’inconstance de nos actions »).
« L’ouvroir » des Essais
Sur cette lancée impulsée par le malicieux savoir d’A. Legros, on pourrait continuer sans fin assignée, sinon celle des nécessaires « diversions » de la vie ordinaire qui a d’autres exigences et « offices » publics 58et privés. Mais il faut résolument couper court, en attendant une relance de la partie lors d’une prochaine traversée des Essais à la lumière des cheminements et suggestions ainsi proposés. Car dans ce jeu de l’abécédaire – et c’est bien l’un des ressorts généreusement offerts à ses lecteurs et lectrices – chaque lettre ou presque invite irrésistiblement à tel ou tel prolongement, complément, et surtout suscite l’appel à d’autres mots possibles entre lesquels il faut pourtant choisir puisque telle est la règle consentie – même s’il y a quelques exceptions facétieusement et judicieusement négociées par l’auteur. Ainsi la lettre « W » qui impose le « choix » du seul mot commençant ainsi dans les Essais : à la différence du W de Georges Perec, il ne s’agit pas d’un « souvenir d’enfance » tragique transformé en récit dystopique, mais d’une dérivation de noms propres qui permet de passer de « Wiclef » à « Wier », médecin non expressément cité par Montaigne dans les Essais mais partageant ses vues courageuses et minoritaires sur le sujet des sorcières qu’il faut aborder humainement et médicalement, à l’opposé de la justice inquisitoriale et de ses violences extrêmes (tortures et mises à mort).
Si l’on continuait les associations d’idées plus ou moins libres, on pourrait également évoquer une formule de Michel Leiris qui convient ici fort bien pour qualifier le « petit alphabet hédoniste » que constitue cette Fricassée : « glossaire, j’y serre mes gloses ». Et on serait alors incité à prolonger un peu différemment ce « jeu » en faisant une liste de termes pour chacune des lettres, à la manière joyeuse et stimulante dont A. Legros énumère, ainsi qu’on l’a déjà évoqué, les noms de bêtes et de plantes qui peuplent les Essais, écho de certains passages où une liste devient pour Montaigne sinon une forme de réflexion, à tout le moins une manière de la mettre en branle sur un mode singulier (ce dont d’autres auteurs tels Umberto Ecco et Bernard Sève ont récemment montré ou rappelé les ressources3).
Il est de fait assez tentant et réjouissant de se laisser entraîner du côté de ce qui ne retient de l’écriture « sous contrainte » (volontiers pratiquée par G. Perec et quelques autres) que son aspect le plus léger, le plus ludique, le plus susceptible d’une bifurcation « impréméditée », d’une « route par ailleurs » le long de laquelle certains mots en viennent à résonner et à s’entrecroiser différemment, à partir d’autres choix possibles, 59d’autres relances impromptues. Ce qui n’est pas sans rapport avec la pratique du jeu de paume4 évoqué par Montaigne à propos des paroles échangées : « La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute. Celui-ci se doit préparer à la recevoir selon le branle qu’elle prend. Comme entre ceux qui jouent à la paume, celui qui soutient [reçoit] se démarche [recule] et s’apprête selon qu’il voit remuer celui qui lui jette le coup et selon la forme du coup ». (III, 13, « De l’expérience »).
Est-ce pur hasard ou contingence si, dans ses travaux plus substantiels et méthodiques décrivant minutieusement le « lieu » réservé pour l’essentiel à l’écriture des Essais – c’est à dire non seulement la « librairie » de la tour avec son dispositif de « sentences » peintes, mais aussi un espace intérieur (espace « mental ») qui cherche à saisir les multiples « trains » de pensées traversant un esprit, A. Legros sollicite à l’occasion le terme « ouvroir » relié à celui de « laboratoire » ? Si le choix de ce terme n’est pas totalement fortuit (on peut le supposer), comment ne pas y entendre un discret appel vers quelque chose qui aurait à voir sinon avec les exigences formelles de l’écriture « sous contraintes » pratiquée par l’Oulipo (« Ouvroir de littérature potentielle »), du moins avec un « exercice de style » à la manière de Raymond Queneau – ce dont semble bien relever la préface « Au lecteur » de cette Fricassée faisant écho avec bonheur à celui de Montaigne en ouverture des Essais : « C’est ici un petit livre selon mon goût, lecteur. Par le présent pastiche, il t’avertit dès l’entrée que je m’y suis d’abord proposé mon plaisir, heureux si tu y trouves aussi le tien, et plus heureux encore s’il te conduit à lire ou relire Montaigne ».
Un « scrutateur » obstiné et perspicace
Quoiqu’il en soit du sens de cet « ouvroir » ou « laboratoire » d’écriture susceptible d’éclairer l’élaboration incessante bien qu’intermittente de l’écriture des Essais, on comprend que s’il s’agit pour A. Legros d’être le plus rigoureux possible, notamment dans le repérage et l’identification des éléments textuels appuyant des hypothèses génétiques patiemment 60construites (et parfois plus risquées mais en toute conscience), c’est également une part de jeu qui anime son écriture la plus savante. Ou pour le dire plus justement : ce qui dans Fricassée nourrit allègrement et de manière plus déliée telle citation et relecture partielle d’un passage des Essais, telle association de termes ouvrant sur d’autres résonances possibles, c’est la minutie du regard « scrutateur » ayant laborieusement relevé au préalable les inscriptions, traces, tracés de nature et de portée diverse : sentences peintes dans la « librairie », peintures du cabinet, ajouts manuscrits sur l’exemplaire des Essais conservé à Bordeaux.
À cet égard, le patient et minutieux travail de déchiffrement d’A. Legros va parfois jusqu’à scruter les ratures d’ajouts autographes, invitant alors à risquer quelques hypothèses et réflexions sur ce qu’on peut tirer d’un « repentir » d’écriture revenant sur un premier repentir pour l’annuler ou le « canceller » (terme de provenance juridique concernant la biffure d’un écrit). Une telle inquisition scripturale, qu’on pourrait juger quelque peu « fétichiste » car poussée à l’extrême de ce qui peut encore être déchiffré sous les ratures, ne renvoie pourtant en rien au « scrutateur sans connaissance » ironiquement évoqué à la fin du chapitre « De la vanité » comme l’une des trois caractéristiques négatives de l’homme, avec celle du « magistrat sans juridiction » et celle qui culmine dans cette pointe dérisoire : « le badin de la farce ». Bravant le rappel salutaire que « la plupart de nos vacations sont farcesques » (III, 10, « De ménager sa volonté »), l’effort de déchiffrement d’A. Legros offre à l’occasion un éclairage très stimulant en précisant, chemin faisant, ce qu’il a pu en être du rapport de Montaigne à son livre dès lors qu’on essaie de saisir la portée de fameuses formules telles : « Je n’ai pas plus fait mon livre que mon livre m’a fait. Livre consubstantiel à son auteur. D’une occupation propre. Membre de ma vie. Non d’une occupation et fin, tierce et étrangère comme tous autres livres… » (II, 18, « Du démentir »).
Mesuré à l’aune de ce genre d’attention qu’on pourrait dire « minuscule » dans le meilleur sens du terme, le « petit alphabet hédoniste » de Fricassée poursuit et prolonge vers des chemins buissonniers le travail des livres et recherches plus méthodiques et exigeantes, leur ajoutant ainsi une saveur supplémentaire déjà présente, mais en filigrane. Autrement dit et pour conclure provisoirement ces quelques remarques de gratitude parmi beaucoup d’autres : nulle antithèse bien évidemment, ni même 61de « séparation bien nette » entre la minutie scrutatrice du travail savant d’A. Legros et la jubilation joueuse de lectures plus traversières. La première, dans son labeur le plus scrupuleux, est fort probablement la condition de l’autre dans sa liberté déliée ; mais à coup sûr, elle en a été et continue d’en être un puissant ressort dont l’énergie emmagasinée au fur et à mesure des livres et articles ne semble pas prête à se tarir. C’est pourquoi, et toutes proportions gardées, on peut appliquer à ce joyeux quoique rigoureux savoir la formule de Virgile détournée et retenue par Montaigne pour caractériser le mouvement d’écriture des Essais : « il s’accroît en avançant » (A. Legros propose cette autre traduction qui convient encore mieux : « plus il avance, plus il se renforce »). Et l’on peut parier que la promesse offerte aux lecteurs et lectrices de cette Fricassée est tout sauf « vanité » : éprouver aussi librement que possible cette jubilation est l’une des meilleures manières d’entrer dans l’œuvre mobile des Essais, d’accepter de s’y perdre pour, peut-être, mieux s’y retrouver, ou du moins y retrouver quelque chose d’essentiel au « vivre à propos ».
François Roussel
Professeur honoraire
de chaire supérieure, Paris
1 Fricassée : petit alphabet hédoniste de Michel de Montaigne, Loverval, Labor, 2006.
2 « Enfin, toute cette fricassée que je barbouille ici n’est qu’un registre des essais de ma vie » (III, 13).
3 Umberto Eco, Vertige de la liste, Paris; Flammarion, 2009 ; Bernard Sève, De haut en bas. Philosophie des listes, Paris, Seuil, 2010.
4 Pratique savamment commentée dans le présent numéro par Dominique Brancher.