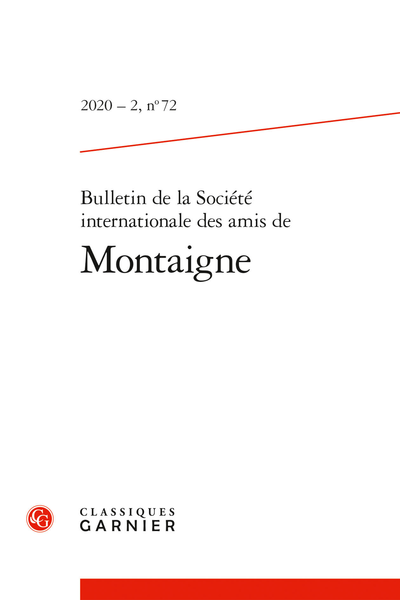
« Doctrine sacrée » vs. « humaines fantaisies » Pour une lecture exotérique du chapitre « Des prières »
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Gontier (Thierry)
- Résumé : En hommage à Alain Legros, cet article montre que les différents états du chapitre « Des prières » sont orientés contre un même ennemi. Celui-ci n’est pas le théologien, mais plutôt celui qui, catholique ou protestant, use, sans y être autorisé, d’un mode de discours dogmatiste réservé au théologien.
- Pages : 85 à 100
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0085
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : théologie, philosophie, dogmatisme, catholicisme, protestantisme
« Doctrine sacrée »
vs. « humaines fantaisies »
Pour une lecture exotérique du chapitre « Des prières »
L’un des grands mérites des recherches d’Alain Legros est pour ainsi dire d’avoir affiné notre oreille au texte des Essais, par des travaux minutieux de contextualisation en premier lieu, mais aussi par ses mises en garde contre une lecture précipitée des textes qui ne tiendrait pas compte de l’importance des nuances. Son édition le chapitre « Des prières » (I, 56)1 représente à ces titres un modèle, tant pour le travail éditorial que pour les précisions que l’introduction et les annotations apportent en corrigeant les interprétations par trop manichéennes qui ont souvent été faites de ce texte à partir des catégories surdéterminées : catholicisme orthodoxe vs. laïcité, censure vs. liberté de conscience, etc. L’édition des états successifs du texte (1580, 1582-1587, 1588, Exemplaire de Bordeaux, 1595-1598) permet de lire chaque édition dans sa logique interne à chaque fois renouvelée par les nouvelles adjonctions, tout en étant attentif aux évolutions d’un état à l’autre.
Mon étude n’aura d’autre but que de poursuivre la réflexion engagée par Alain Legros en tentant de restituer la cohérence du chapitre dans ses dernières versions, et notamment celles postérieures à 1588 (Exemplaire de Bordeaux et 1595). Si on lit le texte dans sa rédaction initiale (1580) et dans ses versions finales (EB et 1595) en prêtant attention aux ajouts successifs – ce que lecteur d’une édition comme celle de Pierre Villey est tenté de faire –, le chapitre, dans sa dernière rédaction, risque de nous apparaître comme scindé en deux par l’excroissance d’un propos absent de la première version. On a pu dire que ce qui était « intéressant » 86dans ce chapitre n’était pas le texte de 1580 sur la bonne pratique de la prière, sa signification et son utilité. Paul Mathias va jusqu’à qualifier le chapitre dans sa version initiale de « dénué d’intérêt2 », Montaigne s’y faisant le simple porte-parole d’une doctrine catholique officielle (on pourrait lui objecter que les maîtres du Sacré Palais n’ont pas été entièrement convaincus de cette orthodoxie). Ce qui est digne d’intérêt selon Mathias, ce sont les « allongeails » ultérieurs, à partir de l’édition de 1588, qui ouvrent un autre débat, celui du conflit d’autorité entre « humaniste » et théologien. Ma première question est celle-ci : que penserait le lecteur qui n’aurait à sa disposition que le texte de l’édition de 1595, par exemple, sans aucune indication sur les diverses strates d’écriture ? Ce qui est pour nous une adjonction serait pour lui une simple digression : ne serait-il pas dès lors plus sensible à l’unité du chapitre qu’à cette scission entre deux discours hétérogènes ?
À ce problème s’ajoute un autre. Est-ce qu’une contextualisation excessive ne nous prive pas d’une lecture plus immédiatement centrée sur la logique interne du texte ? Lorsque la plupart des commentateurs du texte, de Maturin Dreano à Malcolm Smith et Emmanuel Faye lisent le chapitre3, en distinguant le texte initial des ajouts ultérieurs, ils lisent ces derniers à la lumière d’un contexte que nous, lecteurs tardifs des Essais, connaissons principalement grâce au Journal de voyage4. Or ce texte n’était pas destiné à être publié : il ne l’a été qu’en 1774, après la découverte accidentelle du manuscrit quatre ans plus tôt. Le Journal de voyage nous offre des clés de lecture pour comprendre les adjonctions postérieures au texte de 1580. Nous y apprenons que, lors de son voyage à Rome (1580-1581), Montaigne avait été critiqué oralement pour avoir écrit que « celuy qui prioit devoit estre exempt de vicieuse inclination pour ce temps5 ». 87Une fois que nous savons cela, les ajouts ultérieurs trouvent une forme de logique contextuelle : Montaigne répondrait ici (dans son chapitre sur les prières, donc sur le lieu même du délit) à ces remontrances et justifierait, contre la censure romaine – une censure dont on a volontiers exagéré la portée –, quelque chose comme un droit à la liberté d’expression au sens contemporain. Il se trouve par ailleurs que l’usage fréquent du terme paganisant de « fortune » dans les Essais faisait aussi partie des points critiqués par les théologiens du Saint Siège. Quoique le chapitre « Des prieres » ne porte pas sur ce point (le terme même est absent de l’édition de 1580), Montaigne profiterait de sa réponse aux censeurs romains pour justifier son emploi du terme : « Je luy laisse [au dire humain], pour moy, dire, verbis indisciplinatis, fortune, d’estinée, accident, heur et malheur, et les Dieux et autres frases, selon sa mode » (I, 56, p. 323/p. 181).
Une telle lecture est sans doute juste, mais elle ne saurait être exclusive. À qui s’adressent en effet ces ajouts de Montaigne dans le chapitre « Des prières » ? Aux maîtres du Sacré Palais, qui avaient du mal à lire le français ? Aux quelques proches qui ont accompagné Montaigne dans son voyage ou qu’il a connu lors de son séjour à Rome ? Aux rares lecteurs auxquels il a raconté son histoire à son retour ? Le lecteur commun des Essais n’est pas, quant à lui, supposé connaître la relation du Journal de voyage. En réalité, nous en savons trop pour pouvoir lire le texte comme le lecteur ordinaire des Essais est censé le lire. Le lecteur profane d’avant la publication du Journal n’a quant à lui aucune raison de soupçonner une protestation contre une censure dont il n’a jamais entendu parler. On ne saurait certes négliger l’importance d’une écriture ciblée pour quelques rares lecteurs. Comme l’écrira Pascal, dans une formule que Montaigne n’aurait sans doute pas reniée (en s’accusant sans doute lui-même de cette présomption) : « Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l’estime de cinq ou six personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente6 ». Il reste qu’il faut aussi tenir compte du sens exotérique du texte, tel qu’il est adressé aux lecteurs « de toute la terre, et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus ».
88À cette position de principe, selon laquelle il doit y avoir une signification exotérique du texte, s’ajoute par ailleurs un problème de cohérence dans le récit du chapitre. Si Montaigne avait voulu élever une protestation contre la censure romaine, n’aurait-il pas été logique que le principal ajout de 1588 (p. 165-166 de l’édition d’Alain Legros), celui qui oppose les « théologiens » et les « humanistes », apparaisse à l’endroit où il expose sa thèse contestée par le censeur romain selon laquelle l’âme ne doit prier que « deschargée des passions vitieuses », c’est-à-dire au début du chapitre ? Or ce n’est pas à cet endroit que se situe l’ajout : il vient plus loin, pour commenter un propos de théologie politique, défendant au vulgaire de profaner les psaumes (« Ce n’est pas sans grande raison, ce me semble, que l’Eglise defend l’usage promiscue, temeraire et indiscret des sainctes et divines chansons que le Sainct Esprit a dicté en David »). À cette prohibition, Montaigne ajoute en 1588 celle pour le vulgaire de lire, traduire et interpréter les textes sacrés chacun à sa guise. Ces condamnations révèlent toute la distance qu’il y a entre Montaigne et les humanistes de la génération précédente, celle en particulier des disciples français d’Érasme7, des Briçonnet et Lefèvre d’Étaple, qui ont inspiré le premier élan de réforme religieuse en France. Elles sont manifestement dirigées en premier lieu contre les protestants, et, à ce titre, elles ne sauraient faire l’objet d’aucune contestation de la part des autorités catholiques, bien au contraire.
Privé du moyen de rapporter le texte au contexte de l’aventure romaine, le lecteur ordinaire, aussi « suffisant » soit-il, ne possède donc pas la clé de lecture dont nous disposons aujourd’hui, qui nous permet de lire ce texte en mettant l’accent soit sur les professions d’obédience de Montaigne à l’Église romaine, soit sur sa revendication d’une écriture insoumise à l’autorité des théologiens. Il doit donc bien y avoir ici un 89sens à l’opposition entre humanistes et théologiens que n’épuise pas la lecture fondée sur le contentieux romain.
Ce « suffisant lecteur » dispose heureusement d’autres indices. Si les ajouts au chapitre « Des prières » peuvent paraître s’écarter du propos d’origine, ils présentent en revanche des parentés avec des textes d’autres chapitres des Essais. L’opposition entre le « theologien » et l’« humaniste » peut être rapprochée de celle du dogmatiste et du pyrrhonien de l’« Apologie de Raimond Sebond » (II, 12), du « docte » et du profane dans les deux essais pédagogiques, « Du pedantisme » (I, 25) et « De l’institution des enfans » (I, 26), ou encore du bon et du mauvais conférencier du chapitre « De l’art de conferer » (III, 8). À chaque fois, il est question des modalités du discours et de leur rapport à l’autorité.
Prenons pour point de départ les chapitres i, 25 et i, 26. Montaigne y fait une critique de la « doctrine », c’est-à-dire du savoir d’enseignement imposé à l’élève. Il la condamne pour son extériorité et son caractère inassimilable, car foncièrement hétérogène à la nature de l’esprit humain. À travers cette condamnation, Montaigne vise les questions plus générales de l’autorité et de l’autoritarisme8. La rigidité des disciplines ou la férule du maître ne sont que des expressions visibles d’un discours qui se présente comme l’expression d’une vérité déjà trouvée, qui ne laisse plus de place à l’enquête ou à la discussion, mais qui n’a plus qu’à être enseignée et apprise. L’autoritarisme désigne ainsi une modalité inhérente d’énonciation de la doctrine par laquelle elle tend à se communiquer sous la forme d’un savoir achevé et définitif qui s’impose à l’esprit et le bride dans son mouvement naturel d’inquisition. Selon l’aristotélicien que Montaigne a rencontré à Pise, « la touche et regle de toutes imaginations solides et de toute verité c’est la conformité à la doctrine d’Aristote ; que hors de là ce ne sont que chimeres et inanité ; qu’il a tout veu et tout dict » (I, 26, 151)9. Si tout a déjà été vu et dit, il n’y a plus rien à chercher ou à 90découvrir. La science ne sera plus qu’une activité de remémoration et de commémoration de ce qui a été une fois trouvé : « qui suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne cerche rien » (I, 26, p. 151).
Montaigne ne veut pas dire que tout discours doctrinal et autoritaire soit illégitime. Le savoir confère sans doute une autorité : mais le savoir achevé est propre à Dieu et hors de la portée des hommes. Il reste deux domaines dans lesquels l’autorité de la doctrine se trouve légitimée pour Montaigne, à savoir le droit et la théologie. Ainsi, dans le chapitre « Des prieres », le terme de « doctrine », au sens d’un savoir résolutif et « instruisant » (pour reprendre le terme du chapitre « Des prières »), se trouve par deux fois employé en un sens positif pour désigner la « doctrine divine » ou la « doctrine céleste ». Le théologien – entendons le théologien professionnel et autorisé – a pour mission de fixer la doctrine de façon autoritaire. Le motif théologique est avant tout un motif politique : en ces temps où la dogmatomachie dégénère en un conflit civil armé, il est nécessaire qu’une autorité unique gouverne les opinions au-dessus des partis et des ligues. Dans certains textes, l’autorité religieuse semble avoir la même fonction que les leges des aristotéliciens averroïsants du xve et du xvie siècles : « On a raison de donner à l’esprit humain les barrieres les plus contraintes qu’on peut […]. On le bride et garrote de religions, de loix, de coustumes, de science, de preceptes, de peines et recompenses mortelles et immortelles » (II, 12, p. 559)10. Le chapitre « De la gloire » va dans le même sens. Montaigne y parle des superstitions des religions païennes (« bastardes »), mais il se garde bien, ici comme ailleurs, de préciser ce qui pourrait les distinguer du christianisme tel qu’il est pratiqué en son temps :
Puis que les hommes, par leur insuffisance, ne se peuvent assez payer d’une bonne monnoye, qu’on y employe encore la fauce. Ce moyen a esté practiqué par tous les Legislateurs, et n’est police où il n’y ait quelque meslange ou de vanité ceremonieuse ou d’opinion mensongere, qui serve de bride à tenir le peuple en office. C’est pour cela que la pluspart ont leurs origines et commencemens fabuleux et enrichis de mysteres supernaturels. C’est cela qui a donné credit aux religions bastardes et les a faites favorir aux gens d’entendement (II, 16, p. 629).
Le théologien est en cela comparable au législateur ou au juge, qui ont pour fonction d’arbitrer dans affaires sujettes à contestation. Le juriste 91produit la vérité normative plus qu’il ne la découvre, et ce parce qu’il est lui aussi autorisé à le faire. Il fait autorité de par le caractère performatif de ses énoncés, de sorte que la vérité de son discours tient moins dans l’adéquation du contenu à quelque modèle de vérité qu’au fait qu’il soit autorisé à promulguer la règle – « Auctoritas non veritas facit legem », écrira Hobbes dans un esprit proche11. Aussi est-il légitime que les arrêts juridiques s’énoncent comme « le point extreme du parler dogmatiste et resolutif » (II, 12, p. 509-510). Il y a cependant une différence entre droit et théologie, en ce que l’arrêt juridique manifeste une rupture entre légalité et légitimité. Celui-ci relève d’une logique spécifique qui peut aller à l’encontre de notre jugement naturel, ainsi que le montre l’exemple de l’innocent condamné au nom du respect de la procédure judiciaire :
Cecy est advenu de mon temps : certains sont condamnez à la mort pour un homicide, l’arrest, sinon prononcé, au moins conclud et arresté. Sur ce poinct, les juges sont advertis par les officiers d’une court subalterne voisine, qu’ils tiennent quelques prisonniers, lesquels advouent disertement cet homicide, et apportent à tout ce faict une lumiere indubitable. On delibere si pourtant on doit interrompre et differer l’execution de l’arrest donné contre les premiers. On considere la nouvelleté de l’exemple, et sa consequence pour accrocher les jugemens ; que la condemnation est juridiquement passée, les juges privez de repentance. Somme, ces pauvres diables sont consacrez aux formules de la justice (III, 13, p. 1070-1071).
Le caractère profondément contre-intuitif de la sentence manifeste le conflit entre deux régimes de vérité. L’opposition entre la justice selon la loi positive et la justice selon la conscience rend souvent la condamnation « plus crimineuses que le crime ? » (ibid.). Plus généralement, la législation revêt un caractère ambivalent :
Les loix se maintiennent en credit, non par ce qu’elles sont justes, mais par ce qu’elles sont loix. C’est le fondement mystique de leur authorité ; elles n’en ont poinct d’autre ! Qui bien leur sert. Elles sont souvent faictes par des sots, plus souvent par des gens qui, en haine d’equalité, ont faute d’equité, mais tousjours par des hommes, autheurs vains et irresolus. Il n’est rien si lourdement et largement fautier que les loix, ny si ordinairement. Quiconque leur obeyt parce qu’elles sont justes, ne leur obeyt pas justement par où il doibt. 92Les nostres françoises prestent aucunement la main, par leur desreiglement et deformité, au desordre et corruption qui se voit en leur dispensation et execution (III, 13, p. 1072).
Montaigne montre donc à la fois le défaut des lois civiles, écrites par des gens qui ont « haine d’equalité » et « faute d’equité », et dont la pratique est « souvent tres inepte et tres inique » (II, 37, p. 766), et leur nécessité pragmatique, en vue de l’ordre public. Aussi nécessaire soit-elle, la contrainte des lois est toujours perçue dans les Essais comme une violence faite à notre aspiration à la justice : « La justice en soy, naturelle et universelle, est autrement reiglée, et plus noblement, que n’est cette autre justice speciale, nationale, contrainte au besoing de nos polices » (III, 1, p. 796)12.
Il n’en va pas de même pour la théologie, dès lors que les vérités divines se situent hors de la portée de l’intelligence : on ne saurait opposer à l’absurdité des dogmes que l’absurdité égale de nos propres jugements, de sorte que « ce n’est que bestise et ignorance qui nous fait les recevoir avec moindre reverence que le reste » (I, 27, p. 182). Nous avons peut-être quelque sens naturel de la justice et de l’injustice, qui nous fait percevoir le hiatus entre la « justice en soy » et la justice positive, mais nous n’en avons aucun des matières divines. En théologie plus qu’en jurisprudence, la légitimité se confond avec la légalité : est vrai ce qui est promulgué par le théologien autorisé. Seule compte la qualification du théologien à juger, ce pourquoi Montaigne insiste sur le fait que cette tâche incombe au théologien professionnel (catholique), dont l’autorité est reconnue par une tradition suffisamment ancienne et universelle pour faire l’objet d’une adhésion collective.
Nous retrouvons bien le propos qui a initié la digression de Montaigne, à savoir l’interdiction faite au profane de jouer au théologien. La doctrine sacrée n’est plus, comme le voulait Raimond Sebond « commune aux laics et à toute maniere de gens13 ». Le projet universaliste de Sebond 93a été repris par les premiers humaniste chrétiens français au début du xvie siècle (période qui connaît un revival de l’ouvrage de Sebond) : mais les conflits qui ont résulté de la diffusion du protestantisme ont changé la donne. Définir la doctrine est pour Montaigne l’apanage du petit nombre d’hommes à qui Dieu a donné l’intelligence de ses mystères, comme Montaigne le précise dans son ajout de l’édition de 1588 :
Et ne diroit on pas aussi sans apparence [i.e. est-ce qu’on n’aurait pas raison de dire] que l’ordonnance de ne s’entremettre que bien reserveement d’escrire de la Religion à tous autres qu’à ceux qui en font expresse profession, n’auroit pas faute de quelque image d’utilité et de justice ? (I, 56, p. 323 [B]/p. 166.)14
Il s’agit bien entendu d’une question rhétorique : il incombe légitimement au théologien (comme au juriste) de prononcer son jugement non sur un mode dubitatif, mais bien sur un mode dogmatique. C’est pourquoi il ne sied pas à la doctrine divine d’emprunter ses arguments à la philosophie, qui fait appel à un autre registre de savoir que le sien propre :
La doctrine divine tient mieux son rang à part, comme Royne et dominatrice ; […] elle doibt estre principale par tout, poinct suffragante et subsidiaire ; […] les raisons divines se considerent plus venerablement et reveramment seules et en leur stile, qu’appariées aux discours humains ; […] la Philosophie, dict Sainct Chrysostome, est pieça banie de l’escole sainte, comme servante inutile, et estimée indigne de voir, seulement en passant, de l’entrée, le sacraire des saints Thresors de la doctrine celeste ; […] le dire humain a ses formes plus basses et ne se doibt servir de la dignité, majesté, regence, du parler divin (I, 56, p. 322-323 [B]/p. 165-166).
Mais le plus important de ce texte se trouve ailleurs : cette figure du théologien a pour fonction principale de définir en creux la position du non-théologien, et en particulier celle de Montaigne lui-même. Ce qui apparaît de façon encore plus claire dans l’ajout postérieur à 1588 :
Je propose les fantasies humaines et miennes, simplement comme humaines fantasies, et separement considerées, non comme arrestées et reglées par 94l’ordonnance celeste, incapables de doubte et d’altercation : matiere d’opinion, non matiere de foy ; ce que je discours selon moy, non ce que je croy selon Dieu, comme les enfans proposent leurs essais : instruisables, non instruisants (I, 56, p. 322 [C]/p. 181).
L’autoritarisme, aussi légitime soit-il dans ce qui touche à l’énonciation de la doctrine sacrée, reste un droit exclusif du théologien professionnel. Il est absolument refusé pour le « dire humain », qui revêt les prédicats diamétralement opposés. La doctrine des théologiens est à juste titre « arrestée et reglée par l’ordonnance celeste », « incapable de doubte et d’altercation », « matiere de foy », non « matiere d’opinion », « ce que [le théologien] croy selon Dieu », non « ce qu[’il] discour[t] selon [lui-même] », « instruisante », et non « instruisable ». Aussi, dès lors que la vérité n’a pas à être fixée, mais seulement cherchée, la question de l’autorité se pose d’une tout autre façon. C’est le cas pour le non-juriste, qui n’est pas en position d’arbitre, et n’est pas, par conséquent, tenu au « parler dogmatiste et resolutif » : « Nous autres, qui privons nostre jugement du droict de faire des arrests, regardons mollement les opinions diverses » (III, 8, p. 923). Il en va de même pour le non-théologien, celui que Montaigne, dans ce texte, nomme « humaniste » en inventant un nouvel usage pour ce terme : « … il se voit plus souvent cette faute que les Theologiens escrivent trop humainement, que cett’autre que les humanistes escrivent trop peu theologalement » (I, 56, p. 323/p. 155) : cet « humaniste » voit son discours légitimé pour autant qu’il n’a aucune visée dogmatique. Montaigne peut ainsi à la fois revendiquer son droit à une parole (non-doctrinale) et sa soumission aux prescriptions (doctrinales) formulées par les autorités théologiques :
Je propose des fantasies informes et irresolues, comme font ceux qui publient des questions doubteuses à debattre aux escoles, non pour establir la verite, mais pour la chercher : et les soubmetz au jugement de ceux, à qui il touche de regler, non seulement mes actions et mes escris, mais encore mes pensées. Esgalement m’en sera acceptable et utile la condemnation, comme l’approbation. Et pourtant [i.e. par conséquent] me remettant tousjours à l’authorité de leur censure, qui peut tout sur moy, je me mesle ainsin temerairement à toute sorte de propos, comme icy (I, 56, p. 317-318/p. 155).
Ce serait une erreur de croire que l’opposition porte sur des champs du savoir, sacrés et profanes. En réalité, si le discours de l’« humaniste » est légitimé, ce n’est pas parce qu’il s’exercerait dans son ordre propre, au sens où il porterait sur un objet différent de celui de la théologie. En 95parlant de la prière, Montaigne est bien conscient qu’il vient lui-même empiéter sur le domaine du théologien : c’est pourquoi il considère lui-même considère qu’il ferait mieux de laisser un tel discours aux professionnels et « de [s]’en taire ». Cette autocritique n’est bien entendu pas suivie d’effets : car ce qui légitime le discours de l’humaniste, c’est non son objet, mais sa modalité d’énonciation. On pourrait penser que le caractère « instruisable » du discours humain a pour conséquence sa soumission à une autorité supérieure. Le paradoxe est qu’il n’en est rien, bien au contraire. Le rapport du discours à l’autorité est toujours duel : est soumis à l’autorité extérieure le discours qui lui-même prétend faire autorité. Inversement, ne fait autorité que le discours qui reçoit d’ailleurs son autorité : c’est le cas du discours doctrinal, qui trouve l’une de ses seules applications légitimes dans le discours des théologiens, qui est « instruisant » et « matiere de foy » parce qu’il est « arresté et reglé par l’ordonnance celeste ». À l’opposé, le discours « humain » se trouve dégagé de toute soumission aux autorités pour autant que lui-même ne prétend aucunement faire autorité. C’est parce que le dire humain relève d’une dynamique de la recherche, et non d’une logique de la règlementation, qu’il n’est pas lui-même soumis aux autorités extérieures.
Ne pas se mêler de théologie veut donc moins dire ne pas traiter de questions qui touchent à la théologie que ne pas user du ton dogmatique que le seul théologien est en droit d’adopter. Le discours que revendique Montaigne est un discours par nature « non instruisant », au contraire de la doctrine. Mais en même temps, ce discours, parce qu’il renonce à toute prétention autoritaire (« le dire humain a ses formes plus basses et ne se doibt servir de la dignité, majesté, regence, du parler divin »), conquiert son droit à ne pas être contraint par l’autorité extérieure. Il en va en effet de la nature de l’esprit humain de ne pouvoir être fixé ou arrêté par quelque autorité que ce soit, d’échapper, « par volubilité et dissolution » (II, 12, p. 559), à toutes les barrières qu’on lui impose et d’être toujours renvoyé à sa dynamique heuristique : « L’agitation et chasse est proprement de nostre gibier […]. Car nous sommes nais à quester la verité » (III, 8, p. 928). Le chapitre « De l’experience » développe ce propos :
Nul esprit genereux ne s’arreste en soy : il pretend tousjours et va outre ses forces ; il a des eslans au delà de ses effects ; s’il ne s’avance et ne se presse et ne s’accule et ne se choque, il n’est vif qu’à demy ; ses poursuites sont sans terme, et sans forme ; son aliment c’est admiration, chasse, ambiguité (III, 13, p. 1068).
96C’est bien en ce sens que le discours de l’« humaniste » (celui qui use d’un discours humain, donc non dogmatiste) est « instruisable ». Montaigne ne veut pas dire par là qu’il est soumis à une autorité supérieure à même de l’instruire, mais qu’il est ouvert à l’enquête et à la découverte, c’est-à-dire à une vérité qui reste encore (et toujours) à trouver. Le chapitre « Des prières » apparaît bien ici comme le prolongement des chapitres « pédagogiques » I, 25 et I, 26. Le savoir achevé ne se trouve qu’en Dieu : en son sens proprement humain, le savoir désigne l’activité même de la pensée, ou, mieux, la pensée elle-même, comprise prise comme activité constitutivement inachevée et sans doute inachevable.
Les ajouts au chapitre « Des prieres » énoncent ainsi les devoirs et les droits du parler humain. Le droit de juger de tout – ce que fait Montaigne dans les Essais – se paye d’une interdiction du parler dogmatique. Inversement, il est légitime que le théologien professionnel adopte une attitude dogmatique, dès lors que son rôle est d’arbitrer une querelle : mais Montaigne pense qu’il est illégitime que ce mode de discours soit employé par tous ceux qui ne sont placés par nécessité en position d’arbitre. Il ne s’agit pas à ce niveau de critiquer la censure en général : ce qui intéresse Montaigne est moins de définir l’illégitimité du discours du théologien que de définir par contraste le champ de légitimité du discours de l’« humaniste » et par là de la liberté d’écriture des Essais.
La doctrine, au sens de l’opinion des autres, n’est d’ailleurs pas purement simplement rejetée. Ici encore, c’est moins le contenu qui doit être pris en considération que la modalité d’énonciation. Dans ses deux chapitres pédagogiques, Montaigne esquisse en filigrane ce que pourrait être un bon usage de la doctrine : pratique de la lecture, examen critique des opinions en les opposant à d’autres, contextualisation de la doctrine en la liant à la vie de celui qui l’a énoncée, etc. De la même façon, dans le chapitre « Des trois commerces », la doctrine peut être admise en se donnant pour ce qu’elle est – une opinion parmi les autres, ouverte à l’examen et à l’épreuve, non séparée donc du mouvement du savoir : « S’il plaist à la doctrine de se mesler à nos devis, elle n’en sera point refusée : non magistrale, imperieuse et importune comme de coustume, mais suffragante et docile elle mesme » (III, 3, p. 824). Une doctrine « non magistrale » peut sembler une contradiction dans les termes. C’est cependant en ce sens oblique que la doctrine désigne un savoir sans doute appris de l’extérieur, mais qui a renoncé à toute 97prétention autoritaire. Elle ne clôt plus le mouvement du savoir, mais stimule celui-ci dans son activité d’inquisition.
Cette doctrine « suffragante et docile » est ici proche du « discours instruisable, non instruisant » du chapitre « Des prières ». On peut aussi les rapprocher l’une et l’autre du discours des Pyrrhoniens dans l’« Apologie de Raimond Sebond » : « Je voy les philosophes Pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur generale conception en aucune maniere de parler : car il leur faudroit un nouveau langage. Le nostre est tout formé de propositions affirmatives, qui leur sont du tout ennemies » (II, 12, p. 527). Parler sur un mode non affirmatif : l’idée se trouvait déjà dans le Théétète de Platon, lorsque l’héraclitéen se trouvait acculé à ne plus pouvoir dire ni affirmer ni nier, ni dire « ainsi » (houtô) ni « pas ainsi » (mè houtô) ; celui-ci, pour sauvegarder le caractère fluent de la réalité, devait trouver un « autre vocable » (allè phonè) et dire quelque chose comme « pas même ainsi » (oud’houtôs)15 . L’enjeu est un peu différent pour Montaigne : parler sans propositions affirmatives, c’est se défaire de tout lien à une vérité absolue avec laquelle nous n’avons « aucune communication » (II, 12, p. 601). Les pyrrhoniens, écrit Montaigne « se servent de leur raison pour enquerir et pour debatre, mais non pour arrester et choisir » (II, 12, p. 505). L’essai représente ce mode de discours non résolutif, respectant le mouvement de la quête qui constitue l’essence même de la vie de l’esprit16.
Les ajouts postérieurs à 1588 sont donc cohérents avec le texte de 1580 qui sert d’amorce à la digression – l’interdiction faite au vulgaire (aux « humanistes », donc à tous ceux qui n’ont pas pour charge d’arbitrer sur les matières religieuses) non certes de parler des choses divines, mais d’en parler sur un mode magistral qui n’appartient qu’au théologien professionnel. Plus généralement, Montaigne condamne les postures dogmatiques, qu’il rend responsable du sectarisme confessionnel de son temps. En s’attaquant à « ces gens […] qui n’ignorent rien, qui 98gouvernent le monde, qui sçavent tout » (II, 12, p. 538), l’« Apologie de Raimond Sebond » peut être lue ainsi comme un vaste pamphlet politique contre les attitudes sectaires et bellicistes. Mais n’est-ce pas aussi l’objet du chapitre « Des prières » ?
Ce chapitre n’a en réalité que peu à voir avec une méditation, théologique sur la prière, sa pratique et sa finalité. Montaigne, sans doute, croise Augustin ou Thomas dans leur combat contre la conception magique des requêtes païennes17, tels les charactères (signes vivants et efficaces) de Porphyre, les synthèmata de Proclus ou la télétique des Oracles chaldaïques18. Mais les buts sont bien différents. Il ne s’agit pas de savoir par quel moyen nous pouvons nous élever à Dieu ni quel est le pouvoir efficace des signes verbaux ou la valeur sacramentelle de la prière, si elle doit être privée ou publique, etc. Il s’agit bien de la conduite en ce monde de ceux qui se disent chrétiens. Alain Legros a parfaitement résumé ces enjeux : il s’agit d’une remontrance adressée aux chrétiens19 – plus précisément d’une remontrance morale faite à ceux qui multiplient les actes extérieurs de contrition tout en semant la sédition et en répandant les pires cruautés. Ici comme ailleurs, Montaigne fustige l’hypocrisie de ceux se couvrent d’une apparence de piété pour couvrir les motifs inavouables qui animent leur conduite belliqueuse. Selon lui, la marque première du chrétien se situe non dans les pratiques rituelles ou sacramentaires, mais dans la conduite vertueuse :
Toutes autres apparences sont communes à toutes religions : esperance, confiance, evenemens, ceremonies, penitence, martyres. La marque peculière de nostre verité devroit estre nostre vertu, comme elle est aussi la plus celeste marque et la plus difficile, et que c’est la plus digne production de la verité (II, 12, p. 442).
La remontrance du chapitre « Des prières » épouse un schéma argumentatif semblable à celui du début de l’« Apologie de Raimond Sebond », lorsque Montaigne reproche (car il s’agit bien là d’un reproche, et non 99d’une revendication d’agnosticisme) aux hommes de son temps d’être chrétiens superficiellement et du bout des lèvres, à même titre que nous sommes « Perigordins ou Alemans » (II, 12, p. 445). Cette thématique est aussi développée, en particulier, dans l’« Apologie de Raimond Sebond », lorsque Montaigne se plaint que le zèle religieux serve de couverture à « nostre pente vers la haine, la cruauté, l’ambition, l’avarice, la detraction, la rebellion » (II, 12, p. 444). De la même façon, dans le chapitre i, 56, Montaigne demande aux chrétiens de mettre leurs actions en accord avec leurs paroles, et en particulier ici les paroles du Notre Père. « Que ton nom soit sanctifié » doit être pris comme une condamnation de l’orgueil. « Que ta volonté soit faite » réfute l’instrumentalisation de la religion à des fins personnelles. « Comme nous pardonnons » réfute par avance le quotidien des vengeances, des tueries et des supplices, etc. Citons Montaigne sur ce dernier point, qui est sans doute le plus important dans le contexte des guerres civiles :
Pardonne nous, disons nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offencez. Que disons nous par là, sinon que nous luy offrons nostre ame exempte de vengeance et de rancune ? Toutesfois nous appellons Dieu et son ayde au complot de nos fautes, et le convions à l’injustice (I, 56, p. 323/p. 150-151).
Comme l’écrit Alain Legros, « Montaigne trouve avant tout dans le Pater une exigence de fraternité et pardon mutuel, et c’est cela qu’il rappelle aux chrétiens divisés et dévoyés de son temps20 ». Les chrétiens en guerre ne sont donc chrétiens que de nom et leur conduite est condamnée par les paroles mêmes qu’ils prononcent dans le Notre Père. Si l’on a pu qualifier la position de Montaigne de « rigoriste21 », il convient de préciser que ce rigorisme n’est pas, en son sens premier, théologique : il fait partie des ingrédients de la rhétorique morale des Essais – comme il faisait déjà partie de la rhétorique de la parénétique des cyniques ou des stoïciens22. Montaigne ne dit pas aux chrétiens sectaires de son 100temps que la prière leur est interdite : il les appelle à une réforme morale intérieure23 et dit plutôt à ceux qui prient qu’ils doivent mettre leurs actions à la hauteur de leurs paroles. Ce qui importe n’est pas de savoir comment il faut prier, mais bien comment il faut agir.
Le texte dans ses états finaux (EB et 1595) et le texte initial de 1580 sont orientés contre un même ennemi. Celui-ci n’est pas le théologien, mais plutôt celui qui, sans être autorisé, use d’un mode de discours dogmatiste réservé au théologien. Il n’est pas non plus le protestant en tant que tel : Montaigne dénonce plus généralement les enjeux de domination et de pouvoir qui se cachent sous le discours et la conduite de tous ceux qui prétendent, d’une façon ou d’une autre, avoir un accès privilégié à la vérité. Ces critiques de l’édition de 1588, développées dans les éditions ultérieures, prolongent le projet initial du chapitre, tourné contre les attitudes d’orgueil et de fanatisme, hypocritement couverts sous le voile d’une fausse piété, qui entretiennent la guerre civile au lieu de l’éteindre. Le chapitre, dans sa version initiale comme dans sa version finale, contribue ainsi au programme moral des Essais, qui vise à former un homme pour la paix civile24 – un programme qui sera prolongé, un demi-siècle plus tard, dans l’exposé des lois de nature du Léviathan de Hobbes.
Thierry Gontier
Université de Lyon / IRPhiL / LabEx COMOD
1 Michel de Montaigne, Des Prières (Essais, I, 56), édition et commentaire A. Legros, Genève, Droz, 2003. Pour les citations des Essais, l’édition utilisée est celle de Villey-Saulnier (Les Essais, édition de Pierre Villey, sous la direction et avec une préface de V.-L. Saulnier, Paris, PUF, 1992 [1924]). Pour les citations du chapitre i, 56, nous ajoutons la pagination de l’édition d’Alain Legros.
2 Paul Mathias, « Sans Dieu ni maître : le “fidéisme”de Montaigne », Ph. Desan (dir.), « Dieu à nostre commerce et société ». Montaigne et la théologie, Genève, Droz, 2008, p. 260.
3 Voir Maturin Dreano, La Religion de Montaigne, Paris, Nizet, 1969 ; Malcolm Smith, Montaigne and the Roman Censors, Genève, Droz, 1981 ; Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme, de la Renaissance à Descartes, Paris, Vrin, 1998.
4 Aujourd’hui appuyé par quelques documents des archives de la congrégation pour la Doctrine de la Foi. Voir en particulier Vincent Carraud et Jean-Robert Armogathe, « Les Essais de Montaigne dans les archives du Saint-Office », J.L. Quantin & J.C. Waquet (dir.), Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu, Genève, Droz, 2007, p. 79-96, ainsi que Jean-Louis Quantin, « Les censures de Montaigne à l’index romain : précisions et corrections », Montaigne Studies, no 34, 2014, p. 145-162.
5 Journal de voyage de Michel de Montaigne, éd. F. Rigolot, Paris, PUF, 1992, p. 119.
6 Pensées, Lafuma 120. Montaigne écrivait pour sa part écrire son livre « à peu d’hommes et à peu d’années » (III, 9, p. 982).
7 Par exemple, sur la traduction de la Bible en langue vulgaire : « Je suis en effet tout à fait opposé à l’avis de ceux qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire pour être lues par les profanes, comme si l’enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de théologiens pouvaient le comprendre, ou bien si le rempart de la religion était fait de l’ignorance où on la tiendrait. Les mystères des rois, peut-être valait-il mieux les taire, mais le Christ a voulu que ses mystères à lui fussent répandus le plus possible. Je voudrais que toutes les plus humbles des femmes lisent les évangiles, lisent les épîtres de Paul. Puissent ces livres être traduits dans toutes les langues, de façon à ce que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les Turcs et les Sarrasins soient en mesure de les lire et de les connaître » (Érasme, Paraclesis, trad. Y. Delègue et J.P. Gillet, dans Érasme. Les Préfaces au Novum Testamentum, Genève, Labor et Fides, 1990, p. 75).
8 Voir notre article, Thierry Gontier, « Doctrine et science dans les Essais de Montaigne », R. Imbach et Ph. Büttgen (dir.), Vera doctrina. Zur Begriffsgeschichte der Lehre von Augustinus bis Descartes. L’idée de doctrine d’Augustin à Descartes, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Wiesbaden, Harrassowitz, 2009, p. 343-364.
9 C’est moins Aristote lui-même qui est critiqué ici que la figure emblématique de l’autoritarisme scientifique, le « Dieu de la science scolastique », le « monarque de la doctrine moderne », dont la « doctrine nous sert de loy magistrale », dont « c’est religion de debatre [des] ordonnances » (II, 12, p. 539).
10 Je souligne.
11 Léviathan, II, 26, traduit du latin et annoté par F. Tricaud et M. Pécharmant, intro M. Pécharmant, Paris, Vrin, 2004, p. 210.
12 Sur le caractère ambivalent de l’obligation des lois, voir André Tournon, « Justice oblige », BSAM, no 21-22, 2001, p. 71-79 ainsi que Ullrich Langer, “Montaigne’s Ethics in Context : Fortitude (I, 12) and Justice (I, 23)”, Montagne Studies, no 14, 2002, p. 7-18. Thomas Berns (Violence de la loi à la Renaissance : l’originaire du politique chez Machiavel et Montaigne, Paris, Kimé, 2000, p. 317-320) souligne plus encore l’engagement de Montaigne, dans ses fonctions publiques, en faveur de la justice et sa critique de institutions.
13 La theologie naturelle de Raymond Sebon Docteur excellent entre les modernes, en laquelle par l’ordre de Nature est desmontrée la vérité de la Foy Chrestienne et Catholique, traduite nouvellement de Latin en François par Mel de Montaigne, Paris, 1569, p. 2 vo. Nous avons reproduit la traduction de Montaigne du prologue dans notre étude, Th. Gontier, « La notion de “doctrine”, de la traduction du prologue de la Théologie naturelle de Sebond aux Essais de Montaigne », Ph. Desan (dir.), Dieu à nostre commerce et société. Montaigne et la théologie, Genève, Droz, 2008, p. 171-174.
14 Sur l’expression « sans apparence », voir Kirsti Sellevold, « J’ayme ces mots … » : expressions linguistiques du doute dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2004, p. 137-152.
15 Platon, Théétète, 183 a-b.
16 Paradoxalement, ce discours non doctrinal retrouve aussi, mutatis mutandis, quelque chose de l’humilité de la doctrina sabundiste : « elle rend l’homme obéyssant, ennemy du vice et du péché, amoureux de la vertu, sans l’enfler pourtant ou l’enorgueillir pour sa suffisance » (La theologie naturelle de Raymond Sebon …, op. cit., fo 2vo ; voir Th. Gontier, art. cité, p. 172). On sait par ailleurs que la traduction de Montaigne attenue l’optimisme rationaliste par trop prononcé de la doctrine de Sebond.
17 « Orantes autem nolite multum loqui sicut ethnici, putant enim quia in multiloquio suo exaudiantur, nolite ergo adsimilari eis, scit enim Pater vester quibus opus sit vobis antequam petatis eum » (Matthieu 6, 7-8).
18 Voir Proclus, Commentaire du Timée, II, prologue et Jamblique, De mysteriis, I, 15 ; II, 11 ; V, 26 et surtout VII, 5. Sur cette tradition théurgique de la prière, voir E.R. Dodds, Les Grecs et l’irrationnel, trad. fr., M. Gibson, Paris, Flammarion, 1965 et Henri-Dominique Saffrey, Recherches sur le néoplatonisme après Plotin, Claix, La pensée sauvage, 1980.
19 Montaigne, Essais, I, 56 …, op. cit., Introduction, p. 19 et 23.
20 Voir l’introduction d’Alain Legros (Montaigne, Essais, I, 56 …, op. cit.), p. 27.
21 V. Carraud, « Avoir l’âme nette : scepticisme et rigorisme dans “Des prieres” », Ph. Desan (dir.), « Dieu à nostre commerce et société ». Montaigne et la théologie, Genève, Droz, 2008, p. 73-89.
22 Selon Vincent Carraud et Jean-Robert Armogathe (« Les Essais de Montaigne dans les archives du Saint-Office », art. cité), les Essais ont été censurés en 1581 pour des motifs théologiques (liés à la querelle anti-protestante) alors qu’ils ont été mis à l’index en 1676 pour leur morale relâchée et leur encouragement au libertinisme (p. 93). Il reste significatif que la liste donnée par Montaigne des remontrances des théologiens ne porte que très indirectement sur des questions théologiques proprement dites. User du mot païen de « fortune », nommer des poètes hérétiques, faire l’apologie de Julien l’Apostat ou condamner la cruauté des supplices, prôner une éducation aussi peu coercitive que possible, ne touche guère la théologie proprement dite, et encore moins la polémique anti-protestante.
23 Voir Celso Azar, « La notion de réformation chez Montaigne », dans E. Ferrari, Th. Gontier et N. Panichi (dir.), Montaigne. Penser en temps de guerres de religion, Paris, Classiques Garnier, à paraître.
24 Voir Douglas Thompson, « Construire un avenir commun en période de conflit. Les conseils politiques de Montaigne », dans ibid.