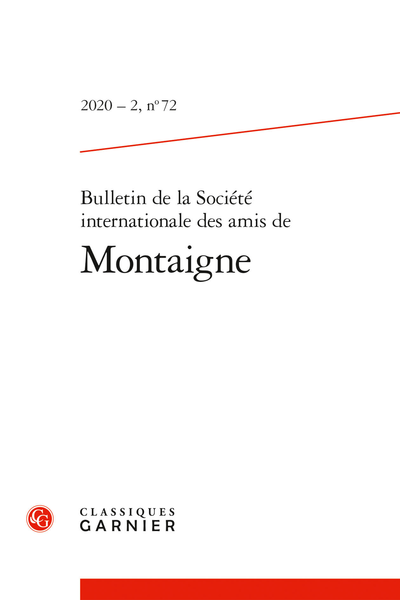
Portrait d’Alain Legros en paumier
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Brancher (Dominique)
- Résumé : Il s’agit de célébrer la virtuosité critique d’Alain Legros en prolongeant la réflexion qu’il a menée autour de la rencontre entre jeu de paume et philosophie chez Montaigne. La traduction de l’epochè pyrrhonienne par « je soustiens » correspond à l’attitude du joueur se positionnant pour réceptionner la balle, qu’elle soit celle du jeu ou celle de la parole humaine.
- Pages : 71 à 84
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0071
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Montaigne, epochè, pyrrhonisme, philosophie, jeu de paume
Portrait d’Alain Legros en paumier
Alain Legros tient sans doute beaucoup moins aux hommages, à l’éloge du plumage, même s’il fait l’oiseau, qu’au généreux partage de ses explorations dans le « païs au-delà », où il s’efforce de « desmeler », tant que va la plume, la « veue trouble et en nuage », pourtant toujours affûtée, de Montaigne1. À la manière du joueur de paume qui « tombe à pic » en faisant parvenir la balle exactement au pied du mur du fond, il maîtrise un art bien à soi de la « chasse-pic2 » par sa perspicacité critique, roulant ses pensées jusqu’aux endroits décisifs, pour que rayonne leur impact, marquant le bon point au bon moment. Esprit agile, il sait toujours prendre la balle au bond, autrement dit à la volée, faisant sienne la célèbre formule de Montaigne : « la parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l’escoute3 ». Or le Bordelais compare cet échange à celui entre deux joueurs, celui qui sert, celui qui reçoit : « comme entre ceux qui jouent à la paume, celuy qui soustient sa desmarche [positionne] et s’apreste selon qu’il voit remuer celuy qui luy jette le coup et selon la forme du coup [la frappe]4 ». Prêtant l’oreille à la trame d’échos que tissent les Essais, Alain Legros a montré avec virtuosité comment cette acception sportive du verbe « soutenir » permettait de mieux visualiser 72l’abstraite formule « je soutiens », par laquelle Montaigne traduit en 1580, dans l’Apologie, le vocable pyrrhonien Épékhô : « Je soustiens, je ne bouge5 ». Le monde des idées apparaît intimement lié à celui des corps, « s’entre-communiquants leurs fortunes6 », et si la nature des « ressorts » de cette étroite « cousture », « jamais homme ne l’a sçeu7 », du moins la chair du texte la donne-t-elle à palper au lecteur, à compter qu’il soit suffisant paumier. Ainsi Alain Legros tient-il une raquette de bon boyau de chat bien en main (et en poche), le manche renforcé de nerf de bœuf8, et surtout légère, ailée, « la meilleure », car « à la paulme faut avoir une raquette legere & l’eteuf pesant […] ne trop, ne trop peu, car toute chose ou il y a trop, ou trop peu ne vault rien9 ». Ainsi dûment équipé et lesté, il pratique une danse de philologue herméneute dont on ne peut qu’admirer les « pirouettes10 » (le jeu de jambes) pour mieux attraper l’« éteuf » virevoltant des Essais. Bien plus qu’une œuvre critique, il nous présente une démarche de pensée, allant et venant inlassablement sur le court du texte à la poursuite d’une balle – d’une parole –sans cesse en mouvement, tout en inspirant infinies nouvelles parties à ses lecteurs épatés, postés à la galerie (encore une expression tirée du jeu de paume). Aussi, à la volée, voudrais-je « remettre la partie sur la chasse11 », autrement dit intervertir les positions en continuant ici à « peloter » le vocabulaire de nos anciens paumiers que goûtait fort sportivement Montaigne et qu’a si bien éclairé Alain Legros. Une manière de poursuivre, en se renvoyant la balle pour s’échauffer (sens du 73verbe « peloter »), le dialogue performé lors d’une mémorable journée au Jeu de Paume de Bordeaux, qui aura inscrit une nouvelle ligne de vie, joyeuse et ludique, dans nos (longues et courtes) paumes12.
Montaigne ou l’athlétisme de la pensée
En 1569 paraît à Venise le De gymnastica, un ouvrage du grand médecin érudit Girolamo Mercuriale qui sera maintes fois republié, notamment en 1577 à Paris13. Cet influent traité humaniste plaide pour l’intégration de la gymnastique à la médecine hygiénique – ne permet-elle pas de maintenir ou rétablir la santé ? Il s’inscrit dans la vogue d’ouvrages, souvent écrits par des médecins, qui à partir de la deuxième moitié du xvie siècle, s’intéressent au possible bénéfice de la gymnastique antique une fois adaptés au monde contemporain. Parmi ces auteurs, au moins trois (les médecins Andrea Bacci et Laurent Joubert, le chirurgien Ambroise Paré14) sont bien connus de Montaigne, car 74l’usage des exercices est étroitement lié à celui des bains, où il cherche à amollir ses pierres rénales pour mieux les expulser.
Sa rencontre avec la gymnastique n’est évidemment pas seulement livresque. Elle a joué un rôle important dans son éducation, tandis que son père en maîtrisait les plus virtuoses exercices. Durant son voyage en Italie, il a manifesté un grand intérêt pour diverses joutes (courses équestres, voltige, tir à l’arc, escrime et jeux de balle)15 et fait fréquemment référence dans les Essais à son goût pour les déplacements à cheval ou à pied – il lui faut marcher pour penser, et aller « de la plume comme des pieds16 ». Le mouvement conditionne une écriture décrite par des métaphores elles-mêmes doublement cinétiques, par leur nature de métaphore, qui consiste à déplacer un sens sur un autre sens, et par leur prédilection pour les référents gymniques. Pour Montaigne, il ne s’agit donc pas tant de disserter sur les exercices que de s’exercer en maniant la plume, de faire bouger le livre, à coups de voltes, sauts et renversements argumentatifs et stylistiques, jusqu’à en perdre le souffle : « il n’est rien si contraire à mon stile qu’une narration estendue : je me recouppe si souvent à faute d’haleine17 ». Cette altération de la respiration est le critère qui, de Galien aux traités d’hygiène du xvie siècle, permet de distinguer l’exercice du simple mouvement.
Cependant, loin de s’aligner sur le modèle athlétique, Montaigne s’emploie à le problématiser. Il privilégie une poétique de la nonchalance, livrée au hasard, plutôt qu’encadrée par des règles et un programme orientés vers une finalité : « Je suis desgousté de maistrise et active et passive18 ». Cette « exercitation » nonchalante19 réveille l’étymologie du mot « sport », un terme introduit au milieu du xvie siècle, issu de « deporter », qui signifie se distraire, notamment en pratiquant l’exercice physique. Comme l’écrit Rabelais à propos du géant Gargantua, « se desportaient […] ès prés et jouaient à la balle, à la paume20 ». Le verbe 75signifie aussi se décharger d’une obligation, comme celle de se soumettre à la codification de plus en plus technique et mathématisée des exercices physiques dans les traités du xvie siècle21.
Comme l’écrit Alain Legros, avec Montaigne, le corps n’est jamais très loin de la pensée, et son esprit « mousse », nonchalant, va de pair avec un « corps tendre » : l’essayiste se targue d’être un piètre sportif, un désastre gymnique – affirmation que l’on ne saurait prendre au pied de la lettre. Vérité, exagération ou mensonge, la question est plutôt de savoir pourquoi l’auteur tient à se façonner un tel ethos. Il existe ainsi, dans les Essais, un décalage frappant entre le modèle de bonne condition physique qu’il prône et l’insistance sur la mollesse de sa nature. Dans « De l’Institution des Enfans », son programme pédagogique accorde, comme Rabelais dans l’éducation humaniste de Gargantua, et sous l’égide de Platon, une grande importance à l’exercice corporel. Or ce modèle pédagogique apparaît comme un antidote au contre-modèle montaignien, dont l’éducation, conduite « d’une façon molle et libre22 », est tantôt rendue responsable de sa languissante complexion, tantôt jugée incapable de vaincre l’incroyable force de résistance d’une mollesse innée : « j’estois parmy cela si poisant, mol et endormi, qu’on ne me pouvoit arracher de l’oisiveté, non pas [= pas même] pour me faire jouer23 ». Et la vieillesse, qui assèche le corps, n’a su altérer cette complexion, et a comme maintenu notre auteur dans sa « tendreur24 » originelle et enfantine :
Ce n’est pas assez de luy [l’enfant] roidir l’ame ; il luy faut aussi roidir les muscles. Elle est trop pressée, si elle n’est secondée, et a trop à faire de seule fournir à deux offices. Je sçay combien ahanne la mienne en compagnie d’un corps si tendre, si sensible, qui se laisse si fort aller sur elle25.
Par son incurable mollesse, Montaigne trahit un double modèle : non seulement celui qu’il préconise, mais aussi celui qu’incarnait son père, 76que nul « homme de sa condition » ne sut jamais égaler « en tout exercice de corps ». Et l’auteur de poursuivre, en exacerbant le contraste avec son géniteur : « A la danse, à la paume, à la luite, je n’y ay peu acquerir quune bien fort legere et vulgaire suffisance ; à nager, à escrimer, à voltiger et à sauter, nulle du tout26 ». Or en se dépeignant aussi peu habile à bondir qu’à plonger, à manier l’épée que la raquette (sport qui fut fatal à son frère, mort d’un éteuf reçu dans l’œil), Montaigne met d’autant mieux en valeur ses « exercitations » proprement littéraires, ressources et symptômes des périodes turbulentes. C’est grâce à ses mouvements scripturaires « intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuel27 », ou pour mieux dire, intellectuellement sportifs, sportivement intellectuels, qu’il va se forger un corps de remplacement susceptible, à coup de toniques métaphores gymniques, de rivaliser avec celui du père.
L’arrêt dynamique de la pensée
« Je soutiens, je ne bouge28 » : grâce à Alain Legros, on a vu à quel point le verbe « soutenir » se leste d’un sens dynamique : au jeu de paume, on soutient quand, aux aguets, on attend la balle. De même, en danse, « soutenir le pas », signifie conserver la cadence (1690), et en équitation, « soutenir un cheval » revient à « l’empêcher d’aller trop tôt sur le terrain » (1611). Il y aurait ainsi une manière bien montaignienne de soutenir l’exigence d’une pensée engagée mais consciente de ses limites. « Ne pas bouger » n’est donc pas l’antithèse du branle pédestre ou mental, mais relève d’une gymnastique suspensive plus subtile qui condamne implicitement les adhésions irréfléchies à des opinions partisanes et violentes. Ainsi, Montaigne fait sien le refrain pyrrhonien dans un ajout décisif de l’exemplaire de Bordeaux :
J’essaye de soubstraire ce coing à la tempeste publique [les guerres de religion], comme je fay un autre coing en mon ame. Nostre guerre a beau changer de formes, se multiplier et diversifier en nouveaux partis ; pour moy, je ne bouge. 77Entre tant de maisons armées, moy seul, que je sache en France, de ma condition, ay fié purement au ciel la protection de la mienne29.
Notons que le « je ne bouge » a de fait… bougé dans les ajouts autographes sédimentés de l’exemplaire de Bordeaux, puisqu’il corrige une première formulation, « la miene [forme] ne bouge ».
Jean-Yves Pouilloux proposa, il y a quelques années, une conférence intitulée « Montaigne. L’arrêt ou la renaissance de la pensée ». Or comment penser l’articulation de cet arrêt et de cette renaissance, où l’immobilité est condition de l’éveil de la pensée ? Pour un aussi fin connaisseur des questions juridiques qu’était Montaigne, l’arrêt renvoie à une décision ferme de la cour de justice. Peut-être est-ce précisément parce qu’il rédigea entièrement de sa main, ainsi que l’a montré Alain Legros, dix arrêts ou plutôt dicta30 et qu’il en contrôla trente-sept autres, signés, à une exception près, de son nom, qu’il écrit ironiquement : « Recevons quelque forme d’arrest qui die : La court n’y entend rien31 ». Passé maître dans l’art de déjouer ou assouplir les arrêts des disciplines trop sûres d’elles-mêmes, à la manière de ce président « assurément humaniste », invitant à « “géhenner” le suspect “avec moderation32” », Montaigne ne serait-il pas ce qu’on appellera au xviie s. un homme « sans arrêt », à savoir irrésolu et volage ?
Rien n’est moins sûr, tant l’essayiste semble tout autant priser l’arrêt, mot qui désigne, depuis le xiiie siècle, la suspension d’une action, d’un processus ; d’où, au xviie siècle, la référence au chien qui s’immobilise à la chasse, ce qui donnera « être en arrêt », être sur le qui vive, au début du vingtième. C’est bien dans ce sens que je comprends la notion d’« arrêt » dans les Essais : non comme un dispositif pour maintenir un système immobile, tel le « point d’arrêt » en couture, non comme une capture, une saisie, l’« arrestation » (xive) d’un sens définitif, sommé de se rendre, mais comme une mise aux aguets de la pensée, un moment 78suspendu pour mieux s’élancer et se relancer. C’est une exigence du pyrrhonisme que cet arrêt interrogatif et anti-dogmatique. Selon Sextus Empiricus, « la suspension de l’assentiment [epochè] est l’arrêt de la pensée [stasis dianoias] du fait duquel nous ne rejetons ni nous ne posons une chose33 ». Ce vocabulaire technique posa un véritable défi aux traducteurs. Henri Estienne, dont Montaigne possédait la version latine des Hypotyposes pyrrhoniennes, parue en 156234, opte pour assensus retentio, conformément aux fiches de vocabulaire de son Ciceronianum lexicon graecolatinum (1557) où figure la traduction assentionis retentio, tirée du premier livre des Academica35. Dans les annotations à ce passage des Hypotyposes, Estienne mentionne cependant une autre variante cicéronienne, se ab assensu sustinere, ou assensum sustinere, assensionem sustinere36, que reprend Montaigne sous une forme intransitive : « je soutiens ». L’expression est intimement liée à l’idée d’exercice physique, comme le révèle un passage des Académiques de Cicéron, où le stoïcien Chrysippe se compare à un « habile conducteur de char », freinant ses chevaux au bord du précipice (equos sustinebo), lorsqu’il s’impose un arrêt dans la discussion, se retient [sic me ante sustineo], et cesse de répondre à des questions captieuses37.
Cette extension du domaine de la mobilité prend un tour particulièrement fascinant dans certains traités techniques de la Renaissance, comme le De arte natandi de Digby (1587), qui inclut dans sa typologie des mouvements le corps allongé, immobile dans l’eau – avec un orteil dressé, éventuellement pour se couper les ongles38, ou le menton suspendu au-dessus des flots, au chapitre « menti suspensio ». Flottant 79sur le dos, il s’agit ici de renverser la tête vers l’arrière en surélevant le visage, de tirer ses pieds un peu vers le haut, les mains jointes derrière le dos, en courbant le corps comme un arc, de sorte que l’eau, montant et descendant en son creux, le soutienne si facilement qu’il ne soit besoin de remuer ni mains, ni pieds39.
Dans un chapitre du De gymnastica, le praticien Girolamo Mercuriale quant à lui s’interroge : An erectum stare sit exercitatio40 ? Rester debout constitue-t-il un exercice, à rebours de l’opinion commune ? La réponse, affirmative, ne repose plus comme avant sur l’enchaînement dynamique de la halte et du rebond, mais sur l’articulation tensionnelle du corps et de l’esprit, ce muscle qui actionne la possibilité de rendre le corps, en apparence, immobile. L’équilibre d’un homme, comme celui d’un oiseau dans le ciel, résulte ainsi de deux mouvements contradictoires, celui du corps qui chute et celui de l’âme qui s’élève, en s’alliant la volonté des muscles. L’exemple permet à Mercuriale de contester à Platon l’opposition entre status et motus, immobilité et mouvement, pour se rallier à Aristote (Physique, 5), qui n’oppose pas le mouvement à l’immobilité, mais à un autre type de mouvement, idée chère à Montaigne : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. […] La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant41 ». En travaillant la limite indécise séparant arrêt et mouvement, le Bordelais déconstruit l’association morale entre immobilité et paresse, tout en développant un véritable art de la résistance à la gravité des idées reçues, où l’activité passive n’est pas servitude volontaire mais abandon réfléchi.
Se perdre à trop vouloir gagner
Tous ces éléments culturels ne font que souligner ce qu’a si bien mis en valeur Alain Legros, l’importance pour Montaigne du verbe « soutenir », cette suspension dynamique, à la fois gymnique et philosophique, où 80l’on se retient de pencher d’un côté ou de l’autre. Refusant les trop fortes inclinations, Montaigne affirme ailleurs, dans le chapitre « De Ménager sa volonté », et en jouant du même verbe, qu’il ne tient pas aux choses, ou plutôt, que les choses ne le « tiennent » pas : si elles le touchent, elles ne le possèdent pas, et notre paumier du style de mettre en avant comme heureuse singularité ce « privilège d’insensibilité ». Non qu’il ne ressente rien, mais il ne s’attache et ne se passionne : « mon opinion », écrit-il, « est qu’il se faut prester à autruy et ne se donner qu’à soy-mesme », se prêter au jeu, en quelque sorte, sans s’y perdre, en maintenant à égale distance peurs et désirs – « jusques à la santé que j’estime tant, il me seroit besoing de ne la pas desirer et m’y adonner si furieusement que j’en trouve les maladies importable42 [insupportables] ». Cette éthique redéfinit la véritable santé comme stratégie existentielle, positionnement juste par rapport au monde et à soi-même, qui vaut aussi sur le terrain du jeu de paume, significativement rapproché d’un jeu tactique, les échecs :
Considerez, qu’aux actions mesmes qui sont vaines et frivoles, au jeu des eschets, de la paume et semblables, cet engagement aspre et ardant d’un desir impetueus jette incontinent l’esprit et les membres à l’indiscretion et au desordre : on s’esblouit, on s’embarrasse soy-mesme. Celuy qui se porte plus moderéement envers le gain et la perte, il est tousjours chez soy ; moins il se pique et passionne au jeu, il le conduict d’autant plus avantageusement et seurement. Nous empeschons au demeurant la prise et la serre [saisis] de l’ame à luy donner tant de choses à saisir. Les unes, il les luy faut seulement presenter, les autres attacher, les autres incorporer43.
Cette relégation du jeu de paume parmi les actions frivoles, de peu d’importance, n’a rien d’insultant pour les paumiers, car la force d’illustration métaphorique de cette activité éclate à nouveau, pour faire comprendre cinétiquement au lecteur une disposition d’être.
L’engagement trop passionné à la paume apparaît même à Montaigne comme une constante anthropologique qui, de l’Ancien au Nouveau monde, récemment découvert, affiche l’unité du genre humain. Dans les lointaines et exotiques Indes occidentales, les gens pratiquent ainsi « jeux de paume, jeu de dez et de sort auquel ils s’eschauffent souvent jusques à s’y jouer eux mesmes et leur liberté44 ». L’aliénation est la 81chose du monde la mieux partagée ; on se perd soi-même à trop vouloir gagner. D’où la nécessité d’apprendre à déjouer l’obsession, à y mettre du jeu plutôt qu’à s’y engager, au sens étymologique de se mettre en gage soi-même, comme valeur marchande à troquer plutôt que quant à soi à préserver.
Cette réflexion éthique autour de la paume s’enrichit d’une dimension épistémologique, dès lors qu’il s’agit de penser la cécité humaine face aux aveuglements et angles morts de la pensée. Comme à son habitude, Montaigne aime à ancrer sa réflexion dans l’observation concrète d’un cas étonnant :
J’ay veu un gentil-homme de bonne maison, aveugle nay, au-moins aveugle de tel aage qu’il ne sçait que c’est que veue : il entend [comprend] si peu ce qui luy manque, qu’il use et se sert comme nous des paroles propres au voir, et les applique d’une mode toute sienne et particuliere. […] Il dira comme l’un d’entre nous : Cette sale a une belle veue : il faict clair, il faict beau soleil. Il y a plus : car, par ce que ce sont nos exercices que la chasse, la paume, la bute, et qu’il l’a ouy dire, il s’y affectionne et s’y embesoigne [emploie], et croid y avoir la mesme part que nous y avons ; il s’y picque et s’y plaist, et ne les reçoit pourtant que par les oreilles. […] L’esteuf [la balle], il le prend à la main gauche et le pousse à tout [= avec] sa raquette ; […] Que sçait-on si le genre humain faict une sottise pareille, à faute de quelque sens, et que par ce defaut la plus part du visage des choses nous soit caché45 ?
Telle serait la « maladie » et l’« imperfection » (les termes sont de Montaigne) congénitale de l’homme : ignorer sa propre ignorance et manquer de lucidité critique, comme l’aveugle impunément satisfait de lui-même se croit maître du jeu en saisissant la balle de la main gauche et en la poussant maladroitement de sa raquette. Mais attention : Montaigne prend soin de formuler cette hypothèse sur un mode interrogatif (« Que sait-on si le genre humain faict une sottise pareille […] ? »), car affirmer tout de go que l’humanité méconnaît sa propre ignorance serait tomber dans le même travers dogmatique. Comme il l’écrit pour présenter l’enquête philosophique telle que la conçoivent les sceptiques pyrrhoniens : « L’ignorance qui se sçait, qui se juge et qui se condamne, ce n’est pas une entiere ignorance : pour l’estre, il faut qu’elle s’ignore soy-mesme46 ». Si l’on ajoute un niveau supplémentaire, 82statuer catégoriquement sur l’ignorance de l’ignorance ne ferait que reconduire le vice dénoncé, alors que la forme interrogative suspend (soutient) tout jugement, relève d’un exercice critique jamais clos, non d’une sanction ou d’un score définitif.
Articulées, les deux longues citations que j’ai commentées révèlent toute leur complexité : la présence autarcique à soi-même, si elle est revendiquée, menace aussi de se renverser en sottise. À trop adhérer à soi, on risque d’oublier la chasse pour une prise illusoire. On voit donc comment Montaigne maintient les éteufs ou balles de sa pensée constamment en mouvement (c’est le titre du bel ouvrage de Jean Starobinski), les fait rouler et rebondir avec une infatigable souplesse, invitant à se déprendre d’un trop fort engagement aux choses mais aussi à ses propres croyances, potentiellement pathogènes. Qu’on dialogue avec soi ou avec les autres, la parole s’échange entre deux joueurs attentifs l’un envers l’autre, comme l’a montré Alain Legros, mais rien ne garantit le rapport de ce qui se dit à la vérité.
Filant la métaphore sportive, le texte semble assimiler la circulation défaillante des représentations humaines à un jeu de paume sans raquette – au xvie siècle, la pratique à main nue perdure et raquette, étymologiquement, vient du latin médiéval rasceta, « paume47 », avant que la vogue de ce sport n’en déplace, par métonymie, le sens (vers 1450). Moins noble (jeux de mains, jeux de vilains, autrement dit de paysans, énonce le proverbe en s’inspirant du jeu), cet usage renvoie à la maladresse de l’aveugle saisissant la balle de se main gauche. Pour Montaigne, les parties humaines souffrent du statut ontologique des joueurs, défaillantes créatures en regard de la toute-puissance divine qui seule lance des balles marquées du sceau de la vérité dans les textes incarnant la Révélation chrétienne48 : « Quoy qu’on nous presche, quoy que nous aprenons, il faudroit tousjours se souvenir 83que c’est l’homme qui donne et l’homme qui reçoit ; c’est une mortelle main qui nous le presente [le pseudo-savoir], c’est une mortelle main qui l’accepte49 ».
Le jeu souffre aussi du manque flagrant de coordination des joueurs : « si les prises humaines estoient assez capables et fermes pour saisir la vérité par noz propres moyens, ces moyens estans communs à tous les hommes, cette verité se rejecteroit de main en main de l’un à l’autre50 ». Faute de consensus perceptif, les individus multiplient les balles perdues. Nous croyons pouvoir soumettre les choses « à nostre mercy », les assimiler « comme il nous plaist51 », mais cette apparente toute-puissance se renverse en faiblesse, puisque la subjectivité de la perception multiplie les vérités possibles, et altère ce qu’elle accueille dans les callosités de la main. Ce n’est ainsi que dans la conscience de ces ratages et impossibles coïncidences que peut s’opérer, à un autre niveau, la rencontre d’expériences singulières du corps et de la pensée sous l’égide d’un scepticisme revivifié.
Le partage de cette expérience nous rassemble, qui consiste à jouer avec Montaigne, à échanger nos éteufs à fleur de corde. Non pas pour gagner, mettre l’autre sur le « carreau » (dont était constitué le sol des salles dédiées à ce jeu), mais pour le plaisir de la partie, car « qui n’a jouyssance qu’en la jouyssance, qui ne gaigne que du haut poinct, qui n’aime la chasse qu’en la prinse, il ne luy appartient pas de se mesler à nostre escole52 ». Goûtons à ce « haut poinct » qui resémantise la « chasse » du côté du jeu de paume, où ce substantif désigne l’endroit où la balle tombe après le premier bond (chez Furetière, après Cotgrave). Et partageons avec Montaigne, maître du rebond et du redémarrage salvateur de la pensée, l’éthique de cette souple résistance, de ce « tenir bon » auquel il s’essaie en affrontant la Fin de partie de sa vie : « Je soustien tant que je puis53 ». Cette aptitude pourrait bien dépendre de la mise en pratique du « commandement paradoxe » d’Apollon qui, clôturant l’essai « De la Vanité », exploite significativement les deux mêmes verbes, cette fois sous une forme réflexive. À la croisée du jeu de paume, du pyrrhonisme 84et de l’éthique du « connais-toi toi-même », où se couturent corps et esprit, le dieu nous intime : « Regardez dans vous, reconnoissez vous, tenez vous à vous ; […] appilez vous, soutenez vous […]54 ».
Dominique Brancher
Université de Bâle
1 Michel de Montaigne, Essais, éd. Pierre Villey et Verdun-Louis Saulnier, Paris, PUF, 1992 [1924], I, 26, p. 146A. Sauf mention contraire, nous nous référons toujours à cette édition. Les italiques seront de notre fait.
2 Voir Marc Fumaroli, Le Livre des métaphores, Paris, Éditions Robert Laffont, 2012, rubrique « Pic – arriver, tomber à pic », expression issue du vocabulaire du jeu de paume. Si la balle arrive au pied du mur du fond, c’est une « chasse-pic ».
3 II, 15, p. 615C. La correction manuscrite de l’exemplaire de Bordeaux remplace la première lettre de « comme » par « Comme », scansion mettant en valeur la comparaison (voir sur le site Monloe l’accès à la version numérique de l’EB réalisée par Marie-Luce Demonet et Alain Legros, accueillie par les BVH, III, 13, f. [490v]), http://xtf.bvh.univtours.fr/xtf/view?docId=tei/B330636101_S1238/B330636101_S1238_tei.xml;chunk.id=B330636101_S1238_n6.13;toc.depth=1;toc.id=B330636101_S1238_n6;brand=default;query=bouge#1 (consulté le 29/10/2020).
4 III, 13, p. 1088B.
5 II, 12, p. 505A. Voir Alain Legros, « Suspendre son jugement : philosophie et jeu de paume », site de la SIAAM, 19 octobre 2020 https://siaam.hypotheses.org/699 ; consulté le 20 octobre 2020 ; « Epékhô, c’est-à-dire je soutiens, je ne bouge. Jeu de paume, histoire et philosophie », in Montaigne global, Mélanges en l’honneur de Philippe Desan, Paris, Classiques Garnier, à paraître en 2021, p. 411-423.
6 I, 21, p. 104A.
7 II, 12, p. 539A.
8 Pour ces indications sur la fabrication des raquettes, nous nous référons au commentaire de Serge Vaucelle sur le poème érotique de François Du Souhait, « Les Joueurs de Paume aux Dames », in Le Labyrinthe d’amour ou suite des Muses françoyses, Lyon, 1611, vers 34. Nous remercions S. Vaucelle qui a eu la générosité de nous faire part de ses analyses.
9 Henri de Saint-Didier, Traité contenant les secrets du premier livre sur l’épée seule (Paris, Jean Mettayer, & Matthurin Challenge, 1573, transcription par Olivier Dupuis, version du 12/08/2010, https://ffamhe.fr/sources/Sainct_Didier_Transcription_1.1.pdf, p. 93 (consulté le 29/10/2020).
10 Ibid., p. 94.
11 « Les Joueurs de Paume aux Dames », in Le Labyrinthe d’amour ou suite des Muses françoyses, Lyon, 1611, vers 9.
12 Cette journée, intitulée « Athlétisme philosophique. Montaigne au Jeu de paume », a eu lieu le 15 février 2020 au Jeu de Paume de Bordeaux, à Mérignac, 14h30. Je l’ai organisée dans le cadre du « Mois Montaigne 2020, Santés ! » qui m’avait été confié, en mêlant table ronde et performance sportive, avec Alain Legros, Christophe Bouneau (UBM), Thierry Bernard-Tambour (paumier et historien du jeu de paume), Tom Conley.
13 La première édition paraît à Venise en 1569. Pour une bibliographie, voir L’Art de la gymnastique. Livre premier, éd. et trad. Jean-Michel Agasse, Paris, Les Belles Lettres, 2006. ; pour l’histoire du texte, voir du même auteur « Girolamo Mercuriale : Humanism and Physical Culture in the Renaissance », in De arte gymnastica, éd. C. Pennuto, trad. V. Nutton, Florence, Olschki, 2008, p. 863-872. Sur cet ouvrage, voir plus généralement Vivian Nutton, « Les exercices et la santé : Hieronymus Mercurialis et la gymnastique médicale », in Le Corps à la Renaissance : Actes du XXXe Colloque de Tours 1987, éd. J. Céard et alii, Paris, Amateurs de livres, 1990, p. 295-308 ; Nancy G. Siraisi, « History, Antiquarianism, and Medicine : The Case of Girolamo Mercuriale », Journal of the History of Ideas, vol. 64, no 2, avril, 2003, p. 231-251 ; Girolamo Mercuriale : medicina e cultura nell’Europa del Cinquecento : atti del convegno Girolamo Mercuriale e lo spazio scientifico e culturale del Cinquecento : Forlì, 8-11 novembre 2006, éd. A. Arcangeli, V. Nutton, Florence, Olschki, 2008.
14 Le médecin Andrea Bacci, mentionné dans le Journal de Voyage, publia en 1571 à Venise un ouvrage important sur les bains, le De thermis, où il prend position par rapport à Mercuriale ; le médecin Laurent Joubert, dont Montaigne connaît bien les Erreurs populaires publiées chez son propre éditeur bordelais, Millanges, est l’auteur de deux opuscules (De gymnasiis et De balneis antiquorum), publiés de manière posthume en 1582. De son côté, le chirurgien Ambroise Paré propose pour la première fois en français, dans son Introduction à la chirurgie (Œuvres, 1575), une application du mouvement à l’hygiène.
15 John McClelland, « Montaigne and the Sports of Italy », Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, n.s., vol. 27, no 2, 2003, p. 41-51.
16 III, 9, p. 991B.
17 I, 21, p. 106C.
18 III, 7, p. 917B.
19 De « non-chaloir », négliger, tenir peu de compte de qqn ou qqch selon Godefroy.
20 Gargantua, Œuvres complètes, éd. M. Huchon, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1994, chap. xxiii. Sur ce terme, voir Bernard Merdrignac, Le Sport au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, chap. 1.
21 Sur cette technicisation rationaliste, aux dépens du mouvement spontané, voir John McClelland, Body and Mind : Sport in Europe from the Roman Empire to the Renaissance, Londres – New York, Routledge, 2007, chap. 7-8.
22 II, 17, p. 643A.
23 I, 26, p. 174A.
24 Le Littré illustre l’article « tendreur » de cette citation issue des Cincq dialogues faits à l’imitation des Anciens, par Or. Tubero : « Cette tendreur qui empêche de reconnaître les défauts de ses enfants spirituels [livres] ».
25 Ibid., p. 153C.
26 Ibid., II, 17, p. 642A.
27 III, 13, p. 1107C.
28 II, 12, p. 5050A.
29 II, 15, p. 617C.
30 Comme l’explique Alain Legros en introduction au formidable travail d’édition numérique des « Arrêts du Parlement de Bordeaux au rapport de Montaigne », « ces textes, élaborés par les conseillers siégeant dans la Première des deux Chambres des Enquêtes du Parlement de Bordeaux qui jugeaient en appel, n’allaient devenir arrêts au sens propre qu’une fois lus à haute voix et validés par la Grand Chambre » (Monloe, https://montaigne.univ-tours.fr/arrets-parlement-bordeaux/ ; consulté le 29/10/2020).
31 III, 11, p. 1030B.
32 Alain Legros, « Arrêts du Parlement de Bordeaux au rapport de Montaigne », Introduction.
33 Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, éd. et trad. P. Pellegrin, Paris, Seuil, 1997, I, 4, [10], p. 59.
34 Sexti Philosophi Pyrrhoniarum hypotypωseωn libri III, trad. Henri Estienne, [Genève], Henri II Estienne, 1562, I, 4, p. 10.
35 Ciceronianum lexicon graecolatinum, Id est, Lexicon ex variis Graecorum scriptorum … [Genève], Henri II Estienne, 1557, « Ex libris philosophicis », Lucullus, premier livre des Academica, p. 160, où figure la traduction assentionis retentio.
36 Sexti Philosophi Pyrrhoniarum hypotypωseωn libri III, « Annotationes Henrici Stephani », p. 245.
37 Cicéron, Les Académiques / Academica - édition bilingue, trad. José Kany-Turpin, introd. Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 2010, XXIX, 94.
38 Everard Digby, De arte natandi, Londres, Thomas Dawson, 1587, chap. 27, f. M2. La traduction anglaise n’a guère tardé : A Short introduction for to learne to Swimme. Gathered out of Master Digbies Booke of the Art of Swimming. And translated into English for the better instruction of those who understand not the Latine tongue. By Christofer Middleton, Londres, James Roberts for Edward White, 1595.
39 Everard Digby, De arte natandi, Londres, Thomas Dawson, 1587, chap. 22, « Menti suspensio », f. K4.
40 Mercuriale, De arte gymnastica libri sex, Venise, Junta, 1573, III, chap. 3, p. 136 sqq.
41 III, 2, p. 805B.
42 Toutes les citations proviennent du même passage, III, 10, p. 1003B.
43 Ibid., p. 1008-1009B.
44 II, 12, p. 574B.
45 II, 12, p. 589A.
46 II, 12, p. 503A.
47 Il est employé pour la première fois par Constantin l’Africain au xie siècle pour désigner le tarse, à partir de l’arabe dialectal rahet, « paume ». Voir Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 1992, article « raquette ».
48 Sans remettre en question la Révélation chrétienne et le caractère sacré des textes qui l’incarnent, Montaigne dit seulement que Dieu s’avale à nous et parle notre langue. Il se sert donc d’intermédiaires humains. Voir Alain Legros, Essais, I, 56 : « Des prières » de Michel de Montaigne, Genève, Droz, 2003, p. 31 sqq. Sur la sugkatabasis ou divine condescendance, voir François Rigolot, L’erreur de la Renaissance, p. 51, sqq. ; Mario Turchetti, « Une question mal posée : Érasme et la tolérance. L’idée de sugkatabasis », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, no 53, 1991, p. 379-395.
49 II, 12, p. 563B.
50 Ibid., p. 562A.
51 Idem.
52 III, 5, p. 881B.
53 III, 2, p. 817B.
54 III, 9, p. 1001B.