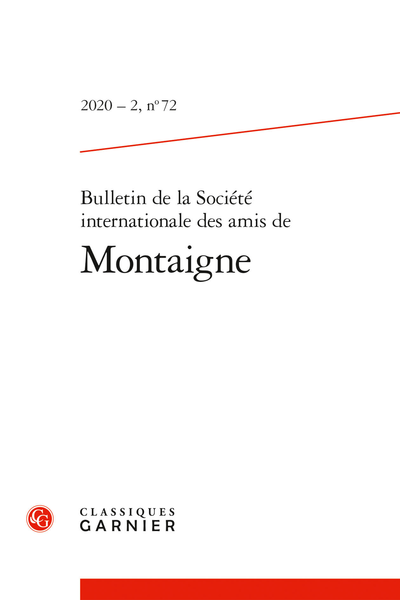
Sur un passage de l’Apologie Repenser la philosophie contre elle-même, docte ignorance et déraison
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Llinàs Begon (Joan Lluís)
- Résumé : L’objet de cet écrit est de proposer un commentaire d’un passage de l’ « Apologie de R. Sebond ». Montaigne y conteste l’utilité de la philosophie dans sa prétention à fournir des armes pour supporter les aléas de l’existence. Valorisant l’oubli plutôt que la mémoire, l’ignorance plutôt que la science, il montre cependant qu’il est possible d’en dégager une nouvelle manière de bien vivre… et donc de philosopher. Notre commentaire revient sur le traitement des sources de Montaigne.
- Pages : 119 à 130
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0119
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Philosophie, raison, folie, mémoire, docte ignorance, vie bonne, sources antiques
SUR UN PASSAGE DE L’APOLOGIE
Repenser la philosophie contre elle-même,
docte ignorance et déraison
Le texte qui suit est issu d’un atelier de lecture organisé autour d’un passage de l’Apologie. Cet atelier s’est déroulé lors d’une séance de l’Atelier Montaigne, dans le cadre de la collaboration entre le LabEx COMOD (Université de Lyon), l’IRPhiL (Université Jean Moulin Lyon 3), l’École Normale Supérieure de Paris (Ulm) et le centre parisien de l’Université de Chicago. Alain Legros est un habitué de l’Atelier, qu’il enrichit grâce à ses contributions précises et stimulantes. Il m’a notamment permis de découvrir la figure du médecin Pierre Pichot1, qui constitue un éclairage intéressant. Tous les contributeurs à cette recherche philosophique, apprécient infiniment les interventions d’Alain, car elles nous permettent de ne pas oublier que nous travaillons sur des textes qui s’enrichissent mutuellement – nous ne faisons que nous entregloser, écrivait déjà Montaigne. Le texte qui suit a été rédigé deux ans après cette séance, et doit beaucoup à Alain ; qu’il en soit donc sincèrement remercié.
L’objet de cet écrit est de faire quelques suggestions pour commenter un passage de l’Apologie de Raimond Sebond, traitant de la faiblesse de la philosophie, de l’utilité de la mémoire, de la science et du jugement. Le passage en question est II, 12, 494-496. Je découperai le texte en quatre parties, et ferai quelques remarques sur chaque partie2.
120I.
(A) Comment la philosophie, qui me doit mettre les armes à la main pour combatre la fortune, qui me doit roidir le courage pour fouler aux pieds toutes les adversitez humaines, vient-elle à cette mollesse de me faire conniller par ces destours couards et ridicules ? Car la memoire nous represente, non pas ce que nous choisissons, mais ce qui luy plaist. Voire il n’est rien qui imprime si vivement quelque chose en nostre souvenance que le desir de l’oublier : c’est une bonne maniere de donner en garde et d’empreindre en nostre ame quelque chose que de la solliciter de la perdre. (C) Et cela est faux : Est situm in nobis, ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus, et secunda jucunde et suaviter meminerimus. Et cecy est vray : Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum quae volo. Et de qui est ce conseil ? de celuy qui se unus sapientem profiteri sit ausus,
(A) Qui genus humanum ingenio superavit, et omnes
Praestrinxit stellas, exortus uti aetherius sol3.
La première remarque sur ce passage est la suivante : dans le texte de 1595, après « Comment » figure une interrogation. On devrait donc lire « Comment ? », soit une interrogation pratiquement exclamative. Ainsi, la critique devient plus forte, car le ton est plus méprisant : la philosophie, qui doit me permettre d’affronter les adversités de la vie et de les vaincre, est incapable d’y faire face. Le langage ici est guerrier : la philosophie prétend fournir des armes pour lutter contre la fortune et l’adversité mais, en réalité, elle substitue aux armes des conseils de fuite.
Deuxième remarque : ce passage s’insère dans un contexte plus large (II, 12, 488-501) d’éloge de la simplicité. Le contexte étroit renvoie au passage immédiatement antérieur : la philosophie prétend que nous possédons la science de l’oubli et, ainsi, conseille de ne garder en mémoire que la félicité passée et d’effacer les peines endurées. Ces conseils constituent pourtant, écrit Montaigne, des « détours » couards et ridicules. Couards, parce que la philosophie (notamment stoïcienne) prétend faire face aux difficultés, et les résoudre grâce à la vertu. Ridicules, parce que la philosophie propose une action en réalité impossible.
Troisième remarque : en effet, pour Montaigne, nous n’avons pas de contrôle sur notre mémoire. Plus nous voulons oublier, plus nous nous souvenons. La mémoire, pour Montaigne, possède sa volonté propre, elle 121est pour ainsi dire autonome. Ici, Montaigne se montre très affirmatif : l’ajout de la couche C qualifie de fausses et de vraies deux phrases empruntées au De finibus de Cicéron. Dans le premier livre du De finibus (I, 32, 57), Cicéron se réfère à la doctrine épicurienne sur le plaisir, qui donne à l’être humain la capacité d’être sélectif par rapport aux souvenirs. De cette façon nous pourrions, si nous sommes sages, oublier les souvenirs qui nous contrarient, et conserver ceux qui nous causent du plaisir. Dans le deuxième livre (II, 32, 104-105), Cicéron répond à Torquatus, alléguant un propos de Thémistocle qui affirmait préférer l’art de l’oubli à celui de la mémoire. En effet, notre nature ne peut pas mettre en œuvre le précepte épicurien selon lequel il faut contrôler sa mémoire. Un tel langage, si rude en matière de vérité et de fausseté, est paradoxal dans un contexte de dévaluation de la prétention à la vérité de la science. C’est que Montaigne juge ici la vérité et la fausseté des deux propositions à partir de son expérience, et donne raison à Cicéron (ou plutôt à Thémistocle). Épicure, qui ose se proclamer sage, le plus sage des sages même selon Lucrèce, se trompe. Le sage prétend disposer du contrôle absolu de soi-même, et Montaigne essaie de montrer que cela n’est pas possible – l’expérience (son expérience) nous le dit. Montaigne, donc, ne joue pas au philosophe contre la philosophie, il se place seulement en tant qu’homme qui attend que la philosophie lui démontre sa force et sa validité.
Quatrième remarque : notre expérience humaine nous permet de constater que, plus nous voulons oublier un souvenir, plus il reste fixé dans notre mémoire. La nature humaine est ainsi faite. Vouloir établir une science efficace de l’oubli impliquerait de dépasser notre nature, de vouloir aller plus loin que ce que l’on peut. La source de Montaigne n’est peut-être pas seulement Cicéron et sa critique de la doctrine épicurienne, mais aussi, peut-être, Pierre Pichot. Ce médecin et philosophe établi à Bordeaux, expert en maladies psychosomatiques, Montaigne le connaît, puisqu’il dispose dans sa « librairie » d’un exemplaire du De animorum natura, morbis, vitiis, noxis, horumque curatione ac medela, ratione medica ac philosophica (Bordeaux, Millanges, 1574)4. Dans ce livre, Montaigne a pu trouver un résumé de ce que Cicéron reproche à Épicure5. Peut-être 122Montaigne prend-il en compte la première phrase de ce résumé pour l’adapter à son propos : « Medela consistit in duobus, in avocatione animi, a cogitanda molestia, id est in revocatione animi ad contemplandas voluptates6 ».
II.
(A) De vuyder et desmunir la memoire, est-ce pas le vray et propre chemin à l’ignorance ? (C) Iners malorum remedium ignorantia est. (A) Nous voyons plusieurs pareils preceptes par lesquels on nous permet d’emprunter du vulgaire des apparences frivoles où la raison vive et forte ne peut assez, pourveu qu’elles nous servent de contentement et de consolation. Où ils ne peuvent guerir la playe, ils sont contents de l’endormir et pallier7.
Attaquant la mémoire, Montaigne attaque par là-même la philosophie, et la science en général, puisque la mémoire constitue le réceptacle de tout savoir (II, 17, 651). En s’affirmant dépourvu de mémoire, Montaigne peut ainsi se dire dépourvu de science. Par conséquent, évacuer la mémoire signifie prendre le chemin de l’ignorance. Le sage Épicure est dans l’erreur, mais l’alternative philosophique implique de se jeter dans les bras de l’ignorance. Le but est le même : le contentement et la consolation. Si la science ne peut y parvenir, l’ignorance peut constituer une issue intéressante, acceptable. Notons que le plan du texte est autant épistémologique que moral. L’absence d’un art efficace de la mémoire montre que la science ne concerne qu’une toute petite partie de la réalité par rapport à tout ce que nous ignorons.
Cela veut-il dire que Montaigne est d’accord pour prendre le chemin de l’ignorance ? L’ajout de la couche C, la citation de Sénèque, « Iners malorum remedium ignorantia est » corrige cette impression. L’ignorance n’est pas assez forte pour constituer un remède à nos maux. N’oublions pas que, quelques pages plus loin (II, 12, 516), Montaigne affirmera que « les choses les plus ignorées sont plus propres à être déifiées ». Il ne s’agit pas donc uniquement d’une controverse épistémologique, qui se déroulerait entre la vérité et le scepticisme, le savoir et l’ignorance, 123mais plutôt d’une controverse morale. L’enjeu est de trouver le meilleur chemin pour améliorer la vie humaine. Face à cela, les préceptes de la philosophie sont tenus en échec, même quand elle renonce au projet de connaissance, de contrôle de nous-mêmes, et qu’elle recommande le chemin de l’ignorance. La philosophie reconnaît son impuissance, et ce passage confirme ce que Montaigne a affirmé dans la page immédiatement précédente : « C’est un très grand avantage pour l’honneur de l’ignorance que la science même nous rejette entre ses bras, quand elle se trouve empêchée à nous roidir contre la pesanteur des maux8 ».
Nous trouvons plusieurs sens du mot « ignorance » dans les Essais. Au sens philosophique du terme, Montaigne parle parfois de l’ignorance de qui ne sait pas et de qui méconnait l’ignorance même ; d’autres fois, il s’agit de l’ignorance de celui qui s’émerveille et qui, ce faisant, cesse d’être un ignorant ; d’autres fois encore, l’ignorance est le résultat d’une enquête, au terme de laquelle nous nous rendons compte que ce que nous savons est, soit erroné, soit provisoire. Telle est la docte ignorance, à laquelle nous arrivons par les chemins de la philosophie. Dans notre passage, Montaigne, ayant débuté par la mémoire, puis par l’ignorance, il en arrive à la raison « vive et forte ». L’opposition n’est plus entre mémoire (savoir) et oubli (ignorance), mais entre la raison des doctes et le savoir populaire. À nouveau, Montaigne remarque la faiblesse de la raison philosophique, qui ne peut pas parvenir à son but seule, et doit recourir aux arguments du vulgaire. Signalons que Montaigne n’affirme pas que la raison ne serve jamais, mais que le recours aux arguments du vulgaire se produit quand la raison n’y parvient pas (ce qui veut dire que parfois elle y arrive). Signalons aussi quel est le but de la philosophie dans notre texte : le contentement et la consolation. Le but est un but moral, et tous les chemins qui peuvent servir à y parvenir sont bons. Le critère est ici l’efficacité : tout ce qui sert à nous contenter et à nous consoler est bon. Croire qu’il y aurait un seul chemin pour y parvenir, celui de la raison, est erroné.
Mais le chemin opposé, l’ignorance absolue, ne semble pas non plus efficace. Or si certains remèdes peuvent être trouvés en s’inspirant du mode de vie des paysans, simple et naïf, suivons-les. Mais cela aussi, pour Montaigne, constitue un détour, une renonciation à essayer de guérir les blessures de la vie ; tout au mieux peut-on essayer de les soigner. 124Autrement dit, a) la philosophie ne peut pas aller contre notre nature, ni contre la nature en général ; b) la philosophie finit par reconnaitre qu’elle doit accommoder ses préceptes aux faits antérieurs ; c) mais une fois cela fait (et cette conclusion n’est pas explicite dans le texte), la philosophie qui adopte des préceptes susceptibles de nous contenter, même s’ils ne résultent pas de la « pure » et « forte » raison, est une philosophie sans doute utile. L’ignorance issue de la philosophie, donc, a un sens dans la mesure où elle se révèle efficace pour bien mener notre vie.
III.
(A) Je croy qu’ils ne me nieront pas cecy que, s’ils pouvoient adjouster de l’ordre et de la constance en un estat de vie qui se maintint en plaisir et en tranquillité par quelque foiblesse et maladie de jugement, qu’ils ne l’acceptassent :
potare et spargere flores
Incipiam, patiarque vel inconsultus haberi.
Il se trouveroit plusieurs philosophes de l’advis de Lycas : cettuy-cy ayant au demeurant ses meurs bien reglées, vivant doucement et paisiblement en sa famille, ne manquant à nul office de son devoir envers les siens et estrangiers, se conservant tres-bien des choses nuisibles, s’estoit, par quelque alteration de sens, imprimé en la fantasie une resverie : c’est qu’il pensoit estre perpetuellement aux theatres à y voir des passetemps, des spectacles et des plus belles comedies du monde. Guery qu’il fust par les medecins de cette humeur peccante, à peine qu’il ne les mit en proces pour le restablir en la douceur de ces imaginations,
pol’me occidistis, amici,
Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas,
Et demptus per vim mentis gratissimus error ;
d’une pareille resverie à celle de Thrasilaus, fils de Pythodorus, qui se faisoit à croire que tous les navires qui relaschoient du port de Pyrée et y abordoient, ne travailloient que pour son service : se resjouyssant de la bonne fortune de leur navigation, les recueillant avec joye. Son frere Crito l’ayant faict remettre en son meilleur sens, il regrettoit cette sorte de condition en laquelle il avoit vescu plein de liesse et deschargé de tout desplaisir9.
« Ils », dans ce passage, désigne les philosophes. Ceux-ci sont déjà contraints de recourir aux remèdes des paysans. Montaigne y ajoute 125une hypothèse sur la constitution de l’homme : si, par un défaut de jugement, un individu se maintient dans un état de plaisir et de tranquillité, et que par-là s’accomplit le but de la philosophie (établir une vie plaisante et ordonnée), les philosophes seraient peu sages de ne pas l’adopter. Les exemples que Montaigne donne à la suite se trouvent chez Érasme (Adages, « Fortunata Stulticia »), même si celui-ci ne mentionne ni Lycas ni Horace. Les deux exemples, celui de Lycas et de Thrasilaus, suivent le même schéma : dans les deux cas il s’agit d’une « folie » de l’imagination qui a des conséquences positives, car elle occasionne du plaisir. Lycas est guéri par les médecins ; Thrasilaus, par son frère. Mais dans le second cas, même si Montaigne ne le mentionne pas, son frère le met entre les mains d’un médecin, qui le guérit. Cette histoire apparait à la fin du livre XII des Deipnosophistes et aussi dans les Histoires variées d’Elien IV, 25.
Voici le texte d’Athénée :
L’histoire qui suit est fort intéressante, car elle évoque une lubie dont la cause directe est une vie de plaisirs. C’est Héracléidès du Pont qui nous la rapporte dans son traité Sur le Plaisir :
« Thrasyllos, le fils de Pythodoros, du dème d’Ǣxonê, était victime d’une étrange lubie, conséquence de la vie dépravée qu’il menait : il s’imaginait que tous les vaisseaux du monde qui entraient au Pirée lui appartenaient : de ce fait, il les enregistrait dans ses comptes, les expédiait, et traitait de toutes les affaires les concernant ; à leur retour au bercail, il les accueillait à bras ouverts, avec une joie si sincère qu’on eût cru qu’il en était le véritable propriétaire. Les bateaux qui avaient péri en mer ne l’intéressaient guère ; par contre ceux qui revenaient à bon port, le rendaient visiblement heureux. Son frère Criton, revenu à Athènes, après un séjour en Sicile, le prit en main et le confia à un médecin, qui parvint à la guérir de sa folie. Plus tard, Thrasillos raconta son étrange expérience, et avoua qu’il n’avait jamais ressenti une telle béatitude que lorsqu’il était dans sa folie ; il n’éprouvait alors aucune souffrance, bref il était dans une extase perpétuelle10 ».
Et voici le texte d’Élien :
Thrasyllus d’Aexone eut un genre de folie singulière et sans exemple. Il avait quitté la ville et s’était établi dans le Pirée : là, il se figura que tos les vaisseaux qui y abordaient, étaient à lui ; il en tenait un registre exact, leur ordonnait de repartir pour de nouveaux voyages ; et quand, après une heureuse navigation, ils rentraient dans le port, il en témoignait sa joie par les démonstrations les plus vives. Cette frénésie dura plusieurs années, jusqu’à 126ce que son frère, revenant de Sicile, le mit entre les mains d’un médecin qui l’en guérit. Depuis ce temps, Thrasyllus se rappelait souvent les années qu’il avait passées dans la démence, et avouait que le plus grand plaisir qu’il eût dans le cours de sa vie, avait été de voir arrivé en bon état ces vaisseaux qui ne lui appartenaient point11.
Par rapport à la première source, Montaigne opère un changement significatif. Il ne mentionne pas le commentaire préalable à l’histoire rapporté par Athénée, selon lequel la folie serait due à une vie dédiée aux plaisirs. Ce commentaire n’est pas présent non plus chez Élien, ce qui peut vouloir dire que c’est la source utilisée par Montaigne. Mais il est aussi possible que Montaigne ne veuille pas d’histoire moralisatrice, qui induirait le besoin de guérir Thrasilllos. Au contraire, il s’agit de montrer que le dérèglement imaginatif de Thrasilllos peut conduire à plus de bonheur que s’il possédait plus de raison.
Un deuxième changement, déjà mentionné, affecte ces deux sources : Montaigne écrit que c’est son frère qui le guérit ; or, chez Athénée de Naucratis et chez Élien, Criton le confie à un médecin. Deux hypothèses sont possibles : a) la suppression est involontaire, donc les deux exemples, celui de Lycas et celui de Thrasillos, sont identiques, et ce sont les médecins qui s’occupent de « normaliser » les dérèglements de l’imagination ; b) la suppression est intentionnelle et sert à faire remarquer le lien entre la médecine et la société, toutes deux organisées selon ce qui est normal et acceptable. Si quelqu’un voit ce que personne d’autre ne voit, alors le problème n’est pas seulement médical, mais social.
Dans les deux exemples, en tout cas, il s’agit de « guérir » quelqu’un qui sort de la normalité, scientifique ou sociale. Mais dans les deux cas, la déviation, produite par l’imagination, a des effets bénéfiques sur le sujet. Les deux sujets, une fois « guéris », se plaignent de leur nouvelle situation et désirent retourner à l’état de « folie ». Une fois de plus, l’objectif est le contentement et la tranquillité de l’âme. Si parfois la nature ne nous permet pas d’y arriver, car il nous manque la vigueur et la force du corps, inversement, c’est cette même nature qui peut parfois nous procurer, grâce à une sorte de dérèglement de l’âme, ce contentement désiré. Ce qui ne change pas, c’est le but de chercher une forme de vie allègre et tranquille, qui constitue le but de la philosophie. 127C’est pour cette raison que les philosophes (pas tous, mais « plusieurs », dit le texte) sacrifieraient la raison pour y arriver.
IV.
(A) C’est ce que dit ce vers ancien Grec, qu’il y a beaucoup de commodité à n’estre pas si advisé,
En taoi phronein gar maeden haedistos bios,
et l’Ecclesiaste : En beaucoup de sagesse, beaucoup de desplaisir ; et, qui acquiert science, s’aquiert du travail et tourment. Cela mesme à quoy en general la philosophie consent, cette derniere recepte qu’elle ordonne à toute sorte de necessitez, qui est de mettre fin à la vie que nous ne pouvons supporter : (C) Placet ? pare. Non placet ? quacunque vis, exi ; Pungit dolor ? Vel fodiat sane. Si nudus es, da jugulum ; sin tectus armis Vulcaniis, id est fortitudine, resiste ; et ce mot des Grecs convives qu’ils y appliquent : Aut bibat, aut abeat, (qui sonne plus sortablement en la langue d’un Gascon qui change volontiers en V le B, qu’en celle de Cicero) ;
(A) Vivere si rectè nescis, decede peritis ;
Lusisti satis, edisti satis atque bibisti ;
Tempus abire tibi est, ne potum largius aequo
Rideat et pulset lasciva decentius aetas ;
qu’est-ce autre chose qu’une confession de son impuissance et un renvoy non seulement à l’ignorance, pour y estre à couvert, mais à la stupidité mesme, au non sentir et au non estre ?
Democritum postquam matura vetustas
Admonuit memorem motus languescere mentis,
Sponte sua leto caput obvius obtulit ipse12.
Même si toutes les voies peuvent servir, aucune ne sert complètement. Montaigne établit cependant une hiérarchie : la science est celle qui sert le moins. Premièrement, Montaigne traduit le vers grec emprunté à Sophocle13 : la vie la plus agréable consiste à ne rien penser, ce qui nous fait penser à l’ataraxie des Pyrrhoniens. Mais par la suite Montaigne 128revient à l’Ecclésiaste : plus de science apporte plus de peines. Les médecins, qui agissent à la demande des proches, font plus de mal que de bien, quand ils s’occupent de « guérir » des déviations qui ne font aucun mal, si ce n’est qu’elles sont étranges, au-delà de la normalité. La phrase antérieure au passage cité par Montaigne (en I, 17) dit : « j’ai donné mon esprit à connaitre la sagesse et à comprendre la folie et les délires ». Qu’est-ce que la folie : le dérèglement de l’ordre et du savoir scientifique ou bien la science elle-même ? L’Ecclésiaste, un des livres les plus philosophiques de la Bible, représente le contrepoids de la médecine, de la philosophie et de la science en général : l’homme est vanité et le reconnaitre est une condition pour une vie heureuse. Ce-faisant, Montaigne, qui probablement emprunte à Érasme le passage de l’Ecclésiaste (1, 18), se place commodément dans l’orthodoxie catholique, et montre l’accord entre une position sceptique par rapport à la science et les Écritures.
Notre passage se termine avec une nouvelle critique à la philosophie. Si la vie est si peu plaisante que nous ne la pouvons plus supporter, alors la philosophie recommande de la supprimer. Deux citations de Sénèque et Cicéron illustrent cette « recette » philosophique : il faut suivre ce qui nous plait et fuir de ce qui nous déplait. Et si nous ne pouvons pas résister à la douleur, nous devons en finir. L’idée de l’épître 70 de Sénèque est que le sage doit vivre tant qu’il doit le faire, et non tant qu’il peut, car l’important n’est pas vivre, mais de vivre avec rectitude. Cicéron est dans la même ligne stoïcienne : la forteresse du sage lui permet de résister à la douleur, mais si elle fait finalement défaut, il faut abandonner le combat (comme le fait le gladiateur), car la vie ne vaudra pas la peine d’être vécue14. L’autre citation de Cicéron est extraite de la fin des Tusculanes (V, 41). La loi des banquets grecs (« soit tu bois soit tu t’en vas ! ») est comparée par Cicéron au comportement face à la fortune : si tu ne peux pas les supporter, tu dois fuir. La citation d’Horace suppose un léger déplacement : il ne s’agit plus de supporter la douleur, mais de savoir vivre (bien). Et savoir vivre, dans l’exemple d’Horace, implique de savoir bien boire, manger et folâtrer. C’est cela, agir en homme. Quand nous ne pouvons pas remplir correctement cette tâche, il faut partir. La question, pour Montaigne, n’est pas de savoir si cette recette est bonne ou non (au plan moral), mais de savoir reconnaitre 129un échec sur le plan théorique (épistémologique) autant que pratique, comme le montre l’exemple de Démocrite, dans la dernière citation empruntée à Lucrèce. L’impuissance de l’homme à faire face à sa vie à travers la science culmine dans ce recours à l’anéantissement. La fin de notre texte fait alors écho au début : nous avions commencé avec un langage martial, la philosophie était censée de fournir des armes pour lutter contre la fortune, mais nous finissons avec une capitulation, la reconnaissance d’une défaite.
V. Quelles conclusions pouvons-nous donc tirer de ce bref commentaire ? J’en signale quatre, qui peuvent être développées à partir d’autres passages de l’Apologie :
1) La faiblesse de la philosophie n’est pas mise en évidence par des arguments subtils, élaborés par Montaigne, mais à partir des propres arguments de la philosophie, qui se réfutent eux-mêmes. Pour disqualifier la philosophie dans ses prétentions épistémologiques, il suffit d’examiner ses recettes et de montrer qu’elles constituent en réalité un aveu d’échec.
2) L’ignorance de la science est-elle docte au sens où elle émerge à la fin de l’enquête ? Oui, au sens où elle est meilleure que la simple ignorance. De quoi dépend-elle ? De son utilité. Pour quoi ? Pour ce qui intéresse l’être humain.
3) Tout le passage repose sur la supposition que la science – la philosophie – cherche à permettre à l’homme de triompher de l’adversité de la fortune et de mener une vie heureuse. L’idée de la philosophie comme manière de vivre, et non pas seulement comme production de vérités sur le monde, est maintenue. Le constat de Montaigne ne porte pas sur l’inutilité de la philosophie comme mode de vie, mais dans la reconnaissance de son incapacité à vaincre la fortune au moyen de la connaissance. Par conséquent, la conclusion implicite est qu’elle peut être utile si elle renonce à cette vanité qu’elle-même reconnait.
4) Notre texte se déroule en trois couples d’oppositions, qui se suivent et se relient l’une à l’autre :
–Mémoire vs. Oubli
–Science vs. Ignorance
–Raison vs. Folie
130Le deuxième terme de l’opposition sert de contrepoids aux excès du premier. Mais ces mêmes termes peuvent, chacun dans son sens, être utiles pour faire du bien à l’homme. Finalement, le scepticisme se révèle comme un bon outil pour ne pas oublier à quoi doivent servir nos outils.
Joan Lluís Llinàs
Université des Iles Baléares
1 Alain Legros lui a consacré un article : « La vie et l’œuvre d’un médecin contemporain de Montaigne, Pierre Pichot ». Revue française d’histoire du livre, 1996, p. 361-374.
2 Toutes les citations des Essais sont tirées de l’édition Villey.
3 II,12, 494-495.
4 Voir sur le site Monloe une description de l’exemplaire appartenant à Montaigne faite par Alain Legros : https://montaigne.univ-tours.fr/pichot-pierre-animorum-natura-bordeaux-millanges-1574/ (consulté le 29/10/2020).
5 Pierre Pichot, De animorum natura, éd. citée, p. 48.
6 Ibid.
7 II,12, 495.
8 II, 12, 494.
9 II, 12, 495-496.
10 Athenée, XII.
11 Élien, Histoires variées, IV, 25.
12 II, 12, 496.
13 Ajax 552. Cette citation fait partie des sentences peintes sur le plafond de la librairie scruté par Alain Legros (Essais sur poutres. Peintures et inscriptions chez Montaigne, Paris, Klincksieck, 2000, rééd. 2003 et sur le site de la SIAAM : https://siaam.hypotheses.org/576 ; consulté le 29/11/2020).
14 Tusculanes II, 14.