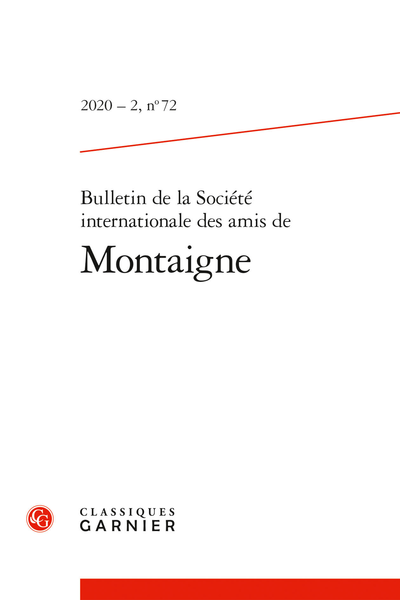
Montaigne ou les contradictions de l’éthique bourgeoise
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Desan (Philippe)
- Résumé : Il s’agit de montrer ici que l’éthique de Montaigne, alors qu’il revendique des valeurs aristocratiques, relève de l’éthique de la bourgeoisie montante de la fin du XVIe siècle.
- Pages : 165 à 180
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0165
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : sociologie, éthique, capitalisme, bourgeoisie, aristocratie
Montaigne ou les contradictions
de l’éthique bourgeoise
Bien avant que les études dites « matérielles » deviennent un champ de recherches à part entière dans les humanités, en 2000, Alain Legros publia un livre qui fit date et influença mes propres travaux. Son étude sur la « librairie » de Montaigne, sa tour et ses célèbres poutres, permit de contextualiser l’œuvre de papier de l’écrivain gascon. En 2010, ce premier travail connut un prolongement logique dans Montaigne manuscrit. Les nombreuses études d’Alain Legros sur la bibliothèque de Montaigne, c’est-à-dire ses propres ouvrages, les livres de sa bibliothèque et ceux de La Boétie, ses notes de lecture et annotations diverses (en français, en latin et en grec), sans oublier les poutres de son cabinet de travail et les fresques qui décoraient diverses pièces de sa tour, ont permis de dresser un portrait de l’essayiste au travail. Cette approche qui s’intéresse à la pratique des livres permit de redécouvrir un Montaigne existentiel. Depuis presque un quart de siècle, je continue de suivre avec enthousiasme les publications d’Alain Legros qui apportent toutes, à chaque fois, du nouveau. Au fil des ans, les Montaigne Studies ont accueilli une douzaine d’articles (presque tous avec des reproductions de documents à l’appui d’une argumentation toujours précise et convaincante) d’Alain Legros, la plupart du temps dans la partie « varia » de la revue dédiée à ce que l’on pourrait appeler les « trouvailles » (dans le sens positif et matériel du terme) sur Montaigne.
Loin de nous sont les années 1960 et 1970, c’est-à-dire le règne de la nouvelle critique et de la théorie pour le plaisir de la théorie. Les études montaignistes avaient bien besoin de revenir à la réalité matérielle d’un Montaigne plus « existentiel » et un peu moins « essentiel ». C’est à ce tournant décisif du début des années 1980 que l’œuvre d’Alain Legros – à la suite des recherches matérielles fondatrices de Michel Simonin, Jean Balsamo, John O’Brien et George Hoffmann – a permis un virage 166empirique qui apporta de nouveaux éléments matériels nécessaires non seulement à l’interprétation des Essais, mais aussi à la compréhension de son environnement immédiat, c’est-à-dire ses livres, sa bibliothèque, sa tour, son château, et le milieu bordelais dans lequel il évolua. C’est dans cette même voie d’un « Montaigne contextualisé » que j’aimerais reprendre ici à frais nouveaux, et en hommage à Alain Legros, quelques réflexions plus anciennes sur ce que j’appelle les contradictions de l’éthique bourgeoise dans l’œuvre et la vie de Montaigne.
Dans sa célèbre étude sur L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber définit l’action économique capitaliste comme « l’espoir d’un profit par l’exploitation des possibilités d’échange, c’est-à-dire sur des chances (formellement) pacifiques de profit1 ». C’est en effet la notion d’échange qui est fondamentale dans l’esprit du capitalisme ; pourtant, ce principe doit à mon avis être pris dans une acception plus large du terme et inclure une composante sociale. Car le capitalisme marchand tel qu’il se met en place à la Renaissance est accompagné d’une sociabilité complexe – fondée sur l’échange culturel, politique et économique – qui produit une éthique nouvelle que l’on peut qualifier de « bourgeoise ». Avec le temps, cette éthique bourgeoise s’est transformée en idéologie dominante et s’est imposée comme un fait accompli qui, par nature (c’est du moins le mythe que cette idéologie véhicule), se présente à nous comme anhistorique et universelle. Loin d’être homogène, cette idéologie s’adapte à la réalité du terrain et s’exprime souvent dans ses propres contradictions. Ce sont précisément les contradictions de l’éthique bourgeoise que j’aimerais ici aborder à partir de l’exemple de Montaigne.
Le développement du capitalisme marchand durant la Renaissance permit à une nouvelle mentalité de faire son apparition et de s’imposer en moins de deux siècles. Cette mentalité, comme le remarque Max Weber, privilégie la multiplication des interactions humaines, car c’est bien sur le plan quantitatif des échanges et des rapports sociaux que le capitalisme s’imposa historiquement. La pensée dogmatique et qualitative fut lentement remplacée par une pensée sceptique, comparative et quantitative. Ces interactions répétées (on peut aussi les appeler « expériences ») n’ont pourtant pas pour finalité l’élargissement du champ social, mais bien l’accroissement des échanges économiques. Au 167xvie siècle, les échanges sociaux se mettent au service d’une finalité qui, elle, est d’ordre commercial. On peut dire que le social se met alors au service de l’économique pour permettre une multiplication toujours plus grande des échanges potentiels. On constate de plus qu’il n’y a pas de capitalisme possible sans une redéfinition des rapports sociaux qui s’inscrivent à leur tour dans une logique économique fondée sur les notions d’utilité et de profit. Au xvie siècle, le social et le politique sont lentement réinterprétés par la pratique économique dominante imposée par une nouvelle classe marchande s’enrichissant grâce au commerce à grande échelle.
L’éthique protestante, telle qu’elle est définie par Max Weber, s’identifie à une nouvelle éthique bourgeoise et marchande. Il serait pourtant erroné de limiter l’apparition d’une éthique marchande aux seules sociétés où s’imposa l’Église réformée, comme le fait Weber. En effet, l’apparition du capitalisme marchand fut loin d’être un phénomène circonscrit à quelques pays qui embrassèrent les thèses de Luther et de Calvin – même s’il est vrai que son essor fut plus rapide dans les pays européens où la cause réformée se propagea rapidement. En 1916, Werner Sombart a proposé, dans Les Origines du capitalisme moderne, l’idée d’un éthos spécifique au capitalisme qui, contrairement à la thèse de Weber, n’a pas pour cause principale l’acceptation d’une nouvelle idéologie religieuse (le protestantisme). C’est cet éthos bourgeois étudié par Sombart qui, à mon avis, marque profondément le contexte de la rédaction des Essais.
Je ne reviendrai pas sur les thèses qui appréhendent le capitalisme soit comme une cause, soit comme un effet, de l’essor d’un nouveau dogme chrétien plus permissif envers des pratiques économiques traditionnellement condamnées par l’Église romaine. Peu importe de savoir si le mode d’organisation capitaliste est le résultat d’un changement idéologique profond – thèse de Max Weber –, ou encore si, comme le soutient Sombart (et Marx, bien entendu), l’éthique protestante ne fait que refléter le mode de production capitaliste naissant. Ce type de débat reviendrait à s’interroger sur la précellence de l’œuf ou de la poule. Il est préférable de considérer les notions de superstructure et d’infrastructure – pour reprendre les termes de la critique marxiste – comme complémentaires sans nous préoccuper d’un quelconque déterminisme causal. Malgré leurs divergences d’interprétation, les deux sociologues (Weber et Sombart) s’accordent à voir dans la Renaissance 168la période clé d’une nouvelle éthique marchande. Cette constatation a fait l’objet de nombreuses études2. Le discours économique envahit littéralement la pensée – politique, religieuse, philosophique – de l’époque et influence largement la production littéraire et philosophique3.
L’éthique marchande se retrouve ainsi en filigrane dans beaucoup de textes du xvie siècle. Montaigne n’échappe pas à cette influence et subit les pressions idéologiques exercées par cette nouvelle éthique bourgeoise, même s’il la critique à maintes reprises. L’éthique marchande, telle qu’elle se manifeste vers la fin du xvie siècle, n’est certes pas totalement établie comme idéologie dominante dans les esprits ; elle est encore en compétition avec l’éthique cicéronienne toujours représentée et défendue dans la haute culture par le biais d’une intelligentsia qui a tendance à se mettre du côté des Anciens et à poursuivre le chemin qu’ils avaient tracé. Les intellectuels de la Renaissance se sont presque tous rangés du côté des « Anciens ». Les « Modernes » quant à eux sont les bourgeois et riches marchands qui ne se posent pas de questions sur leur histoire et sont indifférents à la coutume. Leur pensée se veut utile et universelle, car elle se donne le monde comme limite ; elle est également atemporelle, car ils ne s’embarrassent guère des modèles antiques. Le quotidien détermine leur modus operandi. Montaigne est à la fois un Ancien et un Moderne. On pourrait même dire que les Essais expriment une « querelle » entre ces deux aspects contradictoires de sa pensée. Paradoxes et contradictions définissent pour cette raison le genre de l’essai.
L’éthique bourgeoise représente bien plus qu’une simple morale, c’est un mode de vie, une façon d’être et de voir le monde, un sens devenu « commun » puisqu’il se situe en dehors de l’histoire et se réclame universel. Cette éthique nouvelle se veut également pragmatique, pacifique, non discriminatoire, informée par les pratiques locales et adaptée au temps et à l’espace qui la régit. Elle a pour principe vital la multiplication des interactions humaines, sans arrière-pensée politique ou religieuse. Plus le « marché social » s’agrandit, plus les échanges économiques 169peuvent se multiplier. Nous sommes bien dans une logique quantitative du social et de l’économique, tout comme les Essais (en tant que livre dans sa matérialité) est un objet qui croît en fonction d’échanges et d’expériences répétées, tant qu’il y aura de l’encre et du papier au monde. Les échanges (ou commerces) sont le principe même de cet accroissement sans fin du livre consubstantiel à son auteur (du moins jusqu’à sa mort). Montaigne considère également son œuvre comme un espace de liberté, un lieu d’affranchissement envers les contraintes sociales, politiques et culturelles de son temps. On a ainsi vu en lui – à mon avis de façon problématique – le précurseur du libéralisme qui affranchit l’homme des doctrines et des idéologies.
Il est vrai que la nouvelle éthique bourgeoise qui s’affirme à la Renaissance défend aussi la liberté individuelle, y compris la liberté de penser différemment. Le droit à la « différence » fait même partie intégrante de l’éthique bourgeoise qui a appris à reconnaître et accepter la diversité des peuples afin de mieux pouvoir commercer avec eux. Sa logique quantitative visant à maximaliser les échanges (économiques et sociaux) la rend implicitement plus permissive ; elle privilégie l’acceptation des différences et rejette les dogmes et les extrêmes. La capacité à accepter la différence des autres et à multiplier les échanges est bien entendu intéressée, car l’idée d’un profit détermine utilement cette ouverture vers l’altérité et la diversité. Mais là n’est pas le problème, car une critique fondée sur l’efficacité et la fonctionnalité de cette éthique ne serait guère productive. On peut très bien s’accommoder d’une idéologie sans pour autant comprendre le profit qu’elle apporte à certains. Pour faire des affaires, il est nécessaire d’avoir l’esprit ouvert. Une fois que l’on a fait ce geste d’ouverture, on n’est évidemment pas obligé de faire des affaires, pourrait-on dire. C’est un peu la position de Montaigne. Un bénéfice sans profit, en quelque sorte. On voit logiquement poindre à l’horizon l’esprit du libéralisme moderne, mais je n’aborderai pas ici ce chemin sinueux du « libéralisme » de Montaigne, préférant m’intéresser aux contradictions montaigniennes de l’éthique bourgeoise (elle-même fondée sur un principe de contradictions).
Sans faire de Montaigne le porte-parole de la nouvelle « classe montante » que représente la bourgeoisie au xvie siècle à Bordeaux, il est cependant symptomatique que l’auteur des Essais publie en 1580 un livre d’un genre nouveau où la plupart de ces qualités d’ouverture et d’échange 170(le terme choisi par Montaigne est « commerce ») sont réunies. Parce qu’il se considère lui-même comme un homme « moyen » (et possédant un sens commun), tout étant en contact direct avec le milieu marchand local lors de ses deux mandats (1581-1585) à la mairie de Bordeaux, Montaigne s’offre comme personnage idéal pour vérifier l’apparition de cette éthique bourgeoise à la fin du xvie siècle. Les bourgeois de la ville de Bordeaux – membres de la jurade au même titre que les nobles et les robins – ne se trompèrent d’ailleurs pas d’allié en soutenant la réélection de Montaigne à la mairie en 1583, alors que l’auteur des Essais avait une partie importante de la noblesse contre lui4. Certes, on ne fait pas toujours les alliances que l’on souhaite, mais cette association contre nature entre un représentant de la petite noblesse et les riches familles marchandes bordelaises a de quoi surprendre. J’ai argué ailleurs (dans ma biographie de Montaigne) qu’en fait la modernité de Montaigne était peut-être plus tournée vers les pratiques bourgeoises que vers les idéaux nobiliaires, des idéaux certes défendus – par principe – par notre essayiste, mais souvent sans grande conviction.
Bien qu’ouvertement du côté de la noblesse par ses affinités politiques et ses prétentions nobiliaires, Montaigne affiche néanmoins une mentalité complexe et contradictoire qui, d’un côté, soutient les valeurs de la noblesse (culture chevaleresque, honneur, loyauté, constance, gloire, magnanimité5) au niveau politique, mais, de l’autre côté, les met souvent en cause au niveau idéologique et n’hésite pas à douter de leur pertinence à la fin du xvie siècle. Bien entendu, Montaigne défend la stricte hiérarchie entre les trois ordres, mais il plaide aussi pour le droit à la différence culturelle et se livre à une attaque en règle contre toute forme d’autorité. Le texte des Essais n’est pas sans équivoques et il est clair que Montaigne a poussé très loin les contradictions – peut-être malgré lui. On a même parlé d’un « Montaigne paradoxal6 » pour expliquer les nombreuses antinomies présentes dans les Essais, faisant 171même du paradoxe une des composantes essentielles de la forme de l’essai. Ce n’est pourtant pas Montaigne mais bien l’époque durant laquelle il écrit qui est paradoxale. C’est pourquoi il faut sur ce point placer Montaigne dans son époque et contextualiser son œuvre. Ainsi, l’ambiguïté idéologique des Essais semble dériver d’une opposition fondamentale entre deux systèmes de valeurs qui sont antinomiques et s’opposent ouvertement de son temps.
À l’origine de beaucoup de ces contradictions, on peut déceler une ambiguïté économique chez Montaigne. Cette ambiguïté résulte d’une double perception des phénomènes économiques dans les Essais : l’« économique » est nié dans son contenu, mais présent par sa forme, une forme qui définit également le genre de l’essai. De façon inconsciente, Montaigne pose dans toute son ambivalence le problème de l’économique comme valeur dominante qui modifie les rapports sociaux par le biais du langage quotidien. Car c’est bien dans le langage – la somme des performances verbales individuelles – que se révèle la nouvelle éthique marchande. Ce langage « nouveau » est facilement repérable dans les Essais. Les rapports humains sont désormais perçus et décrits d’après un modèle économique où l’échange, le profit, l’emprunt et les pertes redéfinissent le social.
Au niveau conscient, Montaigne affirme à plusieurs reprises qu’il abhorre le commerce et tout ce qui se rapporte à la « mercadence » et la « trafique », des termes péjoratifs dans les Essais. Le marchand est pour cette raison presque toujours associé à la classe vulgaire : « comme Sire, c’est un tiltre qui se donne à la plus eslevée personne de nostre estat, qui est le Roy, et se donne aussi au vulgaire, comme aux marchans » (I, 54, 311)7 écrit Montaigne. Ce dernier exprime souvent son dégoût pour le marchandage : « Il n’est rien que je haisse comme à marchander » (I, 14, 63). Toute activité marchande le met mal à l’aise : « J’excepte les payements où il faut venir à marchander et conter, car si je ne trouve à qui en commettre la charge, je les esloingne honteusement et injurieusement tant que je puis » (ibid.). Montaigne affirme ne pas s’intéresser à l’économie domestique. C’est du moins ce qu’il aimerait nous faire croire. Il existe bien entendu un décalage entre les déclarations de l’auteur et la réalité. J’ai sur ce point souvent affirmé qu’il fallait se méfier des 172déclarations tonitruantes présentes dans les Essais et aller vérifier celles-ci dans les pratiques sociales et politiques de leur auteur.
Prenons par exemple le cas du « marchandage » qui est pour Montaigne « un pur commerce de trichoterie et d’impudence » (ibid.), une activité où l’on abandonne sa parole pour peu de gain ; et là où la parole ne compte guère, Montaigne ne peut que refuser l’échange. Il n’accepte d’ailleurs pas la contestation : « J’ay rompu plusieurs marchez qui m’estoyent utiles, par l’impertinence de la contestation de ceux avec qui je marchandois » (III, 8, 928). À ses yeux, le marchandage représente une nouvelle forme de sociabilité pernicieuse. Notre auteur n’est donc jamais prêt à jouer le jeu de l’échange. Les négociations matérielles ne sont pas pour lui, et il ne supporte pas les débats et discussions qui interviennent entre vendeurs et acheteurs. Il dit par exemple être incapable d’adopter le pragmatisme du commerçant, cette profession qui dévalue la parole donnée et transforme les mots en contrats. Toutes ces déclarations sont pourtant en contradiction flagrante avec son passage au parlement de Bordeaux et son rôle d’intermédiaire politique et de négociateur entre Henri III et Henri de Navarre. On pourrait même dire que Montaigne est fier d’avoir pu « marchander » entre les deux rois. Le moins que l’on puisse dire est que la théorie et la pratique du marchandage sont contradictoires.
Prenons un autre exemple. Dans le chapitre « Des récompenses d’honneur », Montaigne exalte les récompenses gratuites décernées par le prince. À plusieurs reprises, l’auteur des Essais se révolte contre la vente des titres de noblesse et laisse éclater son indignation contre ceux qui monnaient l’honneur. Comme on le sait, gloire et honneur forment les deux valeurs les plus désirables pour Montaigne. Cependant, bien que les titres soient censés échapper au commerce, ils sont malgré tout dépendant d’« échanges politiques » et subissent les mêmes lois que toute autre marchandise à la Renaissance. La vente des offices publics à cette époque a pour effet de redéfinir la notion même de « récompense d’honneur ». L’honneur a ainsi intégré le modèle économique qui règle non seulement les activités humaines, mais aussi les idées, les sentiments et les principes moraux. Tout s’achète et tout se monnaie.
Parce qu’ils symbolisent la meilleure marque de distinction sociale, les titres de noblesse représentent les valeurs suprêmes de l’idéal nobiliaire auquel aspire Montaigne. S’il prend la défense des titres de noblesse, 173c’est pour mieux critiquer la façon dont ils sont attribués. Nouvelle contradiction. On peut en effet se poser des questions sur les titres nobiliaires obtenus par Montaigne à partir de 1573 – titres qu’il ne manque pas de faire apparaître sur les pages de titre de ses deux premières éditions des Essais (1580 et 1582). Si Montaigne n’a pas acheté ses titres, il est pourtant probable qu’il les obtint en contrepartie de services politiques rendus, ou du moins comme des « avances » pour défendre les intérêts de la famille de Foix dans sa région. Le champ de bataille (lieu où l’on obtient ces titres durant le Moyen Âge) est remplacé par un nouvel espace politique, la cour, elle-même fortement liée aux banquiers et aux riches représentants du nouveau pouvoir économique à cette époque.
Du temps de Montaigne tout s’échange pour une somme d’argent, même les charges publiques8. Dans « De la coustume de ne changer aisément une loy recüe », notre essayiste commente de quelle façon le commerce est passé maître dans tous les domaines :
Qu’est-il plus farouche que de voir une nation, où par legitime coustume la charge de juger se vende, et les jugements soyent payez à purs deniers contans, et où legitimement la justice soit refusée à qui n’a dequoy la payer, et aye cette marchandise si grand credit, qu’il se face en une police un quatriesme estat, de gens maniants les procés, pour le joindre aux trois anciens, de l’Eglise, de la Noblesse et du Peuple ; lequel estat, ayant la charge des loix et souveraine authorité des biens et des vies, face au corps à part de celuy de la noblesse : d’où il avienne qu’il y ayt doubles loix, celles de l’honneur, et celles de la justice. (I, 23, 117-118)
Le « quatriesme estat » auquel Montaigne fait allusion renvoie à la nouvelle classe des robins qu’il a lui-même rejetée, mais qui constitue une force politique impossible d’ignorer – la jurade de Bordeaux durant la mairie de Montaigne offre un exemple concret de ce pouvoir nouveau. Le pouvoir de l’argent s’impose sur les modèles traditionnels de l’autorité sociale. L’opposition honneur/justice présage une séparation définitive entre deux éthiques. L’appareil législatif représenté par les parlements se transforme en justice de classe influencée par l’argent : on achète un jugement comme on achète un tonneau de vin. Le nouvel ordre économique, visible jusque dans 174la façon dont les procès se déroulent, est en train de redéfinir la hiérarchie sociale. C’est en ce sens que la confrontation de deux systèmes de valeurs incompatibles provoque une série de paradoxes et de contradictions qui dénotent l’ambiguïté idéologique du discours montaignien et l’apparition d’une éthique fondée sur le nouvel ordre économique.
Devant la montée de cette éthique marchande qui influence désormais la justice, la noblesse tenta bien de créer quelques garde-fous. Ainsi, à l’époque de Montaigne, la dérogeance avait pour fonction de séparer ces deux éthiques (marchande et noble) qui se côtoyaient. Travail et oisiveté symbolisent les deux pôles de la vie morale ; ces deux activités (l’oisiveté peut être considérée comme une « activité noble ») sont alors mises en opposition pour louer ou condamner tantôt la noblesse, tantôt la bourgeoisie. Au xvie siècle, la dérogeance signale non seulement une activité commerçante, mais aussi une mentalité marchande. Penser en bourgeois, du moins pour Montaigne, c’est aussi déroger. Cette accusation, si elle est prouvée, suffit à faire perdre son titre de noblesse. Ainsi, une des grandes questions débattues à l’époque consiste précisément à savoir si un noble peut commercer sans déroger. Il n’existe sur ce sujet aucune loi précise. Il est par exemple permis aux nobles de vendre le produit de leurs vignobles en gros, mais formellement interdit d’ouvrir des tavernes ou des débits de boissons. Comme le note une ordonnance royale de l’époque, les nobles « ne vendront ou pourront vendre de vin ne autres breuvages en détail, soit de leur creu ou autrement ». Cette pratique pourtant assez courante est considérée un « vil mestier », car dans ce cas le noble s’abaisse au niveau des marchands et risque ainsi de raisonner en bourgeois. C’est une affaire de moralité. On sait sur ce point précis de la vente du vin que Montaigne fut dénoncé par la noblesse pour avoir entreposé du vin provenant de ses terres à l’intérieur des murs de la ville de Bordeaux. Cette dérogeance aux strictes règles à la fois imposées par la bourgeoisie bordelaise (nul vin ne pouvait passer les portes de la ville s’il n’était pas un cru dit bourgeois) et par la noblesse (interdiction de débiter du vin pour un noble) mit Montaigne dans l’embarras (il fut réprimandé par le roi). Le maire fut à la fois condamné par la noblesse et par la bourgeoisie.
Sur la question du travail et de la noblesse, Montaigne embrasse les idées du juriste André Tiraqueau (1488-1558)9, longtemps conseiller 175au Parlement de Bordeaux. Pour Tiraqueau il n’y a aucune hésitation possible : toute activité commerciale est considérée vile (Genus esse sordidissimum)10 car elle encourage le mensonge et conduit au parjure : « Nobiles prohiberentur exercere mercimonia, cum passim, mentiantur, parjerent, furentur, important11 ». La position de Montaigne est identique quand il s’agit de définir la noblesse : c’est le mode de vie qui fait le gentilhomme, et ce mode de vie se situe résolument en dehors de tout commerce. La situation se complique pourtant quand il s’agit de considérer la fonction de juge ou de conseiller. Doit-on interpréter ces charges comme un véritable travail ? C’est en fait toute la noblesse de robe longue qui est placée au banc des accusés par cette question.
Selon un autre juriste de l’époque, Charles Loyseau, les nobles qui occupent la fonction de juge ou d’avocat ne dérogent pas, car leurs revenus ont une origine intellectuelle et non pas manuelle12. La noblesse de robe est ainsi à l’abri de la dérogeance. Par contre, selon Loyseau, si les avocats sont absous de tout soupçon, les procureurs et les notaires n’échappent pas à la dérogeance par le caractère bas de leur occupation. La même logique se retrouve chez Tiraqueau, quoiqu’exprimée différemment. À la lumière de ce débat juridique sur la dérogeance de noblesse à la Renaissance, on comprend mieux la situation difficile de Montaigne qui, il n’y a pas si longtemps, occupait une charge de conseiller au parlement de Bordeaux. On peut ainsi s’interroger sur l’abandon par Montaigne de sa carrière parlementaire. En effet, après la vente de sa charge de magistrat en juillet 1570, Montaigne se mit à vivre noblement sur ses terres ; un mode de vie en accord avec son nouveau rang de gentilhomme et ses titres récemment acquis. Il est clair que l’abandon de son emploi de conseiller doit être analysé en rapport avec le débat juridique autour du problème de la dérogeance et son souci constant de ne pas être associé à une activité marchande quelconque. Même si la charge d’avocat et de conseiller n’est pas une preuve légale de dérogeance, dans le doute il est toujours préférable de s’abstenir. On comprend aussi pourquoi Montaigne admet l’utilité des charges publiques uniquement si celles-ci sont gratuites et ne rapportent 176rien. C’est de cette façon qu’il rejoint le camp plus noble de l’honnête, mais, comme on le voit, ce choix affiché n’est pas sans contradictions.
L’honnête – en tant que valeur nobiliaire – ne semble plus correspondre à la réalité vérifiable chaque jour dans les actions politiques. L’idéologie bourgeoise se préoccupe d’ailleurs peu de l’honnêteté dans la mesure où celle-ci ne peut être définie que par rapport à la tradition. Les échanges se situent toujours dans le présent et sont fondés sur une utilité réciproque qui repousse à l’arrière-plan la notion d’honnêteté qui, sur le plan de son « utilité », est devenue obsolète. L’éthique marchande évacue l’histoire et la tradition qui n’apportent rien à la pratique des échanges économiques. La valeur d’échange ne peut pas avoir d’histoire, car elle est constamment redéfinie en fonction des forces en présence sur le marché à un moment précis. L’échange commercial n’existe que dans le présent. Il en va de même dans le domaine du politique durant la seconde moitié du xvie siècle. Cette redéfinition de la temporalité qui désormais met l’accent sur le présent et le quotidien a pour conséquence de privilégier une vision plus pragmatique des rapports sociaux.
À maintes reprises, Montaigne démontre comment le discours de l’utile renvoie au domaine public et est implicitement lié à un raisonnement de type marchand, c’est-à-dire sans règle morale fixe ; un discours adapté à des situations particulières, mais qui ne repose pas pour autant sur des positions arrêtées par avance. L’éthique du marchand, tout comme celle du politique en cette fin de la Renaissance, est toujours relative par rapport aux autres acteurs économiques. Montaigne rejette l’idée de commerce et d’échange, mais il ne peut s’empêcher d’exprimer ce refus par un langage qui est lui-même profondément utilitariste et échangiste : « Tout ce mien proceder est un peu bien dissonant à nos formes ; ce ne seroit pas pour produire grands effets ; ny pour y durer : l’innocence mesme ne sçauroit ny negotier entre nous sans dissimulation, ny marchander sans manterie » (III, 1, 795). Sur ce point, les contradictions inhérentes à l’opposition utile/honnête occupent une place essentielle dans le dernier « allongeail » des Essais13.
177Montaigne constate l’impossibilité de réconcilier d’un côté l’utile, c’est-à-dire le politique, la vie publique, et plus particulièrement toute activité économique – cela bien avant la théorisation de l’utilité et du mercantilisme par les économistes du xviie siècle (Sully, Montchrestien, Laffemas, Colbert) –, et, de l’autre côté, le concept d’honnêteté tel qu’il faut l’entendre à la fin de la Renaissance, c’est-à-dire un terme qui annonce déjà l’honnête homme, dilettante, oisif, et défenseur des valeurs et idéaux nobiliaires qui sont lentement en train de se dégrader. L’éthique marchande déprécie les valeurs nobiliaires en les qualifiant d’oisives et inutiles ; elle les présente comme nuisibles au progrès social qui passe inévitablement par le travail. Montaigne ne s’enferme pas pour autant dans une vision réactionnaire qui tendrait à rejeter tous les échanges économiques ; il reconnaît même le succès de la nouvelle éthique marchande. Grâce à Machiavel notamment, il comprend bien qu’à la Renaissance le politique fonctionne désormais à partir d’une vision du pouvoir où se confondent les lopins du lion et du renard. La realpolitik se développe en harmonie avec les nouvelles pratiques marchandes.
Un dernier point qui me semble important concerne l’exubérance de la parole, l’inflation et la corruption des discours (dont Montaigne se plaint à plusieurs reprises) à la fin de la Renaissance. Ces bouleversements du langage marquent également un tournant idéologique important qui est caractérisé par une véritable crise du discours. Les échanges économiques servent dorénavant de repère fondamental pour tout discours politique ou social. La langue de la Renaissance se met à son tour au service d’une idéologie dominante qui impose sa vision du monde ; une vision résolument utilitariste et échangiste qui forme la base d’une nouvelle éthique. Puisque la parole donnée est de moins en moins suivie, on assiste à une expansion discursive produite par une perte de confiance dans un langage stable et durable. C’est de cette façon que la dichotomie entre utilité et honneur met en scène deux idéologies contradictoires et irréconciliables. Montaigne condamne et vante tour à tour l’utilité et l’honnêteté, certes pour des raisons différentes, et finit par reléguer l’honnêteté dans la sphère de la vie privée, tandis qu’il préconise l’utilité dans le domaine public. La séparation, tardivement théorisée par Montaigne, entre vie privée et vie publique peut ainsi être perçue comme un moyen de fonctionner à partir de deux idéologies contradictoires : noblesse et bourgeoisie. Noble dans sa vie privée et 178empreint de l’idéologie bourgeoise dans sa vie publique, Montaigne apprend à vivre avec ses contradictions, des contradictions qui reflètent la réalité sociale de son époque. Ces systèmes de valeurs ne renvoient pas seulement à des modes de production distincts (féodalisme et capitalisme) au niveau de l’infrastructure économique de la société, mais ils sont également visibles au niveau des idées produites, consciemment ou inconsciemment, aussi bien par les acteurs sociaux des guerres de religion que par l’auteur des Essais. Ces idées constituent la somme des représentations dans lesquelles les hommes vivent leurs rapports à leur condition d’existence. Les croyances, la loi, l’éducation, la culture (y compris la production littéraire) et les modes de vie s’inscrivent forcément dans une idéologie qui façonne et détermine nos comportements.
Comme je l’ai avancé, l’infrastructure économique de la Renaissance connaît des bouleversements qui ne sont plus à démontrer. Le développement du commerce sur une grande échelle a libéré un monde précédemment enclavé et fermé sur lui-même. Les villes représentent désormais les nouveaux centres de pouvoir économique et politique, et le fief médiéval – en tant qu’unité de production économique – est en déclin constant tout au long des xve et xvie siècles. On commence à se poser la question de savoir si la noblesse est « utile14 ». Sur ce point, Montaigne se présente comme un cas d’école. Bien que gentilhomme campagnard – du moins après 1570 –, il occupa toute sa vie des fonctions administratives et politiques importantes à Bordeaux et en Guyenne : d’abord comme parlementaire dans les années 1560, ensuite comme maire et gouverneur de Bordeaux au début des années 1580, et finalement comme négociateur entre Henri de Navarre et le roi de France. De fait, l’activité politique de Montaigne ne peut être dissociée de sa carrière littéraire ou philosophique : dans un premier temps comme traducteur de Raymond Sebond (1569), ensuite comme éditeur des œuvres d’Étienne de La Boétie (1570) et finalement comme auteur des Essais (1580-1592). L’idéologie ne saurait être reléguée à une seule activité humaine, qu’elle soit publique ou privée, car elle transcende la division arbitraire entre vie privée et vie publique. Par contre, la séparation effectuée par Montaigne entre vie privée et vie publique résulte précisément d’une conjoncture idéologique qui tend à isoler le sujet hors 179de la vie publique en lui donnant la possibilité d’exprimer et de vivre une nouvelle forme de liberté au niveau individuel, sans que celle-ci ne débouche pour autant sur de véritables bouleversements politiques ou sociaux. Cette liberté se retrouve dans les Essais, lieu par excellence d’affranchissement envers les dogmes et les idées reçues.
Depuis plus de vingt ans, j’ai essayé d’aborder l’œuvre de Montaigne à partir d’une approche sociologique en arguant que les actions humaines résultent d’une constante négociation entre, d’un côté, la normativité des institutions et, de l’autre, notre capacité à dévier de la norme pour bénéficier d’un avancement ou d’une reconnaissance au sein de ces institutions. La norme doit être respectée dans son ensemble, mais subvertie dans les actions individuelles. Les Essais représentent une telle négociation entre normalité (norme) et idiosyncrasie (individualité). Montaigne agit souvent dans le cadre des institutions qu’il embrasse (parlement, administration de la ville, corps diplomatique), adaptant son discours aux manières de faire (habitus) de ces institutions. En conséquence, les Essais marquent un déplacement significatif de l’histoire (contenu) vers l’essai (forme). L’essai – tel qu’il est inventé par Montaigne – nécessite la négation d’un contenu historique stable et un repli dans le quotidien et l’instant présent. Les Essais brouillent ainsi toute chronologie ou historicité. Les contradictions éthiques que j’ai tenté ici de présenter illustrent assez bien (certes inconsciemment) l’idéologie bourgeoise qui s’impose à la fin de la Renaissance. Ce n’est plus la chose rapportée qui est jugée primordiale par Montaigne, mais plutôt la façon dont elle est révélée, indépendamment de son contenu. La forme se suffit à elle-même, où, comme l’avoue Montaigne, « Par long usage cette forme m’est passée en substance » (III, 10, 1011). La forme, c’est ce qui se révèle à nous d’abord, dans l’instant présent, en dehors de toute histoire. Cette forme est malléable, car elle permet ainsi d’intégrer des contradictions sans que celles-ci nuisent pour autant au genre de l’essai. La forme plastique de l’écriture montaignienne, redéfinie par l’opinion, le doute, la morale, l’éthique, finit par devenir la matière de ses Essais15. Elle se suffit à elle-même, hors de l’histoire et dans une temporalité nouvelle qui est censée objectiver l’être dans ce que Montaigne appelle l’« humaine condition », une condition médiocre et implicitement bourgeoise.
180Chez Montaigne, l’éthique bourgeoise fonctionne à partir d’expériences individuelles qui sont ensuite réifiées en histoires et s’offrent comme modèles au sein d’une idéologie qui met en avant l’homme moyen. On trouve pour cette raison un éloge de la médiocrité et de la modération dans les Essais : « Ma fortune le veut ainsi. Je suis nay d’une famille qui a coulé sans esclat et sans tumulte, et de longue memoire particulierement ambitieuse de preud’hommie. Nos hommes sont si formez à l’agitation et ostentation que la bonté, la moderation, l’equabilité, la constance et telles qualitez quietes et obscures ne se sentent plus » (ibid., 1021). L’homme moyen pourra toujours mieux s’adapter que l’homme trop engagé qui a tendance à se rapprocher des extrêmes. L’adaptation préconisée par Montaigne pourrait être perçue comme contradictoire, mais il a appris à déconstruire les contradictions dans son livre. L’essai accepte implicitement la transformation et l’accommodation pragmatique issue de contradictions idéologiques afin de s’adapter aux situations rencontrées. Sur ce point Montaigne est clair :
Il faut accommoder mon histoire à l’heure. Je pourray tantost changer, non de fortune seulement, mais aussi d’intention. C’est un contrerolle de divers et muables accidens et d’imaginations irresoluës et, quand il y eschet, contraires ; soit que je sois autre moymesme, soit que je saisisse les subjects par autres circonstances et considerations. Tant y a que je me contredits bien à l’adventure, mais la vérité, comme disoit Demades, je ne la contredy point (III, 2, 805).
Philippe Desan
University of Chicago
1 Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. Jacques Chavy, Paris, Plon, 1964, p. 15.
2 Citons notamment Emmanuel Wallerstein, Le Système du monde du xve siècle à nos jours, t. 1, Capitalisme et économie-monde 1450-1640, Paris, Flammarion, 1980 ; et Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949.
3 Voir nos livres, Les Commerces de Montaigne : le discours économique des Essais, Paris, A.-G. Nizet, 1992 ; et L’Imaginaire économique de la Renaissance, Paris & Fasano, Presses de l’Université de Paris Sorbonne & Schena Editore, 2002.
4 J’ai analysé en détail cette réélection dans Montaigne. Une biographie politique, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 427-437.
5 Pour une présentation des valeurs nobiliaires à l’époque de Montaigne, voir Nicolas Le Roux, Le crépuscule de la chevalerie. Noblesse et guerre au siècle de la Renaissance, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015 ; Benjamin Deruelle, De papier, de fer et de sang. Chevaliers et chevalerie à l’épreuve de la modernité (ca 1460 – ca 1620), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 ; et Nicolas Le Roux et Martin Wrede (dir.), Noblesse oblige. Identités et engagements aristocratiques à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
6 Alfred Glauser, Montaigne paradoxal, Paris, A.-G. Nizet, 1972.
7 Je cite Montaigne dans l’édition Villey-Saulnier publiée par les Presses Universitaires de France.
8 Voir Roland Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII (Rouen, Éditions Maugard, 1945), plus particulièrement le deuxième chapitre : « Les temps modernes : le xvie siècle ».
9 Sur la vie et l’œuvre de Tiraqueau, voir J. Brejon, André Tiraqueau (1488-1558), thèse de Droit, Poitiers, 1935.
10 André Tiraqueau, De Nobilitate, Caput sextum, Lyon, 1569, p. 492.
11 Ibid.
12 Charles Loyseau, Cinq Livres du droict des Offices, suivis du Traitez des Seigneuries et de celui des Ordres, Paris, Abel L’Angelier, 1610.
13 J’ai plus longuement analysé le chapitre « De l’utile et de l’honnête » dans « De l’utile, de l’honnête et de l’expérience : le cadre idéologique du troisième livre des Essais », dans Daniel Martin (dir.), The Order of Montaigne’s Essays, Amherst, Hestia Press, 1989, p. 200-220 ; et « Montaigne “métis” : “De l’utile et de l’honnête” (III, 1) », dans Philippe Desan (dir.), Lectures du Troisième Livre des Essais de Montaigne, Paris, H. Champion, 2016, p. 59-84.
14 Arlette Jouanna, « Les controverses sur l’utilité de la noblesse », dans Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris, Vrin, 1977, p. 287-300.
15 Sur ce point, voir mon livre : Montaigne : les formes du monde et de l’esprit, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008.