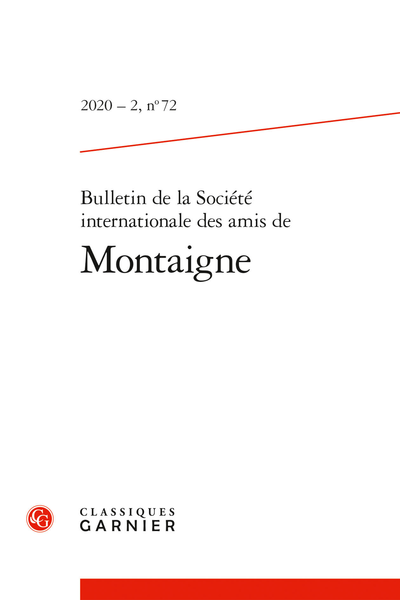
Montaigne and Cardinal Carafa’s maître d’hôtel
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Author: Balsamo (Jean)
- Abstract: The Essais mention a conversation Montaigne had with Cardinal Caraffa’s majordomo. This meeting took place before his travel in Italy. Its account concerns literature more than biography: it points out Montaigne as a reader of Italian gastronomy books, which he used in a satirical intention linked to the contemporary anti-Italian debate.
- Pages: 131 to 139
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406113560
- ISBN: 978-2-406-11356-0
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0131
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 01-25-2021
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: witticism, satire, anti-Italianism, intertextuality, Rabelais, Cristoforo di Messiburgo, Bartolomeo Scappi
Montaigne et le maître d’hôtel
du cardinal Caraffa
Personne ne connaît mieux Montaigne et les Essais qu’Alain Legros. Il leur a consacré une vie savante, sans jamais chercher à se les approprier, ni à les plier à une interprétation fondée sur des préjugés ou servant à conforter des choix idéologiques. Son but a été de les révéler, progressivement, dans la plus grande objectivité, par une méthode rigoureuse, en philologue qui cherche à comprendre ce qui est écrit et qui s’efface derrière l’objet de son étude. La modestie d’Alain Legros cache la plus grande science. Aussi serait-il bien présomptueux de vouloir lui offrir en guise d’hommage et en témoignage d’amitié, dans le cadre de ce volume qui lui est dédié, autre chose qu’un bref essai destiné à susciter sa curiosité sur un point qui demande encore à être éclairci.
Le chapitre « De la vanité des paroles » (I, 51) dénonce la rhétorique et à travers elle, l’imposture politique de l’éloquence. Il est ouvert sur un mode spirituel par le bon mot d’un « rhétoricien du temps passé », pris et adapté de Plutarque. Cette critique, développée sur une page, est amplifiée par un exemple, rattaché au mot liminaire et à l’argumentation qui le suit par une formule de régie : « J’en ay dit ce mot, sur le subject d’un Italien, que je viens d’entretenir1 ». L’ensemble du développement a eu pour prétexte immédiat une conversation que Montaigne aurait eue avec le maître d’hôtel du cardinal Caraffa. Celui-ci lui aurait tenu avec une gravité digne d’un docteur en théologie un discours sur son office, qui comprend l’art du cuisiner et les usages du service à table, en lui détaillant les manières de stimuler l’appétit, la qualité des ingrédients, le choix et la préparation des mets, l’ordonnance des services. Par l’emphase de son discours, et en particulier par choix de son vocabulaire, le maître d’hôtel 132haussait la cuisine, une activité domestique, à la dignité du politique. Ce bref passage, au sein d’un de ces chapitres « oubliés », sur lesquels Philippe Desan a naguère incité la critique à revenir2, pose trois problèmes : celui, philologique, de son inscription textuelle ; celui, littéraire de sa structure et de son statut ; celui, historique et biographique, de l’identification du personnage, dans le cadre plus général du discours personnel des Essais, déterminant la signification de l’ensemble. On pourra passer sur les deux premiers, qui ont déjà été partiellement traités ailleurs3, pour revenir de façon plus précise sur le troisième.
Publié pour la première fois en 1580, dans la première édition des Essais4, le passage évoquant le maître d’hôtel a été repris sans modifications autres que typographiques dans l’édition suivante, en 15825. Dans la grande édition publiée à Paris, en 1588, chez Abel L’Angelier, Montaigne modifia sensiblement le chapitre par plusieurs ajouts et des corrections. Dans le passage examiné, il inséra deux vers pris de Juvénal, qui précisaient en termes satiriques, du moins pour le lecteur qui savait les reconnaître, la portée du passage6, et il modéra sa propre emphase, en supprimant « mille » de l’expression « plein de mille belles et importantes considérations ». Dans la révision du texte dont l’exemplaire de Bordeaux porte le témoignage, alors qu’il avait notablement enrichi le début du chapitre, Montaigne retoucha peu ce passage : outre l’insertion de deux virgules, il se borna à remplacer, en écrivain attentif à la précision des mots, « de gousts » par « d’appetits », et il corrigea une coquille introduite dans la citation de Térence (« Hoc », pour « Hol »). L’édition posthume, établie sur un autre manuscrit, confirma ces deux corrections, tout en proposant quelques autres modifications, ailleurs dans le chapitre.
Dès la première édition, l’anecdote du maître d’hôtel est conclue par une citation de cinq vers tirés des Adelphes (III, iii, v. 425-429) de Térence, un auteur dont Alain Legros a mis en lumière l’importance dans 133la bibliothèque de Montaigne7. Cette citation joue un rôle plus complexe que celui d’une simple illustration, destinée à amplifier l’exemple du maître d’hôtel. Montaigne introduit ces vers en relation au personnage lui-même, dans un processus de remémoration : « il m’est souvenu de nostre homme », à la fois comme si en relisant et en citant Térence, il se rappelait sa rencontre avec le maître d’hôtel, et comme si celui-ci était l’incarnation du personnage littéraire de Syrus, donnant des conseils à ses compagnons d’esclavage : le type de la comédie trouve son actualisation dans le personnage réel, dont il est en même temps le prétexte, de même que l’évocation du personnage réel est le prétexte du développement initial consacré à la critique de l’éloquence. La citation qui prolonge l’anecdote éclaire celle-ci en la situant dans une continuité littéraire ; elle donne sa cohérence à l’ensemble du chapitre, en reliant le mot initial tiré de Plutarque à l’évocation du palais d’Apollidon, empruntée à la série romanesque des Amadis de Gaule, qui suit l’anecdote du maître d’hôtel italien8, et au développement sur l’Arétin qui le conclut. C’est dans cette continuité que prend sens un nouveau mot d’esprit, inventé par Montaigne, qui résume et concentre le propos du chapitre : « Je luy faisoy compter de sa charge. Il m’a fait un discours de cette science de gueule, avec une gravité et une contenance magistrale ».
Au discours pédant du maître d’hôtel, d’un pédantisme d’autant plus ridicule qu’il traite d’une fausse science, Montaigne peut opposer la subtilité du discours mondain, fondé sur l’esprit et l’ironie. Son mot, un bon mot, est excellent, dans sa conception et sa concision. Il joue des deux sens du substantif gueule : manger, parler, auxquels s’ajoute implicitement le sens héraldique du pluriel « gueules ». Ce mot revêt ainsi une fonction facétieuse, comme il résume le chapitre dans son ensemble : l’art de la parole mis au service d’une célébration de la cuisine par l’éloquence du maître d’hôtel italien est un blason de l’ignorance. Ce bon mot, inventé par Montaigne, est en réalité la reprise d’une formule de Rabelais, les « mots de gueule », des mots pour rire qui sont aussi des mots qui se rapportent à la gueule, évoqués dans le titre de l’épisode des paroles gelées du Quart Livre, lui-même imité de Castiglione9. 134Cette allusion confirme l’intertexte rabelaisien des Essais. On souhaite à Alain Legros de mettre un jour la main sur l’exemplaire des Œuvres de Rabelais annoté par Montaigne, comme il l’a fait pour son Térence.
C’est dans ce contexte et en relation à cette intertextualité que s’inscrit l’anecdote elle-même, la conversation que rapporte Montaigne, comme un fait advenu, une expérience personnelle, avec le maître d’hôtel, « un Italien, que je vien d’entretenir ». Cette conversation est située dans le temps, dans une relation de proximité avec le moment de la rédaction. Objet d’un récit publié dans la première édition des Essais, elle a eu lieu avant le voyage que Montaigne fit en Italie (septembre 1580-novembre 1581), et ailleurs qu’en Italie, où, du moins pour ce que l’on en sait, Montaigne n’était jamais allé auparavant. De ce point de vue, elle est d’autant plus intéressante qu’elle révèle, élargi dans le même chapitre à une considération sur l’esprit éveillé des Italiens et l’art oratoire de l’Arétin, un arrière-plan italianisant antérieur à l’expérience directe de l’Italie. Toutefois, aucun autre indice ne permet de dater cette rédaction, sinon cette anecdote, dans le cadre d’un chapitre que Pierre Villey lui-même n’avait pas su dater. À défaut de terminus ante quem, un temps proche de la rédaction, entre 1572 et 1580, Montaigne suggère un terminus post quem. Le maître d’hôtel n’est pas nommé, mais il est connu par son patron. Il aurait servi le cardinal Caraffa « jusques à sa mort », expression imprécise, mais qui désigne probablement la mort du prélat et non pas celle du personnage dont Montaigne rapporte le discours.
Au cours du xvie siècle, l’illustre famille napolitaine des Caraffa a donné sept cardinaux à l’Église, le plus célèbre d’entre eux étant Giovanni Pietro, élu pape sous le nom de Paul IV (1536-1555)10. Le Journal du voyage mentionne à deux reprises le cardinal Antonio Caraffa ; celui-ci, qui mourut en 1592, ne peut pas être le personnage mentionné dans les Essais11. Peuvent également être écartés les cardinaux Oliviero Caraffa (1430-1511) et Gianvincenzo Caraffa (1492-1541), trop éloignés dans le temps pour que Montaigne eût rencontré leur maître d’hôtel, ainsi que Pietro Caraffa, que Montaigne aurait désigné sous sa dignité de pape. Restent trois personnages à prendre en considération pour cette identification : Diomede (1492 – 12 août 1560, créé cardinal en 1555, parfois 135dit cardinal teatino), Carlo (1517 – 4 mars 1561, créé cardinal en 1555), Alfonso (1540-1565, créé cardinal en 1557, dit le cardinal de Naples)12. Le seul d’entre eux à être connu sous le titre de « cardinal Caraffa » est Carlo, un ancien condottiere devenu cardinal-neveu et secrétaire d’État13. Ce personnage s’impose à la fois par sa notoriété tragique, dont on peut trouver un écho dans l’allusion que fait Montaigne à sa mort, et parce qu’il fut le seul à avoir eu des liens avec la France, politiques et littéraires. Olivier de Magny le célébra comme « predisant mille maux à l’Espagne ennemie14 », avant de se moquer de son ignorance et de ses mœurs15. Au même moment, dans un sonnet satirique, où il rapprochait ingénieusement la coupe et la carafe, Du Bellay ironisait sur la mort du « bel Ascaigne », Ascanio Sanguine, l’échanson du prélat et son Ganymède16. En relation épistolaires avec Monluc et avec les Guises, Caraffa joua un rôle décisif dans l’affaire de Sienne17. Peu auparavant, il avait été envoyé par son oncle Paul IV auprès de Henri II en qualité de légat, pour tenter d’infléchir la politique royale et de convaincre le roi de reprendre les hostilités contre l’Espagne après la trêve de Vaucelles18. François Rasse de Neux mentionne cette légation dans une annotation portée sur son exemplaire de l’Ephemeris historica de Beuther19. Accompagné d’une suite 136importante de plus de deux cents personnes, parmi lesquels probablement un maestro della casa et un cuisinier, dont les noms ne nous sont pas connus20, Caraffa séjourna à la cour du mois de juin au mois d’août 1556. C’est à cette occasion que Montaigne, à supposer qu’il se fût trouvé lui aussi à la cour, aurait pu rencontrer le personnage qu’il évoque. Mais comme il parle de celui-ci en mentionnant la mort du prélat (« qui a servi le feu Cardinal Caraffe de maistre d’hostel jusque à sa mort »), cette rencontre, si elle a eu lieu, se serait située non pas en 1556, mais après le 4 mars 1561, date de l’exécution de Caraffa, toujours en France, où il faudra supposer que le maître d’hôtel serait resté ou serait revenu s’établir, puisque Montaigne n’était pas allé en Italie à cette époque21. Cette datation reste hypothétique mais elle est plus plausible : durant l’hiver 1561-1562, Montaigne avait obtenu un congé du parlement de Bordeaux et s’était rendu à la cour ; il était revenu à Paris pour plusieurs mois durant l’été, et il avait à nouveau suivi la cour au siège de Rouen en octobre 156222. Si ses voyages sont moins bien documentés pour les années suivantes, il eut plusieurs occasions de faire une telle rencontre.
La conversation rapportée par Montaigne appartient à l’ordre du vraisemblable. Comme telle, elle ne conserve pas moins un intérêt d’ordre biographique, même si les biographes de Montaigne ne lui ont pas porté attention. Il n’est pas exclu qu’on trouve un jour, dans un fonds d’archives ou de correspondance, les éléments qui lui donneront sa réalité. Mais en tant que telle, cette vraisemblance définit aussi la dimension littéraire des Essais. Elle sert en premier lieu à préciser le portrait que Montaigne donne de lui-même, comme elle conforte l’èthos noble de son discours. Montaigne se présente comme un familier des Grands, impliqué dans une conversation civile qui lui donne son autorité. Le personnage du maître d’hôtel, le scalco, n’est pas un simple domestique, même s’il fait l’éloge de l’art de cuisiner, mais un gentilhuomo di casa, éclatant du 137prestige de l’illustre maison qu’il sert. Liée à celui-ci, l’évocation du « cardinal Caraffa » est la troisième d’une série de cinq mentions à des noms de cardinaux dans les Essais. Ces mentions illustrent à la fois une forme sociale de name dropping et une poétique du nom propre, dont les effets demandent encore à être étudiés23.
Dans les Essais, les indications chronologiques n’ont souvent qu’une précision approximative, quand elles ne servent pas d’effet de réel, pour dissimuler une origine livresque. La vraisemblance de la conversation avec le maître d’hôtel sert peut-être surtout à actualiser une référence littéraire, sur un mode non docte, en la dissimulant. Hugo Friedrich avait déjà noté que le discours attribué au maître d’hôtel semble être le résumé de la satire d’Horace dans laquelle Catius formule les règles de la gastronomie et rappelle que nul ne saurait prétendre maîtriser l’art des dîners sans avoir étudié méthodiquement les saveurs24. Dans le chapitre « Des destriers », un prétendu souvenir d’enfance dissimulait un emprunt à un traité napolitain d’art équestre25. On pourrait se demander si, de la même manière, l’évocation d’une conversation avec le maître d’hôtel d’un cardinal napolitain venu en France n’est pas, en réalité, l’adaptation par Montaigne de sa lecture d’un traité italien, consacré à l’art de servir à table, voire la reprise d’une note de lecture, analogue à celle qu’il avait consacrée à Guichardin, prétexte d’un long développement dans le chapitre « Des livres ». Les matières traitées par le maître d’hôtel anonyme et l’ordre de leur exposition semblent être un écho assez précis de deux ouvrages dont Montaigne aurait pu se servir. Ces ouvrages étaient rares en France26 : le livre des Banchetti (1549), de Cristoforo di Messiburgo, publié ensuite sous le titre de Libro novo (1559)27, et les dix livres, dont 138un premier livre en forme de dialogue, qui composent le célèbre traité des Opera (1570), de Bartolomeo Scappi28. Le premier, dû au scalco de la cour de Ferrare, était dédié au cardinal Hippolyte d’Este, le second, au cuisinier vénitien Matteo Barbini. Les deux ouvrages constituaient une véritable encyclopédie domestique et non pas un simple livre de cuisinier ; de ce point de vue, Montaigne en aurait parfaitement compris le dessein29.
Toutefois, ni Messiburgo, mort en 1549, ni Scappi n’avaient de liens avec le cardinal Caraffa ; le premier avait été au service des Este, le second prétendait avoir été « cuoco segreto di Papa Pio quinto », après avoir été le maître d’hôtel du cardinal de Carpi30. On pourra alors se demander pourquoi Montaigne, s’il avait fait un emprunt à ces livres, en aurait changé le nom des dédicataires ou des patrons du maître d’hôtel. Un tel changement s’explique : pour dissimuler un emprunt et rendre vraisemblable la fiction d’une rencontre et d’une conversation avec le personnage du maître d’hôtel, il devait modifier l’identité des patrons de celui-ci, pour les adapter à un contexte français. Une telle modification pouvait se justifier, par discrétion, dans le cas du cardinal d’Este31. Montaigne mentionna le nom du prélat avec éloge dans le Journal du voyage, à l’occasion de sa visite de la villa édifiée par celui-ci32. Cette modification se justifiait nécessairement dans le cas de Pie V et du cardinal de Carpi, qui n’étaient jamais venus à la cour de France, et dont les noms n’évoquaient rien dans l’imaginaire littéraire français de l’époque. De surcroît, dans le cas de Scappi, la fiction inventée par Montaigne, nécessaire à son propos, était 139d’autant plus légitime, que les noms sur lesquels l’auteur italien fondait son autorité, servaient eux aussi à dissimuler une probable fiction littéraire : la critique a montré que le livre de Scappi, ou plus exactement du pseudo-Scappi était le résultat d’un bricolage éditorial, combinant des matériaux divers, et non pas le récit véridique d’une carrière de maître d’hôtel et de cuisinier : ceux-ci étaient des êtres de papier33.
Enfin, de même qu’Ascanio Sanguine, l’échanson du cardinal Caraffa, dont Du Bellay déplorait la disparition, le maître d’hôtel du même Caraffa évoqué par Montaigne est un personnage satirique. L’un et l’autre illustrent des vices ou des défauts italiens, d’un côté la luxure et la sodomie, de l’autre le pédantisme et l’abondance de paroles. La conversation que rapporte Montaigne prend sens, dans le même chapitre, en relation avec un jugement général porté sur les Italiens et une sévère critique du style de l’Arétin. En apparence, Montaigne approuve les Italiens « qui se vantent, et avecques raison, d’avoir communément l’esprit plus esveillé, et le discours plus sain que les autres nations de leur temps34 ». En réalité, il dénonce une imposture, à laquelle les Italiens ne sont que trop enclins à céder en qualifiant l’Arétin de « divin ». Ces trois exemples servent d’arguments pour une critique de l’éloquence. Or celle-ci est aussi un « lieu » du discours polémique anti-italien qui s’est développé en France durant les années 1570. Ce n’est pas un hasard ni un paradoxe si Montaigne, le plus italianisant des écrivains français, utilise un tel « lieu » dès le début de la rédaction des Essais, pour célébrer par contraste son propre art français de la parole35. L’exemple du maître d’hôtel du cardinal Caraffa nous rappelle ainsi, ce qu’Alain Legros n’a pas cessé de confirmer dans ses travaux, combien les Essais sont inscrits dans leur temps.
Jean Balsamo
Université de Reims
1 Montaigne, Les Essais, éd. J. Balsamo, M. Magnien et C. Magnien-Simonin, édition des « Notes de lecture » et des « Sentences peintes » établie par A. Legros, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2007, I, 51, p. 326.
2 Philippe Desan (éd.), Les Chapitres oubliés des Essais de Montaigne, Actes de la journée d’étude à la mémoire de Michel Simonin, Paris, University of Chicago, 2010, Paris, Honoré Champion, 2011, et l’étude d’Alain Legros, « Délaissés, mais laissés, les chapitres d’une page et l’ordre des Essais », ibid., p. 13-30.
3 Voir H. Friedrich, Montaigne, 1949, Gallimard, 1994, p. 99 ; Paul J. Smith et N. van der Toorn, « Science de gueule et rhétorique, ou “De la vanité des paroles” », Studi francesi, XXXII, 1988, p. 82-90.
4 Essais, Bordeaux, S. Millanges, 1580, t. I, p. 467-468.
5 Essais, Bordeaux, S. Millanges, 1582, p. 287-288.
6 Essais, Paris, L’Angelier, 1588, f. 127r et 127v.
7 Alain Legros, Montaigne manuscrit, Paris, Classiques Garnier, 2010, no 88, p. 161-205.
8 André Chastel a brillamment commenté cette allusion, « Le palais d’Apollidon », Culture et demeures en France au xvie siècle, Paris, Julliard, 1989, p. 76-116.
9 Rabelais, Le Quart Livre, LVI, « Comment entre les paroles gelées Pantagruel trouva des mots de gueule » ; Castiglione, Il libro del cortegiano, II, lv.
10 Voir Milles Pattenden, Pius IV and the Fall of the Caraffa. Nepotism and Papal Authority in Counter Reformation Rome, Oxford, Oxford University Press, 2013.
11 Montaigne, Journal de voyage, éd. François Rigolot, Paris, Puf, 1992, p. 93 et 122.
12 R. De Maio, Antonio Caraffa cardinale di Napoli (1540-1565), Città del Vaticano, 1961.
13 Sur le personnage, voir Georges Duruy, Le Cardinal Caraffa (1519-1561). Étude sur le pontificat de Paul IV, Paris, Hachette, 1882, en particulier p. 150-182.
14 Olivier de Magny, Les Souspirs, Paris, 1557, sonnet 39, v. 11.
15 Ibid., sonnet 118 : « J’ay veu ce grand Guerrier qui Prestre ore veut vivre / Chasser un qui venoit luy presenter un livre / Afin de retenir un bouffon près de luy », v. 9-11. Le lettré méprisé par le prélat était probablement Antonio Brucioli, qui lui avait dédié sa traduction des Libri tre dell’anima d’Aristote (Venise, Imperatore, 1557).
16 Joachim du Bellay, Les Regrets [1558], 103 ; « Ascanii Sanguinii card. Carafa a poculis », Tumuli, 10, in Poemata [1558], Œuvres poétiques, t. VII, éd. Geneviève Demerson, Paris, Société des Textes français modernes, 1984, p. 179.
17 Voir Paul Courteault et Charles Samaran, « Deux lettres inédites de Blaise de Monluc au cardinal Carlo Caraffa », Bulletin italien, 1903, p. 145-156 ; René Ancel, « La question de Sienne et la politique du cardial Carlo Caraffa (1556-1557), Revue bénédictine, vol. 22, 1905, p. 398-428.
18 Voir Lucien Romier, Les Origines politiques des guerres de religion, Paris, Perrin, 1914, p. 62-74. Sur les fonctions de Caraffa, voir Bernard Barbiche et Ségolène de Dainville-Barbiche, « Les légats en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles », Archivium Historiæ Pontificiæ, vol. 23, 1985, p. 93-165. À l’époque de cette légation, le nonce en France était Cesare Brancaccio, qui avait succédé à Sebastiano Gualterio et à qui Lorenzo Lenzi succéda ; sa correspondance n’a pas été éditée.
19 Voir Stephan Geonget, Remi Jimenes et Alain Legros, « Annoter l’éphéméride de Beuther : les pratiques comparées de deux contemporains de Montaigne », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, no 77, 2015, p. 505-535,ici p. 522.
20 On connaît quelques noms, ou plus exactement les prénoms, de cuisiniers pontificaux vers 1540 : Maestro Giorgio, Giovanni, en l’occurrence le Français Jean Duval, mort en 1542, Giulian, en 1544 ; Giovanni et Bernardo étaient les cuisiniers des cardinaux, voir Bruno Laurioux, « De Jean de Bockenheim à Bartolomeo Scappi : cuisiner pour le pape entre le xve et le xvie siècle », dans Armand Jamme et Olivier Poncet, Offices et papauté (xive-xviie siècle) : charges, hommes, destins, Rome, École Française de Rome, 2005, p. 303-330.
21 Le personnage n’est pas mentionné par Émile Picot, Les Italiens en France au xvie siècle, Bordeaux, 1918, éd. Nuccio Ordine, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 1995.
22 Voir Philippe Desan, Montaigne. Une biographie politique, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 110.
23 Les cardinaux Jean du Bellay (Les Essais, I, 10, p. 61), de Cornete [Adriano Castellesi] (I, 33, p. 226), Charles de Lorraine (II, 32, p. 757, désigné comme « un Prince des nostres » (I, 2, p. 35), auxquels, dans la dernière rédaction, s’ajoute le cardinal Borromée (I, 40, p. 271).
24 « Nec sibi cenarum quiuis temere arroge artem / non prius exacta tenui ratione saporum » Horace, Sermones, II, 4, v. 36-37 ; Hugo Friedrich, Montaigne, op. cit., p. 99.
25 Voir Jean Balsamo, « Montaigne, le style (du) cavalier, et ses modèles italiens », Nouvelle revue du xvie siècle, no 17, 1999, p. 253-267.
26 On exclura le traité Dello scalco (Ferrare, Mammarello, 1584) de Giovanni Battista Rossetti, dont la parution est postérieure à la rédaction du passage des Essais. Toutefois, son auteur, scalco de la cour de Ferrare après Messiburgo, avait voyagé en France à la suite de ses patrons. Les relations de Montaigne avec la cour de Ferrare sont bien connues.
27 Cristoforo di Messiburgo, Banchetti, compositioni di vivande et apparecchio generale (Ferrare, De Bulghat et Hucher, 1549) ; Libro novo nel qual s’insegna il modo d’ordinar banchetti, apparecchiar tavole […] et a far d’ogni sorte di vivanda secondo la diversità dei tempi, cosi di carne, come di pesce. Opera molto necessaria a maestri di casa, a scalchi, a credentieri e a cuochi (Venise, 1559, 1581). Le recueil contient 323 recettes.
28 Bartolomeo Scappi, Opera divisa in sei libri. Nel primo si contiene il raggionamento che fa l’Autore con Gio suo discepolo. Nel secondo si tratta di diverse vivande du carne, si di quadrupedi, come di volatili. Nel terzo si parla della statura e stagione de’ pesci. Nel quarto si mostrano le liste del presentar le vivande in tavola, cosi di grasso come di magro. Nel quinto si contiene l’ordine di far diverse sorti di paste, et altri lavori. Nel sesto et ultimo libro si ragiona de’ convalescenti et molte altre sorti di vivande per gli infermi, Venise, Michele Tramezzino, 1570. L’ouvrage a connu deux éditions différentes en 1570, l’une sans date. Les exemplaires en sont rares (Paris, BnF, Nice, Bibliothèque municipale, Chantilly, Musée Condé). Sur l’œuvre, voir June Di Schino et Furio Luccichenti, Il cuoco segreto dei Papi Bartolomeo Scappi e le confraternità dei cuochi e dei pasticcieri, Rome, 2016.
29 Voir B. Laurioux, « …Cuisiner pour le pape… », art. cité, note 109.
30 É. Picot, Les Italiens en France, op. cit., p. 59.
31 Voir Jean Tricou, « Un archevêque de Lyon au xvie siècle, Hippolyte d’Este », Revue des Études italiennes, V, 1958, p. 147-164.
32 Journal du voyage, éd. citée, p. 18 et 130.
33 Voir B. Laurioux, « …Cuisiner pour le Pape… », op. cit., p. 327.
34 Les Essais, I, 51, p. 327.
35 Sur cette question, voir Jean Balsamo, « Italianisme, anti-italianisme, italophobie en France à l’époque des derniers Valois », Comparatio, 1/1, 2009, p. 9-28 ; Id., « L’italophobie à l’époque des guerres religieuses et civiles : une composante de l’idéologie française », Revue des études italiennes, no 59, 2013, p. 17-26.