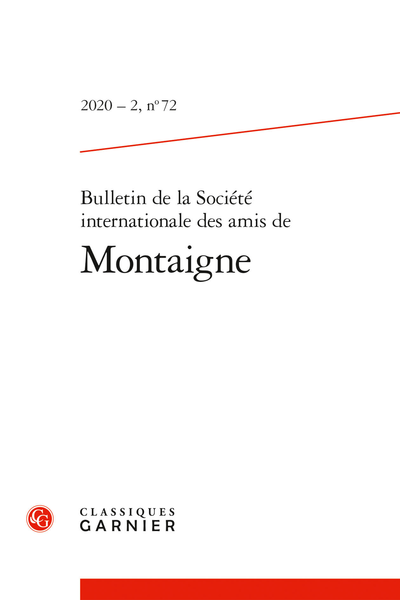
Repérer et collectionner les livres provenant de Montaigne et Rabelais Un parcours croisé
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2020 – 2, n° 72. Saveur du savoir Mélanges Alain Legros - Auteur : Pédeflous (Olivier)
- Résumé : Cet article présente en parallèle l'histoire de la constitution de deux bibliothèques, celle de Rabelais et de celle de Montaigne à laquelle Alain Legros a significativement contribué.
- Pages : 101 à 107
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113560
- ISBN : 978-2-406-11356-0
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11356-0.p.0101
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/01/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : histoire du livre, provenances, bibliothèques, Montaigne, Rabelais
Repérer et collectionner les livres provenant de Montaigne et Rabelais
Un parcours croisé
Dans un essai au titre provocateur consacré aux manuscrits, « Seven Bad Reasons Not to Study Manuscripts », Robert Darnton s’interrogeait naguère sur la manière d’éviter l’anachronisme et préconisait la voie suivante :
Comment pouvons-nous restituer les processus mentaux par lesquels les lecteurs s’appropriaient les textes ? Comment pouvons-nous éviter l’anachronisme, le péché mortel de nombreuses recherches en histoire ? Une des meilleures stratégies passe par les marginalia1.
Étudiant et scrutant la bibliothèque de Montaigne, Alain Legros a justement suivi cette piste : il est parvenu à affiner considérablement un portrait de lecteur et à éclairer en particulier les studia humanitatis du jeune Montaigne en analysant méthodiquement lesdits marginalia, l’évolution de sa main et des pratiques de marquage des livres2. Il s’est intéressé à la passion gréco-latine de Montaigne sur tous les supports – on se souvient de son important Essais sur poutres paru en 2000. J’écrirai quant à moi en tant que bibliographe travaillant à l’exhumation et la mise en valeur des livres qui ont appartenu de Rabelais, chemin parallèle en quelque sorte dans le premier xvie siècle.
102Pour l’heure, dans la mise au jour hasardeuse de leurs ouvrages – en l’absence de catalogue domestique ou d’inventaire après décès –, l’avantage numérique est très nettement à Montaigne dont on conserve 106 livres selon le recensement le plus récent (sur le millier qu’il avoue avoir possédé dans sa « librairie »), tandis que, pour Rabelais, on peine à dépasser les 28-30 numéros3. La formule d’un colloque érasmien nous rappelle que le nombre ne fait pas tout : « Nunc adeamus bibliothecam, non illam quidem multis instructam libris, sed exquisitis ». Leurs livres à tous deux sont par ailleurs d’une insigne rareté sur le marché de l’ancien4. Mais le lecteur bibliophile serait bien en peine de trouver une vente de la fin du xxe siècle comparable, pour Rabelais, à celle de la bibliothèque du Dr. Pottiée-Sperry (Sotheby’s 1997) – sans parler de la bibliothèque de Gilbert de Botton entrée à Cambridge.
On pourrait s’interroger à bon droit sur les lectures communes que nos deux auteurs ont pu avoir5. Montaigne et Rabelais avaient au moins un grand auteur de prédilection en partage, Plutarque dont ils maîtrisaient l’œuvre ad ungem. Ils n’ont pas craint de se procurer des livres sulfureux, mis à l’index dès sa création. Le Novum testamentum grec publié à Haguenau en 1521 par les soins de Conrad Grebel pour Rabelais, et, pour Montaigne, les deux volumes imprimés à Bâle de Bernardo Ochino (Pierre Perna, 1561), la Disputa intorno alla presenza del corpo di Giesu Christo nel sacramento della Cena et Il Catechismo, o vero institutione6.
À quand faire remonter l’émergence du sujet de la bibliothèque de Montaigne et Rabelais ? Parmi les importants devanciers d’Alain Legros, l’histoire se souvient notamment de Gustave Brunet – l’autre Brunet. À côté de son important travail sur les livres de Montaigne aux alentours de 18507 qu’il ramenait au jour en communicant régulièrement 103ses découvertes au Dr Payen, montaignologue frénétique, c’est grâce à lui que la bibliothèque de Rabelais devint timidement un objet d’étude dans le Bulletin du bibliophile en 1852. Il y signa une brève note sur les « livres signés de la main de Rabelais » dans sa revue des recherches bibliographiques sur Rabelais8. C’est la marque d’un premier intérêt, au moment où il tentait le même travail, avec beaucoup plus d’ampleur, pour la bibliothèque de Montaigne. Il ne signale que quatre volumes pour Rabelais : les Moralia de Plutarque, un Platon aldin, les Hieroglyphica d’Horapollon (1521) et le Plutarque de Froben (1542). Au tournant des xixe et xxe siècles, tandis que Paul Bonnefon et Pierre Villey reprennent et enrichissent le dossier, Abel Lefranc (et dans une moindre mesure Jean Plattard) mènent un travail parallèle pour Rabelais.
Les livres de Rabelais et Montaigne ont parfois cohabité dans les bibliothèques des grands collectionneurs qui alliaient recherche de la rareté, des provenances illustres et, parfois, des monuments de l’ancienne littérature française. C’est dans la génération précédente que, dans le cadre des nouvelles bibliophilies du début du xixe siècle, on a mis notamment à l’honneur les exemplaires annotés (« autographiés » disait-on alors). L’« inventeur » en est le libraire-collectionneur Antoine-Augustin Renouard († 1853) dont Antoine Coron9 a montré l’importance capitale pour la considération des marginales des auteurs classiques. Renouard, à côté d’un Platon aldin de Rabelais et d’un Hippocrate grec qui a peut-être aussi été entre les mains du Chinonais, avait acquis le Belloy et le Bèze de 1569 avec l’autographe de Montaigne. C’est précisément dans un compte rendu de la vente Renouard de 1854 que Gustave Brunet, toujours lui, associait dans un même paragraphe les volumes marquées de « notules » « tracées par le curé de Meudon » aux livres « avec la signature de Michel Montaigne » [sic]10. Citons aussi Louis Aimé-Martin († 1847), conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, dont le catalogue de la vente, tenue peu de temps avant sa mort, utilise les notes de grands 104auteurs comme argument promotionnel : Bibliothèque de M. Aimé-Martin composée de livres anciens et rares (…) tout particulièrement remarquable par des ouvrages précieux qui ont appartenu à des personnages célèbres comme Le Tasse, Rabelais, Montaigne, Racine, Montesquieu, Bossuet, Bourdaloue, Lafontaine (sic), Voltaire, J.-J. Rousseau, etc., Techener, 1847. Il possédait le Plutarque bâlois de 1542 de Rabelais11 et plusieurs ouvrages de Montaigne dont l’Histoire des rois et princes de Pologne de Herburt de Fulstin (no 46).
L’exemple le plus remarquable de cohabitation concertée de Rabelais et Montaigne dans une collection de grande envergure est fourni par le duc d’Aumale. Une lettre de 1853 qu’il adresse à son ancien précepteur Cuvillier-Fleury résume son état d’esprit et l’objet de sa quête : « Vous savez que j’ai déjà l’Eschyle de Racine et l’Aristophane de Rabelais. Vous savez combien il me conviendrait d’y joindre le César de Montaigne12 ». Ce fut chose faite en 1856, lorsque le duc acquit le volume à la vente J.-P. A. Parison. Ces livres arborant les grands noms français des xvie et xviie siècles, au pedigree remarquable, furent parmi les plus belles pièces de l’exposition que le duc organisa à l’intention des bibliophiles en marge de l’Exposition universelle de Londres en 1862. Il en rédigea lui-même le catalogue13.
Au début du xxe siècle, Montaigne et Rabelais coexistent aussi dans la bibliothèque du patron de presse Arthur Meyer. En témoigne son catalogue sélectif rédigé par ses soins, Mes livres, mes dessins, mes autographes paru en 192114, dans lequel le Guillaume du Choul de 1556 (Discours de la religion des anciens romains) est décrit comme « Exemplaire de Michel de Montaigne, avec sa signature autographe sur le titre », tandis que le volume de Proclus-Plutarque-Hésiode de Rabelais, issu de Guglielmo Libri, se trouve quelques numéros plus loin : « le dernier feuillet porte la signature autographe de François Rabelais. Le volume renferme aussi un certain nombre d’annotations manuscrites de la main de Rabelais ». Les attaques contre la condition d’israélite de Meyer, sa conversion au catholicisme, la direction du très droitier Gaulois, n’étaient certainement 105pas pour rien dans son souhait de rassembler une collection des œuvres du « génie français ». Martin Bodmer († 1971) est peut-être le dernier parmi les grands bibliophiles emblématiques à pouvoir réunir dans sa bibliothèque un livre de Rabelais et un de Montaigne : le Proclus-Plutarque-Hésiode de Rabelais dont nous venons de parler entré dans sa bibliothèque à une date inconnue, et, sur le tard, en 1961, un Quinte-Curce de 1545 de Montaigne, ce qui est bien mis en valeur dans le catalogue des « Fleurons de la Bodmeriana » établi par Jacques Quentin15. Alfred Lindeboom, parmi les bibliophiles importants de la fin du xixe siècle, propriétaire heureux du Chronicon de Bugnyon (1559) de Montaigne16, avait « seulement » dans sa collection une quittance datée de 1548 dont la signature est autographe de Rabelais17. Les magnats américains ont dû se contenter de l’un ou l’autre : Montaigne pour Lucius Wilmerding (l’Eusèbe grec, 1544, un Castanheda de 1554 et le Förster, 1565), Rabelais pour les Heinemann (les Hieroglyphica d’Horapollon maintenant à la Pierpont Morgan Library).
Les grands collectionneurs dépendaient pour la formation de leur goût et de leur bibliothèque de quelques figures prescriptrices et de relais dans le marché du livre (libraires et maisons de ventes aux enchères). Avant même que les revues de bibliophilie n’enregistrent les livres avec ex-libris de nos deux auteurs, les catalogues de ventes aux enchères ont commencé à faire figurer, comme éléments promotionnels, les noms d’auteurs renommés dans les descriptions brèves des exemplaires proposés. Je peux citer deux cas pour Rabelais dans des catalogues de vente du xviiie siècle en Angleterre et en Allemagne. Dans le catalogue de la profuse bibliothèque du Révérend Thomas Crofts, vendue en 1783, j’ai trouvé la mention « Liber olim Rabelaesi » à côté de la notice des Hieroglyphica, volume qui avait échappé à Seymour de Ricci. Quelques années plus tôt, dans l’Allemagne protestante, un autre catalogue atteste également que le nom de Rabelais était devenu un argument commercial. Dans le catalogue de vente des livres du théologien et bibliothécaire de l’université de Leipzig, Christian-Friedrich Boerner, on lit sous le no 130 : 106« Libri hujus possessor fuit Franc. Rabelais, cujus manu in fronte illius scriptum legitur Francisci Rabelæsii Χινώνος μὲν τὸ γένος, τὴν αἵρεσιν δὲ φράγκισκανα [sic] ιατρου18 ». Bien sûr, il est probable que certains exemplaires soient arrivés dans les grandes bibliothèques aristocratiques pour d’autres raisons que l’ex-libris de Rabelais ou Montaigne, comme la fureur des aldines (ainsi du Gaza dans la bibliothèque du duc de Pembroke). Pour le début du xxe siècle, B. Pistilli et M. Sgattoni ont retrouvé une lettre de 1917 au grand libraire américain Lathrop Harper après la vente de la bibliothèque des Pembroke, au sujet de l’incunable de Théodore de Gaza (1495) qui sera revendu par ses soins à Alfred Chapin19. L’ouvrage provient peut-être de Pierre Eyquem. Son compatriote et prédécesseur au poste de sous-maire de Bordeaux, Charles de Candeley, avait un exemplaire de la même édition, conservé à la Mazarine, qu’il a pourvu de son ex-libris en grec20. En 1924, tandis que s’annonçait la vente des livres du collectionneur belge Hector de Backer, Seymour de Ricci signalait à A.S.W. Rosenbach, autre mythique libraire américain, l’intérêt de cette bibliothèque en remarquant qu’elle renfermait en particulier un ouvrage de Ronsard et un de Rabelais21 . Le livre de Rabelais, les Hieroglyphica, figura de fait ensuite dans une collection américaine, celle de Dannie Heinemann. Certains collectionneurs comme Maurice Escoffier, professeur d’histoire diplomatique à l’École libre des sciences politiques, ont aussi officié comme libraires – il ouvrit la « Maison du bibliophile » en 1922 – avant de devoir se séparer aux enchères de nombre de ses trésors à la suite de la crise de 1929. Il possédait plusieurs livres de Montaigne (Eusèbe, Du Choul). Bien sûr, une telle bibliothèque, à la provenance très convoitée, charrie son lot d’exemplaires douteux. On peut nourrir des soupçons sur l’authenticité de l’ex-libris du Boaistuau de la Lily Library (Indiana University). L’ex-libris paraît être issu, par calque, de 107l’authentique signature de l’Ausone de 1558 qui a appartenu à Payen et qui a peut-être été un moment dans la bibliothèque de Benjamin Fillon, ce qui serait un objet de soupçon supplémentaire.
De nombreuses zones d’ombre demeurent. On ignore où le patriote écossais Andrew Fletcher de Saltoun s’est procuré le lexique gréco-latin imprimé par Estienne en 1557, pourvu du précieux ex-libris montanien. Mais ses commissionnaires fréquentaient aussi assidûment le marché hollandais. Il y aurait lieu d’approfondir les travaux sur les transmissions des volumes dans les châteaux anglais ou britanniques22. Bien des livres importants pourvus des précieux autographes ont quitté la France au xviiie siècle pour garnir les rayons des bibliothèques de Wilton House (demeure de Thomas Herbert, le 8e duc de Pembroke), Picton Castle au Pays de Galles (demeure de lord Milford qui possédait le César de 1543 de Montaigne maintenant dans la bibliothèque de Jean Bonna), tandis que les Manchester à Kimbolton Castle ou Thomas Crofts, familier du comte de Fitzwilliam, possédaient des livres de Rabelais.
Il est un domaine où la bibliothèque de Rabelais pouvait s’enorgueillir de disposer de trois ensembles de Plutarque. Jusqu’ici le ou les Plutarque de Montaigne se faisai(en)t attendre. L’exhumation remarquable d’un exemplaire des Moralia dans l’édition de Vascosan, de 1565, pourvu de son ex-libris et dans sa reliure du temps, proposé aux enchères par une maison de ventes bordelaise (15 octobre 2020)23, vient rééquilibrer la balance.
Olivier Pédeflous
1 Harvard Library Bulletin, no 4, 1993, p. 40. Ma traduction.
2 Voir son Montaigne manuscrit, Paris, Classiques Garnier, 2010 (et les travaux antérieurs qui figurent en bibliographie) et des compléments dans l’article « À la recherche des premiers livres de Montaigne », dans Les Labyrinthes de l’esprit : collections et bibliothèques à la Renaissance, dir. A. Vanautgaerden et Rosanna Gorris Camos, Genève, Droz, 2015, p. 155-172. Voir aussi la mise à jour régulière de sa recherche en ce domaine sur le site des BVH, en particulier l’article d’Alain Legros et Marie-Luce Demonet, 10 mars 2020. D’utiles informations figurent encore dans Gilbert de Botton et Francis Pottiée-Sperry, « À la recherche de la “librairie” de Montaigne », Bulletin du bibliophile, 1997, no 2, p. 254-297, ainsi que Barbara Pistilli et Marco Sgattoni, La Biblioteca di Montaigne, Pise, Edizioni della Normale, 2014.
3 Un bilan provisoire figure dans Olivier Pédeflous, « Sur la bibliothèque de Rabelais », Arts et savoirs, 10, 2018 (en ligne). Voir également, pour la bibliothèque grecque, les développements nourris de Romain Menini, Rabelais altérateur, Paris, Classiques Garnier, 2014, troisième partie et l’Annexe.
4 On se reportera à l’article de Jean Balsamo et Philippe Desan, « Cher, très cher Montaigne », Montaigne Studies, no 16, 2004, p. 3-10.
5 Voir ici même la contribution de « Rabelais et Montaigne, lecteurs jumeaux ? (dans les marges du ‘Giraldus’) ».
6 BnF, RES-2-PAYEN 498 et RES-D2-5240. Voir Richard Cooper, « La bibliothèque italienne de Montaigne », dans La Librairie de Montaigne, dir. Ph. Ford, Cambridge, Cambridge French Colloquia, 2012, p. 45.
7 « La bibliothèque de Montaigne », Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft, 8, 31 août 1852, p. 211-213 et 9, 30 septembre 1852, p. 238-239 et « La bibliothèque de Michel de Montaigne », Revue de Bordeaux, I, 1854, p. 198.
8 Gustave Brunet y reprend et complète une note figurant dans ses Essais d’études bibliographiques sur Rabelais, Paris, Techener, 1841, p. 67-68 n. 1 (« L’autographe de Rabelais est rarissime… »), qui ne signale que les Hieroglyphica d’Horapollon (1521) et le Bembo (1532) de Montpellier.
9 Antoine Coron, « Les exemplaires annotés : des bibliothèques érudites aux cabinets d’amateurs », Revue de la BNF, no 2, 1999, p. 62.
10 Bulletin du bibliophile belge, I, 2e série, 1854, p. 30.
11 Voir Romain Menini, Rabelais altérateur, op. cit., p. 600-602.
12 La Bibliothèque du Prince, Château de Chantilly : les manuscrits, F. Vergne dir, Paris, Editerra, 1995, p. 43.
13 Description sommaire des objets d’art faisant partie des collections du duc d’Aumale exposés pour la venue du Fine Arts Club, le 21 mai 1862, no 527, p. 58.
14 Arthur Meyer, Mes livres, mes dessins, mes autographes, Paris, 1921, no 106 (Montaigne) et no 115 (Rabelais).
15 Jacques T. Quentin, Fleurons de la Bodmeriana. Chroniques d’une histoire du livre, Paris, L’Ingénu-Panama / Cologny, Fondation Bodmer, 2005, no 17 pour Rabelais, no 35 pour Montaigne. Voir Pistilli-Sgattoni, La Biblioteca di Montaigne, op. cit., no 77.
16 Pistilli-Sgattoni, La Biblioteca di Montaigne…, op. cit., no 19.
17 Sa bibliothèque fut vendue en 1925 (Très beaux livres anciens, 20-23 avril 1925, no 68). Il fit don de la quittance de Rabelais à la Bibliothèque nationale.
18 Catalogus bibliothecæ Boernerianæ, Leipzig, Breitkopf, 1754, section « Codices biblici », no 130, p. 9. Signalé dans S. de Ricci, La bibliothèque de Rabelais, 1925 (d’après une indication issue de la correspondance d’Abel Lefranc avec le conservateur de la bibliothèque de Dresde Schnorr von Carolsfed).
19 Pistilli-Sgattoni, La Biblioteca di Montaigne…, op. cit., no 40. Sa collection a intégré la bibliothèque de Williams College à Williamstown.
20 Inc. 833. Voir Denise Hillard, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques de France, VI. Bibliothèque Mazarine, Paris, Aux amateurs de livres, 1992, no 867. L’ouvrage figura ensuite dans la bibliothèque de Jean Gélida.
21 Voir Joseph Rosenblum, « The bookseller and the bibliographer. A.S.W. Rosenbach and Seymour de Ricci in the interwar period », The Book collector, 49, no 3, 2000, p. 383-396.
22 Des ajouts et pistes à ce sujet, pour le cas de Montaigne, se lisent dans John O’Brien, « A Book (or Two) from the Library of La Boétie », Montaigne Studies, no 27, 2015, p. 179-192. On consultera, plus généralement, l’essai de Christopher Edwards, « Antiquarian bookselling in Britain in 1725 : the nature of the evidence », dans A Genius for Letters. Booksellers and Bookselling from the 16th to the 20th Century, dir. R. Myers et M. Harris, Winchester/St Paul’s bibliographies et New Castle (Delaware), Oak Knoll Press, 1995, p. 85-102.
23 Voir la note d’Alain Legros en ligne : https://montaigne.univ-tours.fr/notes-de-lecture-de-montaigne/plutarque-annote-par-montaigne/ (consulté le 29/11/2020).