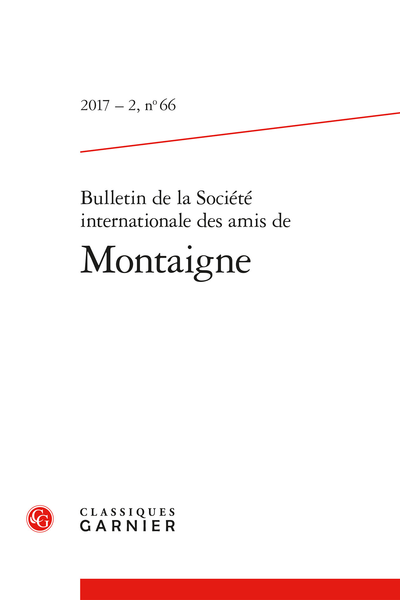
Montaigne et le temps
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2017 – 2, n° 66. varia - Auteur : Comte-Sponville (André)
- Résumé : Montaigne, philosophe du devenir, n’a pourtant que peu écrit sur le temps. Cet article vise à reconstituer la conception qu’il s’en fait. Le temps n’est ni un être ni une illusion : il n’existe pas par lui-même, mais il existe bien ; il est une dimension non substantielle mais objective de la nature, dans son perpétuel « passage », c’est-à-dire dans sa perdurable et toujours actuelle impermanence.
- Pages : 79 à 105
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406073444
- ISBN : 978-2-406-07344-4
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-07344-4.p.0079
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/10/2017
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Montaigne et le temps
Montaigne n’a consacré aucun de ses 107 essais au temps. Et le seul développement un peu substantiel qu’il s’autorise sur cette question, à la fin de l’Apologie de Raimond Sebond, n’est pas de lui : il est presque intégralement emprunté à Plutarque, en l’occurrence dans la belle traduction de Jacques Amyot, publiée en 1572. Cette absence et cet emprunt ne laissent pas de surprendre. Montaigne est un penseur du devenir, de l’impermanence, du passage comme il dit (« je ne peins pas l’être ; je peins le passage1 »). Or rien ne passe que dans le temps : comment se fait-il que Montaigne n’ait consacré à cette notion aucun texte un peu étendu et personnel ? Timidité spéculative ? Désintérêt pour une notion trop abstraite ? Ce n’est pas exclu. Montaigne se méfie des doctrines, surtout métaphysiques, et des abstractions, qui n’ont d’existence que verbale. Le nominalisme est l’une des dimensions, non la moindre, de son scepticisme. Pas étonnant qu’on ne trouve chez lui aucune définition du temps :
Notre contestation est verbale. Je demande [ce] que c’est que nature, volupté, cercle et substitution. La question est de paroles, et se paie de même. Une pierre c’est un corps. Mais qui presserait : Et corps, qu’est-ce ? – Substance, – Et substance, quoi ?, ainsi de suite, acculerait enfin le répondant au bout de son calepin. On échange un mot pour un autre mot, et souvent plus inconnu. Je sais mieux [ce] que c’est qu’homme que je ne sais ce qu’est animal, ou mortel, ou raisonnable. Pour satisfaire à un doute, ils m’en donnent trois : c’est la tête de l’hydre2.
80Marcel Conche a raison de rapprocher la position de Montaigne, sur ce point, de celle d’Épicure, lequel « supprime les définitions3 », notamment celles du temps, « disant qu’“il ne faut pas prendre en échange d’autres termes comme meilleurs”, car le temps lui-même se donne immédiatement dans l’évidence4 ». Et raison aussi de constater que la position d’Épicure n’est guère éloignée, de ce point de vue, de ce que sera celle de Blaise Pascal, lui-même très proche ici de Montaigne5. Cela, toutefois, n’empêche pas qu’il y ait, comme le notait Pascal, « bien de différentes opinions touchant l’essence du temps6 », et c’est celle de Montaigne que nous voudrions ici interroger. Il y a là quelque audace, puisque l’auteur des Essais, semble-t-il, « repousse ce genre de question7 ». Peut-être. Mais cela ne nous interdit pas de lui poser celle-ci, qui ne porte pas sur le sens du mot mais sur la nature de la chose : qu’est-ce que le temps ?
Partons du texte de l’Apologie, ou plutôt, puisque tout le monde ne l’a pas sous la main, de celui de Plutarque, dans le dernier traité de ses Œuvres morales, traduites par Amyot : Que signifiait ce mot E’i, qui était gravé sur les portes du temple d’Apollon en la ville de Delphes. C’est, de très loin, le plus long emprunt que Montaigne ait jamais fait à 81quiconque8, et à la fin de son essai le plus étendu. Nul doute qu’il attachait à ce passage une importance particulière. En voici le texte, dont je modernise l’orthographe et au sein duquel j’indique les principales modifications que Montaigne lui fait subir (à l’exception des changements de ponctuation : celle de Montaigne est plus appuyée, plus claire, plus rigoureuse) ; les passages qu’il supprime sont ici barrés, les formulations qu’il rectifie sensiblement sont indiquées entre crochets pointus, les ajouts entre crochets pointus et en italiques :
Nous n’avons aucune participation du vrai être <nous n’avons aucune communication à l’être>, pour ce que <parce que> toute humaine nature est toujours au milieu, entre le naître et le mourir, ne baillant de soi qu’une obscure apparence et ombre, et une incertaine et débile opinion ; et si d’aventure vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera ni plus ni moins que qui voudrait empoigner l’eau, car tant plus il serrera et pressera ce qui de sa nature coule partout, tant plus il perdra ce qu’il voulait retenir et empoigner : ainsi étant toutes choses sujettes à passer d’un changement en un autre, la raison y cherchant une réelle subsistance se trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant à la vérité et permanent, parce que tout ou vient en être et n’est pas encore du tout, ou commence à mourir avant qu’il soit né ; <Platon disait que les corps n’avaient jamais d’existence, oui bien naissance, estimant que Homère eût fait l’océan père des dieux, et Thétis la mère, pour nous montrer que toutes choses sont en fluxion, muance et variation perpétuelle : opinion commune à tous les philosophes avant son temps, comme il dit, sauf le seul Parménide, qui refusait mouvement aux choses, de la force duquel il fait grand cas ; Pythagore, que toute matière est coulante et labile ; les stoïciens, qu’il n’y a point de temps présent, et que ce que nous appelons présent n’est que la jointure et assemblage du futur et du passé> ; car comme soulait [avait coutume de] dire Héraclite, On ne peut pas entrer deux fois en une même rivière < ; Épicharme, que celui qui a piéça emprunté de l’argent ne le doit pas maintenant ; et que celui qui cette nuit a été convié à venir ce matin dîner, vient aujourd’hui non convié, attendu que ce ne sont plus eux : ils sont devenus autres ; et qu’il ne se pouvait trouver>, ni trouver une substance mortelle deux fois en un même état : car par soudaineté et légèreté de changement, tantôt elle [se] dissipe, et tantôt elle [se] rassemble, elle vient et puis s’en va, de manière que ce qui commence à naître ne parvient jamais jusqu’à perfection d’être, pour autant que ce naître n’achève jamais, ni jamais n’arrête comme étant à bout, ains [mais] depuis la semence va toujours se changeant et muant d’un en autre, comme de semence humaine se fait premièrement dedans le ventre de la mère un fruit sans forme, puis un enfant formé, puis étant hors du ventre, un enfant de mamelle, après il devient garçon, puis 82conséquemment un jouvenceau, après un homme fait, puis homme d’âge, à la fin décrépité vieillard : de manière que l’âge et génération subséquente va toujours défaisant et gâtant la précédente ;
<Car le temps change la nature du monde entier,
Toute chose doit passer d’un état à un autre,
Aucune chose ne reste semblable à elle-même : tout passe,
Tout change et se transforme, la nature y contraint ;>
et puis nous autres sottement craignons une sorte de mort, là où nous en avons déjà passé, et en passons tant d’autres ; car non seulement, comme disait Héraclite, la mort du feu est génération de l’air, et la mort de l’air, génération de l’eau ; mais encore plus manifestement le pouvons-nous voir en nous-mêmes, la fleur d’âge se meurt et passe quand la vieillesse survient, et la jeunesse se termine en fleur d’âge d’homme fait, l’enfance en la jeunesse, et le premier âge meurt en l’enfance, et le jour d’hier meurt en celui d’aujourd’hui, et le jourd’hui mourra en celui de demain, et n’y a rien qui demeure ni qui soit toujours un, ains renaissons plusieurs alentour d’un fantasme ou d’une ombre et moule commun à toutes figures, la matière se laissant aller, tourner et virer alentour. Car qu’il ne soit ainsi, Si nous demeurons toujours mêmes et uns, comme est-ce que nous nous réjouissons maintenant d’une chose, et puis après <et maintenant> d’une autre ? comment est-ce que nous aimons choses contraires, ou les haïssons, nous les louons ou nous les blâmons ? comment usons-nous d’autres et différents langages ? comment avons-nous différentes affections, ne retenant plus la même forme et figure de visage ni le même sentiment en la même pensée ? Car il n’est pas vraisemblable que sans mutation nous prenions autres passions, et ce qui souffre mutation ne demeure pas un même, et s’il n’est pas un même, il n’est donc pas aussi, ains quant et l’être tout un, change aussi l’être simplement, devenant toujours autre d’un autre : et par conséquent se trompent et mentent les sens de nature, prenant ce qui apparaît pour ce qui est, à faute de bien savoir [ce] que c’est qui est. Mais qu’est-ce donc qui est véritablement ? Ce qui est éternel, c’est-à-dire qui n’a jamais eu commencement de naissance, ni n’aura jamais fin de corruption, à qui le temps n’apporte jamais aucune mutation : car c’est chose mobile que le temps, et qui apparaît comme en ombre, avec la matière coulante et fluante toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente, comme le vaisseau percé, auquel sont contenues génération et corruption, à qui appartiennent ces mots, devant et après, et a été ou sera, lesquels tout de prime face montrent évidemment que ce n’est point chose qui soit : car ce serait grande sottise, et fausseté toute apparente, de dire que cela soit qui n’est pas encore en être, ou qui déjà a cessé d’être : et quant à ces mots de présent, instant, maintenant, par lesquels il semble que principalement nous soutenions et fondions l’intelligence du temps, la raison le découvrant incontinent, le détruit tout sur le champ, car il se fend et s’escache [s’écrase] tout aussitôt <car elle le fend incontinent et le part [le partage]> en futur et en passé, 83comme le voulant voir nécessairement mesparti [divisé] en deux. Autant en advient-il à la nature, qui est mesurée, comme au temps qui la mesure : car il n’y a non plus en elle rien qui demeure, ni qui soit subsistant, ains y sont toutes choses <ou nées> ou naissantes ou mourantes, mêlées avec le temps : au moyen de quoi ce serait péché de dire de <Dieu, qui est le seul qui> ce qui est, il fut ou il sera, car ces termes-là sont déclinaisons [changements], passages et vicissitudes de ce qui ne peut durer ni demeurer en être. Par quoi il faut conclure que Dieu seul est, et est non point selon aucune mesure de temps, ains selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps, ni sujette à aucune déclinaison, devant lequel rien n’est, ni ne sera après, ni plus nouveau ou plus récent, ains un réellement étant, qui par un seul maintenant emplit le toujours, et n’y a rien qui véritablement soit que lui seul, sans qu’on puisse dire il a été ou il sera, sans commencement et sans fin9.
On voit qu’il s’agit bien d’un emprunt, le plus souvent mot pour mot, et d’ailleurs expressément présenté comme tel10. Notons toutefois que Montaigne commence cette longue citation juste après, et l’interrompt juste avant, des passages où Plutarque se montre plus pieux ou plus théologien que dans celui – il est vrai déjà fort long – qu’on trouve reproduit presque intégralement dans l’Apologie. L’auteur des Vies parallèles, qui fut prêtre d’Apollon à Delphes, prônait en effet, dans les lignes qui précèdent, « une entière salutation et appellation de Dieu », célébrant « la grandeur de la puissance d’icelui », et concluait, dans les lignes qui suivent, que « C’est donc ainsi qu’il faut qu’en l’adorant nous le saluions, et révéremment l’appelions et le spécifions, ou vraiment, ainsi comme quelques-uns des anciens l’ont appelé, Toi qui es un : car Dieu n’est pas plusieurs, comme chacun de nous, qui sommes une confusion et un amas composé d’infinies diversités et différences procédant de toutes sortes d’altérations, ains faut que ce qui est soit un, et que un soit ce qui est : car diversité est la différence d’être, sortant de ce qui est pour produire ce qui n’est pas11. » On comprend que cela ait plu à Jacques Amyot, évêque d’Auxerre. À l’inverse, le choix que fit 84Montaigne, de ne pas retenir ces lignes-là, laisse augurer que ce n’est pas la théologie qui l’intéresse, ici comme ailleurs, mais bien la philosophie – non l’immuable mais le changeant, non Dieu mais la nature, non l’éternité mais le temps.
L’ajout, dans l’édition de 1588, des quatre vers de Lucrèce va dans le même sens : celui d’une pensée naturaliste du temps, comme puissance de changement, bien plus que de l’immuable éternité divine, à laquelle Lucrèce ne croit pas (les dieux d’Épicure, qui font partie de la nature, sont immortels, point atemporels) et sur laquelle Montaigne ne s’attarde guère, se contentant de citer Plutarque, sans rien ajouter, et en ne supprimant, au tout début du passage, que l’adjectif « vrai » accolé à « être ». Cette suppression radicalise le propos. Le contexte, dans le traité de Plutarque, suggère que le « vrai être » auquel nous n’avons pas accès, c’est Dieu ; dans le texte de Montaigne, c’est plutôt l’être même, quel qu’il soit, transcendant ou immanent, et sans se prononcer sur sa nature : position non plus religieuse mais philosophique, non plus idéaliste (Plutarque se veut platonicien) mais sceptique.
Les autres additions relevant de l’histoire de la philosophie (références à Platon, Pythagore, Épicharme…) semblent moins significatives – Montaigne aime faire état de ses lectures, jusqu’à se faire parfois doxographe –, sinon en ceci qu’elles manifestent ce que Montaigne perçoit comme un consensus, chez les Anciens, concernant l’universel devenir, ce qu’on pourrait appeler un héraclitéisme de fond – à la seule exception de Parménide, dont Platon faisait « grand cas » mais à l’avis duquel Montaigne, qui ne l’évoque que fort rarement et toujours parmi d’autres12, ne semble guère attacher d’importance. « Refuser le mouvement aux choses » ? C’est une position métaphysique soutenable, comme elles sont presque toutes, mais que ne saurait envisager sérieusement celui qui juge que « le monde n’est qu’une branloire pérenne », où « toute choses branlent [bougent] sans cesse13 »…
On pourrait s’étonner de voir Platon intégré de force à ces penseurs du devenir, sans qu’il soit fait référence à l’éternité du monde intelligible, dont le temps ne serait, selon le Timée (que Montaigne a lu, mais dont 85il ne cite jamais cette expression), que « l’image mobile14 ». C’est que Montaigne, qui prête volontiers aux autres sa propre liberté d’esprit, et même exagérément, n’arrive pas à imaginer que Platon, qu’il admire, ait vraiment cru à ses Idées, pas plus que Pythagore à ses Nombres ou qu’Épicure à ses Atomes15. Aussi préfère-t-il n’en retenir ici que ce qui lui paraît vrai, à savoir que toutes choses ici-bas « sont en fluxions, muance et variation perpétuelle16 ». On pourrait d’ailleurs faire la même réflexion concernant Pythagore : Montaigne n’en retient nullement l’idéalisme arithmologique (les Nombres, pour Pythagore, étaient sans doute aussi éternels que les Idées pour Platon), mais seulement une certaine conception de la matière comme « coulante et labile ». Lectures plus qu’orientées, comme on le voit, et qui en disent long sur l’orientation de Montaigne : le devenir, non l’immuable, est sa patrie.
Je parlais d’héraclitéisme… Au sens large du mot, comme pensée du devenir (« Panta rhei »), c’est assurément la position de Montaigne. Mais il ne semble pas qu’elle doive beaucoup au philosophe d’Éphèse, que Montaigne, là encore, n’évoque que rarement17, et plus souvent pour rappeler son obscurité18 ou sa tristesse19, l’une et l’autre légendaires, que pour s’appuyer positivement sur les quelques fragments qu’il en peut connaître. Notons d’ailleurs que c’est dans ce passage de l’Apologie – mais donc empruntées à Plutarque – que l’on trouve deux des très rares citations que Montaigne, qui aime tant citer, fait d’Héraclite, ce qui confirme que ce que nous appelons son héraclitéisme, pourtant incontestable, doit peu à l’auteur qui lui donne – mais pour nous, non pour Montaigne – son nom. Il n’en reste pas moins que la philosophie d’Héraclite, saisie par Plutarque (et au contraire de celles de Pythagore 86ou Platon présentées par Montaigne), est fidèlement présentée dans ce qu’elle apporte d’essentiel : une pensée du changement perpétuel (« Jamais homme n’est deux fois entré en même rivière20 ») et de l’unité des contraires (en l’occurrence de la mort, par exemple du feu ou de l’air, et de la génération, par exemple de l’air ou de l’eau21). Montaigne, ici, n’a pas à s’éloigner du cœur de la doctrine, ni de la tradition : même le connaissant mal, et seulement de seconde main, il se sent chez Héraclite comme chez lui.
Autre ajout à considérer, dans le texte de Montaigne : la référence aux stoïciens, qui disaient « qu’il n’y a point de temps présent, et que ce que nous appelons présent n’est que la jointure et assemblage du futur et du passé22 ». La source est à nouveau Plutarque, comme le note Villey, mais cette fois dans Des notions communes contre les stoïciens, au § XLI. On touche ici un point capital et difficile du stoïcisme. Chrysippe enseignait à la fois qu’« aucun temps n’est entièrement présent », puisque « toute durée peut-être indéfiniment divisée en passé et futur », et que « seul le présent existe », puisque le passé et le futur « subsistent » mais « n’existent pas du tout » (ce sont des incorporels23). Position paradoxale, souvent mal comprise, dès l’Antiquité, puisqu’elle semble affirmer à la fois l’inexistence du présent (il n’est, pour la pensée, qu’un instant sans durée) et son existence exclusive (puisque « seul le présent existe »). Le paradoxe se résout, Victor Goldschmidt l’a bien montré, dès lors que l’on comprend que « le temps se prend en deux acceptions », comme disait Chrysippe qui les désigne par le même mot, mais qu’on peut distinguer plus clairement, comme fera Marc Aurèle, en leur donnant deux noms différents : aiôn pour la somme infinie et infiniment divisible du passé et de l’avenir, qui « subsistent mais n’existent pas du tout », et chronos pour le seul temps qui existe véritablement, toujours au présent, puisqu’il est le présent même, indivisé (qui pourrait fractionner 87le présent24 ?) et qui ne cesse de continuer. Deux temps, donc, ou deux façons de le penser, mais dont l’une vise un temps qui n’existe pas (le temps-aiôn est un incorporel : passé et avenir ne « subsistent » que pour l’esprit), et dont l’autre est l’existence même (la seule qui soit réelle : celle des corps, dans le toujours-présent du monde25).
De ces deux acceptions, Montaigne semble ne retenir ici que la première, qui va jusqu’à nier la réalité du présent (« il n’y a point de temps présent26 »), anticipant en cela sur le texte de Plutarque qu’il citera un peu plus bas, selon lequel la raison « détruit » le temps ou le présent (le texte est innocemment équivoque : les deux reviennent au même) en les divisant en passé et futur. Il y a là une réelle difficulté, car Montaigne ne fait pas seulement du présent, avec Plutarque ou Platon, la seule temporalité – si l’on peut dire, puisqu’elle est alors éternelle – de l’Être (la majuscule, qu’on ne trouve pas chez Montaigne, indiquant ici l’unique être « réellement étant27 », celui de Dieu, comparable en cela à l’ontôs on de Platon28), mais aussi, en maints autres passages des Essais et cette fois citant volontiers Sénèque, le seul moment, pour nous et dans ce monde toujours changeant, de la sagesse ou du bonheur. Par exemple, au livre I, ceci :
Ceux qui accusent les hommes d’aller toujours béant après les choses futures, et nous apprennent à nous saisir des biens présents, et nous rasseoir en ceux-là, 88comme n’ayant aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n’avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs, s’ils osent appeler erreur chose à quoi nature même nous achemine pour le service de la continuation de son ouvrage, nous imprimant, comme assez d’autres, cette imagination fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l’espérance nous élancent vers l’avenir, et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est, pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est animus futuri anxius29.
Le texte indique clairement que « ce qui est », c’est ce qui est présent : non pas, en l’occurrence, l’Être « réellement étant » (Dieu), mais les étants toujours naissants et mourants, apparaissants et disparaissants (ce qu’on pourrait appeler les devenants), dont nous avons « le sentiment et la considération ». Ni passé ni avenir ne sont jamais donnés. C’est qu’ils ne sont pas. C’est d’ailleurs conforme au texte de l’Apologie, qui constatait avec Plutarque que « ce serait grande sottise et fausseté toute apparente de dire que cela soit qui n’est pas encore en être, ou qui déjà a cessé d’être30 ». Les « biens présents », d’évidence, ne relèvent pas de l’« éternité immuable et immobile » de l’Être divin, mais bien du temps « mobile » de la nature, en qui « rien ne demeure ni [n’est] subsistant », c’est-à-dire des devenants, donc aussi de « la matière coulante et fluante toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente31 ». D’où le problème : comment Montaigne peut-il parler de « biens présents », comme il parle ailleurs de « plaisirs présents32 », si le présent n’est rien ? Incohérence ? Ce n’est pas exclu, mais – principe de charité oblige – c’est une hypothèse à laquelle il convient de ne se ranger que si l’on n’en peut point trouver une autre, plus favorable à notre auteur. Est-ce le cas ? Sommes-nous face à une contradiction irréductible ? Il me semble que non. En l’occurrence, mon hypothèse de lecture est plutôt la suivante : s’il existe des « biens présents », comme dit Montaigne, et « point de temps présent », comme disaient « les stoïciens » qu’il cite, c’est que le présent n’est pas 89autre chose que ces biens mêmes, ou ces maux, disons que toutes ces « choses sujettes à passer d’un changement en un autre33 ». Le temps ne s’ajoute pas au devenir, de l’extérieur, comme s’il pouvait exister sans lui, pas plus d’ailleurs que l’éternité ne s’ajoute à l’Être. Il « n’y a rien qui véritablement soit que lui seul », écrit Montaigne à propos de Dieu34 : cela suppose que l’éternité n’existe pas indépendamment de lui (Dieu n’est pas dans l’éternité ; c’est l’éternité qui est en lui, ou de lui). De même, me semble-t-il, le temps n’existe pas indépendamment de ce qui change, donc indépendamment du devenir ou de la nature : il n’est pas autre chose que la perduration toujours changeante du monde. Cela pourrait expliquer que Montaigne, recopiant le texte de Plutarque, ait supprimé, vers la fin de la citation, l’expression « mêlées avec le temps », laquelle pouvait donner le sentiment que le temps existe indépendamment des choses (puisque celles-ci se « mêleraient » à lui). Pour Montaigne, me semble-t-il, il n’en est rien : cette « chose mobile » qu’est le temps (l’expression est de Plutarque) n’est pas une chose de plus, qui s’ajouterait ou se « mêlerait » aux autres, mais la mobilité de toutes. Il n’est pas un être, ni même un étant-devenant, mais comme l’ombre portée du devenir (il « apparaît comme en ombre35 »), dans la lumière du présent. Aussi comprend-on que Montaigne ne lui consacre aucun essai, ni même aucun développement suivi et personnel. Le temps « n’est point chose qui soit36 » : il n’est, pour la raison, que la somme infinie du passé et du futur, qui ne sont plus ou pas encore (l’aiôn de Marc Aurèle), et, pour la nature, que sa présence même, toujours changeante et toujours continuée, toujours actuelle et différente (le chronos de Chrysippe, qui « dans son ensemble est présent37 »).
Ce présent est-il un instant ? Non pas, puisqu’aucun instant, ni aucune somme d’instants, ne feraient une durée. Est-il une durée ? Non plus, puisque toutes peuvent se diviser en passé et futur. Qu’est-il ? Rien qui soit, si l’on entend par là un « réellement étant » (ce que « Dieu seul est »), mais rien d’autre non plus que « ce qui apparaît38 » et disparaît, 90naît et meurt, non pas au début et à la fin (puisqu’on n’en finit pas, tant qu’on vit, de naître et de mourir) mais dans un processus perpétuel de mort et de génération, comme Héraclite l’avait vu, autrement dit rien d’autre que la nature ou le devenir, où « toutes choses », pour citer à nouveau Platon cité par Montaigne, « sont en fluxion, muance et variation perpétuelle39 ».
Une telle interprétation tire-t-elle trop fortement Montaigne du côté du Portique ? Sans doute, si l’on voulait lire dans le texte de l’Apologie une adhésion explicite à la conception stoïcienne du temps, ou même une influence avérée de celle-ci sur celui-là. Plutarque n’est nullement stoïcien, et Montaigne, qui le préfère de plus en plus à Sénèque40, ne se pique guère de l’être. Je crois davantage à une rencontre, certes nourrie par des lectures, comme sont toujours les Essais, mais davantage appuyée sur l’expérience que leur auteur, comme chacun d’entre nous, a du devenir, donc aussi du temps, et par le double constat qu’elle lui impose : que rien n’existe qu’au présent, et que le présent n’est pas un être. Il ne semble pas que Montaigne ait lu les Confessions de saint Augustin41, mais il rejoint, au moins pour une part, l’analyse quasi phénoménologique de l’évêque d’Hippone : « Ni l’avenir ni le passé n’existent », et le présent n’est réel – et différent de l’éternité – qu’en tant qu’il ne cesse de s’abolir42. Toutefois Montaigne ne dirait pas que le temps n’est qu’une « distension de l’âme43 » : il le juge plutôt indissociable de l’universel changement de la nature, donc déjà de « la matière coulante et fluante toujours44 ». Comme l’a bien vu Marcel Conche, le temps, ou plutôt, préférerais-je dire, le devenir (puisque le temps n’est pas un être, ni donc une cause), « affecte les choses non dans leur seule phénoménalité, mais dans leur être même45 ». Ce n’est pas le temps qui est spirituel ; c’est l’âme qui est temporelle, c’est-à-dire soumise au changement perpétuel. « Bien loin que le temps soit dans la dépendance de l’âme, c’est l’âme au contraire (et les facultés de connaissance) qui se trouve de part en 91part dans la dépendance du temps46 » : l’âme fait partie de la nature (elle ne vient pas « d’ailleurs que d’une suite naturelle47 »), elle n’est pas « quelque autre chose hors du corps48 » mais au contraire « naît, croît et vieillit avec lui49 », dont elle ne cesse de dépendre50. Notre condition est « merveilleusement [étonnamment] corporelle51 ». Montaigne s’en accommode volontiers : « La vie est un mouvement matériel et corporel, action imparfaite de sa propre essence, et déréglée ; je m’emploie à la servir selon elle52. »
C’est le point où Montaigne est le plus proche des matérialistes53, spécialement de Lucrèce, qu’il cite abondamment. Il l’est aussi s’agissant du temps. Si l’interprétation que je propose est correcte, Montaigne pourrait écrire, avec le disciple latin d’Épicure :
Le temps n’existe pas par lui-même, mais c’est des événements [rebus ipsis]
Que découle le sentiment de ce qui s’est accompli dans le passé,
De ce qui est présent, de ce qui viendra par la suite ;
Et personne, il faut le reconnaître, n’a le sentiment du temps en soi,
Indépendamment du mouvement des choses et de leur paisible repos54.
On pourrait m’objecter que ces cinq vers ne font pas partie des quatre-cent-cinquante-quatre que Montaigne emprunte expressément à Lucrèce55. Le fait est. Mais Montaigne les avait lus et en avait même noté par deux fois l’essentiel. Une fois en latin, sur une page de garde de son exemplaire personnel du De rerum : « Tempus per se non est sed rebus ab ipsis consequitur sensus » (le temps n’existe pas par soi mais nous 92tirons des choses elles-mêmes [des événements] le sentiment [de son existence]). Et une fois en français, dans la marge, en face de ces mêmes vers : « Le temps, chose n’ayant de soi nulle essence56 ». Là encore, je ne prétends nullement que cela vaille comme adhésion. Mais je ne vois rien, dans les Essais, qui dise le contraire de ce que Montaigne avait lu et noté chez Lucrèce, à savoir que le temps n’est pas un être (il n’a « de soi nulle essence ») et que nous n’avons le sentiment ou la sensation (sensus) de son existence que relativement aux choses qui adviennent et passent (les événements).
Faut-il en conclure que le temps n’a de réalité que subjective ? Nullement. Car les choses passent effectivement, ou plutôt ne cessent de « passer d’un changement en un autre », comme dit Montaigne citant Plutarque57, et cela, bien évidemment, que nous en ayons conscience ou non. Le temps n’est pas un être (il « n’existe pas par lui-même »), mais point non plus une illusion. Il apparaît « comme en ombre58 », écrit Montaigne ; or une ombre, si l’on file la métaphore, n’est pas une illusion : elle n’est pas un être (pas une chose), encore moins une partie de l’Être immuable, mais elle existe objectivement (apparaît puis disparaît) et relativement (à la lumière, à ce corps qui la masque, à cet autre qui en reçoit l’ombre portée), qu’on la perçoive ou pas. Celui qui « dévale à l’ombre59 » ne la crée pas. Il perçoit bien quelque chose de réel (il fait réellement plus sombre ici que là-bas, même lorsque personne n’est là pour s’en rendre compte), mais qui n’est pas une chose de plus, qui s’ajouterait aux autres : l’ombre existe objectivement mais point substantiellement, indépendamment ou absolument. Telle est, me semble-t-il, la conception montanienne du temps : il n’existe pas par lui-même mais il existe bien ; il est une dimension non substantielle mais objective de la nature, par quoi « il n’y a en elle rien qui demeure ni qui soit subsistant60 ». Il n’est pas un être, ni même un flux (ce n’est 93pas lui qui passe : ce sont les choses), mais rien n’est ni ne passe, dans la nature, sans lui ou hors de lui.
On retrouve ici ce qu’on a pu appeler le « nominalisme » de Montaigne. De même que Guillaume d’Ockham écrivait que « Courbure et droiture ne signifient pas des choses qui sont distinctes des choses qui sont courbes ou droites61 », Montaigne pourrait écrire que le mot « temps » ne désigne pas une chose qui soit distincte des choses temporelles, autrement dit de ce qui dure et change, naît et meurt, apparaît et disparaît. Le temps n’existe pas par lui-même, ni en lui-même (on ne peut le considérer isolément que par abstraction) ; mais rien, dans la nature, ne lui échappe. C’est qu’il est la nature même, qui ne cesse de durer et de changer : « Le monde n’est qu’une branloire pérenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant62. » Marcel Conche avait donc raison, commentant Montaigne, de citer Ronsard :
Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame.
Las ! le temps non, mais nous nous en allons.
Tout passe, du moins ici-bas, sauf le temps seul, qui « ne passe pas63 ».
J’évoquais en commençant une éventuelle « timidité spéculative » de Montaigne… S’agissant du temps, il y a autre chose : pour qui utilise, même implicitement, le redoutable rasoir d’Ockham64 (ne pas multiplier inutilement les entités), le temps n’est qu’un mot, dont on ne peut certes se passer, pour décrire notre expérience, mais qu’on aurait tort d’hypostasier ou d’ériger isolément en être. Ce qui est réel, pour Montaigne, ce n’est pas le temps, c’est le changement, le « branle », le devenir, le « passage », qui n’existent qu’au présent – puisqu’ils sont l’existence même, dans sa perduration toujours actuelle et toujours mobile. C’est donc du présent qu’il faut s’occuper, et auquel Montaigne ne cesse de nous ramener. Non, certes, qu’il s’agisse de vivre dans l’instant, ce que nul ne peut ni ne 94doit. L’exemple d’Épicharme, pour revenir au texte de l’Apologie, est une claire exagération, à laquelle Montaigne ne saurait souscrire : celui « qui a piéça emprunté de l’argent65 » doit assurément rembourser sa dette, de même – l’exemple est autrement fort – que celui qui a promis, sous la menace, de remettre une « certaine somme » à des brigands qui l’ont agressé, se doit, une fois « hors de leurs mains », de tenir sa parole66. L’enjeu, ici, est plutôt éthique que métaphysique, mais sans violer en rien ce que j’appellerais volontiers l’actualisme de Montaigne. Seul le présent existe ; mais la mémoire, qui fait partie du présent, interdit de tenir le passé pour rien. Elle ne tient lieu ni d’entendement ni de conscience67, ni même de science68. Mais elle est moralement nécessaire (pour tenir ses engagements) tout en restant insuffisante (encore faut-il les tenir : ce n’est plus mémoire mais volonté). L’enjeu est décisif : « Autrement, de degré en degré, nous viendrons à renverser tout le droit qu’un tiers prend de nos promesses et serments69 ». Cela vaut aussi par rapport à soi et pour l’avenir. Montaigne, entreprenant de se peindre « si continuellement, si curieusement » [avec tant de soin] dans les Essais, voit bien qu’il « s’engage à un registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force70 ». Aussi ne juge-t-il pas qu’il y ait « perdu [son] temps71 », puisqu’il s’y est trouvé, au contraire, ou plutôt puisqu’il s’y est « fait72 ». L’identité personnelle, telle que Montaigne la conçoit, n’est pas ontologique (nul ne demeure « toujours même et un73 », et « s’il n’est pas un même, il n’est donc pas aussi74 ») mais indissociablement éthique et linguistique. « Nous ne sommes hommes, et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole75. » C’est pourquoi le mensonge est « un maudit vice76 », qui corrompt en chacun l’essentiel : le rapport aux autres, à la vérité 95et à soi. « Chacun doit avoir juré à soi-même ce que les rois d’Égypte faisaient solennellement jurer à leurs juges : qu’ils ne se dévoieraient de leur conscience pour quelque commandement qu’eux-mêmes [les rois] leurs fissent77. » Mais il ne suffit pas d’avoir juré (dans le passé) ; il faut se souvenir de sa parole (jour après jour, donc toujours au présent) et lui rester fidèle. « Le jour d’hier meurt en celui du jourd’hui, et le jourd’hui mourra en celui de demain78 », certes ; mais cela ne saurait justifier qu’on manque à sa parole : c’est toujours le jourd’hui, pour la conscience comme pour le monde. Nul ne tient ses promesses au passé ou au futur.
Non pas vivre dans l’instant, donc, mais vivre dans un présent qui dure et change, qui est le présent même. Du moins c’est l’idéal que Montaigne nous propose, sans s’illusionner beaucoup sur notre capacité à l’atteindre. C’est ce que montrait bien clairement le début, que je citais plus haut, du troisième chapitre du livre I. « Aller toujours béant après les choses futures », au lieu de « nous saisir des biens présents », c’est certes « la plus commune des humaines erreurs ». Sauf que Montaigne ajoutait, on s’en souvient : « s’ils osent appeler erreur chose à quoi nature même nous achemine, pour le service de la continuation de son ouvrage79 ». Comment mieux dire que la préoccupation de l’avenir, même si elle est une « imagination fausse » (du point de vue de la raison : elle donne au futur une réalité qu’il n’a pas), obéit à une nécessité vitale, que la nature, « plus jalouse [plus 96soucieuse] de notre action que de notre science80 », inscrit en nous ? Même Épicure, qui prétendait « dispenser son sage de la prévoyance et sollicitude de l’avenir », est incapable, en pratique, de s’y tenir : il « se console en sa fin sur l’éternité et utilité de ses écrits81 », donc sur sa postérité (« la réputation qu’il en espérait acquérir après sa mort82 »). Et il est vraisemblable que Montaigne, quoiqu’il prétendît écrire son livre « à peu d’hommes et à peu d’années83 », n’y échappe pas : il annonçait d’ailleurs, dès l’envoi du livre I, que ses essais devaient aider ses proches, une fois qu’il ne serait plus, à « retrouver » ce qu’il avait été84.
Cela n’annule aucunement la volonté de vivre au présent, dans la mesure du possible, mais la relativise – car cette mesure est strictement limitée : les exigences de l’action, c’est-à-dire de la nature elle-même, interdisent de s’y conformer absolument. Il y a là quelque paradoxe, puisque le présent s’impose, qu’on le veuille ou non (« On peut regretter de meilleurs temps, mais non pas fuir aux présents85 »). Vivre au présent, de ce point de vue, est moins l’objet d’un choix qu’une nécessité, à quoi nul n’échappe. Mais presque tous le voudraient, et même y tendent, absurdement, par l’imagination, laquelle fait objectivement partie du présent mais tend, subjectivement, à nous empêcher d’en jouir. Ce n’est pas toujours le cas : il arrive que l’imagination s’ajoute au plaisir et l’augmente (par exemple dans la vie érotique86). Mais plus souvent qu’elle nous en sépare, à force d’« outrepasser87 » le présent. Le souci, comme inquiétude actuelle portant sur l’avenir, fait partie de la condition humaine. « Nous pensons toujours ailleurs ; l’espérance d’une meilleure vie nous arrête et appuie, ou l’espérance de la valeur de nos enfants, ou la gloire future de notre nom, ou la fuite des maux de cette vie, ou la vengeance qui menace ceux qui nous causent la mort88… » C’est là un effet de « la forcenée curiosité de notre nature, s’amusant à préoccuper [saisir d’avance] les choses futures, comme si elle n’avait pas 97assez à faire à digérer les présentes89 ». Il faut donc l’accepter, tout en essayant, autant que faire se peut, d’en alléger le poids. De là un art du temps, qui est une partie essentielle de la sagesse en général, et de celle de Montaigne en particulier. Il s’agit de ménager le temps, plutôt que de le passer, donc de profiter du présent plutôt que de rester l’esclave de l’avenir (c’est-à-dire de l’imagination actuelle, presque toujours inquiète ou impatiente, que l’on s’en fait). Le thème est bien connu90 ; on me pardonnera de ne l’évoquer que rapidement.
Le contre-modèle, ici, est celui des occupati (les affairés), comme disait Sénèque, qui ont « l’âme toujours penchée vers l’avenir », qui « se donnent tout entier à l’espoir », qui « ne vivent pas mais se préparent à vivre », enfin qui « édifient leur vie aux dépens de la vie91 ». Montaigne, contre eux, est presque aussi sévère que Sénèque :
Ce sont gens qui passent vraiment leur temps ; ils outrepassent le présent et ce qu’ils possèdent, pour servir à l’espérance et pour des ombrages et vaines images que la fantaisie [l’imagination] leur met au devant,
Semblables à ces fantômes qui voltigent, dit-on, après la mort,
Ou à ces songes qui trompent nos sens endormis,
lesquelles hâtent et allongent leur fuite à même [à mesure] qu’on les suit92.
Montaigne, à l’inverse, ne veut pas passer le temps, mais le ménager. Qu’est-ce à dire ? D’abord qu’il refuse de se précipiter, quand nulle urgence n’y contraint :
Ésope, ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant : Quoi donc, fit-il, nous faudra-t-il chier en courant ? Ménageons le temps ; encore nous en reste-t-il beaucoup d’oisif et mal employé93.
98On voit qu’il ne s’agit nullement de faire l’éloge de la paresse ou de l’inaction, mais bien plutôt celui d’une sagesse en acte (« nous sommes nés pour agir94 ») plutôt qu’en attente (« Chacun court ailleurs et à l’avenir, d’autant que nul n’est arrivé à soi95 »). C’est ce que Montaigne appelle la nonchalance, qui est comme le contraire du souci et qui n’est pas sans rappeler le « détachement par rapport au fruit de l’acte » dans les sagesses orientales :
Je veux qu’on agisse, et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’ont peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait96.
« Vivre à propos97 », pour Montaigne, c’est-à-dire « de manière opportune, au bon moment ou à bon escient98 », c’est d’abord vivre au présent, donc savoir « prendre le temps » (saisir « l’opportunité », le moment favorable99), plutôt que le passer ou le perdre, savoir « bien dispenser [employer] les heures100 », savoir « méditer et soigner » sa propre vie101, savoir la « vivre » sans « mépriser notre être102 ». Telle est notre « besogne », ou la plus grande de toutes103. Cela n’exclut pas d’autres résultats, ni même d’autres buts (« régner, thésauriser, bâtir104 »), mais importe davantage. Point besoin de hauts faits pour vivre en acte ! « Nous 99sommes de grands fols : Il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous ; je n’ai rien fait aujourd’hui. – Quoi, avez-vous pas vécu ? C’est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations105 ». Ainsi Socrate, qui, « tout vieil, trouve le temps de se faire instruire à baller [danser] et jouer des instruments », qui « ne refusait ni à jouer aux noisettes avec les enfants, ni à courir avec eux sur un cheval de bois, et y avait bonne grâce : car toutes actions, dit la philosophie, siéent également bien et honorent également le sage106 ».
Sagesse de l’action : sagesse en acte (vivre en est un107, et la condition de tous les autres). C’est vivre sa vie, plutôt que la rêver. « Ma philosophie est en action, écrit Montaigne, en usage naturel et présent, peu en fantaisie [en imagination]108. » Non, bien sûr, qu’il s’interdise tout projet : ce n’est pas plus possible, ni ne serait plus acceptable, que de s’amputer de la mémoire. Mais ses projets, il les veut à court terme, d’autant plus que la mort se rapproche109, ou en tout cas toujours « divisibles » et susceptibles d’être interrompus sans regrets. « Il ne faut rien desseigner [projeter) de si longue haleine, ou au moins avec telle intention de se passionner pour n’en voir la fin110. » Ce conseil qu’il donne, il le suit facilement, non parfois sans quelque égoïsme : « Je vis du jour à la journée ; et, parlant en révérence, ne vis que pour moi : mes desseins se terminent là111. » La vie n’a pas d’autre finalité qu’elle-même112, pas d’autre justification que le plaisir qu’on y trouve113. C’est pourquoi Montaigne aime tellement les voyages, qui en sont comme la métaphore : ils peuvent bien avoir un but, où l’on désire se rendre, mais valent surtout par le cheminement même. Par exemple lorsque Montaigne part en Italie : son but, pourrait dire un 100stoïcien (son skopos : Rome), n’est pas sa fin (son telos : le voyage lui-même), ni forcément son terme (puisqu’on n’est jamais certain de l’atteindre). Le Journal de voyage en porte témoignage : lorsque ceux qui l’accompagnaient reprochaient à Montaigne de ne se tenir à aucun itinéraire préétabli, « il répondait qu’il n’allait, quant à lui, en nul lieu que là où il se trouvait, et qu’il ne pouvait faillir ni tordre sa voie, n’ayant nul projet que de se promener par les lieux inconnus114… » Les Essais le confirment : « S’il fait laid à droite, je prends à gauche ; si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m’arrête. […] Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne ; c’est toujours mon chemin115. » Le temps qu’il y faut est le contraire d’un temps perdu :
– Mais en tel âge, vous ne reviendrez jamais d’un si long chemin. – Que m’en chaut-il [Que m’importe] ? Je ne l’entreprends ni pour en revenir, ni pour le parfaire [pour l’achever] ; j’entreprends seulement de me branler pendant que le branle me plaît. Et me promène pour me promener. […] Mon dessein est divisible partout ; il n’est pas fondé en grandes espérances ; chaque journée en fait le bout. Et le voyage de ma vie se conduit de même116.
Ce thème du vivre au présent, plutôt stoïcien dans les premiers essais, prendra volontiers, dans le livre III, des accents épicuriens. Par exemple dans ce passage, si justement célèbre, du dernier chapitre :
Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; voire et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Nature a maternellement observé cela, que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses, et nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par l’appétit : c’est injustice de corrompre ses règles117.
Soit, dira-ton, lorsque le plaisir est là. Mais lorsqu’il fait défaut ? Lorsqu’il n’y a que la souffrance ou l’ennui ? C’est alors le moment de « passer le temps », en effet, de le « courir », comme dit Montaigne. Affaire d’opportunité, qui suppose qu’on sache s’adapter au cours changeant 101des choses. « Ménager le temps », c’est déguster le présent, lorsqu’il est agréable, et le laisser fuir – le plus vite possible, subjectivement, donc sans s’y attarder, sans le retenir (par la mémoire) ni l’anticiper (par l’imagination) – lorsqu’il ne l’est pas. Montaigne ne méprise pas les divertissements, voire en fait, contre les chagrins, une espèce de stratégie, qu’il appelle la « diversion118 ». La lecture en est une, particulièrement efficace et délectable : « Si quelqu’un me dit que c’est avilir les muses de s’en servir seulement de jouet et de passe-temps, il ne sait pas, comme moi, combien vaut le plaisir, le jeu et le passe-temps. À peine que je ne dise toute autre fin être ridicule119. » Toutefois le passe-temps ne fait pas un bonheur, qui demande davantage d’attention, d’« application », de « ménage ». Montaigne s’en explique à la toute fin des Essais, dans le dernier chapitre du livre III :
J’ai un dictionnaire tout à part moi : je passe le temps, quand il est mauvais et incommode ; quand il est bon, je ne le veux pas passer, je le retâte, je m’y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l’usage de ces prudentes gens, qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, de la passer, gauchir [esquiver] et, autant qu’il est en eux, ignorer et fuir, comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre, et la trouve et prisable et commode, voire en son dernier décours, où je la tiens ; et nous l’a nature mise en main, garnie de telles circonstances, et si favorables, que nous n’avons à nous plaindre qu’à nous si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. […] Je me compose [je m’exerce] pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste et importune. […] Il y a du ménage [du soin, de l’art, de l’habileté] à la jouir : je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d’application que nous y prêtons. Principalement à cette heure que j’aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids ; je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l’usage compenser la hâtiveté de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine120.
Je cite ici l’édition de 1588 (la couche B), où la pensée est la plus continue et la plus claire. Sur l’Exemplaire de Bordeaux, Montaigne fait deux ajouts manuscrits, qui brisent quelque peu l’enchaînement des idées 102mais en précisent l’orientation. Il ajoute d’abord, en latin, une citation de Sénèque citant lui-même Épicure : « Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur » (La vie de l’insensé est ingrate, inquiète, tout entière portée vers l’avenir121). Nouvelle confirmation que le « vivre au présent », chez Montaigne, doit moins à telle ou telle doctrine particulière qu’à une espèce de sagesse universelle, dont Montaigne, butinant « deçà delà les fleurs », fait son miel, qui est « tout sien122 ». Puis, quelques lignes plus bas, après avoir noté qu’il s’exerçait à perdre la vie sans regret, Montaigne ajoute : « Aussi ne sied-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu’à ceux qui se plaisent à vivre123. » Qu’est-ce à dire ? Sans doute ceci : que ceux qui n’acceptent de mourir que parce qu’ils n’éprouvent nul plaisir à vivre ne manifestent en cela aucune sagesse, ni n’y ont aucun mérite. Ils meurent comme ils ont vécu, vainement. Ils « ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que la couler et échapper » ; pourquoi regretteraient-ils qu’elle leur échappe ? La vie leur est « moleste et importune » ; pourquoi regretteraient-ils de la quitter ? Il en va tout autrement du sage selon Montaigne. Lui « aime la vie124 », et c’est parce qu’il veut l’aimer comme elle est (« perdable de sa condition », c’est-à-dire mortelle) qu’il accepte de mourir et s’efforce de le faire sans regrets.
C’est où l’écart avec la divinité, donc avec l’Être, si fortement marqué à la fin de l’Apologie, se réduit, à la fin du livre III, étrangement : « C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être125. » Comment est-ce possible, si « nous n’avons aucune communication à l’être », si « Dieu seul est », si le présent ni le moi ne sont126 ?
Incohérence ? Là encore, on ne peut l’exclure, pas plus qu’on ne doit s’y résigner sans essayer de trouver d’abord une autre solution, plus favorable à notre auteur.
Évolution ? Elle me paraît vraisemblable : Montaigne, vieillissant, se soucie de moins en moins de théologie, de plus en plus de sagesse, 103mais humaine, autrement dit « gaie et sociable127 », « sans miracle et sans extravagance128 ». La confrontation des deux textes – la fin de l’Apologie, la fin du livre III – n’en reste pas moins problématique. Quant au fond, il me semble qu’il existe bien, dans la pensée de Montaigne, une tension entre deux pôles, dont la compatibilité ne va pas de soi. Le premier (qu’on peut appeler le pôle négatif, puisqu’il nous voue au néant) mesure l’être à sa durée (la nature), voire à son immuabilité sans mesure (Dieu), et nous en exclut : « Étant hors de l’être, nous n’avons aucune communication avec ce qui est129. » C’est ce qu’on pourrait appeler le pôle platonicien, en l’occurrence emprunté à Plutarque, comme on l’a vu, mais aussi formulé par Montaigne lui-même, toujours dans l’Apologie, en une phrase que Marcel Conche a citée, me semble-t-il, plus souvent qu’aucune autre :
Pourquoi prenons-nous titre d’être, de cet instant qui n’est qu’une éloise [qu’un éclair] dans le cours infini d’une nuit éternelle, et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition, la mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et une bonne partie encore de ce moment130 ?
C’est proportionner l’être à la durée, comme Montaigne, à la fin du même essai, le proportionnera à l’immuabilité. Auquel cas « Dieu seul est », en effet, et notre vie ici-bas semble être comme une mort131. On ne s’étonnera pas que j’aie, sur ce point, quelque peine à acquiescer… C’est l’une de mes divergences avec Montaigne, comme aussi avec Marcel Conche132 : je ne vois pas en quoi un événement fugace – l’envol d’un oiseau, un éclair, un sourire, une gifle – sont moins réels qu’un objet apparemment immuable (« la Terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte ») ou même absolument permanent (« Dieu »). Et il me semble que Montaigne lui-même, à la fin du livre III, le voit de moins en moins, ou y attache de moins en moins d’importance. C’est 104le deuxième pôle que j’évoquais, qu’on peut appeler positif puisqu’il nous ouvre à la positivité du présent. Il n’annule pas le précédent mais s’installe en tension avec lui et pousse – surtout dans le livre III ou les couches B et C des deux premiers livres – à en corriger les effets. Dès lors que « c’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être », il faut en conclure que le passage a bien, lui aussi, sa réalité, certes éphémère (c’est en quoi les deux pôles ne sont pas contradictoires : nous sommes voués et au néant, par le temps, et à l’être, par le présent), mais qui n’en est pas moins réelle pour autant. Nous ne sommes pas l’Être, ni même un être (puisque nous ne cessons de changer), mais nous sommes (puisque nous changeons). « Le soin que chaque animal a de sa conservation et de fuir ce qui nuit » est sans doute la première « loi vraiment naturelle », comme « l’affection que l’engendrant porte à son engeance » est la seconde133. Il y a là comme une espèce de conatus, qui inclut la filiation. Persévérer dans l’être et le transmettre (« l’étendre et faire aller avant »), voilà ce que la nature « semble nous avoir recommandé134 ». À quoi Montaigne ajoute, après 1588, ceci, qui est décisif : « Nous avons cher, être [nous chérissons l’existence] ; et être consiste en mouvement et action135. » Il n’y a plus à choisir, ici, entre l’être et le devenir : celui-là « consiste » en celui-ci, celui-ci est la seule occurrence, pour nous, de celui-là. « Jouir loyalement de son être », ce n’est pas échapper au devenir : c’est jouir de ce passage même, qui nous traverse et nous constitue (« notre vie n’est que mouvement136 »), c’est « conserver et durer137 », comme Montaigne s’efforça de faire à la mairie de Bordeaux, non pour tendre vers une impossible immuabilité, mais pour « demeurer fidèle à la présence138 », c’est-à-dire à la nature elle-même, qui ne conserve et ne dure qu’en changeant. « Absolue perfection », qui n’est que « comme divine » (nous ne sommes pas Dieu), mais qui ne cesse pas pour autant – tant qu’elle continue – d’être parfaite et absolue. On pense à Spinoza (« Par réalité et par perfection, j’entends la même 105chose139 »), et l’on n’a pas forcément tort140. Rien, pour Montaigne comme pour Spinoza, n’est « contre nature141 », ni hors d’elle ; tout n’est que « selon elle [la nature], quel qu’il soit142 », et est donc, au présent, tant qu’il passe. Toutes choses, dans la nature, « sont ou nées, ou naissantes, ou mourantes143 » ; c’est ce qui les sépare de Dieu, qui ne naît ni ne meurt, mais aussi du néant, qui ne naît ni ne meurt davantage : disons que c’est leur façon d’être, c’est-à-dire de passer.
La tension n’en demeure pas moins, entre ces deux pôles. On ne pourrait tout à fait les concilier, au moins intellectuellement, qu’à partir d’une tout autre conception de l’éternité : il faudrait cesser de la confondre avec l’immuabilité, comme font Platon, Plutarque ou Montaigne, mais aussi avec la sempiternité (la somme infinie du passé et de l’avenir), comme font souvent les Modernes. Cette éternité-là ne serait plus le contraire du devenir mais son actualité pérenne : le toujours-présent du réel et du vrai, qui ne se distinguent qu’au passé ou au futur (donc que pour la pensée) et qui sont, au présent, l’être même, éternellement changeant et continuant (« en continuelle mutation et branle144 »), c’est-à-dire le devenir en acte – ce que j’appelle l’être-temps. Ce serait penser que le temps et l’éternité sont une seule et même chose (quelle chose ? le présent), ce que Montaigne, assurément, ne dit pas, et que j’ai essayé, ailleurs, de concevoir145.
André Comte-Sponville
1 Essais, III, 2, p. 805 B. Je cite Montaigne d’après l’édition Villey-Saulnier, Paris, PUF, 1965, dont je modernise toujours l’orthographe, parfois la ponctuation, rarement l’expression. Les lettres A, B et C indiquent les trois « couches » du texte : A pour les premières éditions des deux premiers livres (en 1580 et 1582), B pour l’édition de 1588 (avec le livre III), C pour les ajouts ultérieurs.
2 Essais, III, 13, p. 1069 B. Sur le « nominalisme » de Montaigne (et quoique ce soit un mot que ce dernier n’utilise pas), voir Antoine Compagnon, Nous, Michel de Montaigne, Paris, Seuil, 1980, p. 22 et suiv. (« L’individu ou l’universel »). Voir aussi Marcel Conche, Montaigne et la philosophie, I (« L’homme sans définition »), Mégare, 1987, rééd. Paris, PUF, 1996, p. 12 : « Montaigne est tout naturellement nominaliste dans sa conception de l’universel ».
3 Selon le témoignage de Cicéron, De Fin., I, 7, 22 (tollit definitiones), cité par Marcel Conche, Montaigne et la philosophie, III (« Le temps, la mort, l’ignorance »), op. cit., p. 44.
4 M. Conche, op. cit., p. 44 (qui cite la Lettre à Hérodote et renvoie en note à son édition d’Épicure, Paris, PUF, 1987, p. 117 et 171 sq.).
5 « Il n’y a rien de plus faible que le discours de ceux qui veulent définir ces mots primitifs. Quelle nécessité y a-t-il d’expliquer ce qu’on entend par le mot homme ? Ne sait-on pas assez quelle est la chose qu’on veut désigner par ce terme ? […] Il y a des mots incapables d’être définis. […] Le temps est de cette sorte. Qui le pourra définir ? Et pourquoi l’entreprendre, puisque tous les hommes conçoivent ce qu’on veut dire en parlant de temps, sans qu’on le désigne davantage ? » (De l’esprit géométrique, I, éd. Lafuma des Œuvres complètes, Seuil, « L’Intégrale », p. 350, partiellement cité par M. Conche, Épicure, Lettres et maximes, p. 171).
6 De l’esprit géométrique, ibid. Pascal ajoutait : « Aussi ce n’est pas la nature de ces choses que je dis qui est connue de tous : ce n’est simplement que le rapport entre le nom et la chose ; en sorte qu’à cette expression, temps, tous portent la pensée vers le même objet ; ce qui suffit pour faire que ce terme n’ait pas besoin d’être défini, quoique ensuite, en examinant ce que c’est que le temps, on vienne à différer de sentiment après s’être mis à y penser ; car les définitions ne sont faites que pour désigner les choses que l’on nomme, et non pas pour en montrer la nature. »
7 M. Conche, op. cit., p. 43.
8 Compte non tenu des « Vingt et neuf sonnets d’Étienne de la Boétie », en I, 29, qui ne sont pas un emprunt (Montaigne ne les prend pas à son compte) mais un hommage.
9 Plutarque, « Que signifiait ce mot E’i… », Œuvres morales, traduction Jacques Amyot, 1572 (que je cite d’après la réimpression à l’identique de l’édition de 1618, Hachette-BNF, p. 356-356 bis ; les deux éditions de 1572 et 1618 sont identiques pour le passage considéré. Le texte est repris par Montaigne, Essais, II, 12, p. 601-603. L’essentiel relève de la couche A : Montaigne n’ajoute guère, en B et C, que quelques références ou citations supplémentaires (dont, en latin, les quatre vers de Lucrèce, De rerum natura, V, 828-831 dans l’édition Ernout, aux Belles Lettres).
10 Essais, II, 12, p. 603 A (« cette conclusion si religieuse d’un homme païen »).
11 Plutarque, ibid.
12 La précieuse Concordance de Leake (Genève, Droz, 1981) donne les références suivantes : Essais, II, 12, p. 509 B, 515 C, 526 C, 539 A, 542 A et 602 C.
13 Essais, III, 2, p. 804 B.
14 Timée, 37 d.
15 Essais, II, 12, p. 511 A.
16 Villey renvoie en note au « Théétète, passim ; pris chez Diogène Laërce, Platon, II, X » (livre III, 9-10, dans l’édition Goulet-Cazé, Paris, Le Livre de Poche, 1999) : « Alcimos écrit ce qui suit : “Il est évident que Platon aussi reprend beaucoup d’idées d’Épicharme ; Qu’on en juge ! Platon dit que le sensible, c’est ce qui jamais ne demeure identique ni en qualité ni non plus en quantité, mais ne cesse de s’écouler et de se transformer…” » Mais la suite du texte, chez Diogène Laërce, évoque « l’intelligible », à quoi rien n’est jamais « enlevé ni ajouté », et « la nature des choses éternelles, nature à laquelle il appartient d’être toujours semblable, toujours identique » – ce que Montaigne ne retient pas.
17 Essais, I, 25, p. 135 C ; I, 50, p. 301 A et 303 A ; II, 12, p. 485 A, 508 B, 540 A, 543 C, 572 C, 585 A, 587 A et 602 A ; III, 13, p. 1068 C.
18 Essais, II, 12, p. 508 B.
19 Essais, I, 50, p. 303 A-B, et III, 8, p. 929 B.
20 Essais, II, 12, p. 602 A. C’est le fragment 134 (DK 91) dans l’édition par Marcel Conche des Fragments d’Héraclite, Paris, PUF, 1986.
21 Ibid. Cf. Héraclite, op. cit., fr. 85 (DK 76).
22 Essais, II, 12, p. 602 A.
23 Voir le texte d’Arius Didyme, 26 (S.V.F., II, 509), cité et traduit par Victor Goldschmidt, Le Système stoïcien et l’idée de temps, III, 10, Paris, Vrin, 1985, p. 30-31. Il faut entendre « subsistent » non pas au sens d’une existence-sous (la substance) mais au sens d’une sous-existence (celle des incorporels, qui n’existent pas vraiment : le vide, le lieu, le temps, le sens). Voir à ce propos l’opuscule fameux d’Émile Bréhier, La Théorie des incorporels dans l’ancien stoïcisme, rééd. Paris, Vrin, 1982.
24 Sur le problème de la divisibilité à l’infini, Voir V. Goldschmidt, Le Système stoïcien et l’idée de temps, op. cit., § 14, p. 38 : qu’il s’agisse des corps ou des incorporels, « on ne divise qu’“en pensée”, sans entamer l’être réel ».
25 Pour résumer les analyses décisives de Victor Goldschmidt, § 13-18, op. cit., p. 35-44. Voir aussi Gilles Deleuze, Logique du sens, séries 2 (« Des effets de surface ») et 23 (« De l’Aiôn »), Paris, Minuit, 1969, rééd. 10/18, UGE, 1973, p. 12-17 et 223-229.
26 Essais, II, 12, p. 602 A (à propos des stoïciens).
27 Ibid., p. 603 A.
28 Dans le Phèdre, 247 e (« le réellement réel »). La position de Plutarque, sur ce point, est manifestement débitrice de celle de Platon, dans le Timée 37 e – 38 a : « Les expression “il était”, “il sera” ne sont que des modalités du temps, qui sont venues à l’être ; et c’est évidemment sans réfléchir que nous les appliquons à l’être qui est éternel. En revanche, les expressions “il était” et “il sera”, c’est à ce qui devient dans le temps qu’il sied de les appliquer, car ces deux expressions désignent des mouvements. Mais ce qui reste toujours dans le même état sans changer, il ne convient pas que cela devienne plus jeune ou plus vieux avec le temps, ni que cela soit venu à l’être dans le passé, se trouve venu à l’être dans le présent ou vienne à l’être dans l’avenir. Et, de façon générale, à ce qui reste toujours dans le même état sans changer, n’appartient rien de tout ce que le devenir a attaché à ce qui est transmis par les sens, mais ce ne sont là que des modalités du temps qui imite l’éternité et qui se meut en cercle suivant le nombre. »
29 Essais, I, 3, p. 15 B C. La phrase en latin est une citation de Sénèque, dans sa Lettre 98 à Lucilius (« Bien malheureux est l’esprit soucieux de l’avenir »).
30 Essais, II, 12, p. 603 A.
31 Ibid.
32 Essais, III, 13, p. 1107 C.
33 Essais, II, 12, p. 601 A.
34 Ibid., p. 603 A.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Apollodore, ap. Arius Didyme, 26 (Dox. Gr., 461, 10), cité par Goldschmidt, op. cit., p. 43.
38 Essais, II, 12, p. 603 A.
39 Ibid., p. 601-602.
40 Voir par exemple Essais, II, 10, p. 413 ABC.
41 Même si Françoise Joukovsky estime qu’il n’est « pas impossible que Montaigne ait connu et apprécié la fameuse méditation du livre XI sur la réalité du présent », Montaigne et le problème du temps, Paris, Nizet, 1972, p. 37 ; voir aussi la note 22, p. 120.
42 Saint Augustin, Confessions, livre XI (chapitre 20 pour l’expression citée).
43 Saint Augustin, Confessions, XI, chap. 26.
44 Essais, II, 12, p. 603.
45 Montaigne et la philosophie, III, op. cit., p. 44.
46 M. Conche, ibid.
47 Essais, II, 12, p. 548.
48 Ibid.
49 Ibid., p. 549 (c’est une citation de Lucrèce, III, 445-446, mais que Montaigne prend manifestement à son compte).
50 Voir, ibid., les pages 549-551.
51 Essais, III, 8, p. 930 B.
52 Essais, III, 9, p. 988 B.
53 Voir à ce propos un suggestif article de Marcel Conche, « Tendances matérialistes chez Montaigne », BSAM, VIII, no 19-20, juillet-décembre 2000, p. 11-21.
54 Lucrèce De rerum natura, I, 459-463 (traduction Ernout, légèrement modifiée).
55 Selon les décomptes de P. Villey, Les Sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Paris, Hachette, 1908, t. I, p. 170, et C.-A. Fusil, « Montaigne et Lucrèce », Revue du seizième siècle, Paris, Champion, 1926, tome XIII, p. 265. Sur le rapport de Montaigne à l’épicurisme en général et à Lucrèce en particulier, voir mon article « Montaigne et Épicure », à paraître aux éditions Hermann, dans les actes du colloque des 8 et 9 avril 2016, « Le plaisir des Modernes, Épicurisme et pensée morale de la Renaissance à nos jours ».
56 J’emprunte ces citations à l’édition typographique qu’Alain Legros a donnée de la totalité des autographes de Montaigne (à l’exception de l’Exemplaire de Bordeaux) : Montaigne manuscrit, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études montaignistes », no 55, 2010. On y trouve notamment les annotations portées par Montaigne sur son exemplaire du De rerum natura (dans l’édition Lambin, Paris-Lyon, 1563). Voir aussi Michael Screech, Montaigne’s annotated copy of Lucretius, Genève, Droz, 1998, p. 94 et 222.
57 Essais, II, 12, p. 601.
58 Ibid., p. 603.
59 Essais, I, 30, p. 198.
60 Essais, II, 12, p. 603.
61 Guillaume d’Ockham, Summa totius logicae, I, c. 55, cité par Antoine Compagnon, op. cit., p. 26.
62 Essais, III, 2, p. 804-805.
63 Marcel Conche, Montaigne et la philosophie, III, op. cit., p. 60 (qui cite le « Sonnet à Marie » de Ronsard).
64 Que Montaigne semble bien évoquer en I, 10, p. 40 C : « Si je portais le rasoir partout où cela m’advient, je me déferais de tout » [je supprimerais tout mon livre].
65 Essais, II, 2, p. 602.
66 Essais, III, 1, p. 801.
67 Essais, I, 25, p. 136 A C : « Nous ne travaillons qu’à remplir la mémoire, et laissons l’entendement et la conscience vides ».
68 Ibid., p. 136 C : « Nous ne sommes, ce crois-je, savants que de la science présente, non de la passée, aussi peu que de la future. »
69 Ibid. Sur la mémoire (que Montaigne dit avoir mauvaise), voir aussi I, 9.
70 Essais, II, 18, p. 665 C.
71 Ibid.
72 Ibid. : « Je n’ai pas plus fait mon livre que mon livre m’a fait ».
73 Essais, II, 12, p. 602.
74 Ibid., p. 603.
75 Essais, I, 9, p. 36 B.
76 Ibid.
77 Essais, III, I, p. 797 B. Marcel Conche, qui cite ces lignes, ajoute : « On ne voit pas qu’il y ait, chez Montaigne, un autre fondement à l’identité personnelle. Nous changeons sans cesse, et ces changements ne sont pas des accidents glissant sur une substance invariable. Il n’y a rien en nous de substantiel. Il n’y a pas identité de nous à nous-même, mais ressemblance. Celui que j’étais hier est seulement celui à qui, aujourd’hui, je ressemble le plus. Je pourrais dire que ce que j’ai promis hier ne m’engage plus, car je suis devenu un autre. Mais non : ce que j’ai promis, je le tiens, ou du moins je dois le tenir ; je dois décider de toujours tenir ce que j’ai promis, et d’abord ce que je me suis promis à moi-même, sous peine que mon être ne se dissolve, ne s’annule dans l’inconsistance et le rien. Le fondement de mon être et de mon identité est purement moral : il se trouve dans la fidélité à la foi que je me suis jurée à moi-même. Je ne suis pas réellement le même qu’hier ; je ne le suis que parce que je m’avoue le même, parce que je prends à mon compte un certain passé comme le mien, et parce que j’entends, dans l’avenir, reconnaître mon engagement présent comme toujours le mien », Montaigne et la philosophie, VI, « La conscience », op. cit., p. 118-119.
78 Essais, II, 12, p. 602.
79 Essais, I, 3, p. 15.
80 Ibid.
81 Essais, III, 4, p. 834 B.
82 Essais, II, 16, p. 620 A.
83 Essais, III, 9, p. 982 B.
84 « Au lecteur », Essais, I, p. 3.
85 Essais, III, 9, p. 994 B.
86 Voir par exemple Essais, III, 5 (« Sur des vers de Virgile), p. 892 B, 894 C et passim. Voir aussi III, 9, p. 975 BC.
87 Essais, III, 13, p. 1112 B.
88 Essais, III, 4, p. 834 B.
89 Essais, I, 11, p. 41 A.
90 Voir notamment le chapitre que Georges Poulet a consacré à Montaigne, dans ses Études sur le temps humain, Paris, Plon, 1952, rééd. Éditions du Rocher, 1976, t. 1, chap. 1, p. 49 à 62, ainsi que les ouvrages déjà cités de Françoise Joukovsky, Montaigne et le problème du temps, op. cit. et de Marcel Conche, Montaigne et la philosophie, op. cit., chap. 3. De ce dernier auteur, voir aussi Montaigne ou la conscience heureuse, Paris, Seghers, 1964, rééd. PUF, 2002, p. 101-102 (« Le sage vit au présent »).
91 Sénèque, De la tranquillité de l’âme, II, 7 et IX, 2 ; Lettre 45, 13 ; De la brièveté de la vie, IX, 1. C’est un thème majeur du stoïcisme, que j’ai longuement analysé dans mon article, « La volonté contre l’espérance (à propos des stoïciens) », Une éducation philosophique, Paris, PUF, 1989, p. 189-218.
92 Essais, III, 13, p. 1112 B (qui cite en latin deux vers de l’Énéide de Virgile, X, 641-642, dont j’emprunte ici la traduction à Villey).
93 Essais, III, 13, p. 1115 B C.
94 Essais, I, 20, p. 89 A.
95 Essais, III, 12, p. 1045 C.
96 Essais, I, 20, p. 89 A C.
97 Essais, III, 13, p. 1108 C : « Notre grand et glorieux chef-d’œuvre c’est vivre à propos ».
98 Dictionnaire historique de la langue française, article « Proposer, Propos », Paris, Le Robert, 1992, qui note que l’expression est attestée, en français, dès la « fin du xve siècle ».
99 Essais, III, 5, p. 866. Je profite de l’occasion pour signaler un contresens que j’ai commis, il y a quelques années, dans Le Sexe ni la mort (II, 2, Albin Michel, 2012, p. 185) : évoquant ce même passage de Montaigne, j’eus tort de comprendre l’expression « savoir prendre le temps » en son sens moderne, comme signifiant le refus de la précipitation. En fait, il ne s’agit pas d’un « érotisme de la lenteur », comme je l’ai cru à l’époque (et quoique Montaigne, on s’en doute, n’y fût pas opposé), mais d’une stratégie amoureuse de l’opportunité. Faute d’avoir su prendre le temps, alors, de relire avec assez d’attention l’ensemble du paragraphe, je prends aujourd’hui le temps (je saisis l’opportunité) de m’en excuser auprès du lecteur.
100 Essais, III, 13, p. 1108 B.
101 Ibid., C.
102 Ibid., p. 1110 B C : « Il n’est rien si beau et légitime que de faire bien l’homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie ; et de nos maladies la plus sauvage c’est mépriser notre être ».
103 Ibid., p. 1108 C.
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Ibid., p. 1109-1110 B.
107 Voir par exemple les textes déjà cités du livre I, 20, p. 89 A, et du livre III, 13, p. 1108 C.
108 Essais, III, 5, p. 842 B C.
109 Voir par exemple Essais, I, 20, p. 88-89 C.
110 Essais, I, 20, p. 89 A. André Lanly, dans son adaptation des Essais en français moderne, Paris, Gallimard, 2009, propose la formulation suivante : « Il ne faut pas faire de projets de si longue haleine, ou du moins avec une ardeur telle que l’on se tourmente parce qu’on n’en voit pas la fin. »
111 Essais, III, 13, p. 829 B.
112 Essais, III, 12, p. 1052 C : « Elle doit être elle-même à soi sa visée, son dessein ».
113 Voir par exemple Essais, I, 20, p. 81-82 A C (l’hédonisme est clairement accentué dans la couche C).
114 Montaigne, Journal de voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1967, coll. « L’Intégrale », p. 478.
115 Essais, III, 9, p. 985 B.
116 Essais, III, 9, p. 978 B.
117 Essais, III, 13, p. 1107-1108 B.
118 Cf. Essais, III, 4, « De la diversion ».
119 Essais, III, 3, p. 829 B C.
120 Essais, III, 13, p. 111-112 B.
121 Ibid., p. 1111 C. La phrase de Sénèque est extraite des Lettres à Lucilius, II, 15, 9, qui citent expressément Épicure (fragment 491 Us).
122 Cf. Essais, I, 26, 152 A.
123 Essais, III, 13, p. 1111 C.
124 Ibid., p. 1113 B.
125 Ibid., p. 1115 B.
126 Pour citer à nouveau la fin de l’Apologie, II, 12, p. 601-603.
127 Ibid., p. 1116 B.
128 Ibid., B C.
129 Essais, I, 3, p. 17 C.
130 Essais, II, 12, p. 526 B C. Marcel Conche, qui en fait une de ses « phrases-clés », la cite de multiples fois : j’en ai fait le relevé, sans doute incomplet, dans mon article « Le tragique selon Marcel Conche », L’Enseignement philosophique, juin 2015, p. 44 à 59 (note 42, p. 51).
131 Essais, II, 12, p. 526 B : « Euripide est en doute si la vie que nous vivons est vie, ou si c’est ce que nous appelons mort qui soit vie. Et non sans apparence… »
132 Je m’en suis expliqué brièvement dans mon article, « Le tragique selon Marcel Conche », op. cit., p. 51-52.
133 Essais, II, 8, p. 386 A.
134 Ibid.
135 Ibid., p. 386 C.
136 Essais, III, 13, p. 1095 B.
137 Essais, III, 10, p. 1023 B.
138 Comme l’écrit Jean Starobinski, Montaigne en mouvement, VII, 5, Paris, Gallimard, 1982, p. 335.
139 Spinoza, Éthique, II, définition 6.
140 Voir les belles analyses de Bernard Sève, qui montre (à propos de l’essai II, 30, « D’un enfant monstrueux ») qu’« une lecture spinoziste » de Montaigne « est également possible, et féconde » : Montaigne, Des règles pour l’esprit, Paris, PUF, 2007, chap. xi, p. 306-309 (« Deus sive Natura ? »).
141 Essais, II, 30, p. 713 C.
142 Ibid.
143 Essais, II, 12, p. 603 A.
144 Comme disait Montaigne, juste avant l’emprunt à Plutarque : Essais, II, 12, p. 601 A.
145 Voir notamment mon livre L’Être-temps, Paris, PUF, 1999.