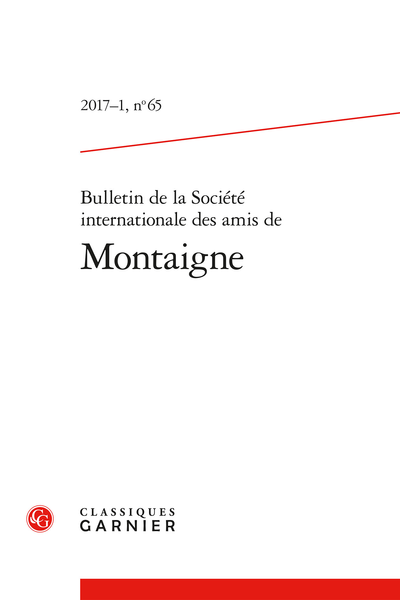
La santé dans le livre III des Essais
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2017 – 1, n° 65. varia - Auteur : Perona (Blandine)
- Résumé : Deux définitions de la santé sont en tension dans le livre III des Essais. Parfois critère de supériorité, elle relève d’un ethos noble. Parfois état de moindre maladie, elle révèle une perspective augustinienne qui appréhende la condition humaine comme essentiellement malade, coupée de la Nature. Pour le corps, moins radicalement séparé de la Nature que l’âme, le plaisir est un signe fiable pour juger de la santé. Il ne l’est plus pour l’« interne santé ». Il reste alors l’humour et l’ironie.
- Pages : 183 à 196
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406069072
- ISBN : 978-2-406-06907-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06907-2.p.0183
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/03/2017
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
La santé
dans le livre III des Essais
« La santé de par Dieu1. » C’est presque sur cette exclamation énergique que se terminent les Essais de Montaigne lorsqu’il les publie en 1580. En 1588, c’est sur une prière à Apollon, « Dieu protecteur de santé et de sagesse » qu’il achève ses Essais. Ainsi, le dernier chapitre en 1580 « De la ressemblance des enfans aux peres » et le dernier chapitre des Essais en 1588 « De l’expérience » disent tous deux la « dispathie naturelle » de Montaigne envers la médecine et font aussi tous deux résonner le souhait fort et puissant de santé d’un homme malade de la gravelle depuis 1577-15782. Montaigne réserve donc à chaque fois les dernières lignes de ses Essais à la santé.
Il y a un autre signe fort de cette place essentielle de la santé : les Essais comptent 75 occurrences du mot « sagesse » et 151 du mot « santé3 ». Et, dès 1580, Montaigne, comme Héraclite et Phérécyde de Syros qu’il évoque dans l’« Apologie de Raimond de Sebond » ne balance pas entre la sagesse et la santé. Il choisit la santé qu’il appelle « le plus beau et le plus riche present que nature nous sache faire4 ». Les Essais se revendiquent donc moins comme livre de sagesse que comme livre de santé.
Dans le livre III, la santé, c’est ce à quoi Montaigne aspire à double titre : il est un homme malade, ce qu’il dit avec force dans son dernier 184chapitre et il est l’homme d’un temps malade, corrompu par les guerres civiles, idée récurrente dans le livre III, mais particulièrement centrale dans le chapitre « De la physionomie ». Dans un premier temps, il semble possible de définir la santé par ce qu’elle n’est pas : la santé corporelle est un état naturel qui s’oppose à l’art et en particulier à l’art de la médecine ; le style sain est un style qui refuse la sophistication. De même, la santé politique du royaume doit être assurée par la liberté de ses membres, liberté qui correspond elle aussi à un état de nature. La santé s’oppose dans ce cas à la forme particulière de corruption qu’est la servitude. Cet article se proposera donc déjà de présenter ces antithèses structurantes qui semblent permettre de mieux appréhender ce que serait la « santé » dans les Essais. Mais en un second temps, il mettra en évidence les limites de ces antithèses et la difficulté de s’en tenir à une définition de la santé comme état de perfection naturelle. Les Essais montrent aussi qu’il n’y a pas de rupture de continuité entre la santé et la maladie et que la santé se définit également comme état de moindre maladie5.
La santé comme état de perfection naturelle
La « santé corporelle »
Dans le chapitre « De la ressemblance des enfants aux pères » (II, 37), Montaigne, dès la première édition des Essais, rappelle ironiquement, à l’intention de philosophes, le caractère premier et fondamental de la santé corporelle sans laquelle l’excellence de l’âme ne sert absolument à rien.
C’est une pretieuse chose que la santé, et la seule qui merite à la verité qu’on y emploie, non le temps seulement, la sueur, la peine, les biens, mais encore la vie à sa poursuite ; d’autant que sans elle la vie ne peut avoir ni grace ni saveur […] & aux plus fermes et tendus discours que la philosophie nous veuille imprimer au contraire, nous n’avons qu’à opposer l’image de Platon 185estant frappé du haut mal ou d’une apoplexie : & en cette presupposition le (sic) deffier de s’ayder de ces nobles et riches facultes de son ame6.
Ce chapitre exprime donc avec force l’évidence de cette dépendance radicale de l’homme à la santé du corps et dit ensuite le rejet de la médecine en tant qu’elle est « art ». En 1588, Montaigne concède néanmoins s’être « laissé aller » à la médecine des bains, mais non sans rappeler qu’elle est, précisément, la « moins artificielle7 ». La santé est un état naturel qui ne peut être que corrompu par la médecine. Cette idée est redite avec force dans le chapitre iii, 13. L’expérience que propose Montaigne de son propre corps peut être thérapeutique précisément parce qu’elle n’est pas corrompue par l’art. Il écrit en effet : « quant à la santé corporelle, personne ne peut fournir d’experience plus utile que moy, qui la presente pure, nullement corrompue et alterée par art et par opination8 ». On retrouve cette même opposition entre santé et art, lorsque Montaigne décrit le plaidoyer de Socrate qu’il qualifie précisément de l’adjectif « sain ».
Le « plaidoyer [sec et] sain » de Socrate
Quand il caractérise le discours de Socrate avant sa mort, Montaigne utilise en effet l’adjectif « sain » et écrit plus précisément : « Voilà pas un plaidoyer sec et sain, mais quant et quant naïf et bas, d’une hauteur inimaginable9 ». Cette caractérisation contradictoire d’un style qui se distingue à la fois par la bassesse et la hauteur est dans le prolongement de l’éloge paradoxal du début du chapitre « De la physionomie ». Il est alors surtout question de la façon de parler de Socrate. Dans ces lignes, c’est par son langage plus que par sa laideur physique que Socrate est un silène dans les premières lignes de III, 12. La lettre de Pic de la Mirandole à Ermolao Barbaro qui utilise aussi l’image silénique de Socrate offre de ce point de vue un éclairage plus intéressant que Platon ou Érasme10. On trouve chez Montaigne et Pic de la Mirandole le même 186rejet de l’art, des « grâces […] pointues, bouffies, et enflées d’artifice11 ». Pic de la Mirandole évoque l’art comme un fard qui peut bien souvent cacher un sang infecté12. Lorsqu’après 1588, Montaigne revient sur ces lignes consacrées à la langue de Socrate, il cite très souvent Sénèque qui utilisait déjà lui aussi cette image du style sain pour évoquer un style naturel qui s’oppose à la sophistication efféminée de Mécène :
Soignons donc notre âme. D’elle proviennent les pensées ; d’elle proviennent les paroles ; nous tenons d’elle le maintien, la physionomie, la démarche. Saine et vigoureuse, elle communique au style robustesse, force mâle, fierté (Illo [animo] sano ac valente oratio quoque robusta, fortis, virilis est)13.
À un style sain, une âme saine. C’est bien ainsi que Montaigne caractérise l’âme du Socrate : « il ne la représente que saine », écrit-il. Socrate est fondamentalement une figure de nature et de santé. Il incarne d’ailleurs à tel point la santé que Montaigne en vient à imaginer à la fin du chapitre « Du repentir » que le choix de la mort de Socrate s’expliquerait parce qu’il était impossible à Socrate vraiment Socrate, d’entrer dans la vieillesse, période où « les âmes sont sujettes à des maladies et imperfections plus importunes qu’en la jeunesse14 ». Il ne peut y avoir de Socrate malade (et vieux).
La santé de l’État
Dans « De la physionomie », la santé et la vigueur de Socrate s’opposent à la maladie du « siècle faible » de Montaigne. Son époque est infectée par les guerres civiles, qu’il appelle « maladies populaires ». La corruption se répand comme l’épidémie de peste qu’il évoque aussi dans ce chapitre. Montaigne montre les progrès de cette corruption en décrivant 187déjà le désordre dans l’armée où le commandant réussit en en s’abaissant à « courtiser » ses soldats qui, pour le plus grand nombre, sont des mercenaires. Il fait alors ce commentaire à propos de cette servilité maladive des chefs :
Il me plaist de voir combien il y a de lascheté et de pusillanimité en l’ambition, par combien d’abjection et de servitude il luy faut arriver à son but. Mais cecy me deplaist il de voir des natures debonnaires et capables de justice, se corrompre tous les jours au maniement et commandement de cette confusion […] Nous avions assez d’ames mal nées sans gaster les bonnes et genereuses. Si que, si nous continuons, il restera mal-ayséement à qui fier la santé de cet estat15 […].
Montaigne disait déjà plus haut sa crainte de ne plus pouvoir distinguer les hommes sains des malades. Les sains sont les natures bonnes et généreuses qui ne sont pas gagnées par une servitude volontaire et ambitieuse. Il est frappant de voir à quel point on retrouve ici à quelque chose près les mots et les images de La Boétie. Montaigne distingue comme lui les « biens nés » des mal nés et trouve, en la maladie, une image de la servitude qui corrompt l’état. De nouveau, quand il s’agit de l’État, la maladie s’oppose à un état de nature où l’homme est libre, comme le rappelle Montaigne dans le chapitre « De la vanité » : « Nature nous a mis au monde libres et déliés16 ».
Dans ce passage très proche du Discours de la servitude volontaire, Montaigne semble laisser entendre qu’il y a bien des âmes, bien nées, supérieures, qui se distinguent par la qualité aristocratique de « générosité ». Ces lignes tendent donc à conforter la lecture de Francis Goyet qui met en évidence dans les Essais une conception aristotélicienne de la santé. Francis Goyet rappelle en effet qu’Aristote pour distinguer l’honnête homme du malhonnête utilise l’analogie de la santé17. Un homme sain sait reconnaître les nourritures saines ; un homme honnête juge sainement et se comporte vertueusement. Aussi, dans ce passage, fortement inspiré de La Boétie, il semble en effet difficile de contester que la santé fonctionne comme un « critère de supériorité18 ».
188La santé comme état
de moindre maladie
Cependant, s’il y a cette vision aristotélicienne et aristocratique qui distingue les sains et les malades, les bien nés des mal nés, les natures serviles et les natures généreuses, Montaigne porte aussi un autre regard sur l’homme en général et sur lui-même en particulier. Il se voit comme essentiellement malade et dans ce cas, la distinction entre sains et malades n’est plus opérante.
De même qu’il n’y a plus une différence de nature entre santé et maladie non plus, mais juste une question de degré : la santé n’est plus un état de perfection naturelle, elle est juste un état de moindre maladie. La santé de Socrate relève de la fiction. Socrate est parfait, mais Montaigne est vivant et il est comme les autres hommes destinés à souffrir et mourir et il n’échappe pas à l’expérience de la dégradation qu’est la vieillesse. Il me semble qu’à travers ces deux visages de la santé où elle est tantôt excellence de la nature d’un homme tantôt état de moindre maladie, on retrouve ce qui fait la particularité de la philosophie morale de Montaigne telle que la définit Jean Balsamo. Elle est à la fois héritée d’un scepticisme chrétien d’origine augustinienne et d’un ethos noble19. L’exemple de la santé montre combien ces composantes sont difficilement conciliables. Du point de vue chrétien sceptique, la santé vigoureuse et gaillarde qui caractérise l’ethos noble n’existe pas : la condition humaine est la maladie, comme le rappelle cette citation du chapitre « De l’expérience » : « Il faut souffrir doucement les lois de notre condition : Nous sommes pour vieillir, pour affaiblir, pour être malades, en dépit de toute médecine20 ». Ce passage présent au tout début du livre III s’inscrit plus explicitement encore dans une perspective augustinienne : « Nostre être est cimenté de qualités maladives : L’ambition, la jalousie, l’envie, la vengeance, la superstition, le désespoir, logent en nous d’une si naturelle possession que l’image s’en reconnaît aussi aux bêtes21 ». Il y a quelque chose de fondamentalement malade 189dans la condition humaine, tellement que le vice dénaturé de cruauté vient à lui être naturel et qu’il éprouve un plaisir dans ce vice.
De ce point de vue en effet, la santé naturelle de Socrate ou celle de son style relève d’un idéal ou, si l’on insiste sur la perspective augustinienne, correspondent à une nature d’avant la chute. La santé est comme une façon de retrouver fugitivement seulement un état de nature perdu. Même lorsque Montaigne est jeune, la santé surgit en lui par accès, par « venues », écrit-il. Les instants passagers de santé produisent alors des éclairs d’enthousiasme à qui d’autres donnent uniquement des origines divines : le « feu de gaieté suscite en l’esprit des esloises vives et claires22 » autrement dit, un éclair d’inspiration suit un éclair, un feu de santé. On retrouve encore l’image lumineuse de l’éclair dans cet extrait de l’éloge paradoxal de la gravelle :
Mais est-il rien doux au prix de cette soudaine mutation, quand d’une douleur extrême, je viens par le vidange de ma pierre, à recouvrer, comme d’un éclair, la belle lumière de la santé […] De combien la santé me semble plus belle après la maladie, si voisine et si contiguë, que je les puis reconnaître en présence l’une de l’autre, en leur plus haut appareil, où elles se mettent à l’envi, comme pour se faire tête et contrecarre23.
La santé est un état éphémère de moindre maladie. Santé et maladie se rejoignent, comme la volupté et la douleur, ainsi que le rappelle, juste après cette citation, la réécriture d’un passage du Phédon. Socrate libéré de ses chaînes ressent un vif plaisir et en vient à considérer la proximité de la douleur et du plaisir24. La volupté est donc un signe de santé, elle indique que l’on est moins mal, que l’on a moins mal : Montaigne peut alors écrire : « L’extrême fruit de ma santé, c’est la volupté25 ».
190Et c’est là que Montaigne distingue l’interne santé de la santé corporelle. Pour le corps, il reste un contact avec la nature : le plaisir physique est le signe tangible de la santé du corps26 et d’une attitude conforme à la nature27. Au contraire, quand il s’agit de l’interne santé, la maladie reste insensible : « Les maux du corps s’éclaircissent en augmentant. Nous trouvons que c’est goutte que nous nommions rhume ou foulure. Les maux de l’âme s’obscurcissent en leur force : le plus malade les sent le moins28 ». Dans cet ajout de l’Exemplaire de Bordeaux, Montaigne reprend un lieu commun. Il l’emprunte ici à la lettre de Sénèque qu’il cite juste avant et qu’il paraphrase dans les lignes qui suivent : les maux de l’âme sont plus dangereux, car ils sont indolores29. Le plus dangereux d’entre eux est la philautie. Montaigne l’appelle présomption et la désigne précisément comme la « maladie naturelle et originelle30 » dans l’« Apologie de Raimond Sebond ». Les sources de cet extrait du chapitre iii, 5, comme celles des lignes qui le précèdent et le suivent tendent à confirmer cette lecture selon laquelle Montaigne vise tout particulièrement la présomption. La suite de l’épître précédemment citée de Sénèque, où le philosophe 191stoïcien utilise la métaphore de la veille et du sommeil pour distinguer l’aveuglement et la lucidité d’une personne quant à ses vices, associe confession et guérison morale (vitia sua confiteri sanitatis indicium est31). Montaigne, lui, compare plus précisément la confession à une opération chirurgicale : « il faut les souvent remanier [les maux de l’âme] au jour, d’une main impiteuse, les ouvrir et arracher du creux de notre poitrine. Comme en matière de bienfaits, de même en matière de méfaits c’est parfois satisfaction que la seule confession32 ». Le terme « confession » était déjà utilisé quelques lignes plus loin dès 1588 : « S. Augustin, Origene, et Hippocrates, ont publié les erreurs de leurs opinions, moi, encore, de mes mœurs33 ». L’exemple de la confession d’Hippocrates nous met sur la piste d’une autre source plus éclairante encore que la lettre de Sénèque. Il s’agit d’un traité de Plutarque intitulé – dans la traduction d’Amyot – « Comment lon pourra apparcevoir si lon amende et profite en l’exercice de la vertu ». Dans un passage de ce traité34, Plutarque, comme le fera Montaigne, part de la comparaison entre les maux physiques – mal de dents ou aux doigts – et certaines maladies qui ne se traduisent pas par une douleur physique (fureur de melancholie, frenesie, alienation d’entendement) ; puis, à partir de cette comparaison, fait une typologie des comportements des hommes face au vice. Il y a premièrement ceux 192qui ne les sentent pas et pire ceux qui repoussent les personnes qui les avertissent ; deuxièmement, ceux qui moins présomptueux écoutent les avertissements qu’on leur fait et « sont en meilleur estat et plus beau chemin de recouvrer guarison » et troisièmement, ceux qui devancent les avertissements et guérissent par leur confession spontanée. Le texte précise que les hommes de la deuxième catégorie sont seulement en voie de guérison et qu’ils ont besoin d’un ami pour guérir effectivement. Les hommes de la troisième catégorie dont fait partie Hippocrate n’ont plus besoin de ce regard extérieur et sont par conséquent leur propre ami.
Autrement dit, avant qu’on ait atteint une forme de santé morale définitive, le recours à un ami ou à un ennemi d’ailleurs est indispensable pour guérir, c’est-à-dire pour acquérir une lucidité sur soi-même. Mais l’état parfait consiste à être son propre ami. C’est ce qu’affirme également un passage du chapitre « De ménager sa volonté », être ami de soi est un état qui fait se rencontrer sagesse et santé, qui permet de « bien et saintement vivre » et Montaigne précise bientôt ce syntagme par un second, être ami de soi permet de « sainement et gaiement vivre35 ». Mais là encore, le « vrai point de l’amitié que chacun se doit » relève d’un idéal, car il est réservé à celui qui « a atteint le sommet de la sagesse humaine, et de notre bonheur36 ». Montaigne, on le sait, désire bien souvent le regard d’un tiers, d’un ami qui lui permette de véritablement se voir. Juste avant le célèbre passage du chapitre « De la vanité » où Montaigne s’exclame « Ô un ami », il insère, dans un ajout de l’Exemplaire de Bordeaux, ce vers tiré de la cinquième satire de Perse : Excutienda damus praecordia37, « Nous donnons notre cœur à scruter ». Le mot « praecordia » est déjà un terme d’anatomie. Montaigne met au jour ses entrailles et recherche un regard extérieur qui lui serait vraiment « salutaire38 », comme le regard de Cornutus est indispensable à Perse. La parrhesia du satiriste est un modèle pour Montaigne et la satire, telle que Politien la définit, est précisément un discours qui soigne la philautie, comme la parole vraie de l’ami chez Plutarque39.
193Le chapitre « De l’art de conférer » montre combien le contact avec un autre esprit et en particulier avec celui d’un ami est garant d’une forme de santé morale telle que la conçoit Plutarque : Montaigne écrit ainsi « En cette gaillardise, nous pinçons parfois des cordes secrètes de nos imperfections […] et nous entr’avertissons utilement de nos défauts40 ». Dans la conférence, le déplaisir que Montaigne désigne par les termes « aigreur » ou « âpreté » est précisément un signe de présomption, qu’il faut « fouetter » par « ce mot de Platon » : « Ce que je trouve mal sain, n’est-ce pas pour être moi-même mal sain ? ». C’est précisément en utilisant l’image de la santé que Montaigne réécrit ici un extrait d’un autre traité important de Plutarque41, « Comment il faut ouir ». Si le déplaisir dans la conversation est un critère assez fiable pour déceler une forme de vanité, le plaisir pour l’interne santé est en revanche un critère moins assuré qu’il ne l’est pour la santé physique, car il en existe plusieurs sortes et tous ne sont pas profitables, en tout cas, pour Plutarque qui souhaite que ses lecteurs fortifient leur vertu.
Montaigne présente sans doute la joie de la bonté comme l’un des signes les plus tangibles d’une forme de santé morale. Il en parle avec une force et une assurance assez exceptionnelles. La bonté semble rendre plus palpable un état de nature perdu où l’homme était à la fois libre et bon : « Il n’est pareillement bonté, qui ne réjouisse une nature bien née ». Montaigne ajoute même : « Ce n’est pas un léger plaisir de se sentir préservé de la contagion d’un siècle, si gâté ». Dans ce passage du chapitre « Du repentir », Montaigne retrouve un peu de son ethos aristocratique et parle encore de « fierté généreuse », mais il me semble qu’on peut le lire en regard de cet extrait du chapitre « De la vanité » où Montaigne rappelle que personne n’échappe à la contagion de son 194« temps malade42 » : « le plus juste parti, si est-ce encore le membre d’un corps vermoulu et véreux. Mais d’un tel corps, le membre moins malade s’appelle sain43 ». Tout le monde est donc bien malade, mais plus ou moins et le plaisir de la bonté est un des signes forts d’une forme de santé morale.
Dans le cas de la « conférence », il y a également un plaisir sain, d’exercer le jugement, comme on exerce le corps. L’éclairage de Plutarque a confirmé que c’était une voie de la guérison. Mais il y a aussi le plaisir de la sottise sûre d’elle-même44 ; il y a un plaisir dans la présomption que Montaigne cherche à débusquer sans voir jamais la fin de cette chasse. Par conséquent, les Essais se veulent confession des erreurs de Montaigne et sont un effort de lucidité, mais se savent aussi cernés par la vanité. Montaigne ne peut se guérir par lui-même. Montaigne se sent partiellement aveugle, en attente d’un regard extérieur sur lui et sur les Essais avec qui il ne fait qu’un45. La confession des erreurs guérit dit Plutarque, Montaigne les confesse volontiers mais sans être sûr de pouvoir bien les identifier. Montaigne reste donc réservé quant à la réelle vertu thérapeutique des Essais pour l’interne santé. Et lorsque modestement il dit être moins sûr de ses conseils pour l’« interne santé » que pour la santé du corps, cette modestie n’est sans doute pas que topique ou feinte. Le plaisir pour le corps est un signe tangible que la maladie recule : pour l’interne santé, on trouve surtout des signes tangibles de maladie. Le plaisir est potentiellement trompeur, ce qui n’empêche pas Montaigne de le chercher.
Le vœu de santé répété de Montaigne semble relever d’une contradiction assumée : l’auteur des Essais la souhaite toujours et sait qu’elle est inaccessible. Comme il y a une approche paradoxale et consolatrice de la maladie qui fait dire à Montaigne que c’est pour son mieux qu’il a la gravelle, il y a sans doute aussi une fonction d’apaisement dans cet horizon utopique de la santé. Ce but qu’il ne peut atteindre 195lui donne néanmoins une direction pour circonscrire le domaine de la maladie. Il ne cesse d’y aspirer tout en ne cessant de constater qu’il ne peut y parvenir. Comme ils ont perdu leur liberté naturelle, les hommes ont en effet perdu la santé et doivent l’accepter : « Il faut souffrir doucement les lois de notre condition : Nous sommes pour vieillir, pour affaiblir, pour être malades46 ». Si je reviens en conclusion sur cette citation, c’est aussi pour insister à présent sur l’adverbe « doucement ». La reconnaissance de la condition humaine comme condition malade n’entraîne nul dolorisme ; au contraire, Montaigne fuit l’aigreur. De même que Montaigne se repent rarement47, il ne considère pas qu’il y ait lieu de se lamenter outre mesure de cette condition : il faut simplement l’accepter.
Accepter la maladie est aussi la voie de la « santé », la santé bien réelle dont jouit Montaigne entre deux crises de gravelle. Nul dolorisme donc, puisque, dans cette seconde acception du terme « santé », l’« interne santé », comme la santé du corps, se signalent essentiellement comme plaisir. Comme le plaisir est moindre mal, la santé est seulement un état de moindre maladie.
De ce point de vue, les Essais ont une fonction thérapeutique, ils servent à accepter et à vivre la maladie et autant que possible à circonscrire son empire. Mémoire de papier, comme le Journal de voyage, ils permettent de vivre avec moins d’ignorance les crises de gravelle48. Le plaisir physique est un guide assez sûr et assez naturel encore pour qu’il donne à Montaigne une certaine confiance dans l’utilité des Essais pour la santé physique. En revanche, le plaisir n’est plus un critère absolument fiable pour l’« interne santé ». Certains traités de Plutarque et en particulier « Comment il faut ouir », et « Comment lon pourra apparcevoir si lon amende et profite en l’exercice de la vertu » apparaissent comme des sources fondamentales de la conception montaignienne de l’interne santé. La connaissance de soi lucide est pour Plutarque la voie de la santé et la confession celle de la guérison. Les Essais se savent une confession imparfaite, et servent moins à guérir de la vanité qu’à l’accepter à force 196d’humour et d’ironie. Montaigne n’est pas, comme Plutarque, assuré dans sa capacité à bien appréhender les progrès réels de sa santé intérieure. Et, en outre, si la vanité apporte du plaisir, il n’est pas totalement prêt à y renoncer non plus.
Blandine Perona
Laboratoire Calhiste
Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
1 Essais de Michel de Montaigne, Bordeaux, S. Millanges, 1580, p. 649. Montaigne ajoute un point d’exclamation en 1588.
2 Géralde Nakam insiste sur l’importance de cette expérience de la maladie et de la douleur dont les Essais se font régulièrement l’écho : « Corps malade, “têtes malades” », Montaigne, éd. Pierre Magnard et Thierry Gontier, Paris, Les Éditions du Cerf, Paris, 2010 (voir en particulier p. 279-285).
3 D’après Roy E. Leake, Concordance des Essais de Montaigne, t. II, 1981, p. 1124 et p. 1114.
4 Essais, 1580, II, 12, p. 234. Sur cette célébration de la santé, Géralde Nakam dit « triomphe », on peut lire de cet auteur : Les Essais de Montaigne, miroir et procès de leur temps, Témoignage historique et création littéraire, édition revue, corrigée et mise à jour avec une préface inédite, Paris, Champion, 2001, p. 309-310.
5 Pour Pierre Magnard, ces deux définitions peuvent coexister sans tension, la maladie étant « démystifie, naturalisée, finalisée enfin en ce qu’elle finit par entrer dans l’économie d’une “grande santé” » (« La grande santé, un tournant dans la conception de la maladie », Montaigne, éd. citée, p. 317).
6 Essais, 1580, p. 607.
7 Essais, Paris, Abel L’Angelier, 1588, f. 338 ro.
8 Montaigne, Essais III, éd. E. Naya, D. Reguig-Naya et A. Tarrête, Paris, Gallimard, 2009 [édition au programme de l’agrégation qui sera désormais citée par défaut], p. 424.
9 III, 12, p. 387.
10 Sur ce point, je suis particulièrement redevable aux analyses de Françoise Lavocat : La Syrinx au bûcher Pan et les satyres à la Renaissance et à l’âge baroque, Genève, Droz, 2005, p. 17-68. François Lavocat écrit à propos de Jean Pic de la Mirandole qu’il « est probablement celui qui introduisit la comparaison platonicienne de Socrate et du Silène dans la culture de la Renaissance » (ibid., p. 29).
11 II, 12, p. 363.
12 « Nous aussi, nous devons nous en garder [de polir et d’orner notre style] pour éviter que le lecteur, attiré par une peau soignée, ne s’arrête à elle, sans aller jusqu’à la moelle et au sang – que nous avons vus souvent infectés sous un visage fardé » (Jean Pic de la Mirandole, Œuvres philosophiques, éd. et trad. Olivier Boulnois et Guiseppe Tognon, Paris, PUF, 1993, p. 258).
13 Lettres à Lucilius, éd. François Préchac et trad. Henri Noblot, Paris, Les Belles Lettres, 1991, t. V, Lettre 114, p. 36.
14 III, 2, p. 52.
15 III, 12, p. 370-371.
16 III, 9, p. 274.
17 Francis Goyet, Les Audaces de la prudence Littérature et politique aux xvie et xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 297.
18 Ibid., p. 304.
19 « L’invention d’un moraliste : Montaigne », Literatur und Moral, éd. V. Kapp et D. Scholl, Berlin, Duncker & Humblot, 2011, p. 76.
20 III, 13, p. 439.
21 III, 1, p. 14.
22 III, 5, p. 91. Bernard Sève propose une lecture différente de ce passage. Selon lui, « rien, dans cet extrait, ne place la santé corporelle du côté de l’extraordinaire, […]. La santé, même exceptionnelle, ne passe pas la portée naturelle du corps » (Montaigne. Des règles pour l’esprit, Paris, PUF, 2007, p. 215). Dans ce passage, inspiration de l’esprit et santé du corps nous semblent aller de pair et précisément comme des états d’exception, des états naturels de perfection perdus et retrouvés exceptionnellement pas accès.
23 III, 13, p. 446.
24 « Lorsque Socrates après qu’on l’eut déchargé de ses fers, sentit la friandise de cette démangeaison, que leur pesanteur avait causé en ses jambes : il se réjouit, à considérer l’étroite alliance de la douleur à la volupté : comme elles sont associées d’une liaison nécessaire » (III, 13, p. 447).
25 III, 13, p. 463.
26 Pour la santé corporelle, Montaigne suit en effet l’épicurisme pour qui « le plaisir est un état déterminé indubitable, puisqu’il est, comme la douleur, une affection » et qui « peut donc jouer le rôle d’une règle stable de choix et de refus, et fonder l’estimation rationnelle que représente le calcul prudent » (Pierre-Marie Morel, Épicure, Paris, Vrin, 2009, p. 187).
27 Traduisant un passage du De senectute qu’il cite juste après, Montaigne écrit « Tout ce qui vient au revers du cours de nature peut être fâcheux, mais ce qui vient selon elle doit toujours être plaisant » (III, 13, p. 460).
28 III, 5, p. 93.
29 Voici en effet une traduction récente de la lettre de Sénèque que réécrit Montaigne : « Les pieds ressentent une douleur ; les articulations, des picotements ; jusqu’ici on dissimule […]. Quand le mal, non caractérisé, est dans son prodrome, on lui cherche un nom mais, s’il vient à enfler les chevilles, à déformer les deux pieds, on ne peut plus qu’avouer la goutte. Le contraire arrive dans les maladies qui affectent notre âme (in his morbis, quibus afficiuntur animi) ; plus on est atteint, moins on le sent (quo quis peius se habet, minus sentit) » (Lettres à Lucilius, éd. François Préchac et trad. Henri Noblot, Paris, Les Belles Lettres, 1987, t. II, Lettre 53, p. 50).
30 Sur la « philautie », on peut lire l’article fondateur de Jean Mesnard, « Sur le terme et la notion de philautie », Mélanges à la mémoire de V.-L. Saulnier, Genève, Droz, 1984, p. 197-214. En outre, mes analyses sur l’« interne santé » prolongent dans une certaine mesure les développements de l’article suivant : Blandine Perona, « ‘La plus universelle et commune erreur des hommes’, Philautie et/ou présomption dans les Essais », BSIAM, 2015, 2, no 62, p. 159-175. Dans son article sur la santé, Jakob Amstutz insiste beaucoup sur cette maladie de l’âme et cite aussi cet autre passage de l’« Apologie de Raymond Sebond » : « la peste de l’homme, c’est l’opinion de sçavoir » (« Montaignes Begriff der Gesundheit », Heidelberger Jahrbücher, 18, 1974, p. 108).
31 Lettres à Lucilius, éd. citée, t. II, Lettre 53, p. 51.
32 III, 5, p. 93.
33 III, 5, p. 94.
34 « Or entre ceux qui ont besoing du secours du medecin, les uns qui n’ont mal qu’aux dents, ou au doigt, eux-mesmes vont devers ceux qui les pensent […] mais ceux qui sont tombez en une fureur de melancholie, ou en une frenesie, et alienation d’entendement ne les veulent pas quelquefois recevoir, encore qu’ils viennent d’eux-mesmes, ains les fuyent et les chassent, estans si fort malades, qu’ils ne sentent pas leur mal : aussi entre ceux qui pechent et qui faillent, ceux-là sont incurables et incorrigibles, qui se courroucent amerement, et haïssent mortellement ceux qui leur remonstrent et qui les reprennent : et ceux qui les endurent, et qui les reçoivent sont en meilleur estat et plus beau chemin de recouvrer guarison : mais ceux qui se baillent eux-mesmes à ceux qui les reprennent, qui confessent leur erreur et qui descouvrent eux-mesmes leur pauvreté, n’estans pas bien aises qu’on n’en sçache rien, ny contents d’estre secrets, ains l’advouent, et prient ceux qui les en reprennent, et qui les admonestent de leur y donner remede, cela n’est pas un des pires signes de profit et amendement, suivant ce que souloit dire Diogenes, Que celuy qui se veut sauver et devenir homme de bien, il a besoin d’avoir ou un bon amy, ou un aspre ennemy, à fin que ou par amour de remonstrance, ou par force de iustice il se chastie de ses vices. […] Mais celuy qui profite veritablement, a pour exemple ce grand personnage Hippocrates, lequel publia luy-mesme, et escritvit ce qu’il avoit ignoré touchant les coustures de la teste de l’homme en l’anatomie […] » (Plutarque, Œuvres morales et meslées, « Comment lon pourra apparcevoir si lon amende et profite en l’exercice de la vertu », trad. Amyot, Paris, Vascosan, 1574, f. 296 ro-297 vo).
35 III, 5, p. 321.
36 III, 5, p. 320.
37 III, 9, p. 285.
38 Montaigne parle d’une « amitié salutaire » dans le passage du chapitre iii, 5 précédemment cité (p. 320).
39 Sur la métaphore médicale utilisée pour caractériser la satire, on peut lire l’analyse éclairante de Pascal Debailly de la Praelectio sur Perse de Politien : La Muse indignée. La satire en France au xvie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 195-198 et sur la conception de la satire, comme parole de vérité qui soigne et sa postérité de Politien à Montaigne, nous renvoyons à notre article : « Satire et philautie, franchise et aveuglement de Politien à Montaigne », à paraître dans les actes de la journée Philautie humaniste, héritages et postérités, éd. Anne-Pascale Pouey-Mounou et Charles-Olivier Sticker-Métral, Paris, Classiques Garnier.
40 III, 8, p. 227.
41 « Et ne faut pas en tel endroit oublier l’advertissement du sage Platon, quand on a veu quelqu’un faillant, de descendre toujours en soy esme, et dire à par soy, Ne suis-je point tel ? car tout ainsi que nous voyons noz yeux reluisans dedans les prunelles de ceux de noz prochains, aussi faut il que en la manière de dire des autres nous nous representions la nostre […] » (« Comment il faut ouir », f. 62 ro).
42 III, 5, p. 302.
43 III, 5, p. 303.
44 III, 8, p. 226.
45 Il fait par exemple explicitement appel au lecteur pour qu’il se prononce sur les « boutades de [s]on esprit » lorsque, à la fin de III, 8, il ajoute dans l’Exemplaire de Bordeaux : « Ce n’est pas à moi seul d’en juger. Je me présente debout et couché, le devant et le derrière, à droite et à gauche, et en tous mes naturels plis » (p. 234).
46 III, 13, p. 439.
47 III, 2, p. 36.
48 Sur l’utilisation des Essais pour soigner effectivement le corps, je reprends et suis ici les analyses de Christine de Buzon : « Le soin de soi dans le Journal de Voyage de Montaigne et l’essai II, 37 (1580-1582) », Le corps et l’esprit en voyage, éd. Christine de Buzon et et Odile Richard-Pauchet, Paris, Classiques-Garnier, 2012, p. 139-165.