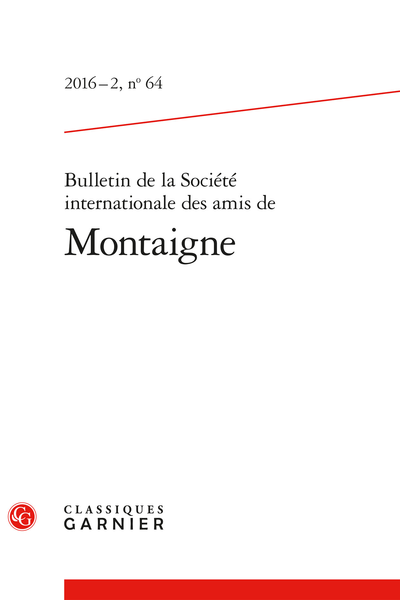
Vivre comme Socrate La notion d'ordre et la morale de l'homme médiocre dans les derniers Essais de Montaigne
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2016 – 2, n° 64. varia - Auteur : Scoralick (Andre)
- Résumé : Contre les passions, les Stoïciens prescrivaient la meditatio mortis. Montaigne oppose à cette conduite « selon la raison », qui produit de la perturbatio, celle « selon les sens », qui nous apprend à chercher le plaisir et à éviter la douleur, en produisant la tranquilitas. Son modèle, Socrate, dénonce les conceptions dogmatiques de l’homme et lui permet de fonder la connaissance de soi sur la perception sensible. Le résultat est la régulation de soi, fruit de l’entraide du corps et de l’âme.
- Pages : 71 à 85
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406066323
- ISBN : 978-2-406-06632-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06632-3.p.0071
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/12/2016
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Vivre comme Socrate
La notion d’ordre et la morale de l’homme médiocre
dans les derniers Essais de Montaigne
Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modelle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance1.
Il est très banal de dire que la matière des Essais appartient au champ de la morale. Il suffit de parcourir les titres des chapitres pour y trouver des passions, des vices, des vertus, des questions concernant l’action et l’agent, toute une myriade enfin de problèmes concernant la moralité. Moins banal, cependant, est d’indiquer le sens de la réflexion morale menée par Montaigne dans ses Essais. Il n’est pas évident, par exemple, que les questions morales ne soient pas de simples objets de réflexion, d’une spéculation désintéressée, d’un traitement théorique ; il n’est pas évident qu’elles puissent avoir un but éminemment pratique. Néanmoins, c’est ce que Montaigne semble suggérer dans un passage de l’essai « De l’Institution des Enfants », quand il se réfère aux leçons qu’il propose pour l’institution de l’élève (des leçons qui ont, bien sûr, des effets sur le caractère du garçon) : « Voicy mes leçons. Celuy-là y a mieux proffité, qui les fait, que qui les sçait. […] Il [l’élève] ne dira pas tant sa leçon, comme il la fera » (I, 26, 167-168). De la même façon, il n’y a rien d’évident dans la conséquence de cette manière de voir les choses, soit le fait que Les Essais puissent avoir une dimension normative allant au-delà de la dimension descriptive suggérée dans la note au Lecteur et dans l’essai « Du Repentir » : « je suis moy-mesmes la 72matiere de mon livre » (I, Note au Lecteur, 03) ; « les autres forment l’homme ; je le recite » (III, 2, 804). Selon cette manière de voir les choses (perspective que cette étude assume), tout se passe comme si Montaigne, dans ses Essais, ne faisait pas seulement un autoportrait, ni, comme l’a voulu un jour Hugo Friedrich2, une « science morale » qui serait aux origines de l’Anthropologie et de la Psychologie modernes. Tout se passe comme si l’on avait, dans cette œuvre, quelque chose de normatif. Dans le présent texte, nous chercherons à aborder cette question, en nous demandant s’il est possible de trouver éparpillés dans Les Essais (surtout dans les derniers chapitres) les éléments d’une morale pratique à visée normative. Il s’agit de récupérer, au-delà de la critique montaignienne de l’indifférence parfaite du sage stoïcien (paradigme éthique hérité de la période hellénistique qui orientait encore les idées morales de la renaissance tardive), la défense, également entreprise par l’essayiste, d’un autre modèle moral : la conduite ordonnée, l’idéal moral à la portée de l’homme ordinaire, médiocre. Pour en venir à la quête de cette morale pratique, notre fil conducteur sera la lecture de quelques passages d’un essai en particulier, le douzième du livre trois, intitulé « De la Physionomie », en ajoutant, quand besoin est, l’analyse de passages d’autres chapitres des Essais.
Dans « De la Physionomie », Montaigne oppose deux formes de conduite : la conduite selon la « science » (c’est-à-dire, selon les doctrines dogmatiques héritées des philosophes du passé) et celle qui est conforme à la « nature ». À l’horizon de cette entreprise ne se trouve rien moins que la bonne vie possible, à savoir, la tranquillité de l’âme, érigée – plusieurs essais en témoignent – comme référence de la pensée de l’essayiste. Dans « De la Physionomie », Montaigne insiste sur le fait que la seule voie vers la sérénité est la conduite conforme à la « nature », et que la conduite selon la science mène à l’opposé de ce qu’elle promet : à la perturbation. Examinons donc la critique de Montaigne à la conduite selon la science, pour aboutir enfin à celle proposée par l’auteur. Nous devrons nous demander alors ce qu’est cette « nature » prise comme paramètre par l’essayiste.
Nous avons dit qu’à l’horizon de cette entreprise se trouve la bonne vie possible, à savoir, la tranquillité de l’âme. De quelle façon les différentes traditions de la pensée occidentale jusqu’au xvie siècle ont-elles voulu 73l’atteindre ? Et bien, à partir de différentes stratégies de connaissance et de contrôle des affections de l’âme, c’est-à-dire de modération ou de contention des passions (les mouvements de l’âme liés à la quête des biens – cupidité, ambition, volupté – ou à l’aversion des maux – tristesse, peur). Parmi ces différentes stratégies, une est saillante pour Montaigne, celle qu’il entend comme « la » stratégie de la science : la meditatio mortis des stoïcismes moyen et impérial, surtout de Cicéron et de Sénèque.
D’après les Stoïciens, la cause de la perturbation de l’âme est une erreur de jugement : considérer comme des biens des choses qui, en soi, sont indifférentes3 (la richesse, l’honneur, la santé, etc.) En les jugeant en tant que biens, l’individu les prend pour des fins (téloi) de ses actions, les souhaite et oriente ses efforts pour les atteindre et les garder. D’où sa souffrance quand il ne les atteint pas ou les perd (quand ce n’était pas prévu par la Providence Divine qu’il les atteignît ou les gardât). La seule possibilité d’échapper à cet attachement pervers est l’acquisition de la science du bien4, c’est-à-dire, la compréhension que le seul et véritable bien (l’unique objectif qui doit être souhaité et cherché) est l’harmonie universelle, qui dépend de l’accomplissement de notre nature individuelle (de notre destin5 personnel). Conformer la propre volonté aux commandements de la raison ou aux desseins de la nature, c’est-à-dire, à la volonté de Dieu ; accepter tout ce qui se passe avec soi-même (ou, encore plus, le souhaiter, le chercher) : voici la source de la tranquillité de l’âme.
Il se passe que l’individu, à partir de sa perspective limitée, ne connaît pas les plans de Dieu. Il ne sait pas s’ils prévoient son mariage, une carrière politique, etc. Alors, que doit-il choisir, chercher ? Or, disent les Stoïciens, il doit poursuivre en choisissant ce que son éducation lui a appris à choisir (ce qui est convenable : la santé, l’honneur, les connaissances, etc.) mais sans les considérer en tant que biens, c’est-à-dire, en tant que fins ultimes (téloi) à ses actes. Il doit les prendre seulement comme des choses préférables, c’est-à-dire, des fins nécessaires pour qu’il continue à agir – en un mot : des fins intermédiaires (skópoi). En chacun de ses choix, sa fin ultime (le vrai objet de ses souhaits) doit être ce que la 74raison et la nature (la volonté de Dieu) déterminent. Ainsi, s’il n’aboutit pas à la fin intermédiaire, il ne sera pas déçu, car en vérité il cherchait ce que Dieu prétendait pour lui (ce qui, de toute façon, s’est réalisé). Il sait que tout ce qui peut advenir sera en conformité à la raison ou à la volonté de Dieu ; que tout collabore pour la réalisation de sa singularité et pour l’harmonie du cosmos, la seule fin qu’il souhaite. Cet homme, nommé sage par les Stoïciens, reste tranquille, dans un état d’indifférence parfaite face à n’importe quoi qui lui arrive6. Mais comment acquiert-on la science du Bien ? Certainement, en prenant la voie de la philosophie, c’est-à-dire, de l’exercice de la dialectique, la pratique répétée de la distinction des biens et des maux. Suite à la répétition de cet exercice (du jugement de ce qui est correct dans chaque cas), on espère que le philosophe puisse faire un « saut intellectuel » par lequel il est subitement amené à l’appréhension du bien.
Néanmoins, au long de l’histoire du stoïcisme, d’autres « méthodes » visant le détachement par rapport aux biens selon l’opinion commune ont été développées. C’est le cas de la méditation de la vanité et de la contingence7 de ces choses, une « méthode » développée dans les stoïcismes moyen et impérial. Cette méditation – une espèce de projection permanente de la possibilité de les perdre à tout moment – doit (du moins c’est ce qu’on attend) avoir comme effet un certain détachement de ces « faux biens » ; en un mot, l’indifférence ou l’impassibilité :
Si l’on pouvait jusqu’au fond de l’âme se pénétrer de cette vérité, et se représenter que tous les maux qui arrivent aux autres, chaque jour et en si grand nombre, ont le chemin libre pour parvenir jusqu’à nous, on serait armé avant que d’être attaqué8.
Toutefois, il y a une stratégie prétendument encore plus efficace conduisant plus rapidement à ce résultat. Dans la mesure où les représentations de l’opinion commune affirment que la mort est le pire des maux (ou 75que la vie est le plus grand des biens), il suffirait que la méditation s’applique à cet objet pour que, comme un effet de cascade, tout le reste devienne indifférent. Ainsi, la meditatio mortis acquiert une centralité parmi les stratégies qui cherchent l’impassibilité ; elle sera la stratégie par excellence du stoïcisme impérial (du moins celui de Sénèque) pour la tranquillité de l’âme. Il s’agit de méditer constamment sur la vanité, sur l’aspect éphémère et sur la contingence de la vie ; de projeter à tout moment, et vers l’instant suivant, sa propre mort :
On vit mal quand on ne sait pas bien mourir. […] celui qui sait, qu’au moment même où il fut conçu, son arrêt fut porté, saura vivre selon la loi de la nature, et trouvera ainsi la même force d’âme à opposer aux événements dont aucun pour lui ne sera jamais imprévu9.
Or Montaigne ne pouvait pas ne pas se moquer de ce « projet » élaboré par les Stoïciens, c’est-à-dire, de leur conception de la tranquillité comme impassibilité (apathia) et du chemin proposé pour l’atteindre (l’acquisition de la science du Bien). Ceci parce que, dit l’essayiste, ni l’un ni l’autre (ni la science ni l’impassibilité) sont à la portée de la plupart des hommes10 (les hommes ordinaires, communs, médiocres), qui sont intellectuellement et affectivement faibles, c’est-à-dire, dotés d’une capacité à juger fragile et d’une volonté faible. En de nombreux passages, Montaigne montre la fragilité constitutive du jugement des hommes (ce n’est même pas la peine de recourir à l’Apologie de Raimond Sebond) :
Qui se souvient de s’estre tant et tant de fois mesconté de son propre jugement, est-il pas un sot de n’en entrer pour jamais en deffiance ? Quand je me trouve convaincu par la raison d’autruy d’une opinion fauce, je n’apprens pas 76tant ce qu’il m’a dict de nouveau et cette ignorance particuliere (ce seroit peu d’acquest), comme en general j’apprens ma debilité et la trahison de mon entendement (III, 13, 1074).
Pour Montaigne donc, le « saut intellectuel » vers l’appréhension du Bien, imaginé par les Stoïciens, est impossible pour les hommes. On peut dire de même par rapport à l’indifférence parfaite du sage. Elle suppose un pouvoir de neutralisation ou d’atténuation d’états affectifs (mouvements de l’âme) qui très souvent n’est pas à la portée des hommes : « N’ataquons pas ces exemples ; nous n’y arriverions point » – (III, 10, 1015). Une fois l’âme étant touchée par les objets qui provoquent les passions, ni le jugement ni la force de la volonté sont à même de freiner le sujet11 – Montaigne même se présente comme exemple de cette incapacité : « Ceux qui doivent avoir soing de moy pourroyent à bon marché me desrober ce qu’ils pensent m’estre nuisible : car en telles choses, je ne desire jamais ny ne trouve à dire ce que je ne vois pas ; mais aussi de celles qui se presentent, ils perdent leur temps de m’en prescher l’abstinence » (III, 13, 1101). Entre l’homme ordinaire et le paradigme du sage proposé il y a une distance insurmontable – ce qui fait de ce dernier, aux yeux de Montaigne, un modèle inutile : « A quoy faire ces poinctes eslevées de la philosophie sur lesquelles aucun estre humain ne se peut rassoir, et ces regles qui excedent nostre usage et nostre force ? » (III, 9, 989).
Dans un contexte semblable, Montaigne va encore plus loin dans la critique, accusant d’ambition les porte-paroles de cette morale :
[Je] hay cette inhumaine sapience qui nous veut rendre desdaigneux et ennemis de la culture du corps. J’estime pareille injustice prendre à contre cœur les voluptez naturelles que de les prendre trop à cœur. […] Il en est qui d’une farouche stupidité, comme dict Aristote, en sont desgoutez. J’en cognoy qui par ambition le font […] Zenon n’embrassoit que l’ame, comme si nous n’avions pas de corps (III, 13, 1106-1107).
77Ici Montaigne fait appel à des arguments qui remontent à une longue tradition, dont les traces se trouveraient dans la poésie grecque (d’Homère aux tragédies), chez Horace et chez certains auteurs chrétiens. Le point commun entre ces différentes sources est la leçon morale dérivée de l’accent mis sur les limites humaines, dont les poètes grecs et les auteurs chrétiens12 soulignent le contraste avec la perfection et puissance divines, pour marquer ce que l’homme ne peut pas revendiquer. Montaigne s’insère dans cette longue tradition quand il accuse dans la morale pratique des Stoïciens quelque chose comme l’aspiration à une condition divine, étant donné que la science et l’impassibilité seraient des attributs uniquement de Dieu : « Ils veulent se mettre hors d’eux et eschapper à l’homme. C’est folie : au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bestes ; au lieu de se hausser, ils s’abattent » (III, 13, 1115).
Montaigne avertit ceux qui proposent cette morale des conséquences néfastes de leur hýbris : il ne s’agit pas seulement d’une prétention vaine, d’une quête inutile, mais d’un projet nuisible. Ceci parce que, contrairement à ce qu’elle promet, cette morale ne produit que la perturbation, le malheur. Sur ce point, la critique s’adresse directement à la meditatio mortis. La méditation permanente de sa propre mort, la projection constante d’un événement fatal pour l’instant à venir ne pourrait avoir d’autre effet que de mettre l’individu dans un état permanent de terreur : « Il est certain qu’à la plus part la préparation à la mort a donné plus de tourment que n’a faict la souffrance. […] Non seulement le coup, mais le vent et le pet nous frappe » (III, 12, 1050-1051). La meditatio ajoute à la souffrance sensible, réelle, inévitable (la mort) ou simplement possible (la pauvreté, le déshonneur), la peur, une souffrance créée par l’imagination. Ainsi, elle anticipe, prolonge dans le temps et approfondit (car il est recommandé de projeter les plus terribles maux, une fois qu’on est prêt à leur éventualité) une souffrance qui n’affecterait le sujet que dans le futur et de façon plus légère et plus brève au moment où elle se présenterait à ses sens :
Jettez vous en l’experience des maux qui vous peuvent arriver, nommément des plus extremes : esprouvez vous là, disent-ils, asseurez vous là […] il faut 78que nostre esprit les estende et alonge et qu’avant la main il les incorpore en soy et s’en entretienne, comme s’ils ne poisoient pas raisonnablement à nos sens. […] [Or] c’est fiévre aller des à cette heure vous faire donner le fouet, par ce qu’il peut advenir que fortune vous le fera souffrir un jour (ibid.).
Imagination et sens : ces sont les deux pôles concernés dans la critique de Montaigne à la meditatio mortis ou, plus largement, à la « science ». L’affectation des sens par quelques malheurs est incontournable. Il est possible d’éviter, cependant, le travail nuisible de l’imagination qui provoque la perturbation.
Nous pouvons nous rendre compte, par là, de la voie empruntée par Montaigne pour faire opposition à la voie de la science, en ce qui concerne l’affrontement aux malheurs : la voie des sens, c’est-à-dire, de la restriction du travail de l’imagination. C’est la voie parcourue de façon spontanée par l’homme simple, non cultivé, qui évite de penser aux malheurs avant qu’ils n’adviennent ; qui ne les subit que quand ils se présentent à ses sens : « Le commun n’a besoing ny de remede ny de consolation qu’au coup, et n’en considere qu’autant justement qu’il en sent » (III, 12, 1052). Cet homme ne s’attriste pas du présent à cause d’un éventuel (ou même nécessaire) malheur futur ; il ne prolonge pas dans le temps ni n’augmente la gravité des souffrances par des projections imaginaires. Au contraire, il fige sa conscience dans le présent et dans la jouissance des plaisirs et des petits bonheurs de l’instant, en éloignant les représentations qui provoquent peur et tristesse : « Je ne vy jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelle contenance et asseurance il passeroit cette heure derniere. Nature luy apprend à ne songer à la mort que quand il se meurt » (ibid.). En abandonnant les malheurs aux sens, en utilisant à minima la faculté de représentation, cet homme est plus à même de les saisir dans leur dimension réelle, qui échappe à l’homme de science, car celui-ci leur ajoute des représentations imaginaires (« comme les parfumiers de l’huile : ils [les hommes de science] l’ont sophistiquée [la nature] de tant d’argumentations et de discours appellez du dehors… » – II, 12, 1049). Tandis que l’homme de science s’éloigne de la vérité des choses, l’homme simple s’en rapproche.
Voici donc le modèle de conduite à suivre : quelqu’un comme le paysan, le rustique. En deux mots : l’homme ignorant (« cette tourbe d’hommes impolis » – II, 12, 1049) qui n’est pas passé par le processus 79d’éducation et qui s’oriente par les usages, par les opinions communes et par l’expérience immédiate. Surtout, cet homme souffre peu parce qu’il cherche le plaisir et fuit la douleur. Il évite d’ajouter à la douleur inévitable qui l’affectera sensiblement (la maladie, la vieillesse, la mort) la souffrance provoquée par des représentations imaginaires (la tristesse, la peur). De la même façon13, il cherche les plaisirs sensibles et en profite intensément, sans les mélanger à des représentations désagréables. Mais il évite aussi les excès, car il ne souhaite pas les douleurs futures que cela pourrait provoquer14 (la gueule de bois suite à une beuverie, l’indigestion suite à un festin) : « L’intemperance est peste de la volupté, et la temperance n’est pas son fleau : c’est son assaisonnement » (III, 13, 1110). Enfin, de cette espèce de sagesse populaire, de cette sagesse presque instinctive (les animaux cherchent aussi le plaisir et évitent la douleur15), advient la tranquillité de l’âme, un état animique coexistant avec une espèce de gratitude16 par le vécu – fruit de la pratique quotidienne et réitérée du détournement de la conscience des douleurs et de sa fixation sur les plaisirs.
Mais que signifie prendre le rustique (cette espèce d’homme presque en « état de nature ») comme modèle de conduite ? Que peut signifier cela pour des hommes qui, comme Montaigne, sont déjà passés par 80le processus d’éducation et ne peuvent plus revenir à cet état primitif d’ignorance ? Comment, ayant été éduqué, se rapprocher de ce modèle ? Pour répondre à ces questions, Montaigne trouve dans l’histoire de la philosophie un modèle de sage qui aurait réalisé ce « projet » : Socrate. Le maître de Platon et Xénophon, selon l’essayiste, aurait justement atteint, par sa pratique philosophique, un état similaire à celui du rustique. Il reproduirait sa tranquillité fondée sur l’ignorance : « Nous n’aurons pas faute de bons regens, interpretes de la simplicité naturelle. Socrates en sera l’un » (II, 12, 1052). Ceci parce que le fruit principal de son enseignement aurait été de conduire ses interlocuteurs à la reconnaissance de leur propre ignorance (reconnaissance que lui même, Socrate, aurait été le premier à effectuer). L’essentiel ici, c’est la pratique socratique de l’elenchos : la critique des discours dogmatiques (de son savoir prétendu), la conduction de ses interlocuteurs à la reconnaissance de leur manque de science (du fait qu’il ne possèdent que des opinions). Dans « De la Physionomie », Montaigne examine le discours proféré par Socrate à l’occasion de son jugement (la version platonique de ce discours dans l’Apologie de Socrate) et il s’intéresse à l’analyse des raisons de sa tranquillité face à sa condamnation à mort. Devant cet horizon, Socrate se montre serein. Et il argumente qu’il reste calme, affirme Montaigne, parce qu’il ne sait pas ce qu’est la mort. Toutes les opinions sur la nature de la mort (s’il y a ou non l’immortalité de l’âme ; si la mort est ou non notre complet anéantissement) se révèlent, une fois examinées, seulement ceci : des opinions, c’est-à-dire, des jugements dont la correspondance à l’objet (la mort, en l’occurrence) ne peut pas être vérifiée. Que redouter alors ? « Je sçay [dit Socrate, selon Montaigne] que je n’ay ny frequenté ny recogneu la mort, ny n’ay veu personne qui ayt essayé ses qualitez pour m’en instruire. Ceux qui la craingnent presupposent la cognoistre. Quant à moy, je ne sçay ny quelle elle est, ny quel il faict en l’autre monde » (III, 12, 1052-1053). Le jugement de Montaigne sur la déclaration socratique situe le maître de Platon dans une position voisine du rustique : « c’est un discours […] [qui] représente […] la pure et premiere impression et ignorance de nature » (ibid., 1054-1055).
Comme le paysan, donc, le Socrate montaignien (mais alors par effet de la critique sceptique, et non pas par inclination « naturelle ») n’ajoute pas à la douleur sensible la souffrance créée par les représentations. Il ressemble aussi à l’homme simple par son dévouement aux plaisirs 81sensibles. Sa tranquillité advient également de la satisfaction des désirs naturels. Dans de nombreux passages Montaigne dessine un Socrate attaché aux petits plaisirs et joies de l’instant : l’homme qui danse, qui joue des instruments, qui joue avec les enfants, boit avec ses compagnons et se permet même quelques excès occasionnels, en affirmant qu’ils répondent (si adaptés aux circonstances) aux règles de la convenance :
[il n’est] chose plus remercable en Socrates que ce que, tout vieil, il trouve le temps de se faire instruire à baller et jouer des instrumens, et le tient pour bien employé […] cet homme là estoit-il convié de boire à lut par devoir de civilité, c’estoit […] celuy de l’armée à qui en demeuroit l’avantage ; et ne refusoit ny à jouer aux noysettes avec les enfans, ny à courir avec eux sur un cheval de bois ; et y avoit bonne grace (III, 13, 1109-1110).
On comprend par là que le modèle de Socrate n’est pas seulement important par sa puissance critique ; son intérêt ne se résume pas au moment négatif de l’elenchos. À partir de la réduction à l’ignorance surgit un nouveau programme, et Montaigne reconnaît en Socrate son plus illustre représentant. Ceci parce que le rustique n’est pas seulement un homme ignorant. Il est un homme ordonné, spontanément ordonné ; un homme qui se conduit conformément à une ordination « naturelle ». Or le programme qui s’inaugure suite au moment de la réduction à l’ignorance est la récupération de cet ordre, perdue par l’effet d’une certaine éducation, d’une certaine culture :
Je ne regarde pas l’espece et l’individu comme une pierre où j’aye bronché ; j’apprens à craindre mon alleure par tout, et m’attens à la reigler (III, 13, 1074) ; […] composer nos meurs est nostre office, non pas composer des livres, et gaigner, non pas des batailles et provinces, mais l’ordre et tranquillité à nostre conduite (III, 13, 1108).
En termes socratiques, ce serait aller vers le moment de la maïeutique, c’est-à-dire, de l’effort pour ordonner les opinions et en extraire des connaissances. En termes montaigniens, il s’agit de récupérer l’ordination de soi, c’est-à-dire, de ses propres opinions et de la relation entre les parties constituantes du moi17, soit, le corps et l’âme. De cet ordre advient l’ordination de la conduite et la tranquillité de l’âme.
82Parlons un peu plus du rustique. Son discours et sa conduite sont spontanément ordonnés. Son discours a de l’ordre, même si ses mots n’en ont pas. D’une manière générale, il se fait comprendre, il communique avec succès ; le sens de ce qu’il dit est compréhensible, même avec un certain désordre en ses mots :
il ne sçait pas ablatif, conjunctif, substantif, ny la grammaire ; ne faict pas son laquais ou une harangiere du petit pont, et si vous entretiendront tout vostre soul, si vous en avez envie, et se desferreront aussi peu, à l’adventure, aux regles de leur langage, que le meilleur maistre és arts de France (I, 26, 169).
Il en va de même avec sa conduite : il agit très souvent de manière droite et reste tranquille, car il assume comme des critères de conduite les usages et les sens (le plaisir et la douleur). Il reste tranquille parce que ses « parties constitutives » (son corps et son âme) sont spontanément ordonnées l’une par rapport à l’autre. Il est l’homme qui garde une relation saine avec son propre corps, qui répond aux demandes de ses impulsions naturelles (désir de plaisir et aversion à la douleur). Il ne cherche pas une impassibilité antinaturelle comme le font les philosophes (les « hommes de science »), ni le contrôle de son âme sur son corps. Ceux-ci (âme et corps) s’entraident. Son âme ne rajoute pas aux douleurs du corps la souffrance découlant de représentations imaginaires ; 83bien au contraire, elle cherche des distractions (des divertissements, des souvenirs de plaisirs passés etc.) pour soulager les douleurs inévitables du corps. Sa conduite est un modèle pour Montaigne lui même, comme il nous le montre dans ce passage :
Voicy depuis, de nouveau, que les plus legers mouvements espreignent le pur sang de mes reins. Quoy, pour cela je ne laisse de me mouvoir comme devant et picquer apres mes chiens d’une juvenile ardeur, et insolente. […] Or sens je quelque chose qui crosle ? Ne vous attendez pas que j’aille m’amusant à recognoistre mon pous et mes urines pour y prendre quelque prevoyance ennuyeuse ; je seray assez à temps à sentir le mal, sans l’alonger par le mal de la peur. Qui craint de souffrir, il souffre desjà de ce qu’il craint (III, 13, 1095).
D’autre part, les plaisirs sensibles sont un baume pour les passions tristes de son âme – sa tristesse et sa peur face à la vieillesse, la maladie et la mort. Encore une fois, c’est la conduite que Montaigne met en œuvre : « Jeune, je couvrois mes passions enjouées de prudence ; vieil, je demesle les tristes de débauche » (III, 9, 977). Finalement, par moyen de l’accord mutuel de ses « parties constitutives », l’homme ordinaire peut régler les excès de l’une et de l’autre18.
Et quant à Socrate ? Encore mieux : et quant au Socrate montaignien ? Or il est l’homme qui s’oppose à une certaine culture, à une éducation déterminée, soit, celle qui rompt avec cet ordre « naturel », qui défait l’adhésion spontanée des hommes aux opinions ordinaires et aux sens, en mettant à leur place, comme critères de conduite, les commandements de la raison (une doctrine morale prétendument fondée sur une physique). Le Socrate montaignien est celui qui soumet à la critique la connaissance prétendue de soi (le savoir supposé des philosophes dogmatiques sur notre essence) ; qui exhibe notre ignorance sur nous-mêmes ; qui réduit, enfin, les doctrines sur la nature humaine au niveau d’opinions et restitue à l’expérience (à l’examen des phénomènes) le privilège d’être la source de la connaissance de soi :
84Les philosophes, avec grand raison, nous renvoyent aux regles de Nature ; mais elles n’ont que faire de si sublime cognoissance : ils les falsifient et nous presentent son visage peint trop haut en couleur et trop sophistiqué […] Qui remet en sa memoire l’excez de sa cholere passée, et jusques où cette fiévre l’emporta, voit la laideur de cette passion mieux que dans Aristote, et en conçoit une haine plus juste. […] La vie de Caesar n’a poinct plus d’exemple que la nostre pour nous ; et emperière, et populaire, c’est tousjours une vie que tous accidents humains regardent. Escoutons y seulement : nous nous disons tout ce de quoy nous avons principalement besoing. […] L’advertissement à chacun de se cognoistre doibt estre d’un important effect, puisque ce Dieu de science et de lumiere le fit planter au front de son temple, comme comprenant tout ce qu’il avoit à nous conseiller. Platon dict aussi que prudence n’est autre chose que l’execution de cette ordonnance, et Socrates le verifie par le menu en Xenophon (III, 13, 1073-1075).
Alors, à partir de l’expérience de soi – et non plus de doctrines dogmatiques sur la nature humaine –, le vieux programme de l’ordination de soi peut être restauré en termes corrects. Ceci parce que l’expérience de soi nous montre notre condition mixte – un vécu simultanément animique et corporel, spirituel et charnel :
Les plaisirs purs de l’imagination, ainsi que les desplaisirs, disent aucuns, sont les plus grands […] J’en voy tous les jours des exemples insignes, et à l’adventure desirables. Mais moy, d’une condition mixte, grossier, ne puis mordre si à faict à ce seul object […] Aristippus ne defendoit que le corps, comme si nous n’avions pas d’ame ; Zenon n’embrassoit que l’ame, comme si nous n’avions pas de corps. Tous deux vicieusement (III, 13, 1107).
D’où le nouveau programme : s’ordonner soi même, au niveau de la conduite (il faudrait examiner aussi ce problème au niveau du discours), c’est établir l’aide réciproque entre corps et âme : « A quoy faire desmembrons nous en divorce un bastiment tissu d’une si joincte et fraternelle correspondance ? Au rebours, renouons le par mutuels offices. Que l’esprit esveille et vivifie la pesanteur du corps, le corps arreste la legereté de l’esprit et la fixe » (III, 13, 1114).
De ce nouveau « programme » formulé par Montaigne, appuyé sur l’exemple de Socrate, adviendront une conduite et une vie ordonnées. À l’ordre ou à la cohérence de la conduite et de la vie du sage idéalisé du stoïcisme, effet de la répétition de l’impassibilité (toujours convenable, toujours adéquate), Montaigne oppose une nouvelle figure de l’ordre 85ou de la cohérence : celle, beaucoup plus humaine, qui est l’effet de la réitération de la fuite de la douleur et de la quête du plaisir (divertissement toujours convenable, toujours « à propos »). Enfin, Montaigne oppose à la constantia stoïque une conduite qui semble inconstante, mais qui échappe à la critique de l’inconstance dans la mesure où elle est constituée par des déviations et quêtes conscientes, volontaires (une « manière » qui n’a rien de passive, mais qui constitue, au contraire, une stratégie pour échapper aux perturbations) : « Socrates ne dit point : Ne vous rendez pas aux attraicts de la beauté, soustenez la, efforcez vous au contraire. Fuyez la, faict-il, courez hors de sa veue et de son rencontre, comme d’une poison puissante qui s’eslance et frappe de loing » (III, 10, 1015-1016). Finalement, en opposant à la répétition stoïque du même la réitération du divers, Montaigne aboutit à une conduite parfaitement « ordonnée », une vie unifiée et uniforme, totalement cohérente (« Il [Socrate] fut aussi tousjours un et pareil » – III, 12, 1037) : la vie de l’homme de bien ordinaire, succession de déviations. Or ne s’agirait-il pas exactement d’une harmonie parfaite, que nous retrouvons dans l’image achevée de la tranquillité de l’âme fondée par Montaigne sur ce modèle de conduite ?
Elle [mon âme] mesure combien c’est qu’elle doibt à Dieu d’estre en repos de sa conscience et d’autres passions intestines, d’avoir le corps en sa disposition naturelle, jouyssant ordonnéement et competemmant des functions molles et flateuses, par lesquelles il luy plait compenser de sa grace les douleurs de quoy sa justice nous bat à son tour, combien luy vaut d’estre logée en tel point que, où qu’elle jette sa veue, le ciel est calme autour d’elle : nul desir, nulle crainte ou doubte qui luy trouble l’air, aucune difficulté passée, presente, future par dessus laquelle son imagination ne passe sans offence (III, 13, 1112).
Andre Scoralick
Université de São Paulo, Brésil
1 Michel de Montaigne, Les Essais, III, 13, 1116. Nous utiliserons ici l’édition Villey-Saulnier : Les Essais, éd. P. Villey, rééditée par V. L. Saulnier ; Paris, PUF, 1999.
2 Friedrich, Hugo, Montaigne, trad. Robert Rovini, Paris, Gallimard, 1992, p. 13.
3 Sénèque, Lettres à Lucilius, texte établi par F. Préchac et traduit par H. Noblot ; édition revue et corrigée par Paul Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 921-932 (lettre 92) et p. 1060-1064 (lettre 118).
4 Ibid., p. 638-640 (lettre 16) et p. 693-696 (lettre 41).
5 Ibid., p. 969-970 (lettre 96).
6 Cf. Sénèque, De constantia sapientis, in Entretiens et Lettres à Lucilius, texte établi par F. Préchac et traduit par H. Noblot ; édition revue et corrigée par Paul Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 326 (10, 4).
7 Nous parlons de contingence parce que la Providence Divine peut être représentée comme la Fortune, du fait que l’agent n’en percevrait qu’une force déterminant les résultats de ses actions, sans avoir connaissance de ses mouvements ; de son point de vue limité, il ne peut savoir si cette force est hasardeuse ou émane de la volonté divine.
8 Sénèque, De tranquilitate animi, in Entretiens et Lettres et Lucilius, op. cit., p. 361 (11, 8).
9 Ibid., p. 361 (11, 4-6). Cf., aussi, Lettres à Lucilius, p. 916-921 (lettre 91) et p. 986-989 (lettre 101).
10 Montaigne met explicitement sous tension le paradigme stoïcien et une certaine conception de l’homme. Il accuse la vanité du modèle à la lumière de l’impossibilité de l’homme ordinaire de le réaliser (« ces regles qui excedent nostre usage et nostre force » – III, 9, 989). Un autre terme auquel il fait appel est le « nous » dans lequel il s’inclut et qui désigne la collectivité humaine (« nous, les hommes faibles » – cf. III, 10, 1015). Nous comprenons que ces notions n’impliquent aucune référence à une nature humaine ou à une universalité. Quand Montaigne parle des « hommes » ou de ce « nous » dans lequel il s’inclut, nous pensons qu’il s’agit d’une notion obtenue par expérience et qui reste, donc, comme une généralité lâche, ouverte aux exceptions. De la même façon, nous comprenons que Montaigne se réfère aux penchants humains en tant que phénomène observable, sans pouvoir dire s’il exprime une « nature » occulte.
11 Ni le jugement, ni la force de la volonté. Plus qu’aux seuls Stoïciens, Montaigne s’oppose donc aux deux traditions qui, depuis les Grecs, discutaient sur la façon de « contrôler » les passions : les intellectualistes, fondant la vertu uniquement sur la connaissance du bien (le jeune Platon, les Stoïciens), et les adeptes de l’enkrateia, c’est-à-dire, la résistance conquise par l’exercice (Xénophon, les Cyniques). Le Platon des dialogues de maturité (à partir de la République) et Aristote comprendront, tous les deux, que la connaissance du Bien et la force de la volonté sont nécessaires à la vertu (la seconde en aidant la première).
12 Cf. aussi Plutarque, L’E de Delfos, in Dialogues Pythiques, Paris, Flammarion, 2006, p. 112-115 (392a-393c).
13 La conduite « naturelle » que, dans l’essai « De l’Expérience », Montaigne revendique par rapport aux plaisirs du corps, ne serait-elle pas le correspondant de la conduite naturelle que, dans « De la Physionomie », il revendique par rapport aux souffrances ? C’est là notre opinion. Même si Montaigne n’attribue pas explicitement au rustique la jouissance saine des plaisirs sensibles (réglée uniquement par le besoin de ne pas retomber en des douleurs futures), il nous semble que le faire est en conformité avec les idées de l’essayiste.
14 Est-ce que le plaisir et la douleur seraient suffisants comme critères de conduite pour éviter le vice et instaurer la vertu morale ? L’application de ces critères serait-elle suffisante ? Ces questions doivent être examinées.
15 « Nature a empreint aux bestes le soing d’elles et de leur conservation. Elles vont jusques là de craindre leur empirement, de se heurter et blesser […] accidents subjects à leurs sens et experience. Mais que nous les tuons elles ne le peuvent craindre, ny n’ont la faculté d’imaginer et conclurre la mort » (III, 12, 1055).
16 Encore une fois il nous semble nous accorder aux idées de l’auteur en établissant une liaison entre la conduite paradigmatique du paysan (conduite selon la nature) et le thème de la gratitude qui apparaît dans l’essai suivant, « De l’Expérience ». Ceci parce que la gratitude est une espèce de corolaire de la vie selon la nature, qui limite l’action de la douleur aux sens et étend les plaisirs sensibles avec l’aide de la faculté de représentation : « Les autres sentent la douceur d’un contentement et de la prospérité ; je la sens ainsi qu’eux, mais ce n’est pas en passant et glissant. Si la faut il estudier, savourer et ruminer, pour en rendre graces condignes à celuy qui nous l’ottroye. […] Pour moy donc, j’ayme la vie et la cultive telle qu’il a pleu à Dieu nous l’octroier » (III, 13, 1112-1113).
17 Or n’est-ce pas exactement le « programme moral » élaboré par Platon dans plusieurs dialogues ? Soit : rétablir, à partir de la connaissance de soi (c’est-à-dire, de notre nature), l’ordre naturel entre nos parties constitutives (dans le cas platonique, la hiérarchie due entre corps et âme ; le commandement de celle-ci sur celui-là) : « la vertu de chaque chose consiste en une ordonnance (táxei) et une disposition heureuse (kekosmeménon) résultant de l’ordre […] Il faut que chacun tende toutes ses forces, toutes celles de la cité, vers cette fin […] qu’on ne permette pas aux appétits (epithymías) de régner sans mesure » (Platon, Gorgias, Paris, Les Belles Lettres, 2003 (col. Classiques en Poche), p. 197-201 (506d-507e)). Montaigne repropose le programme platonique de l’ordination de soi, mais en termes différents. Il ne s’agit pas d’établir un rapport (vertical) de commandement et d’obéissance entre les « parties », mais un rapport (horizontal) d’aide mutuelle, de « mutuels offices » (III, 13, 1114). Sans doute, Montaigne est d’accord avec Platon quant au besoin de la tempérance. Mais celle-ci ne doit pas être l’effet du commandement de l’âme sur le corps, mais de l’aide mutuelle entre ces parties (les passions de l’âme ont également besoin d’être réglées, tempérées ; elles sont d’ailleurs les plus dangereuses). Montaigne ne prétend pas que nous cherchons la tempérance du fait qu’elle soit un bien, mais parce que le plaisir en dépend : « qu’elle [l’âme] l’assiste et favorise [le corps] et ne refuse point de participer à ses naturels plaisirs et de s’y complaire conjugalement, y apportant, si elle est plus sage, la moderation, de peur que par indiscretion ils ne se confondent avec le desplaisir » (III, 13, 1110). La fin ultime (si nous pouvons parler encore – après la critique sceptique – en ces termes) est autre : non pas la vertu et, en conséquence, le plaisir, mais le plaisir et, en conséquence, la vertu. Est autre, aussi, ce qui nous anime dans sa direction : non plus une volonté rationnelle souveraine, mais un désir orienté (favorisé) par le jugement.
18 Encore une fois, nous projetons expressément sur le modèle du rustique une conduite qui n’est pas explicitement associée à lui par Montaigne (tout en étant, en réalité, selon les citations présentées, une conduite de l’essayiste lui-même), soit, l’aide mutuelle entre corps et âme. Cependant, nous pensons que cette projection ne va pas contre les idées de l’auteur, dans la mesure où elle associe justement l’ordination naturelle entre les « parties constitutives » du moi à la conduite conforme à la nature, dont Montaigne trouve le modèle chez le rustique.