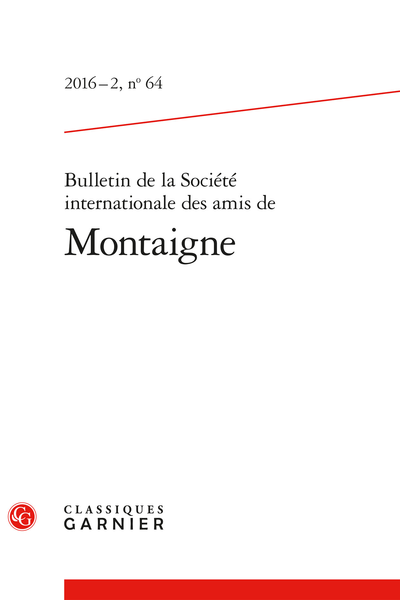
L’Indien dans les Essais Une figure du relativisme ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2016 – 2, n° 64. varia - Auteur : Veiga França (Maria Célia)
- Résumé : La comparaison entre le barbare dessiné dans la Germanie de Tacite et le barbare peint par les Essais nous montrent deux conditions d’homme en vérité très distinctes ; et nous offre, dans le premier cas, un état négatif devant être surpassé, dans le deuxième, un état que nous interpréterons presque comme un idéal humain. Constatation qui, ajoutée à certaines critiques lancées à la religion ou aux chrétiens, nous permet d’esquisser un homme que son scepticisme ne le laisse pas définir.
- Pages : 143 à 158
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406066323
- ISBN : 978-2-406-06632-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06632-3.p.0143
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/12/2016
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
L’Indien dans les Essais
Une figure du relativisme ?
Parler de la nature humaine chez Montaigne pose des problèmes considérables, voire insurmontables. Nous voulons cependant aborder ici quelques questions qui nous paraissent fécondes. Dans notre texte, « Le portrait de l’Indien dans les récits de la conquête américaine1 », sur les divers moyens par lesquels les auteurs du seizième siècle établissaient l’humanité ou l’inhumanité des Américains, nous avons eu l’occasion d’étudier de plus près l’un des principaux aspects de l’idée d’humanité chez Montaigne. Dans « l’Apologie » et dans plusieurs autres chapitres, celui-ci démontre l’impossibilité d’accéder à la connaissance de la nature humaine. À travers son portrait de l’Indien, il réfute plus spécifiquement la définition aristotélicienne de la nature humaine par la raison et la sociabilité. Il attribue sans hésiter l’humanité aux Américains, et reconnaît chez eux une rationalité et une sociabilité, même si ce n’est pas par sur ces caractéristiques qu’il se fonde pour affirmer leur humanité.
Pour mieux comprendre la figure de l’homme indigène, nous devons passer par l’analyse du barbare telle que nous trouvons en particulier dans les chapitres « Des Cannibales » et « Des Coches ». Pierre Villey suggérait que, pour Montaigne, toute civilisation, en tant que produit de la raison et de l’artifice, était condamnable : l’admiration de Montaigne pour les sauvages relèverait ainsi d’une forme de paradoxe visant à exalter l’idée de nature, par opposition à l’art et à la raison. Il nous paraît cependant que la nature n’est pas, chez Montaigne, définie par simple opposition à la civilisation ; et que l’estime qu’il manifeste pour les Indiens ne découle de la seule exaltation de l’idée de nature par opposition à l’artifice et à la raison, lesquels ne sont pas condamnables en tant que tels, mais relativement à l’usage que l’on en fait. Ainsi, dans 144le chapitre « Des Coches », les Mexicains et Péruviens font preuve d’une civilisation, d’une raison et d’une technique supérieure.
Selon Villey encore, Montaigne aurait reproduit, avec le cannibale, l’idéalisation que l’on trouvait déjà dans la Germanie de Tacite, ignorant par là même la spécificité des Américains. Sans dénier la présence de l’ethnocentrisme dans les Essais, il nous faut prendre en compte les grandes disparités entre les deux types de barbares, afin de faire ressortir la singularité du texte de Montaigne. Tacite cite une ou deux fois les vertus, le courage et la fidélité des Germains, mais cela ne lui suffit pas pour dépasser son regard inflexible sur la rusticité et bestialité de ce peuple. Enfin, Tacite ne fait pas des Germains un modèle, et ses quelques mouvements de sympathie envers eux portent le plus souvent sur de beaux animaux possédant de nobles instincts.
Commençons par la nature comprise comme environnement. Contrairement au continent américain qui, dans les toutes premières années de la conquête, fut souvent confondu avec le paradis terrestre, la Germanie était une terre sans attrait : son paysage ne présentait ni séduction ni grâce, et son climat était rude. Il s’agissait d’un pays sinistre à habiter et même à regarder2. Si nous nous rappelons qu’au xvie siècle, la théorie de l’influence du climat sur la nature et sur le caractère des humains était encore d’actualité, nous comprenons que la nature exubérante, fertile et féconde ait pu stimuler, au début de la conquête en tout cas, une vision globalement positive du continent américain et notamment de la nature des hommes qui y vivaient. Si nous transposons cette même idée au territoire conquis par les Romains, il est clair que la terre pauvre et froide de la Germanie ne pouvait pas produire des hommes vertueux.
Venons-en aux hommes. Relevons d’abord quelques rares passages dans lesquels les Germains sont loués de Tacite. En xviii. i, leur mariage est décrit comme rigide et strict, et ils sont présentés comme les seuls barbares qui se contentent d’une seule femme, à l’exception d’un tout petit nombre qui échappe à la règle en raison de sa noblesse : « Aucun autre aspect de leurs mœurs, suggère Tacite, ne saurait être loué davantage ». Ils n’osent pas non plus rire des vices et la corruption n’est pas tolérée dans leur société : « Corrompre et être corrompu ne s’appelle pas 145être de son temps3 ». Le caractère ironique de cette remarque pourrait inciter à penser que les propos des écrivains sur les Germains ne sont qu’un prétexte pour critiquer leur propre société. Mais si cette critique est présente, on ne saurait en déduire l’absence de vice des Germains ; et ce n’est pas non plus dans ce but qu’elle a été faite. Tacite allègue que : « Là-bas, les bonnes mœurs ont plus de puissance qu’ailleurs les bonnes lois4 ». Plus loin5, Tacite met l’accent sur la générosité de leurs réceptions à table et leur hospitalité, qui surpassent celles pratiquées par toute autre race. Sur ce point, d’ailleurs, le discours de Montaigne à propos des Indigènes se rapproche assez du sien. Une fois ces trois points présentés, offrant une vision assez positive des barbares européens, Tacite poursuit son récit, identifiant l’absence d’astuce et d’habilité, qui semble se rapporter à un défaut de jugement, surtout si nous regardons la suite qui dit que « cette race a le corps plus dur, les membres plus solides, le visage menaçant et un courage particulièrement vigoureux. Beaucoup, pour des Germains, de calcul et d’habileté6 ». Rien ne reste plus éloigné du dessein de Montaigne qui, tout en mettant en exergue la simplicité des Indiens, souligne la présence chez eux de toutes les facultés intellectuelles qui concourent au développement et la dignité de l’homme, et avant tout à la présence de l’entendement :
Et, afin qu’on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leur usance et par l’impression de l’autorité de leur ancienne coutume, sans discours et sans jugement, et pour avoir l’âme si stupide qui de ne pouvoir prendre autre parti, il faut alléguer quelques traits de leur suffisance (I, 31, 213)7.
Comme nous venons de le dire, il semble impropre de parler, dans la Germanie, d’un tableau idyllique. Même s’il en était un, il serait très loin de ressembler à celui des Essais. Pour terminer sur cette peinture « idéale », qui n’en est pas vraiment une, du barbare de la Germanie, Tacite souligne8 l’ignorance du prêt à intérêt et de l’augmentation du capital par l’usure, que 146l’on pourra rapprocher du manque d’intérêt des Indiens pour les richesses, démontré par l’absence de propriété privée. Or Tacite ne semble pas louer, comme le fait Montaigne, ce manque d’intérêt, ni reprocher l’avidité de ses contemporains. En ce qui concerne les métaux, tout comme les Indiens dans « Des Cannibales », les Germains n’en possédaient pas non plus, ne leur attribuaient pas de valeur ni ne faisaient d’efforts pour les obtenir. Citons Tacite : « Nous pouvons retrouver, entre les Germains, certains vases en argent offerts en cadeau aux ambassadeurs et notables de leur peuple. Toutefois, ils ne leur attribuaient pas plus de valeur qu’à ceux qu’ils fabriquaient avec de la terre9 ». Montaigne écrira à son tour : « D’or, ils en avoient peu, et que c’estoit chose qu’ils mettoient en nulle estime, d’autant qu’elle estoit inutile au service de leur vie » (III, 6, 911). C’est peut-être là le point qui rapproche le plus ces Germains de nos Indiens, mais nous ne trouvons pas, dans la Germanie, la condamnation de la convoitise des métaux si présente dans les Essais. Ce trait, tout comme l’hospitalité, est jusqu’à un certain point commun à la peinture du cannibale et celle du Germain, mais la réaction des auteurs face à eux n’est pas du tout la même.
Un autre parallèle intéressant entre ces peuples concerne la question du courage à la guerre. Dans le cas des Germains, contrairement aux Indiens, cette question est elle aussi intimement liée à celle des richesses. Les deux peuples sont présentés comme très belliqueux ; dans les deux cas aussi, la démonstration du courage est essentielle à l’établissement de la valeur et de l’honneur de chaque individu. Mais la lecture de ces deux auteurs montre une différence fondamentale pour ce qui est de l’acquisition des biens des vaincus à la guerre. Montaigne célèbre le fait que l’acquisition des biens du vaincu ne fasse pas partie des motivations de la guerre indigène, dans la mesure où ces nations abandonnent ces biens là où ils les trouvent. Il n’en va pas de même dans le cas des Germains pour qui, selon Tacite, le pillage constitue un mobile essentiel de la guerre :
Nous ne pourrions pas les persuader de travailler la terre ou d’attendre la récolte aussi facilement que de provoquer l’ennemi ou de se blesser à la bataille. Il leur semble qu’obtenir par la sueur ce qu’on peut obtenir par le sang est un signe de paresse ou de lâcheté10.
147L’absence d’agriculture mentionnée dans le passage cité ci-dessus nous mène à un autre point de divergence entre les deux auteurs, celui de l’oisiveté. Tacite commente avec un certain mépris le fait que les Germains dédient très peu de temps à la chasse quand ils ne sont pas en guerre, et restent la plupart du temps oisifs : « Tout le temps qu’ils ne passent pas à faire la guerre, ils le consacrent, un peu à la chasse, mais davantage à rester oisifs, à manger et à dormir11 ». L’oisiveté germanique n’a pas dans ce discours les mêmes raisons que celle des Indiens décrits par Montaigne. Ils ne comptent pas, comme ces derniers, sur la bonté et l’abondance de la nature qui pourvoit à tous leurs besoins essentiels, mais espèrent obtenir le nécessaire grâce à la prodigalité des autres, ce qui déçoit énormément Tacite. Montaigne, quant à lui, présente les cannibales comme des gens qui comptent sur la bonté et l’abondance de la mère nature, pourvoyeuse de tous les biens essentiels pour ses créatures. Tandis que les Américains sont présentés comme confiants en leur mère nature pour subvenir à leurs besoins, les Germains étaient décrits comme des êtres paresseux qui, tout en négligeant et méprisant les biens, dépensaient ceux des autres grâce à l’assistance desquels ils survivent. Rien, dans le texte de Tacite, n’approche l’éloge nuancé de l’absence de propriété et du communautarisme indien chez Montaigne. Chez Tacite, l’absence de d’intérêt des Indiens pour les biens matériels ne s’explique pas par une forme de détachement face aux biens matériels, mais par leur primitivisme et leur condition rudimentaire, comme le montre leur coutume simple et ancienne de ne recourir qu’au troc des marchandises12. Montaigne fait l’éloge de ces hommes qui « jouissent encore de cette liberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires » et qui « sont encore dans cet heureux point de ne désirer qu’autant que leurs nécessités naturelles leur ordonnent » (I, 31, 208). Ici, sont « vives et vigoureuses les vraies, et les plus utiles et naturelles vertus et propriétés » (I, 31, 205). Dans le cas de Tacite, la lecture est différente, puisque les Germains considèrent leur vie actuelle plus heureuse que celle qui consisterait à travailler dans les champs et construire des maisons, et préfèrent « alterner espérance et crainte pour leurs biens et ceux des autres ; en sûreté du côté des hommes, en sûreté du côté des dieux, ils sont parvenus à un état bien difficile, ne pas même avoir besoin de rien souhaiter13 ». Les 148Germains sont enfin « très féroces, abominablement pauvres et très sales, leurs chefs sont engourdis, ils ne possèdent d’armes ni de chevaux, leur alimentation est composée de plantes sauvages, leurs vêtements sont les peaux des animaux et leur lit la terre14 ».
Un autre aspect qui sépare les deux textes, est la nudité. Celle des cannibales est une démonstration d’innocence, quelque fois même comparée à celle d’Adam. La nudité des Germains n’est ni associée à l’innocence ni regardée positivement, mais mentionnée de façon très rapide et indifférente juste après une remarque quant à la pauvreté de leurs habits15. Dans le cas des enfants germains, elle est encore immédiatement mise en relation à leur saleté16, caractéristique que Montaigne n’attribue jamais aux Américains. Il associe au contraire indirectement la nudité indigène à la propreté : si les Indiens aiment rester nus, c’est entre autres parce qu’ils aiment se baigner plusieurs fois dans la journée (nous ne parlons ici que de Montaigne, car bien d’autres auteurs diront que les Américains sont eux aussi des êtres immondes).
La référence à l’habitation du Germain participe, elle aussi, d’une vision assez rudimentaire de ces nations, surtout si nous avons à l’esprit l’idée d’Aristote selon laquelle la maison et, plus encore, la vie en société sont les marques premières de l’humanité. La mention par Tacite du domicile des Germains présente, elle aussi, ce peuple comme éloigné d’une plénitude de l’humanité, dont les marques principales sont, comme pour Aristote, la ville et la vie en société. Citons Tacite :
Que les peuples germains n’habitent pas de villes est suffisamment connu, et qu’ils ne supportent même pas des maisons contiguës ; ils ont des demeures séparées, isolées, selon qu’ils ont été séduits par une source, une plaine, un bosquet. Ils arrangent leurs bourgs non pas, comme nous le faisons, en plaçant les maisons côte à côte et tenant l’une à l’autre : chacun entoure sa maison d’un espace vide, soit pour se protéger contre les risques d’incendie, soit par ignorance de l’art de construire17.
Les Germains n’ont donc pas de maison18. Pire encore : leurs « demeures » sont éloignées les unes des autres, car ils fuient le contact 149humain, ne regardant que le bienfait de la nature du lieu qu’ils choisissent. Ils fuient tout contact humain, au contraire des cannibales de Montaigne, qui vivent dans une sociabilité intense.
Tous les deux peuples sont dits « sans roi, sans loi, sans blé et sans métal ». Or, chez les barbares européens, cette absence se fait inhumaine, ce qui les rapproche du barbare mentionné par Aristote. Mentionnons encore la présence du sacrifice humain : « Ils regardent comme légitime d’offrir même des victimes humaines19 ». Les barbares américains qui, pour les uns (Mexicas…), faisaient aussi des sacrifices humains, pour les autres (Tupinambas…), mangeaient leurs prisonniers de guerre, Montaigne atténue les deux traditions, tournant son regard réprobateur vers les Européens qui torturent leurs victimes avant de les tuer :
Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, à deschirer, par tourmens et par geénes, un corps encore plein de sentiment, le faire rostir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons, non seulement leu, mais veu de fresche memoire […] entre des voisins et citoyens, et, qui pis est, sous pretexte de piété et de religion), que de le rostir et manger apres qu’il est trespassé (I, 31, 209).
La soi-disant absence de roi constitue aussi un thème récurrent chez Tacite, puisque la nation des Gothons qui, elle, a un roi, est digne d’être mentionnée20. Un dernier élément qui témoigne de leur barbarie est l’absence d’agriculture, indiquée en même temps que l’absence de maison21. Tacite signale tout de même une exception dans ce cas, évoquant une certaine nation qui cultive le blé et quelques autres produits « avec plus de persévérance que ne comporte la paresse habituelle des Germains ». Si cela peut passer pour un éloge, la suite du texte nous détrompe assez vite. Tacite prend l’exemple de l’ambre jaune qui n’était ni connu, ni utilisé, donc ni valorisé par les Germains, pour illustrer leur ignorance (ignorance qu’il n’a rien d’une ignorance socratique), ainsi que leur manque d’attention et de réflexion : « Quelle en est la nature, qu’est-ce qui le produit, ils ne se le demandent pas, et ne l’ont pas découvert – ce qui est naturel de la part de barbares ; bien plus, longtemps il restait sur le rivage, parmi tout ce que rejette la mer, jusqu’au moment où notre 150amour pour le luxe a fait son renom22 ». Pour finir, essayons de mieux comprendre l’intéressante description que Tacite fait des Fennes. À la fin de cette citation, il fait une observation qui dans un autre contexte ou sous une autre plume pourrait être interprétée comme un éloge :
Mais ils trouvent cette vie plus heureuse que de peiner sur les champs, travailler à construire des maisons, alterner espérance et crainte pour leurs biens et ceux des autres ; en sûreté du coté des hommes, en sûreté du coté des dieux, ils sont parvenus à un état bien difficile, ne pas même avoir besoin de rien souhaiter23.
Cette dernière phrase semble en effet assez proche de celle qui figure dans « Des Cannibales » où Montaigne souligne qu’ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu’autant que leurs nécessités naturelles leur ordonnent, tout ce qui est au-delà leur paraissant superflu. Cette impression de proximité des textes n’est possible que si l’on lit directement la fin du passage de Tacite, comme nous l’avons fait, car si nous lisons le début nous ne pouvons pas nous tromper sur je jugement de l’auteur :
Les Fennes sont extraordinairement féroces, abominablement pauvres ; tous sont sales, les chefs engourdis ; ni armes ni chevaux ni domicile fixe ; comme nourriture, des plantes sauvages, pour vêtement des peaux de bêtes, pour lit, la terre. Ils se fient entièrement à leurs flèches, que, par manque de fer, ils munissent d’une pointe d’os24.
Dans l’introduction du chapitre « Des Cannibales », Villey soutient l’idée selon laquelle Montaigne reprend, dans ce texte, la caractérisation des Germains par Tacite pour l’adapter aux Indiens. Quelques auteurs vont même plus loin en disant que Montaigne ne va pas au-delà de cet emprunt, que sa description ignore absolument la réalité indigène et que, par ailleurs, en tant qu’ethnocentriste, il n’a aucun intérêt à la comprendre et n’entreprend pas de faire. Revenons à la lecture de Villey : Montaigne procéderait à une idéalisation du sauvage à la manière de la Germanie de Tacite, s’inscrivant dans une ancienne tradition chère aux moralistes. Selon lui, cette tradition ne serait que peu représentée 151au xvie siècle, mais persisterait dans un courant continu d’œuvres va de Montaigne à Rousseau. Comme pour le promeneur solitaire, Villey souligne que pour Montaigne, la civilisation tout entière, en tant qu’artifice produit de la raison, est condamnable. Il justifie cette interprétation en faisant valoir que l’admiration de Montaigne pour les sauvages est la forme paradoxale que prend l’exaltation de l’idée de nature par opposition aux idées d’art et de raison. Nous ne pouvons ici nous attarder sur le rapprochement intéressant entre notre auteur et Rousseau, et devrons nous limiter à l’évoquer dans la mesure où il peut nous aider à éclairer la pensée de Montaigne. Si l’influence du texte de Montaigne sur Rousseau, notamment pour ce qui est de l’élaboration de son « bon sauvage », est indéniable, cela ne veut pas dire qu’il y ait un accord sur le contenu des deux concepts (le bon sauvage rousseauiste et l’Indien montainien). La nature chez Montaigne n’est pas l’opposé d’une civilisation condamnable parce que produit de la raison et de l’artifice, la raison et l’artifice n’étant pas condamnables en tant que tels. L’admiration pour les sauvages ne relève pas d’une exaltation de l’idée de nature par opposition aux idées d’art et de raison ; cela apparaît encore plus vrai si nous prenons en compte la reprise de ces thématiques dans le chapitre « Des Coches », où nous retrouvons une construction de l’Indien. Il y a chez Rousseau deux figures de l’homme de la nature : Émile et l’homme sauvage. L’homme sauvage de Rousseau n’est pas l’Indien de Montaigne, et l’état de nature dans lequel ils vivent diffère également. L’état de nature chez Rousseau est un principe, un moment zéro servant de point de départ aux hommes, alors que pour Montaigne il est proche d’un certain idéal d’humanité. Nous voyons l’écart entre les deux, puisque l’homme de nature dans le cas de Rousseau est défini par le manque, alors que dans le cas de Montaigne, il l’est par la plénitude. Compris dans cette perspective, l’homme de l’état de nature ne peut pas recouvrir la même réalité chez ces deux auteurs.
Revenons au parallèle avec Tacite, qui nous intéresse davantage dans ce passage. L’indien serait la reproduction de la caractérisation des Germains. Selon nous, cette interprétation est inexacte. Nous avons pu voir précédemment, lors de la caractérisation détaillée des Indiens de Montaigne, qu’il construit un personnage noble et louable, ou même vertueux. En outre, son but principal n’est pas de faire un portrait généreux des Indiens dans le but de critiquer sa propre société et d’en manifester 152la corruption. Cela se produit bien entendu dans les Essais, mais c’est à nos yeux une conséquence et non le dessein principal de l’ouvrage. Or ceux qui proposent de voir dans les Indiens de Montaigne une réplique des Germains de Tacite se fondent sur ce point. Les modernes percevaient en Tacite un moraliste qui censurait les mœurs de ses contemporains, et exaltait la conservation dans ces nations d’un état de nature antérieur à la corruption moderne.
Nous suivrons sur ce point Pierre Grimal qui, dans sa notice introductive25, affirme que, s’il est exact que Tacite insiste une ou deux fois sur les vertus, le courage ou la fidélité de ces peuples, cela ne suffit pas à surmonter l’intransigeant regard qu’il porte sur la rudesse ou la bestialité de ces gens :
Ce qui est, avec le même vocabulaire, l’idéal du sage stoïcien et, naturellement, celui du cynique. Poussée à la limite, l’ascèse des philosophes conduit à une totale bestialité. Ou plutôt, celle-ci a pour effet ultime de reproduire l’enseignement des philosophes. On sait que Tacite n’aime guère ceux-ci. Il n’est donc pas possible de soutenir que Tacite donne les Germains en exemple. Les mouvements de sympathie que l’on croit discerner chez lui vont, pourrait-on dire, à ces beaux animaux, riches des instincts les plus nobles, que sont les guerriers germains à ses yeux.
Comme nous venons de le dire, il semble impropre de parler ici d’un tableau idyllique ; même s’il en est un, il est très loin de ressembler à celui des Essais. Passons aux métaux : de même que les Indiens dans « Des Cannibales », ils n’en possèdent pas ; de même que les Indiens de toute l’Amérique, ils ne leur attribuent aucune valeur et ne se préoccupent pas d’en acquérir : « On peut voir chez eux des vases d’argent, offerts en présent à des ambassadeurs et des notables de leur peuple, mais auxquels ils n’attribuent pas plus de valeur qu’à ceux que l’on fabrique avec de la terre26 ». C’est peut-être là le point qui rapproche le plus ces Germains de nos Indiens : mais nous ne trouvons pas en contrepoint, dans la Germanie, la censure de la convoitise des métaux, qui est si présente dans les Essais. Un autre aspect intéressant est la question du courage à la guerre, les Germains, comme les Indiens, étant présentés comme des peuples très guerriers : dans les deux cas la démonstration du courage est fondamentale pour établir la valeur de chaque homme.
153Nous nous sommes limités à ces quelques exemples significatifs pour tenter d’esquisser le portrait du Germain. S’il est vrai que les deux auteurs font l’éloge de certains traits des barbares en vue de critiquer la société dans laquelle ils vivent, dans le cas du Bordelais, cette critique ne nous semble pas constituer le but premier de l’auteur. S’il a, comme nous le pensons, considéré les Germains comme des hommes sauvages (au sens où Rousseau construit son sauvage), Montaigne s’en éloigne encore plus. Nous ne pouvons dès lors dire que l’Indien de Montaigne descend du Germain de Tacite, même si le texte de ce dernier ait pu avoir une certaine influence sur sa pensée.
Il est vrai que nous retrouvons chez ces deux auteurs les mêmes thématiques, comme on les trouverait chez presque tous les auteurs qui décrivent des nations considérées comme barbares. Mais, en nous penchant sur les deux textes, nous remarquons qu’au-delà des termes, il n’y a aucune proximité entre les propos et les intentions. Contrairement à Tacite, qui fait l’éloge de deux ou trois traits de la vie des Germains (qui restent de façon générale des barbares paresseux, négligents, rudes et féroces), le « barbare » de Montaigne comprend plusieurs caractéristiques qu’il considère comme essentielles à la plénitude humaine telle qu’il la comprend. Un parallèle sur ce point avec la morale chrétienne primitive pourrait se révéler fécond : Montaigne refuse la conquête telle qu’elle a eu lieu (nous ne parlons pas de sa position sur la colonisation prise en elle-même) ; il refuse par ailleurs l’évangélisation des Indiens – or, les deux prétextes utilisés par les conquérants pour justifier la colonisation de l’Amérique étaient qu’il fallait apporter la civilisation et la vraie religion aux barbares.
Si le portrait de l’Indien dans « Des Cannibales » et « Des Coches » ne se réfère pas à une nature de l’homme, il propose cependant un modèle louable, faisant appel à des valeurs à la fois différentes de et supérieures à celles des Européens. En ce qui concerne la civilisation européenne, Montaigne montre que les Indiens n’en avaient nullement besoin, les Européens ayant surtout apporté avec elle une infinité de vices. Examinons ce point de plus près. Encore commandée par les lois naturelles dans une pureté et simplicité merveilleuses, leur société était maintenue avec peu de soudure humaine et permettait aux individus d’avoir une condition heureuse (I, 31, p. 206). Se contentant des moyens fournis par leur mère nourricière, les cannibales vivaient en l’absence de 154richesses et de biens matériels, dans une vie communautaire qui ne laissait pas de place à la cupidité. L’absence de science scolastique, pouvant être la source de la plus grande hybris, les maintenait dans l’humilité, et ils vivaient avec simplicité, bonté, loyauté et fraternité27, sans connaître le mensonge, la trahison, la dissimulation, l’avarice, l’envie, la médisance et l’offense. Que dire alors de la magnificence des Mexicains et des Péruviens ? Ceux-ci, en plus d’une excellente industrie, de la dévotion et l’observance des lois, avaient la même insouciance pour les richesses, la même clarté d’esprit naturelle, la même libéralité, franchise, courage et constance que les premiers. Aux yeux de Montaigne, la différence essentielle entre Tupinambas, Incas et Mexicas concernait la technique. Pour ce qui était des valeurs, elles leur étaient communes.
La civilisation ne leur manquait donc pas. En revanche, on pourrait dire que l’absence de la religion chrétienne leur était néfaste, puisque sans elle, ils ne pouvaient obtenir le salut. Pour ce qui est de l’évangélisation, Montaigne ne la mentionne pas. Dans un autre contexte, peut-être aurait-il souhaité que les Indiens la reçoivent : de fait, il ne l’envisage pas, quoique ce ne soit pas à cause de la barbarie des Indiens, et que rien n’indique qu’il partageait l’avis de ceux qui les considéraient incapables de recevoir la foi. L’obstacle réside pour lui plutôt dans le fait que les chrétiens n’étaient pas assez vertueux pour la leur apporter. La critique par Montaigne de la vie corrompue menée par les chrétiens peut nous faire conclure qui ne pouvaient pas servir d’exemple de vertu chrétienne aux païens. À commencer par les conquérants espagnols, dont la finalité n’avait rien de pieuse28 – et, la foi sans les œuvres est stérile29.
Nous retrouvons la critique faite aux chrétiens (et non à la religion chrétienne) dans le chapitre « Des Prières ». L’erreur des chrétiens est précisément de ne pas accompagner la foi qu’ils professent par des actions qui la démontrent. Montaigne s’indigne face au recours à Dieu en tout dessein et en tout besoin, sans la moindre considération de la justice ou injustice de l’occasion, et à l’invocation de son nom et de sa puissance dans n’importe quel état ou pour appuyer n’importe quelle action vicieuse, souhaitant que l’on s’adresse à Dieu avec révérence et 155respect30. La justice et la puissance sont inséparables, nous dit-il (en forçant peut-être l’orthodoxie), et c’est en vain que nous implorons sa force en une mauvaise cause. Plus encore, il faut avoir l’âme nette et déchargée des passions vicieuses, au moins au moment auquel nous le prions31.
Passons à « l’Apologie », dans la défense de Sebond contre la première objection, qui blâme certains chrétiens de vouloir appuyer leur croyance sur des raisons, alors qu’elle devrait être conçue par foi et inspiration particulière de la grâce. Quoi que ce soit une entreprise très honorable d’accommoder au service de la foi toutes les facultés naturelles que Dieu a donné à l’homme, et donc d’accompagner la foi de toute la raison qui est en lui, il ne faut jamais, répond Montaigne en substance, croire que cette foi dépend de l’homme et que les efforts humains puissent atteindre une science si divine. La foi n’a toute sa dignité que lorsqu’elle entre par une infusion extraordinaire : elle est alors soutenue avec une fermeté inflexible et immobile32, et la personne est illuminée d’une noble clarté dans ses paroles et plus encore dans ses actions. Or, dans la pratique, c’est tout le contraire qui se passe33. Les chrétiens devraient être les plus vertueux des hommes : en ce cas, ils seraient peut-être légitimés à évangéliser les Indiens. Le problème est qu’ils ne le sont pas, et que, au contraire, ils se montrent remplis de vices34. Ils n’incarnent donc pas l’exemple de vertu qui serait nécessaire pour attirer les païens à leur croyance : ils ne sont donc pas les brebis au milieu des loups.
Si la marque céleste de la foi infusée de façon extraordinaire qu’est la vertu ne se trouve pas chez les chrétiens, cela montre qu’elle est reçue par liaison humaine. Montaigne ne s’intéresse pas de la grâce, qui n’est pas de sa compétence35 – ce qui n’implique nullement qu’il ait une vision relativiste de la religion catholique. Si la grâce n’a pas été infusée de façon divine chez tous les individus qui professent cette foi, cela regarde la divinité, non les individus qui ne peuvent comprendre cela. La foi n’en est pas moins vraie. Et Montaigne ne se montre pas relativiste parce que, malgré le fait que les religions soient dans la 156plupart des cas adoptées par l’observation de l’usage du lieu où l’on est, il n’admet pas l’équivalence des valeurs et des règles morales36 des unes et des autres. Le fait qu’il montre du respect ou de la révérence face aux pratiques religieuses ancestrales, par exemple, ne veut pas dire qu’il accepte qu’elles aient le même fondement que la parole divine. Les sacrifices humains accomplis dans la plus grande dévotion par les Mexicas ne seront jamais mis sur un pied d’égalité avec les pratiques catholiques. Ce qui ne veut pas dire que toute pratique et coutume non chrétiennes soient blâmables.
Les chrétiens, qui devraient suivre les lois et les commandements divins – alors même qu’ils ne peuvent les comprendre – pour accomplir leur humanité, ne sont pas capables de les pratiquer et agissent de façon contraire à la morale chrétienne. Les lois naturelles, dont l’existence semble être acceptée de Montaigne37, en particulier dans l’« Apologie », ne sont cependant pas accessibles à l’homme, en partie à cause de sa raison allongeable et ployable et de son esprit sans bornes. Les lois humaines, quoiqu’accessibles, sont désignées dans plusieurs chapitres, dont le chapitre « De l’experience », comme fausses et injustes38. Si, pour Montaigne, l’homme ne trouve ni dans les lois divines, ni dans les lois naturelles, ni dans les lois humaines une définition claire et certaine de sa nature ou un guide sûr pour sa conduite : que doit-il faire pour s’accomplir en tant qu’homme ? Comment définir les limites de son humanité ? Nous est-il alors défendu de parler de l’homme dans les Essais ? Nous ne le croyons pas : Montaigne défend vivement certaines valeurs, qui nous laissent entrevoir un chemin pouvant mener à un idéal de l’homme.
S’il est vrai que la pensée pyrrhonienne est présente chez Montaigne, qui préconise une suspension du jugement lorsqu’il s’agit de l’ordre de la connaissance, nous ne croyons pas la retrouver lorsqu’il s’agit de l’ordre de la conduite. Resterait l’option de suivre une lecture académicienne de son scepticisme, selon laquelle il adopterait les valeurs qui lui sembleraient avoir plus d’apparence de vérité que les autres. Aussi séduisante que soit cette lecture, nous ne voyons pas non plus Montaigne défendre ces « vertus » en tant que représentations plus vraisemblables et faire du probable un critère d’action. Reste que la seule vérité que Montaigne pourrait accepter 157en tant que telle est la parole divine offerte par le livre sacré. La parole des hommes, aussi sages soient-ils, doit toujours être mise en doute, mais la parole divine, au contraire, ne devrait jamais être mise en doute. Lorsque Montaigne entend, par exemple, des stoïciens qu’il faut rechercher la constance, même si cela lui paraît vraisemblable, il ne pourra affirmer la vérité de cette valeur, sous peine de priver son jugement du droit de prononcer ses propres arrêts, en suivant la mobilité de ses opinions39. Si, en revanche, la Bible lui enseigne que la constance fait partie des vertus chrétiennes et qu’il faut s’efforcer de l’atteindre, il ne le met pas en doute.
D’un évangile à l’autre, certaines formules de conduite se trouvent inlassablement réitérées, par les évangélistes eux-mêmes ou par le Christ, telles par exemple la communauté des biens40, l’humilité41, la simplicité42, la bonté, la charité43, la loyauté44 et la constance45. Or ces éléments correspondent fidèlement aux traits que Montaigne retrouve et loue chez les Américains. Nous pensons pouvoir parler ici d’un ensemble de valeurs qui mènent au perfectionnement de l’homme, et qui, par là même, construisent sa nature.
Ce modèle établi et donné par Dieu nous met face à deux problèmes distincts. Le premier, amplement discuté par Montaigne, réside dans le fait que la majorité des chrétiens n’aient pas la grâce infuse et ne suive pas ce modèle, ni ne puisse travailler à la construction cette nature humaine perfectionnée. Les Essais répondent ici de façon nette : il n’est pas en notre pouvoir de connaître les raisons divines46. Nous ne devons pas nous enquérir des mystères de Dieu, qui doivent rester tels. L’homme ne peut pas avoir accès à la nature des choses, ni encore à la sienne, et il ne peut pas non plus connaître la raison divine. Or il doit se contenter de mener sa vie d’homme dans l’imperfection, dans le doute, mais en s’efforçant tout de même de se conduire de la meilleure façon possible ; ce qui ne veut pas dire qu’il doit vivre de façon béatifique, mais de préférence en ne faisant pas tort à autrui.
158Le deuxième point, que Montaigne ne nomme pas, et qui pourrait difficilement être résolu sans aller au-delà des limites de l’orthodoxie, réside dans le fait que de trop nombreux païens, en différents lieux et en différents temps, aient suivi ce modèle ordonné par un Dieu qu’ils ne connaissaient pas. S’il est vrai que le problème n’est pas posé de façon explicite dans les Essais, et s’il est aussi vrai que Montaigne ne dit pas que ces hommes vertueux qu’il présente tout au long des chapitres tiennent ce modèle de la raison ou de la nature, il faut cependant admettre qu’il ouvre la voie aux auteurs qui s’inspireront de lui pour retrouver ce modèle dans la nature ou dans la raison humaine, et pourront se passer d’un Dieu qui, dans les Essais, se fait selon nous encore présent.
Maria Célia Veiga França
Faculdade Cidade de João Pinheiro, Brésil
1 « O Selvagem como figura da natureza humana : o discurso da conquista americana », à paraître. Recherche développée lors d’un post doc à l’Université Fédérale de Minas Gerais, sous la direction de Telma de Souza Birchal.
2 Tacite, Germanie, II, 2, in Œuvres Complètes, édition et traduction du latin par Pierre Grimal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1990.
3 Ibid., XVIII. 3.
4 Ibid., XVIII. 6.
5 Ibid., XXI. 2.
6 Ibid., XXX. 2.
7 Les citations des Essais utilisées dans ce texte suivront l’édition Villey-Saulnier (Paris, PUF, 2004).
8 Tacite, op. cit., XXI. 51.
9 Ibid., V. 4.
10 Ibid., XIV. 5.
11 Ibid., XV. 1.
12 Ibid., V. 4.
13 Ibid., XLVI. 6.
14 Ibid., XLVI. 6.
15 Ibid., XVII. 1.
16 Ibid., XX. 1.
17 Ibid., XVI. 1.
18 Ibid., XXXI. 5.
19 Ibid., IX. 1.
20 Ibid., XLIV. 1.
21 Ibid., XXXI. 5.
22 Ibid., XLV. 4.
23 Ibid., XLVI. 5.
24 Ibid., XLVI. 3.
25 Ibid., p. 829.
26 Ibid., V. 4.
27 Essais, I, 31, 210.
28 Essais, III, 6, 913.
29 La Bible. Nouveau Testament, trad. Jean Grosjean, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1971. Jc 2, 14.
30 Essais, I, 56, 318.
31 Ibid., 319.
32 Essais, II, 12, 441.
33 Ibid., II, 12, 442.
34 Ibid., II, 12, 444.
35 Ibid., II, 12, 445.
36 Ibid., II, 12, 579.
37 Ibid., II, 12, 580.
38 Ibid., III, 13, 1070-1072.
39 Expression de Charles Larmore dans Vincent Carraud, Montaigne, scepticisme, métaphysique, théologie, Paris, PUF, 2004, p. 26.
40 Act 2, 44.
41 Rom 12, 3-15.
42 I Cor 2, 1.
43 I Cor 13, 4.
44 II Cor 4, 2.
45 Fil 1, 27.
46 Essais, I, 27, 180.