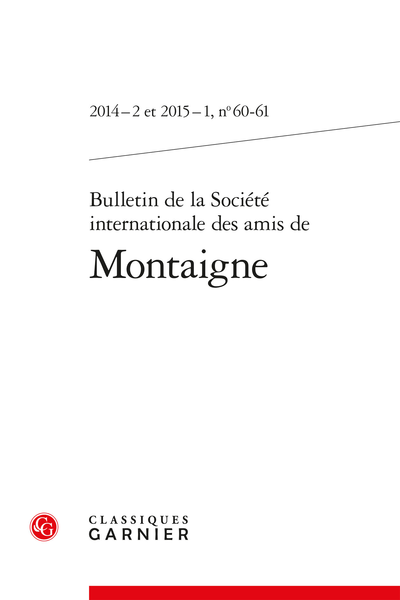
Les « circonstances » et la disparition Une lecture du chapitre III, 4, des Essais : « De la diversion »
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2014 – 2 et 2015 – 1, n° 60-61. varia - Auteur : Autiquet (Benoît)
- Résumé : Au terme de « diversion » correspond l’idée de la fuite de la pensée de la mort par des moyens divers. Mais au moment où Montaigne en vient à évoquer ces « images menues et superficielles » dont l’effet est de nous « divertir », l’argumentation se trouble : les exemples d’« images » que nous donne l’auteur sont précisément des éléments par lesquels celui qui survit regrette celui qui est mort. Loin de divertir, elles permettent au contraire une relation affective à la mort.
- Pages : 65 à 81
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812448461
- ISBN : 978-2-8124-4846-1
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4846-1.p.0065
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/10/2015
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Les « circonstances » et la disparition
Une lecture du chapitre III, 4, des Essais :
« De la diversion1 »
Dans la conclusion de La Glose et l’essai, André Tournon revient sur la fonction du « portrait » de Montaigne et des « détails anodins » qui le composent.
Les informations qui ont trait à son identité – le « portrait » proprement dit – ont pour principale fonction de rappeler que tout ce que l’on peut lire en ces pages a pour support cet être contingent : un certain gentilhomme périgourdin, déjà âgé, de médiocre taille et de santé déclinante, amateur de lectures, de conversations, de galanteries et de voyages, etc… Non l’Auteur, dépositaire d’un savoir qui se divulguerait par sa plume, mais le personnage concret que connaissent ses « parens et amis », avec ses humeurs, ses convictions, ses incertitudes et ses rétractations. Cela est évident, sans doute, et vrai de n’importe quel écrivain ; l’originalité de Montaigne est d’avoir incorporé à son livre des traits individuels, détails anodins qui le représentent sous l’aspect d’un homme « de la commune sorte » (II, 17, p. 635), de manière à porter atteinte, de lui-même, à l’autorité des écrits qu’il offre au public2.
Les « détails anodins » ont donc avant tout une fonction logique : celle de miner la valeur de vérité des énoncés de Montaigne, et par là d’entamer l’autorité de la publication. Dans cette perspective, la peinture détaillée du moi fait partie des nombreux outils par lesquels Montaigne réalise cette gageure d’une langue sceptique, dans laquelle les énoncés assertifs n’auraient pas de pouvoir d’assertion ; ainsi, comme l’écrit A. Tournon, « la description de soi est subordonnée aux exigences logiques de la philosophie de l’essai3 ». Les « lecteurs curieux de psychologie et de particularité biographiques », [qui] « se sont efforcés
de saisir “l’homme” qui transparaît dans l’œuvre4 », sont dès lors dans l’erreur : ils n’ont pas compris que la description de soi et d’éléments personnels, sous la plume de Montaigne, n’avait de valeur que dans le dialogue qu’elle entretenait avec la philosophie sceptique et la perte de contact entre les mots et les choses.
La lecture que propose Olivier Guerrier du chapitre « De la diversion » est très révélatrice de cet enrôlement des « détails anodins » dans une lecture de Montaigne où est soulignée la rupture entre le monde et sa représentation linguistique et mentale. L’ouvrage dans son ensemble montre que, dans les Essais, « les fictions » occupent une place décisive dans « la forme de parole et le modèle d’échange susceptible de donner consistance et validité aux poursuites sans terme5 ». Remarquant que les dernières pages du chapitre « De la diversion » constatent la faiblesse de la rationalité humaine, non seulement par rapport aux images fictives, mais aussi par rapport aux impressions sensibles produites par les petits évènements qui entourent la mort, Olivier Guerrier pose une équivalence entre le « pouvoir des fables » et le « pouvoir des sensations6 ». Ainsi, la vue et l’imagination sont traitées de manière équivalente comme des agents de cette « fantaisie » qui humilie toujours le travail rationnel d’appréhension du monde. L’intégration des choses vues et des fictions au texte philosophique relance les « poursuites sans terme » des Essais : elles sont l’aliment de la « fantaisie », un combustible qui fait se consumer l’esprit humain loin de toute « saisie directe des choses » (pour reprendre une expression d’A. Tournon7). Il nous semble que les « détails anodins », dans l’argumentation de Tournon, et les choses vues grâce aux « pouvoirs des sensations », dans celle de Guerrier, possèdent la même fonction paradoxale : alors qu’ils devraient apporter un surcroît de référence, permettre une « saisie directe des choses », ils fictionnalisent au contraire le texte des Essais, le condamnant aux « poursuites sans terme », ou, pour reprendre une expression de Tournon, à « un processus sans fin de vérification par discours superposés8 ». Or en
évoquant des « détails anodins » et des choses vues dans les dernières pages de III, 4, Montaigne ne relance pas le jeu de la « diversion » ; au contraire, il propose une appréhension affective (et non philosophique) de la mort, qui arrête le regard de l’enquêteur le temps d’un contact direct avec « la chose en soy ».
Dans une première partie, nous retracerons l’architecture globale du chapitre « De la diversion » et nous délimiterons un texte qui nous paraît particulièrement important dans cette architecture, puisque s’y joue une modification fondamentale de la fonction des « détails ». Dans un deuxième temps, nous proposerons, à partir de ce texte, la notion de « circonstances », qui permettra de regrouper ces « détails anodins ». Nous comparerons ensuite la description des circonstances de la mort dans « De la diversion » avec celle qui nous est proposée dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir », pour établir leur différence de fonction. Enfin, nous proposerons, pour expliquer cet intérêt pour les « circonstances », la notion de « pulsion archéologique » que nous emprunterons à Gisèle Matthieu-Castellani en la remaniant quelque peu.
Ce chapitre, comme beaucoup de chapitres des Essais, est caractérisé par un changement assez profond du propos en cours d’argumentation. Il s’ouvre sur la narration d’une anecdote personnelle : Montaigne a « austrefois esté employé à consoler une dame vrayement affligée9 », les notes de nos éditions nous apprenant « qu’il pourrait s’agir de Diane de Foix, dédicatrice du chapitre I, 25, qui perdit son mari et ses deux beaux-frères […] lors du siège de Montcrabeau10 ». Face à cette situation, Montaigne commence par distinguer deux manières de consoler : « s’oppos[er] à cette passion » qu’est la tristesse du deuil, ou s’évertuer à « déclin[er] » ou à « gauch[ir] » le propos de l’interlocutrice, passant « aux subjects plus voysins11 » imperceptiblement. S’ensuit une série d’exemples qui montrent, alternativement, des individus qui appréhendent la mort de manière frontale, et d’autres qui l’esquivent. La première attitude est caractérisée par la fixité des corps et des pensées : ainsi, Socrate qui
« ne cherche point de consolation hors de la chose [la mort]12 » et qui « fiche là justement sa veue, et s’y resoult, sans regarder ailleurs », ou bien Subrius Flavius qui semble, à considérer sa manière de « ternir la teste ferme » lors de sa décapitation, « avoir eu sa pensée droittement et fixement au subject ». À cette fixité s’opposent les mouvements de la diversion : mouvements de pensée (Les « disciples d’Hegesias, qui se font mourir de faim, eschauffez des beaux discours de ses leçons »), ou mouvements du corps (Lucius Syllanus, qui échappe à la « mort longue et préparée » de l’exécution en se ruant sur celui qui vient lui annoncer sa condamnation et en mourant dans l’affrontement).
Mais Montaigne, vers la fin du chapitre, fait une remarque sur les choses propres à nous divertir :
Peu de chose nous divertit et destourne : car peu de chose nous tient. Nous ne regardons gueres les subjects en gros et seuls : ce sont des circonstances ou des images menues et superficielles qui nous frappent […]13.
Cette idée nous semble particulièrement importante dans le chapitre, car elle est le lieu-pivot de l’argumentation. En effet, jusque-là, le chapitre portait sur les moyens de fuir l’idée de la mort. Au terme de « diversion » correspondait l’idée de la fuite de la pensée de la mort par des moyens divers. Au moment où Montaigne en vient à évoquer ces « images menues et superficielles » dont l’effet est de nous « divertir », l’argumentation se trouble : les exemples d’« images » que nous donne l’auteur sont précisément des éléments par lesquels celui qui survit regrette celui qui est mort. Loin de divertir, elles permettent au contraire une relation affective à la mort. Cette communication affective reste cependant de l’ordre de la superficialité : en effet, après avoir énuméré les menus souvenirs qui constituent l’image de l’être disparu, Montaigne concède : « sans que je poise ou penetre ce pendant, la vraye et massive essence de mon sujet14 ». Mais l’ajout postérieur à 1588 renforce encore le rôle de ces « images menues et superficielles » dans la relation à la mort :
Je voy nonchalamment la mort, quand je la voy universellement, comme fin de la vie. Je la gourmande en bloc : par le menu, elle me pille15.
La nouvelle formulation que propose Montaigne reconfigure complètement les métaphores qui définissent les différentes manières de se comporter face à la mort : au regard fixe, qui s’opposait aux mouvements de l’esquive, se substitue le regard « universel » qui s’oppose à la vision de détails. Les « circonstances » (dans le texte antérieur à 1588), étymologiquement « ce qui se tient autour », prennent une importance essentielle dans la reformulation de l’allongeail : elles deviennent ce qui constituent le cœur du rapport affectif à la mort – tandis que la vue « universelle », philosophique et antique, est désormais frappée d’un soupçon de superficialité et d’irréalité. Montaigne, évidemment, ne va pas jusqu’à affirmer qu’il affronte la mort avec autant de courage qu’un Socrate ou qu’un Subrius, mais, par l’introduction des choses « menues », il propose le modèle alternatif, mineur pourrait-on dire, d’un rapport authentique à la mort, aussi douloureux soit-il. Ainsi, du point de vue du rapport à la mort, le texte ne fait pas « diversion » : il fait au contraire une boucle, qui va de l’idée de la mort à ses « circonstances » pour mieux retourner à l’idée première.
Ce retour à l’idée de la mort par l’intermédiaire des « circonstances menues et superficielles », qui pourrait sembler anecdotique, nous semble avoir des conséquences assez importantes sur la manière d’envisager le rapport entre réel et langage dans les Essais de Montaigne. Le chapitre « De la diversion » est généralement considéré comme le chapitre où, par excellence, s’exerce la « fantaisie » montaignienne. Il faut d’abord définir ce qu’est la « fantasie » et comment est décrite son utilisation dans le texte des Essais. Dans l’introduction de son ouvrage, Olivier Guerrier résume ainsi le débat entre les stoïciens et les néo-académiciens sur la représentation :
Si pour le Portique, l’imagination est capable de disposer d’une « représentation compréhensive » (phantasia katalêptikê), saisissant tout ou partie de l’objet, à l’opposé du phantasma qui émeut l’âme sans qu’un rapport à l’objet soit garanti, les néo-académiciens récusent la distinction et coupent toute représentation de son référent réel. D’un côté un travail de vigilance qui consiste à faire confiance aux sens bien portants, à donner son assentiment à l’évidence de perceptions saines, et à résister aux fantasmes du songe ou de l’ivresse. De l’autre, une méfiance généralisée envers des sens incapables d’avoir accès aux choses, qui brouille la démarcation des stoïciens entre états normal et anormal, et rend impossible l’appréhension de la vérité objective16.
Pour Olivier Guerrier, les Essais reprennent à leur compte « la méfiance généralisée envers des sens incapables d’avoir accès aux choses », puisqu’il écrit plus loin : « Si la “fantasie” apparaît comme une faculté de leurre s’affranchissant du réel et combinant les images à merci, les Essais sont la “mise en rolle” de ses résultats bigarrés. » Dans ce groupe composé par le produit des « perceptions » et celui du « songe ou de l’ivresse », Guerrier met l’accent sur la capacité de fictionnalisation par la « fantaisie » de la prose philosophique. C’est dans le prolongement de cette introduction théorique qu’il conclut, lors de sa lecture de III, 4, à l’équivalence du « pouvoir des sensations » et du « pouvoir des fables ».
Cette conclusion est, à première vue, justifiée par le texte de « De la diversion ». En effet, Montaigne ne ménage aucune distinction entre les produits des perceptions et celui de l’imagination dans son chapitre. Nous reprenons le texte que nous venons de citer plus haut :
Les larmes d’un laquais, la dispensation de ma desferre, l’attouchement d’une main cognue, une consolation commune, me desconsole et m’attendrit. Ainsi nous troublent l’ame, les plaintes des fables : et les regrets de Didon, et d’Ariadné passionnent ceux mesmes qui ne les croyent point en Virgile et en Catulle : c’est un exemple de nature obstinée et dure, n’en sentir aucune emotion : comme on recite, pour miracle, de Polemon : mais aussi ne pallit il pas seulement à la morsure d’un chien enragé, qui luy emporta le gras de la jambe17.
Entre les sensations éprouvées lors d’une expérience réellement vécue (dans la première phrase), et celle éprouvée à la lecture ou à l’écoute d’un texte (seconde phrase), il n’y a pas de différence. Pourtant, si l’on attribue aux perceptions et à l’imagination la fonction de fictionnalisation que leur attribue Olivier Guerrier, un problème se pose. En effet, la puissance des « plaintes des fables » réside précisément dans le fait que même ceux qui ne croient pas en l’existence de Didon ou d’Ariane sont touchés par l’écriture de Virgile et de Catulle. L’effet de cette puissance n’est pas de relancer une recherche philosophique qui ne parvient pas à saisir le réel, mais au contraire de suspendre, momentanément et sur le plan affectif, l’incrédulité du spectateur. Si bien que l’insensibilité aux textes des auteurs latins serait presque le signe d’une folie, puisqu’elle est comparable à l’insensibilité au phénomène sensible par excellence qu’est la douleur provoquée par « la morsure d’un chien enragé ». Polémon
devient la figure quasi-pathologique d’une insensibilité qui mettrait en permanence l’homme à distance du réel. Au contraire, Montaigne affirme immédiatement après :
Et nulle sagesse ne va si avant, de concevoir la cause d’une tristesse, si vive et entiere, par jugement, qu’elle ne souffre accession par la presence, quand les yeux et les oreilles y ont leur part : parties qui ne peuvent estre agitées que par vains accidens18.
Certes, pour « concevoir la cause d’une tristesse », l’esprit humain est tributaire de « vains accidens » ; mais c’est la sensibilité à ces « accidens » qui, beaucoup mieux que le « jugement », permet d’accéder à cette « cause ». La présence des choses, qu’elle soit effective ou médiatisée par un texte littéraire, leur confère un surcroît de réalité. Certes, le chapitre continue, et une page plus loin on retrouve le traditionnel constat de la mutabilité de l’esprit humain et de son incapacité à saisir le réel à cause de sa sensibilité aux sensations et à l’imagination :
Frivole cause, me direz vous : Comment cause ? il n’en faut point, pour agiter nostre ame : Une resverie sans corps et sans subject la regente et l’agite19.
Mais la conclusion du chapitre n’empêche en aucun cas qu’au sein du texte se soit déroulé un renversement spectaculaire : les agents de la « diversion », que l’homme commun doit emprunter pour faire face à la mort parce qu’il n’a pas la force des sages antiques, sont devenus les meilleurs moyens d’affronter la mort, d’en saisir la « cause » et, partant, d’accueillir dans le texte des Essais un bout de cette réalité qui semblait perpétuellement échapper.
Avant de continuer à mesurer l’importance du chapitre « De la diversion » dans Les Essais, nous voudrions nous arrêter brièvement sur le terme qui semble s’imposer pour parler de ces « choses » qui permettent d’appréhender la mort mieux que par son idée : Dans quelle mesure le terme de « circonstances », employé par Montaigne, peut-il rendre compte de l’ensemble flottant, ondoyant et divers, que constituent ces « choses » ?
Le sens étymologique du mot « circonstance », « ce qui se tient autour », est repris par un réseau métaphorique immédiatement après le premier texte du chapitre III, 4 que nous avons cité :
Nous ne regardons gueres les subjects en gros et seuls : ce sont des circonstances ou des images menues et superficielles qui nous frappent : et de vaines escorces qui rejaillisent des subjects : Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae / Linquunt20.
Les formes métaphoriques utilisées dans ce texte prolongent le sens latin de circumstantia : ce qui se tient autour de l’idée centrale, c’est, lorsque la métaphore est végétale, « l’écorce », et, lorsqu’elle est biologique, la « pupe » (« folliculos »), qui désigne le fourreau dans lequel la larve s’abrite pour effectuer ses métamorphoses successives. De plus, le terme de « circonstances » a l’avantage de souligner, dans son acception rhétorique, le caractère secondaire d’un élément sur le plan logique. Michel Le Guern a proposé une très riche enquête sur « les antécédents rhétoriques de la notion de circonstances » dans laquelle il rappelle ce point. Parmi les très nombreux textes auxquels il fait référence, il cite la définition de cette notion que donne un contemporain de Montaigne, Ramus, « dont la perspective plus logique que rhétorique assimile les circonstances, adjuncta, aux accidents21 ». Il nous semble que Montaigne reprend non explicitement cette distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui est accidentel lorsqu’il définit les « images » comme « superficielles », c’est-à-dire comme ne faisant pas partie des éléments nécessaires à la définition de l’idée de la mort. Voici les exemples qu’il donne (ce texte suit le passage que nous venons de citer) :
Plutarque mesme regrette sa fille par des singeries de son enfance. Le souvenir d’un adieu, d’une action, d’une grace particuliere, d’une recommandation derniere, nous afflige. La robe de Caesar troubla toute Romme, ce que sa mort n’avoit pas faict. Le son mesme des noms qui nous tintouine aux oreilles : Mon pauvre maistre, ou mon grand amy : helas mon cher pere, ou ma bonne fille. Quand ces redites me pinsent, et que j’y regarde de près, je trouve que c’est une pleinte grammairienne, le mot et le ton me blesse. Comme les exclamations des prescheurs, esmouvent leur auditoire souvent, plus que ne font leurs raisons : et comme nous frappe la voix piteuse d’une beste qu’on
tue pour nostre service : sans que je poise ou penetre ce pendant, la vraye essence et massive de mon subject.
His se stimulis dolor ipse lacessit.
Ce sont les fondements de nostre deuil22.
Tous les exemples que Montaigne donne sont des éléments accessoires dans la disparition d’un être cher : ils s’organisent plus ou moins rigoureusement en trois grandes catégories : les gestes (« adieu », « action », « grace particuliere »), les vêtements (« la robe de Caesar ») et le « son » des « noms » prononcés lorsque la mort arrive. Les phrases situées de part et d’autre de la citation latine résument le paradoxe du chapitre entier : les choses accessoires que Montaigne vient d’évoquer ne constituent pas « la vraye essence et massive de [son] subject », mais elles sont pourtant « les fondements de nostre deuil », c’est-à-dire de ce qui, dans la mort, concerne la douleur de celui qui reste. On passe ainsi d’une appréhension philosophique abstraite à une appréhension esthétique et émotionnelle de la mort. La suite du texte opère un retournement très intéressant : Montaigne, dans la scène qui suit, n’est plus dans le rôle de l’endeuillé, mais dans celui du mourant. En effet, il raconte ses impressions alors qu’une crise terrible de « gravelle » lui laisse peu d’espoirs de survie :
Me trouvant là, je consideroy par combien legeres causes et objects, l’imagination nourrisoit en moy le regret de la vie : de quels atomes se bastissoit en mon ame, le poids et la difficulté de ce deslogement : à combien de frivoles pensées nous donnions place en un si grand affaire. Un chien, un cheval, un livre, un verre, et quoy non ? tenoient compte en ma perte. Aux autres, leurs ambitieuses esperances, leur bourse, leur science, non moins sottement à mon gré. Je voy nonchalamment la mort, quand je la voy universellement, comme fin de la vie. Je la gourmande en bloc : par le menu, elle me pille. Les larmes d’un laquais, la dispensation de ma desferre, l’attouchement d’une main cognue, une consolation commune, me desconsole et m’attendrit23.
Le sens de circumstantia, « les choses qui se tiennent autour », est d’une certaine manière développé ici : les « choses menues et superficielles » ne sont plus celles qui entourent l’idée de la mort, mais le mourant lui-même, qu’on imagine volontiers alité lorsqu’il voit, autour de lui, les « larmes » de son valet, ou lorsqu’il sent cet « attouchement d’une main
cognue ». Mais ce qui fait regretter la vie à l’agonisant ne prend pas tout à fait la même forme que ce qui fait regretter les morts au survivant. En effet, dans ce texte, Montaigne insiste beaucoup plus sur la petitesse des éléments qui composent « le poids et la difficulté de ce deslogement » : ce sont, nous dit-il, des « atomes ». L’idée du minuscule est reprise dans les exemples qu’il donne : la liste « un chien, un cheval, un livre, un verre », qui se termine par les éléments les plus petits, la locution adverbiale « par le menu », qui renvoie aux « images menues » déjà évoquées dans le texte, et la concentration sur de petites manifestations physiques de la tristesse : les « larmes », « l’attouchement d’une main cognue ». Il faut donc bien noter que chez Montaigne, les « circonstances » relèvent très souvent du « détail ». Et ce terme, évidemment, doit aussi s’entendre dans son sens logique : le « détail », c’est aussi, comme la « circonstance », ce qui est secondaire par rapport à l’idée même de la mort.
L’intérêt de ce passage des « simulacres de la “fantaisie”24 » aux « circonstances », et, partant, d’une stratégie de diversion à une appréhension directe de la « chose en soy » de la mort, se mesure en reprenant un parallèle entre deux textes des Essais, déjà proposé par André Tournon dans la perspective qui lui est propre. Ce dernier lit en effet le traitement de la mort dans III, 4 en opposition avec la dernière page du chapitre « Que philosopher c’est apprendre à mourir », elle-même tirée de la vingt-quatrième lettre à Lucilius. En effet, la stratégie de la « diversion » lui semble « difficilement conciliable avec les exhortations philosophiques à jeter un regard lucide sur le réel, à le dépouiller des masques qui le rendent menaçant, etc. ». Nous voyons nous aussi une opposition entre le texte du livre I auquel il est fait ici référence et le passage qui nous intéresse dans « De la diversion », mais selon un axe différent. Il nous semble en effet incomplet de dire que le rapport du chapitre III, 4 à la mort se résume à l’idée de « diversion » : nous avons vu que Montaigne proposait « un regard lucide sur le réel », à travers ces « circonstances » qui permettent d’accéder à « la cause [de sa] tristesse ». Mais ce sont les voies par lesquelles on regarde le réel qui se modifient d’un texte à l’autre. À la fin de I, 20, Montaigne s’interroge sur la terreur qui accompagne l’idée de la mort :
Je croy à la verité que ce sont ces mines et appareils effroyables, dequoy nous l’entournons, qui nous font plus de peur qu’elle : une toute nouvelle forme de vivre : les cris des meres, des femmes et des enfans : la visitation de personnes estonnées, et transies : l’assistance d’un nombre de valets pasles et éplorées : une chambre sans jour : des cierges allumez : nostre chevet assiegé de medecins et de prescheurs : somme tout horreur et tout effroy autour de nous. Nous voylà des-jà ensevelis et enterrez. Les enfans ont peur de leurs amis mesmes quand ils les voyent masquez ; aussi avons nous25.
Les points communs entre ce texte et celui du chapitre III, 4 sont frappants. D’abord, la métaphore des « circonstances » est reprise par le verbe « entourner » : le texte décrit des « mines » disposées en cercle autour d’un point central caché au regard : l’idée de la mort. Ensuite, la forme énumérative par lesquelles ces « mines » sont dites rappelle les longues énumérations des « images menues et superficielles » que nous avons trouvées dans « De la diversion ». L’énumération, dans les deux cas, signifie que les apparences de la mort sont caractérisées à la fois par leur pluralité (ce sont des « atomes »), mais aussi par le désordre dans lequel elles se manifestent, ce qui exige une écriture qui se contente de recueillir ces éléments dispersés. Enfin, le rapport de Montaigne à ces éléments disparates est comparable : d’un côté, c’est l’effroi (« ces mines et appareils effroyables »), de l’autre, l’anéantissement (« Je la [la mort] gourmande en bloc ; par le menu, elle me pille26. »)
Mais entre les deux textes, le statut à la fois épistémologique et affectif des « circonstances » évolue. Dans le livre III, Montaigne reconnaît à ces détails une valeur heuristique : ils ne sont plus seulement des masques, mais permettent de concevoir « la cause d’une tristesse ». Ils acquièrent en outre une nouvelle valeur affective, puisqu’ils ne suscitent plus seulement l’effroi, mais aussi le regret de la vie. Il ne s’agit plus, comme dans le premier texte, d’exhorter à ne plus avoir peur de la mort, par une rhétorique qui oppose l’essentiel au contingent, la vérité au masque ; mais au contraire, d’assumer une forme minuscule d’attachement à la vie : le « livre » et le « verre » qui lui font regretter de mourir valent bien les « ambitieuses esperances », la « bourse » ou la « science » des « autres ». Alors que dans le livre I, « l’assistance d’un nombre de valets pasles et éplorés » suscitait l’effroi, « les larmes d’un laquais », version
plus familière et plus intime du même motif, sont dans le livre III l’objet d’un désir, puisqu’elles sont « attendriss[antes] ». D’un texte à l’autre, la mort n’est pas considérée de manière moins directe, Montaigne ne renonce pas à la saisir. C’est en revanche le statut des « circonstances » de la mort qui se modifie : celles-ci deviennent dans le même temps plus instructives et plus attachantes. Loin de se détourner de la mort, il semblerait que Montaigne en découvre, en faisant la liste des circonstances qui l’entourent, la puissance de fascination.
Il est vrai cependant qu’à lire les énoncés gnomiques qui suivent le texte de III, 4 et celui de I, 20, on est tenté de décrire l’opposition des deux chapitres comme le fait André Tournon. En effet, le texte de I, 20 se conclut ainsi : « Il faut oster le masque aussi bien des choses, que des personnes27 ». Au contraire dans III, 4, on l’a vu, Montaigne en revient à la dénonciation d’une « asme » agitée par « un resverie sans corps et sans subject » : l’esprit humain est en permanence abusé par la puissance des apparences et des images. Mais l’hypothèse que nous proposons ici est que la découverte de la puissance des « simulacres », qui se manifeste dans certains énoncés dépréciant la faiblesse de l’esprit humain face aux apparences, a sa contrepartie dans la découverte de la fascination que peut susciter, au moment de la mort d’un être cher ou de sa propre mort, les menues apparences que nous offrent les « circonstances ». Cependant, l’idée que les « circonstances » dans leur matérialité et leur contingence, pourraient constituer le centre d’une relation à la mort et sa compréhension, n’est pas formulée en tant que telle. Comme la mort elle-même, on ne peut considérer l’« essence » de cette idée ; elle ne s’appréhende que dans ses manifestations concrètes, c’est-à-dire dans ces lignes fugaces où s’inscrit la fascination pour les manifestations matérielles ou sonores, bref, circonstancielles, de ce qui a disparu ou est en train de disparaître.
On peut lire cette fascination dans d’autres textes des Essais ; là encore, elle ne constitue pas le cœur du propos, mais semble bel et bien présente. Il semble qu’il y ait chez Montaigne un lien fréquent entre le regret des morts et les « circonstances » ou les « choses menues et superficielles ». Le texte suivant est un extrait de III, 9 qui nous paraît instructif à cet égard :
Me trouvant inutile à ce siecle, je me rejecte à cet autre. Et en suis si embabouyné, que l’estat de ceste vieille Rome, libre, juste, et florissante (car je n’en ayme, ny la naissance, ny la vieillesse) m’intéresse et me passionne. Parquoy je ne sçauroy revoir si souvent, l’assiette de leurs rues, et de leurs maisons, et ces ruynes profondes jusques aux Antipodes, que je ne m’y amuse. Est-ce par nature, ou par erreur de fantasie, que la veue des places, que nous sçavons avoir esté hantées et habitées par personnes, desquelles la memoire est en recommendation, nous emeut aucunement plus, qu’ouîr le recit de leurs faicts, ou lire leurs escrits ? Tanta vis admonitionis inest in locis. Et id quidem in hac urbe infinitum : quacumque enim ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponimus Il me plaist de considerer leur visage, leur port, et leurs vestements : Je remasche ces grands noms entre les dents, et les fais retentir à mes oreilles. Ego illos veneror, et tantis nominibus semper assurgo. Des choses qui sont en quelque partie grandes et admirables, j’en admire les parties mesme communes. Je les visse volontiers deviser, promener, soupper. Ce seroit ingratitude, de mespriser les reliques, et images de tant d’honnestes hommes, et si valeureux lesquels j’ay veu vivre et mourir : et qui nous donnent tant de bonnes instructions par leur exemple, si nous les sçavions suyvre28.
Le lien entre ce texte et le chapitre « De la diversion » est assez frappant. D’abord, les deux textes soulignent la puissance émotive de ce qui se tient autour du sujet principal : dans III, 4, les « circonstances » de la mort, ici, les « places […] hantées et habitées par personnes, desquelles la memoire est en recommendation », qui nous émeuvent plus qu’« ouîr le recit de leurs faicts, ou lire leurs escrits ». Ce qui est en marge semble posséder plus de pouvoir émotionnel que le cœur du sujet. Par ailleurs, ce qui intéresse Montaigne chez ces grands hommes de la Rome antique, ce sont « leur visage, leur port et leurs vestements », ce qui renvoie à l’attention à « la robe de Caesar », aux « larmes d’un laquais » ou bien aux gestes de la « main ». La sensibilité aux sons des grands noms renvoient aux « sons mesmes des noms qui nous tintouinent aux oreilles » et à la « pleinte grammarienne » de III, 4. Enfin, les « parties mesmes communes » de ces choses « grandes et admirables », que Montaigne admire, évoquent l’énumération d’objets qui symbolisent la banalité : « un chien, un cheval, un livre, un verre ». Mais surtout, les deux textes
parlent d’individus disparus : Montaigne, peu avant le texte que nous venons de citer, met immédiatement en parallèle cet attachement à la Rome antique et le souvenir des morts qui lui sont chers : « Le soing des morts est en recommandation. Or j’ay esté nourry dés mon enfance, avec ceux icy : J’ay eu cognoissance des affaires de Rome, long temps avant que je l’aye eue de ceux de ma maison ». Puis, parlant de « Lucullus, Metellus, et Scipion » :
Ils sont trepassez : Si est bien mon pere : aussi entierement qu’eux : et est plus esloigné de moy, et de la vie, autant en dixhuict ans, que ceux-là ont faict en seize cens : duquel pourtant je ne laisse pas d’embrasser et praticquer le memoire, l’amitié et la societé, d’une parfaite union et tres-vive.
Or le souvenir du père mort est un élément très important dans le texte de « De la diversion » : parmi les « noms » qui lui « titouin[ent] aux oreilles » figure « mon cher pere ». Ainsi est établi le lien entre le deuil des proches et l’intérêt pour les grands hommes du passé, plus particulièrement de la Rome antique. Ces deux relations, entretenues par Montaigne par le biais des « circonstances » qui ont entouré les disparus, suscitent chez lui des émotions très fortes : dans III, 4, comme on l’a vu, c’était l’anéantissement ; ici, c’est le plaisir qui est mis en valeur : « l’estat de ceste vieille Rome », qui a constitué l’environnement des grands hommes de l’Antiquité, « [l’] interesse et [le] passionne ». Et, significativement, c’est encore l’environnement urbain et politique de la Rome antique qui constitue pour Montaigne un souvenir d’enfance :
Or j’ay esté nourry dés mon enfance, avec ceux cy : J’ay eu cognoissance des affaires de Rome, longtemps avant que je l’aye eu de ceux de ma maison. Je sçavois le Capitole et son plan, avant que je sçeusse le Louvre : et le Tibre avant la Seine29.
Les « affaires », le « plant », plutôt que les textes, constituent le plaisir du petit Michel. Mais n’allons pas opposer trop précipitamment le texte de III, 4 et celui de III, 9, sous prétexte que l’un ferait état d’une grande tristesse et l’autre d’un grand plaisir ; comme on l’a déjà vu, les sentiments décrits dans « De la diversion » sont pour le moins ambivalents : regret de ce qui a disparu ou de ce qui est en train de disparaître,
mais très grand attachement à ces « images menues » qui font le sel de la vie. L’attachement aux « circonstances » et l’anéantissement que leur souvenir suscite vont de pair.
Dans son article « Poétique du lieu : Rome, l’enfance et la mort », Gisèle Mathieu-Castellani a formulé l’hypothèse très féconde d’une « pulsion archéologique » qui traverserait Montaigne et son texte lorsqu’il parle de Rome. Elle utilise cette expression pour désigner tout à la fois la fascination de l’auteur pour la ville ruiniforme et pour les profondeurs du moi :
Rome figure l’autre du moi, et l’archéologie de la ville morte se confond avec celle du sujet, modèle fantastique d’exploration des profondeurs abyssales30.
Le parallèle que nous venons d’établir, entre l’émotion liée aux circonstances de la mort d’un proche ou de sa propre mort et celle ressentie face aux traces matérielles de la vie quotidienne des grands hommes de l’Antiquité, va dans le sens du lien proposé par Mathieu-Castellani entre recherche archéologique et recherche dans les profondeurs du moi. Mais nous voudrions retenir cette expression pour une raison que n’a pas soulignée Mathieu-Castellani : la « pulsion archéologique », qu’elle explore les strates de la ville ou celles du moi, a pour combustible privilégié des éléments matériels, ou, pour être plus précis, circonstanciels. Ce qui suscite le plaisir lorsqu’on se souvient des « personnes, desquelles la memoire est en recommendation », ce sont les « places » où ils ont habité, ce sont « leur visage, leur port, et leurs vestements », ce sont les « sons » de leurs noms (et c’est là, évidemment, une limite de la métaphore archéologique), ce sont leurs devis, leurs promenades, leurs soupers. Si les origines de cet intérêt pour les « circonstances » sont d’ordre affectif, les conséquences en sont épistémologiques : Montaigne propose une façon particulière de s’intéresser aux textes des grands hommes en les liant à du hors-texte, comme le prouve cette remarque du même chapitre « Du repentir » :
Qui m’eust faict veoir Erasme autrefois, il eut testé mal-aisé, que je n’eusse prins pour adages et apophtegmes, tout ce qu’il eust dit à son valet et à son hostesse31.
À côté de ce que disent les textes des Adages et des Apophtegmes, Montaigne rêve de pouvoir ajouter les « devis » d’Érasme dans sa vie la plus privée et la plus quotidienne. Phrase qui peut se lire comme une méthode épistémologique, mais qui, on l’a vu, est avant tout le produit d’un fantasme paradoxal : celui de retrouver le disparu à travers ce qui, autour de lui, menace le plus de disparaître.
Il faudrait, pour conclure, revenir à la lecture de « De la diversion » et au dialogue entamé avec André Tournon et Olivier Guerrier. Les deux auteurs faisaient de ce chapitre l’expression du pouvoir de « diversion » des fictions et des impressions sensibles. Nous avons essayé de montrer comment, au cœur de ce chapitre, s’opérait un retournement qui faisait des impressions sensibles suscitées par les « circonstances » de la mort les conditions d’une « saisie directe » de la mort, saisie qui n’est pas philosophique mais esthétique ou affective. Or on remarque, dans d’autres textes des Essais, ce même désir explicite de saisir la réalité par le hors-texte, par exemple dans le passage de III, 9 que nous avons proposé. Si nous avons donc voulu proposer une limite aux « poursuites sans termes » qui, pour Olivier Guerrier, constituent le texte des Essais, ce n’est pas pour donner une image dogmatique de Montaigne, image qu’on aurait bien de la peine à justifier. Il ne s’agit pas ici de réconcilier Montaigne avec la vérité, mais avec la référence. Il ne nous semble pas que l’on puisse faire des Essais un texte uniquement fictionnalisé par ses emprunts à la littérature, composé dans une langue qui chercherait à se modaliser pour ne pas risquer de représenter une réalité. Il y a des moments, certes assez fugaces, mais aussi assez récurrents, où Montaigne formule le souhait d’un rapport direct aux choses. Le désir de hors-texte dont font état ces passages rend difficile de décrire les Essais comme un texte qui s’amuse toujours de la virtualité du langage. Dans le contexte sceptique qui caractérise cette œuvre, on peut apercevoir des moments de nostalgie de la référence, et même de retour de la référence à travers les formes les plus simples : la nomination et l’énumération32.
Reste que, dans le texte des Essais, ce retour d’un désir de référence semble souvent s’effectuer à propos de choses et d’êtres disparus, ou en voie de disparition. Le désir de nommer ce qui est proche surgit dans la mesure où ce qui est proche s’éloigne, ou est en train de s’éloigner. Parler d’un « retour de la référence » dans certains passages des Essais ne permet donc pas de redéfinir un régime général du langage dans cette œuvre. Mais cela permet de mieux poser la question (ou le problème) de la référence dans les Essais : le réel s’absente du langage des Essais de préférence lorsqu’il est palpable, proche ; en revanche, lorsqu’il est fantomatique, absent, disparu, il est à nouveau convoqué par le langage. En effet, les « détails anodins » ne suscitent pas toujours le désir de Montaigne. À propos des affaires domestiques, qu’il ne supporte que lorsqu’il est en voyage, l’auteur écrit :
Vaines pointures : vaines pointures par fois, mais tousjours pointures. Les plus menus et graisles empeschemens, sont les plus persants33.
Lorsqu’il est bel et bien présent, le « menu », d’objet de désir, devient objet de répulsion et d’agression. Les « circonstances », les « choses qui se tiennent autour », semblent ne pouvoir être désirées que dans le cadre d’une nostalgie ; présentes, elles enferment, elles étouffent.
Benoît Autiquet
Université de Bâle (Suisse)
1 Je remercie Hélène Merlin-Kajman, Dominique Brancher, Doris Munch, Michel Jourde, André Bayrou et Adrien Chassain pour leur aide précieuse pendant la rédaction de cet article.
2 André Tournon, La Glose et l’essai, Paris, Champion, 2000, p. 293.
3 Ibid., p. 294.
4 Ibid.
5 Olivier Guerrier, Quand « les poètes feignent » : « fantaisie » et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2002, p. 37.
6 Olivier Guerrier, id., p. 244.
7 André Tournon, op. cit., p. 200.
8 Pour une lecture très similaire du chapitre « De la diversion » par André Tournon, voir le passage qu’il y consacre dans son Essais de Montaigne. Livre III, Paris, Atlande, 2002, « Un essai des leurres (III, 4) », p. 111-112.
9 Montaigne, Les Essais, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 871.
10 Ibid., p. 1731.
11 Ibid., p. 872.
12 Ibid., p. 874.
13 Ibid., p. 878.
14 Ibid.
15 Ibid., p. 879.
16 Olivier Guerrier, op. cit., p. 17.
17 Montaigne, op. cit., p. 879.
18 Ibid.
19 Ibid., p. 881.
20 Ibid., p. 878.
21 Michel Le Guern, Autour du circonstant, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1998, « Les antécédents rhétoriques de la notion de circonstance », p. 59.
22 Montaigne, op. cit., p. 878-879.
23 Ibid., p. 879.
24 Nous empruntons cette expression à André Tournon, Essais de Montaigne. Livre III, p. 112, qui résume ainsi le chapitre : « comportements et sentiments, tout est tributaire de pensées inconsistantes, tout est pénétré des simulacres de la “fantaisie” ».
25 Ibid., p. 98.
26 Ibid., p. 879. Nous soulignons.
27 Ibid., p. 98.
28 Ibid., p. 1043. Première citation latine : « Si grande est la puissance d’évocation des lieux ! Et certes il y en a en cette cité une infinité : on ne fait pas un pas sans mettre le pied sur de l’histoire. » (Cicéron, De finibus, V, II, 2). Seconde citation latine : « Moi je vénère ces grands hommes et je me lève toujours quand j’entends de si grands noms » (Sénèque, Lettres à Lucillius, LXIV, 9.)
29 Ibid., p. 1042.
30 Gisèle Mathieu-Castellani, « Poétique du lieu : Rome, l’enfance et la mort. », in Montaigne e l’italia. Atti del Congresso internazionale di studi di Milano-Lecco, 26-30 ottobre 1988, Genève, Slatkine, 1991, p. 344.
31 Montaigne, op. cit., p. 850.
32 Le débat autour de la capacité à faire référence au réel dans un contexte sceptique nous semble valable dans les Essais, mais trouve aussi des échos à l’époque contemporaine. Ainsi, Carlo Ginzburg a réagi avec véhémence contre les excès du linguistic turn en histoire et ses racines philosophiques dans plusieurs de ses ouvrages. Comme lui, il nous semble important de rappeler que « la construction […] n’est pas incompatible avec la preuve : la projection du désir, sans laquelle nul ne s’adonnerait à la recherche, n’est pas incompatible avec les démentis infligés par le principe de réalité » (Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, Gallimard, coll. « Hautes Études », 2003, p. 34).
33 Montaigne, op. cit., p. 994.