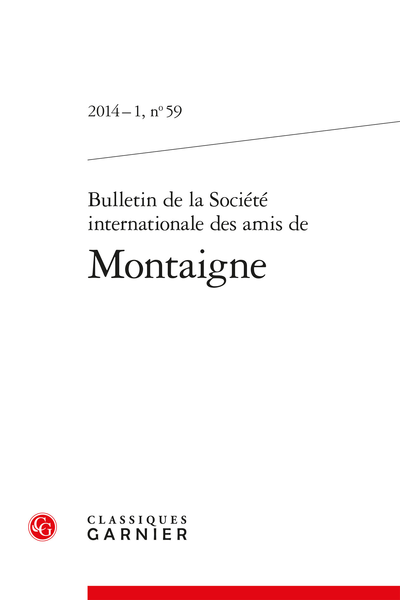
« Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de notre opinion ». La recherche inquiète d’« un discours qui face pour nous »
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2014 – 1, n° 59. varia - Auteur : Perona (Blandine)
- Résumé : Montaigne s’est souvent confronté au stoïcisme, soit pour y reconnaître la pertinence ou l’intérêt de certains thèmes et attitudes morales, soit pour s’en démarquer très nettement et résolument. L’analyse de B. Perona vise à éclairer la manière dont cette confrontation produit une appropriation singulière via les textes de Sénèque, interlocuteur privilégié qui permet à Montaigne de mieux cerner le lien entre amitié et retraite.
- Pages : 107 à 129
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812436772
- ISBN : 978-2-8124-3677-2
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3677-2.p.0107
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/03/2015
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
« Que le goût des biens
et des maux dépend en bonne partie
de notre opinion »
La recherche inquiète d’« un discours qui face pour nous »
Plusieurs lectures du chapitre « Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l’opinion qu’on en a » ont montré que cette réflexion topique sur une maxime stoïcienne tissait des liens – a priori inattendus dans ce contexte – avec la question de l’amitié. Ainsi, Dominique Bertrand1 et Jean Starobinski2 ont tous deux établi une analogie convaincante où la libéralité et l’échange de nature économique évoqués dans ce chapitre sont une possible image de la relation d’accueil de l’autre et plus précisément d’amitié3. Gérard Defaux, de son côté, en appuyant en particulier sa démonstration sur la présence d’une citation de Quintilien, suggère que, lorsque Montaigne entend vérifier que la mort et la douleur ne sont pas dans les choses, mais dans l’« opinion », dans la représentation qu’on en a, il a sans doute très présent à l’esprit et plus exactement au cœur, la vive souffrance de la perte de La Boétie4. Ces éléments mis en évidence par la critique révèlent que le chapitre i, 14 s’efforce de dépasser l’exercice de la « dissertation5 » pour que la méditation apaise réellement les maux.
L’interrogation philosophique dans cet essai n’est pas abstraite ; Montaigne prend à bras le corps la question de la douleur et de la mort. Chaque reprise, chaque relecture de son texte montre les étapes d’un cheminement qui ne se solde pas par une réponse unique, définitive, salvatrice. Montaigne affronte de façon lancinante cette interrogation universelle : que faire face à la souffrance et à la peur de la souffrance ? Il cherche déjà un secours dans les sagesses antiques et met à l’épreuve la certitude confiante des philosophes stoïciens. Peut-on dépasser la douleur ? Si oui, comment ? Si non, qu’est-il en notre pouvoir de faire ? Nous allons suivre de façon chronologique les étapes de cette recherche inquiète, recherche d’un discours qui « fasse pour Montaigne », qui soit efficace pour lui.
Dans la version de 1580, cette enquête se fait en deux temps : Montaigne, en dialogue avec Cicéron et Sénèque, éprouve la validité de la sentence stoïcienne appliquée à la peur de la mort et à la douleur. Dans la version de 1588, Montaigne ajoute à ces deux points un autre objet de crainte et de souffrance : la pauvreté. Il développe alors longuement l’exemple personnel de son comportement face à l’argent. Reste à voir le sens de cet ajout. Que dit, de sa relation à la souffrance, le rapport qu’a entretenu Montaigne avec l’argent ? Quelles conclusions nouvelles et provisoires en tire-t-il dans les ajouts de l’exemplaire de Bordeaux ? La réponse à ses questions sera aussi l’occasion de vérifier le statut tout à fait particulier de Sénèque : si le stoïcisme est assez sévèrement condamné, Sénèque réussit par d’autres biais à trouver grâce aux yeux de Montaigne.
1580, le dialogue avec Cicéron et Sénèque :
le sage, comme illusion
Comme dans le chapitre « Que Philosopher, c’est apprendre à mourir », Montaigne, dans « Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de notre opinion », part d’une maxime bien connue de la philosophie antique. Dès les premières lignes, le chapitre se propose en effet de commenter un des fondements de la pensée stoïcienne. La
conjonction de subordination « Que » indique déjà, dans le titre, que cette phrase est mise à distance comme objet d’observation, ce que confirme ensuite l’injonction « voyons s’il se peut maintenir » qui invite également le lecteur à évaluer la solidité d’un des piliers de la philosophie d’Épictète : « Or que ce que nous appellons mal ne le soit pas de soy, ou au moins, tel qu’il soit, qu’il depende de nous de luy donner autre saveur, et autre visage, car tout revient à un, voyons s’il se peut maintenir6 ». Par conséquent, tout ce qui précède est donné comme hypothèses à infirmer ou confirmer. Nous citons à présent exceptionnellement la version de 1582, où Montaigne a corrigé un oubli qui rendait la première phrase du passage suivant incorrecte dans la version de 1580 :
Si ce que nous appellons mal et tourment, n’est ny mal ny tourment de soy, ains seulement que nostre fantasie luy donne cette qualité : il est en nous de la changer, et en ayant le choix, si nul ne nous force, nous sommes estrangement fols de nous bander pour le party, qui nous est le plus ennuyeux, et de donner aux maladies, a l’indigence et au mespris un aigre et mauvais goust, si nous * le leur pouvons donner bon, et si, la fortune fournissant simplement de matiere, c’est à nous de luy donner la forme. Or que ce que nous appellons mal ne le soit pas de soy, ou au moins, tel qu’il soit, qu’il depende de nous de luy donner autre saveur, et autre visage, car tout revient à un, voyons s’il se peut maintenir7.
L’hypothèse à vérifier est la suivante « ce que nous appelons mal n’existe que dans notre imagination ». Par un jeu d’explicitation et de glose, Montaigne donne deux formulations nouvelles de cette hypothèse : « nous pouvons donner bon goût aux maux » et « nous donnons forme à la matière que fournit la Fortune ». La longue phrase est construite en chiasme : « si les maux n’existent qu’en l’imagination, nous pouvons changer les maux comme bon nous semble et nous sommes fous de ne pas transformer l’aigreur en douceur, si nous sommes en mesure de le
faire et si nous sommes libres de façonner ce que nous envoie la fortune ». Montaigne tire la principale conclusion de cette thèse stoïcienne dont il cherche à vérifier la validité : si elle est vraie, nous sommes en mesure d’échapper à la souffrance en faisant de tout ce que nous vivons un bien. Si nous nous attardons un peu longuement sur ce passage, c’est pour montrer que Montaigne propose bien l’examen de ce qui n’est qu’une hypothèse : dans ces trois occurrences, « si » est un subordonnant qui introduit une subordonnée hypothétique8.
Une fois ces étapes préliminaires terminées, Montaigne en vient effectivement à éprouver cette affirmation. Dans l’édition de 1580, il procède seulement en deux temps. Il examine déjà l’opinion courante selon laquelle la mort est un mal9 : « Nous tenons la mort, la pauvreté et la douleur pour nos principales parties. Or cette mort que les uns appellent des choses horribles la plus horrible, qui ne sçait que d’autres la nomment l’unique port des tourmens de cete vie10 ? » Montaigne, dans cette partie, ne trouve alors pas d’arguments déterminants pour dire que la mort est effectivement un mal. Il en vient alors à son second et dernier point en 1580 : « Bien, me dira l’on, vostre regle serve à la mort, mais que direz vous de l’indigence, que dires vous encor de la douleur, que la pluspart des sages ont estimé le souverain mal11 ? » La mise en évidence du plan et des phrases qui articulent les différentes parties du chapitre suffit à montrer l’oralité du chapitre. Montaigne utilise une fois l’interrogation rhétorique ; une autre fois, il introduit la voix d’un possible opposant. C’est un premier point qui nous amène à montrer la proximité forte entre les Tusculanes et ce chapitre des Essais.
Chacun des cinq livres des Tusculanes12 se présente comme une réponse à une question ou à une objection de l’auditeur auquel s’adresse Cicéron. Montaigne, lui, intègre ce jeu de voix propre au dialogue dans un texte à la première personne et ce chapitre, dans la version de 1580, se veut aussi largement une réponse à Cicéron, surtout dans sa deuxième partie13.
Montaigne s’inscrit dans l’enquête du deuxième livre des Tusculanes et cherche à savoir si la douleur est ou non le plus grand des maux. Il retient déjà qu’il s’agit d’une thèse partagée par plus d’un philosophe, comme le montre la citation précédente et ensuite il s’appuie sur un exemple de Cicéron qu’il détourne pour mieux montrer les limites de l’orgueil du sage stoïcien. Cicéron, en effet, relate la rencontre de Posidonius et de Pompée afin de montrer l’admirable résistance du sage qui bande toutes ses forces contre la douleur et vit, comme si elle n’existait pas. Non sans grandiloquence, Posidonius, répond ainsi aux assauts du mal qui le tenaille : « Nihil agis, dolor ! Quamvis molestus, numquam te esse confitebor malum14 ». Montaigne traduit ainsi le passage : « A quoi il s’escrioit tu as beau faire douleur si ne dirai-je pas que tu sois mal 15 ». Ce n’est pas sans agacement que Montaigne rappelle l’interprétation traditionnelle de cet épisode :
Ce conte qu’ils font tant valoir, que porte il pour le mespris de la douleur ? il ne debat que du mot, et ce pendant si ces pointures ne l’esmeuvent, pourquoy en rompt il son propos ? pourquoi pense il faire beaucoup de ne l’appeler pas mal ? Icy tout ne consiste pas en l’imagination16.
La troisième personne du pluriel accusatrice ne vise en réalité certainement qu’une seule personne, à savoir Cicéron qui préfère voir dans cet épisode le courage de Posidonius, plutôt que l’intensité de la douleur dont l’homme peut être victime. Un ajout de l’exemplaire de Bordeaux témoigne encore que c’est bien à Cicéron que s’en prend Montaigne :
Montaigne retourne l’accusation de Cicéron qui consiste à nier que la douleur soit le plus grand des maux. Quand Montaigne précise quels sont les sages qui ont estimé la douleur comme le « dernier (et non plus “souverain”) mal » et qu’il prend comme témoin et garant de la réalité de la douleur, il mentionne « Aristippus, Hieronimus », ceux précisément que Cicéron accuse de faiblesse avec une grande sévérité au début de son argumentaire :
Je commencerai donc en parlant de la faiblesse des philosophes nombreux et qui, de plus, relèvent de diverses écoles (inbecillitate multorum et de variis disciplinis philosophorum). Parmi eux, le premier aussi bien par l’autorité que par l’ancienneté, Aristippe le Socratique, n’hésita pas à dire que le souverain mal c’était la douleur. Puis vient Épicure chez qui une opinion aussi lâche et digne d’une femme trouva beaucoup de docilité. Après lui, Hiéronymes de Rhodes17…
Montaigne commence donc par s’insurger de la confiance exaspérante de Cicéron dans la force du sage. Poursuivant le dialogue des Tusculanes, il se range, contre Cicéron, avec ceux que l’auteur latin accuse de faiblesse : « Je leur donne que ce soit le pire accident de nostre estre et volontiers18 ». Partant de ce constat, il décide de ne s’occuper par conséquent que de la douleur : « ainsi n’aions affaire qu’a la douleur19 ». Il abandonne l’observation des maux plus faibles. Le désaccord avec Cicéron décide du plan qui ne comporte finalement que deux parties. Montaigne lui cherche sans doute encore un peu la contradiction quand il accepte l’argumentation épicurienne selon laquelle « cela nous doit consoler que naturelement, si la douleur est violente, elle est courte, si elle est longue elle est legiere. Tu ne la sentiras guiere longtemps, si tu la sens trop, elle mettra fin à soy, ou à toy20… » Cette fois, il entre dans le dialogue du De finibus se liguant avec les épicuriens contre Cicéron. De nouveau, ce sont des ajouts de l’exemplaire de Bordeaux qui confirment que Montaigne, en 1580, écrivait effectivement en réponse à Cicéron.
En 1580, Montaigne construit largement la trame de son texte en s’inspirant de l’architecture des deux premiers livres des Tusculanes, à qui il reprend déjà leur caractère dialogique. Les ajouts de l’exemplaire de Bordeaux semblent devoir mettre au jour cette dette de Montaigne envers Cicéron qu’il ne cesse de critiquer et d’attaquer et qui semble toujours néanmoins son meilleur ennemi. Montaigne s’insurge contre son insupportable confiance et ne reconnaît pas moins la maîtrise de son art du dialogue qui informe le chapitre.
Si la dette de Montaigne envers Cicéron n’est pas négligeable, c’est logiquement avec un philosophe stoïcien que Montaigne dialogue plus encore dans ce chapitre : les Lettres à Lucilius en sont la matière principale. La figure du sage stoïcien est fort mise à mal par la lecture de Montaigne. L’exemple du pourceau de Pyrrho repris à Diogène Laërce est déjà à lui seul très éloquent : l’indifférence reste possible quand il s’agit de ne pas craindre inutilement la mort ; en revanche, elle est un vœu pieux concernant la douleur et il ne faut pas tant se moquer des cris du porc, car Sextus Empiricus l’admet parfaitement, le sage n’est nullement insensible. « Loin de l’orgueil du sage stoïcien, Sextus reconnaît sans ambages qu’il n’est pas vrai que le “sceptique est complètement exempt de perturbation […] parfois il frissonne, a soif…” (I, 29)21 ». Comme dans l’exemple détourné de Posidonius, la douleur résiste à la thèse stoïcienne. Le sage, capable de la dépasser réellement, n’existe sans doute pas. Posidonius lui-même en offre la démonstration. Il semble bien que la philosophie stoïcienne repose ni plus ni moins sur la négation de l’irréductible fragilité humaine. La maxime qui constitue le titre du chapitre surmonte l’épreuve de la crainte de la mort ; elle ne résiste pas à celle de la douleur.
Ainsi, dans le développement sur la mort, Montaigne emprunte ses deux principaux arguments aux lettres de Sénèque. De l’épître 70, il tire l’argument selon lequel « même les êtres tenus en parfait mépris sont capables de mépriser la mort22 ». Il multiplie lui aussi les exemples montrant que « les personnes populaires et communes23 » savent affronter
la mort sans peur. Seulement, afin d’actualiser le propos de Sénèque, il puise ses exemples dans des sources qui lui sont plus proches dans le temps, comme les Annales de Jean Bouchet24. Montaigne introduit aussi plus d’humour dans son florilège, en proposant une longue série de morts divertissantes. Il puise un grand nombre d’exemples dans l’Apologie pour Hérodote de Henri Estienne en abandonnant la perspective morale de cet auteur qui regrette l’absence de remords des condamnés25. Montaigne, lui, ne retient que les bons mots de ces hommes qui sont sur le point de mourir. Il emprunte un autre de ces exemples joyeux à Bonaventure des Périers qui, dans sa première nouvelle en forme de préambule, cite les ultima verba de celui qu’on a appelé, « par une antonomasie » le « plaisantin26 ».
Dans le préambule, les Nouvelles récréations s’inscrivent dans une quête qui est aussi celle de Montaigne ; le narrateur cherche un précepte qui vaille pour lui et son lecteur : « L’un vous baillera pour ung grand notable, qu’il faut reprimer son couroux, l’autre peu parler : l’autre, croire conseil : l’autre, estre sobre : l’autre faire des amis. Vous n’en trouverez point de tel qu’est, Bien vivre et se resjouir27 ». Devant la multiplicité des discours, lequel adopter ? La solution de des Périers semble d’inspiration largement stoïcienne : « Une trop grande patience vous consume : Ung taire vous
tient gehenné : Ung conseil vous trompe : une diete vous desseiche : un amy vous abandonne. Et pour cela faut il vous desesperer ? Ne vaut il pas mieux se rejouir, en attendant mieux : que se fascher d’une chose qui n’est pas en nostre puissance28 ? » Pourtant, dans la conclusion de la première nouvelle, Bonaventure des Périers montre lui-même les limites de cette injonction stoïcienne, lorsqu’il s’étonne de la force du plaisantin : « Que voulez vous de plus naif que cela ? quelle plus grande felicité ? Certes d’autant plus grande qu’elle est octroyée à si peu d’hommes ». Il n’est en effet pas donné à tous de se réjouir en une telle extrémité. Le préambule des Nouvelles récréations suffit donc lui-même déjà à montrer la faiblesse des préceptes stoïciens. D’une certaine façon, le problème reste alors entier, comment « bien vivre et se réjouir » sans la force d’âme du « plaisantin » qui est une figure extravagante du sage stoïcien ? Le récit de Bonaventure des Périers est par conséquent un récit modeste, qui ne prétend nullement apporter une exhortation supplémentaire à toutes celles énumérées plus haut. Il montre les limites des recommandations stoïciennes qui ne conviennent qu’à des hommes d’exception qui peut-être n’existent pas, mais ne propose pas un précepte qui supplante celui qui vient d’être immédiatement disqualifié. Sur le plan doctrinal, ce récit n’apporte par conséquent aucun élément. En revanche, il divertit. La faiblesse et la vulnérabilité de l’homme ne sont plus niées : elles sont rendues plus acceptables par le rire et l’inquiétude face au tragique de l’existence humaine est un temps divertie. La jouissance, la capacité à se réjouir passe par cette acceptation souriante.
Montaigne en détournant de leur fin les exemples empruntés à Henri Estienne et en reprenant largement l’épisode du plaisantin à B. des Périers infléchit lui aussi l’argumentation stoïcienne. Il s’agit finalement moins de montrer la vanité de la crainte de la mort que de soulager l’angoisse par le rire. La mort devient presque l’objet d’un éloge paradoxal : la mort se fait temps de plaisanteries et de fête. De nouveau, il ne s’agit pas d’anéantir la peur, mais de se familiariser un peu avec l’objet de notre angoisse, d’accepter cette peur et même d’en rire pour pouvoir finalement « savoir jouir loyalement de son œuvre ». La présence des Nouvelles récréations et joyeux devis annonce déjà ce que montrera plus clairement la lecture du chapitre dans son intégralité :
pour Montaigne, les stoïciens préconisent une voie qu’un homme ne peut suivre. Éradiquer la crainte de la mort, comme de la douleur lui est impossible.
Les hommes les plus simples vont joyeusement à la mort et en outre, la mort est souvent une fuite, une façon d’échapper à un danger ou à une grande douleur. C’est le second argument que Montaigne reprend à Sénèque dans la partie consacrée à la crainte de la mort : « que ne fuirons nous dict un ancien, si nous fuions ce que la couardise mesme a choisi pour sa retraitte29 ? »
La dette de Montaigne envers Sénèque est tout aussi importante dans la partie consacrée à la douleur. C’est encore dans les lettres à Lucilius que Montaigne trouve cette image : « En nous acculant et tirant arriere nous appellons a nous et attirons la ruine30 ». Comme Sénèque encore, Montaigne multiplie les exemples de mépris de la douleur et retient celui de Mucius Scevola qui refuse de trembler devant les menaces de Porsenna et plonge sa main dans le feu, de l’esclave espagnol qui rit sous la torture et celui de Marius qui poursuit sa lecture alors qu’on l’opère de ses varices31. Montaigne enfin traduit plus largement encore Sénèque dans la dernière partie de son chapitre :
Luxurioso frugalitas poena est, pigro supplicii loco labor est, delicatus miseretur industrii, desidioso studere torqueri est ; eodem modo haec, ad quae omnes inbecilli sumus, dura atque intoleranda credimus, obliti, quam multis tormentum sit vino carere aut prima luce excitari. Non ista non difficilia sunt natura, sed nos fluvidi et enerves. Magno animo de rebus magnis iudicandum est : alioquin videbitur illarum vitium esse, quod nostrum est. Sic quaedam rectissima, cum in aquam demissa sunt, speciem curui praefactique visentibus reddunt. Non tantum quid videas, sed quemadmodum, refert32.
Voici ce que ces mots deviennent sous la plume de Montaigne :
Certes tout ainsi qu’a un faineant l’estude sert de tourment, à un yvrongne l’abstinence du vin ; la frugalité est supplice aus luxurieus, et l’exercice geine à un homme delicat et oisif : ainsi est-il du reste. Les choses ne sont pas si douloreuses, ny difficiles d’elles mesmes : mais nostre foiblesse et lascheté les fait telles. Pour juger des choses grandes et haultes, il faut un’ame de mesme, autrement nous leur attribuons le vice qui est le nostre. Un aviron droit semble toutes-fois courbé en l’eau. Il n’importe pas seulement qu’on voye la chose, mais comment on la voye33.
Montaigne coupe seulement le passage personnel, où Sénèque rappelle que la frugalité et l’habitude de se lever tôt, deux choses qui font naturellement partie de sa vie et de celle de Lucilius, ne sont pas communément appréciées. Sinon, comme l’indique l’adverbe « certes », Montaigne concède tous les autres points à Sénèque ; néanmoins, il le suit seulement jusqu’ici. Les deux interrogations qui se trouvent juste après cette copieuse paraphrase indiquent un revirement de Montaigne qui se rebiffe contre les conseils de Sénèque : « Or sus, pourquoy de tant de discours qui nous persuadent de mespriser la mort, et de ne nous tourmenter point de la douleur n’en empoignons nous quelcun pour nous ? Et de tant d’especes d’imaginations, qui l’ont persuadé a autruy
que34 chacun n’en prend il celle qui est le plus selon son humeur35 ? » Comment s’approprier un discours et comment choisir plutôt l’un que l’autre ? La thèse stoïcienne dans un premier temps se retourne contre elle-même. Tout est dans l’opinion en effet et tout n’est qu’opinion conclut Montaigne dans un infléchissement sceptique net de cette thèse : les « discours » se révèlent tous comme « imaginations ». Aussi, qu’il soit en notre pouvoir d’échapper à la crainte de la mort et à l’emprise de la douleur est aussi quelque chose d’imprimé en la fantaisie de Sénèque. Pourquoi alors croire ce discours plutôt qu’un autre ? Surtout qu’il n’échappe pas à la contradiction. Le sage peut être au dessus de tous les tourments et néanmoins la philosophie stoïcienne ne cesse de rappeler qu’on peut toujours mettre fin à ses maux par la mort. C’est donc qu’on ne peut être au dessus de la douleur, s’il faut parfois se résoudre à mourir. Montaigne pointe cette contradiction non sans amertume : « Au demeurant on n’eschappe pas à la philosophie pour faire valoir outre mesure l’aspreté des douleurs. Car on la contraint de nous donner en paiement cecy. S’il est mauvais de vivre en necessité, au moins de vivre en necessité, il n’est aucune necessité36 ». Les stoïciens affirment toujours finalement combien l’homme est fragile face à la douleur, puisqu’en dernier recours, ils n’ont finalement guère mieux à offrir que la liberté de mourir. La fin des stoïciens est illusoire ; le sage au dessus des maux n’existe pas. Le problème est alors déplacé. On ne peut retirer la douleur, comme on nettoie l’infection d’une plaie avant qu’elle se referme. La douleur fait partie intégrante de ce qu’est l’homme. Montaigne renonce à la prétention stoïcienne de l’anéantir ; il cherche seulement à l’accepter, à vivre mieux avec et à l’endormir un peu avec une « drogue lenitive ».
La version de 1580 se solde par conséquent par un désaveu ferme des préceptes contradictoires des stoïciens. Les exhortations à vaincre la douleur deviennent dérisoires, quand on sait qu’en dernier recours, les stoïciens proposent le suicide comme échappatoire. Le sursaut de Montaigne qui refusait de croire qu’on ne puisse se raidir et se renforcer contre la douleur retombe dans l’amertume : le discours stoïcien, opinion
entre les opinions, exalte la figure d’un sage qui ne peut exister et qui prépare ses disciples à se résoudre à la mort. Si la souffrance n’est pas une épreuve à surmonter, mais une chose qui est en l’homme et avec laquelle il doit vivre, quel sens peut-elle prendre pour qu’on puisse l’accepter ?
1588 : « Je ne fu jamais mieux »,
le prix de la liberté
Dans l’édition de 1588, Montaigne abandonne sa résolution de n’avoir affaire qu’à la mort et à la douleur : il ajoute un long passage à propos du caractère relatif de la richesse et de la pauvreté. Cet ajout conséquent est à la fois l’occasion de parler de lui-même et de proposer un début de réponse sur le sens de cette douleur avec laquelle il faut vivre. Avant d’en venir à un témoignage plus personnel, Montaigne insère, après l’évocation des martyrs, quelques exemples nouveaux à propos de la souffrance. Il les introduit ainsi : « L’opinion est une puissante partie, hardie et sans mesure ». Il y montre alors moins que la douleur peut être surmontée que ce qui est aigreur pour les uns est douceur pour les autres. Si la plupart des hommes souhaitent la paix, elle est un fléau pour des généraux comme César et Alexandre. Si le désir d’une vie tranquille est un souhait des plus communs, c’est ce que fuient les ermites. Si être cocu est honteux pour plus d’un, certains se trouvent bien de cet état. Si les membres « qui servent à nous engendrer » sont les « plus plaisants et utiles », certains « les ont pris en haine mortelle37 ». Si le sens de la vue est pour beaucoup le plus précieux, Démocrite préfère se crever les yeux. Cette série d’exemples aurait assez bien illustré le chapitre « De l’incertitude de notre jugement » qui montre qu’« il y a prou loi de parler partout et pour et contre38 ». La maxime stoïcienne selon laquelle les maux sont dans l’opinion est supplantée par une thèse d’inspiration sceptique qui montre à la fois la force de conviction de l’opinion et la
fragilité de ce qui la fonde, autrement dit l’impuissance de la raison à se déterminer pour une voie plutôt qu’une autre.
Cette influence sceptique se lit aussi dans le témoignage personnel de Montaigne. Il explique que son rapport à l’argent a changé plusieurs fois au cours de son existence et qu’il a connu trois temps différents qui l’ont conduit d’une pauvreté insouciante à une aisance maîtrisée. Cette confidence s’inscrit assez logiquement dans la thèse stoïcienne, car Montaigne y montre que l’indigence n’est pas nécessairement un mal, pas plus que la richesse n’est nécessairement un bien. Mais, le rapport à l’argent est aussi une image de la relation entretenue avec la Fortune : il faut savoir admettre que les efforts de la raison ne nous mettent nullement à l’abri de ses caprices.
Le premier état de Montaigne est un état d’insouciance et d’abandon : « Je me remettois de la conduite de mon besoing plus gayment aux astres, et plus librement que je n’ay faict depuis à ma providence et à mon sens39 ». Évoquant cette période, Montaigne devance immédiatement l’objection de ceux qui pourraient lui reprocher l’incertitude d’une telle situation. D’une part, ils oublient que certains ont sacrifié leur sécurité et leur confort pour entreprendre des hauts faits et « secondement, ils ne s’advisent pas que cette certitude sur laquelle ils se fondent n’est guiere moins incertaine et hazardeuse que le hazard même40 ». Or c’est précisément parce que Montaigne s’est efforcé de se préserver de l’incertitude que son rapport à l’argent est devenu aliénant :
… à la suite de ces vaines et vitieuses imaginations, j’allois faisant l’ingenieux à prouvoir par cette superflue reserve à tous inconveniens : et sçavois encore respondre à celuy qui m’alleguoit que le nombre des inconveniens estoit trop infiny ; que si ce n’estoit à tous, c’estoit à aucuns et plusieurs. Cela ne se passoit pas sans penible sollicitude41.
Lorsque Montaigne quitte enfin « cette sotte imagination42 », il retrouve une tranquillité relative. Ce dernier état ressemble au premier. Montaigne aussi « vit du jour à la journée ». Cependant, il ne retrouve pas la joie de ses jeunes années, ce qui était annoncé par ce sobre aveu : « Et despendant de l’ordonnance et secours d’autruy, sans estat certain et sans prescription. Ma despence se faisoit d’autant plus allegrement et avec moins de soing, qu’elle estoit toute en la temerité de la fortune. Je ne fu jamais mieux ». L’abandon à la « témérité » de la fortune, autrement dit à ses caprices43, se confond dans ce premier état avec le fait de se reposer sur la bonté d’autrui. Montaigne ne retrouve pas cet état d’abandon total qui tient pour beaucoup à la naïveté et à l’ignorance : il doit vivre désormais avec la conscience que l’incertitude est le seul état auquel il puisse prétendre. Cette conscience nouvelle lui interdit l’insouciance absolument confiante de sa jeunesse ; les coups et les caprices de Fortune lui ont appris sa vulnérabilité. Face à l’irréductible incertitude, il se choisit un mode de vie, structuré par quelques habitudes et quelques principes : « je suis retombé à une tierce sorte de vie (je dis ce que j’en sens) certes plus plaisante beaucoup et plus reiglée44 ». Montaigne ne peut se passer de quelques règles aussi arbitraires soient-elles, étant donné notre aveuglement quant à l’ordre des choses ; il essaie d’instaurer un peu de stabilité, tout en sachant le caractère provisoire, précaire et menacé de cette façon de vivre45.
Cet ajout de 1588 prolonge la réflexion de 1580 sur la fragilité de l’homme. La peur de perdre son argent est aussi une image de la peur de mourir ; ces deux craintes laissent l’homme seulement préoccupé de savoir ce qui lui reste (à vivre ou à dépenser). Ces craintes paralysent,
aliènent, autrement dit privent tout simplement l’homme de la liberté de vivre et d’agir. La leçon de ces trois étapes semble bien être : vivre est prendre le risque de souffrir, la liberté est à ce prix. La confiance insouciante de la jeunesse de Montaigne passait par l’ignorance de ce risque (c’est aussi cette ignorance qui fait la sérénité du porc de Pyrrhon) et par conséquent par l’ignorance de cette liberté ; il s’agissait ainsi moins d’un bonheur d’homme que d’enfant.
Conscient désormais de sa vulnérabilité, Montaigne quitte l’âge d’or de sa jeunesse. L’expérience de la souffrance laisse une marque indélébile. Il faut apprendre à vivre avec la possibilité d’être atteint à tous moments par les caprices de la Fortune face à laquelle la raison est impuissante. Il n’y a pas de moyen, contrairement à ce que disent les stoïciens, d’être définitivement à l’abri des maux.
Le dernier état du texte
La souffrance fait partie de l’homme, de ce qu’il est, tel était l’enseignement de la version de 1580. Il faut l’accepter, car elle est le coût de la liberté, révèle le témoignage de Montaigne quant à son rapport à l’argent ; c’est pourquoi il ne reçoit qu’à moitié les conseils stoïciens dont il ne peut faire qu’une application lénitive et non « abstersive », comme ils le prétendent. Le sage stoïcien, censé être au dessus de la fragilité humaine, n’existe pas.
Dans les modifications de la fin du chapitre, Montaigne dénonce avec plus de précision les contradictions du stoïcisme qui nie ce qu’est l’homme, en réglant trop rapidement la question de la souffrance. Nous reprenons avec Gérard Defaux les hésitations et les changements qui se lisent dans les ajouts de l’exemplaire de Bordeaux :
[…] on parvient à deviner que Montaigne avait commencé par écrire : « Qui n’a le corage de mourir, qu’il essaye le corage de vivre » (qui n’essaye, qu’il aye) ; puis plus loin, après « qui n’a le ceur de souffrir ny la mort ny la vie » se déchiffre une question sous rature « [a] quoi est il bon ? », question d’autant plus angoissée qu’elle est aussitôt reprise […] qui ne veut ny resister ny fuir, à quoy est il bon46 ?
Cette question qui ne révélait qu’un sentiment profond d’impuissance de Montaigne est supprimée pour une nouvelle « que lui feroit on ? ». Celui qui est au comble du désespoir, que « pourrait-on lui préconiser » ? Montaigne sait déjà que les stoïciens lui diraient de se donner la mort, mais la définition du désespoir qu’il donne recoupe à la fois un profond mal-être et une envie de vivre malgré tout. Ainsi, en fin de chapitre, il reprend en quelque sorte la question de la souffrance au point de départ après avoir échoué une première fois à la résoudre. Que proposer à celui qui connaît une douleur extrême ? Montaigne n’a certainement pas trouvé de discours, d’imagination qui « fasse pour lui » dans la philosophie stoïcienne.
Cette dernière phrase constitue sans doute une allusion à un fragment d’Épictète qui, nous semble-t-il47, n’a jamais été repéré comme tel dans cet extrait. Sénèque le mentionne dans sa quatrième lettre à Lucilius, dont Montaigne cite un autre passage au début du chapitre. Cette lettre est entièrement consacrée à la crainte de la mort (c’est d’elle, on l’a vu précédemment, que Montaigne tire l’un des principaux arguments de la première partie : c’est parfois par lâcheté que les hommes courent à la mort, aussi est-il insensé de s’en effrayer). Sénèque, dans cette lettre, demande à Lucilius de se distinguer d’une bonne partie de l’humanité, dont il décrit l’attitude en ces termes : Plerique inter mortis metum et vitae tormenta miseri fluctuantur et vivere nolunt, mori nesciunt48. Chez Sénèque, comme chez Épictète à qui il reprend ces mots, ce comportement se caractérise par une absurdité intenable :
Si un homme meurt jeune, il en blâme les dieux, parce qu’on l’a fait mourir avant l’heure. Mais si cet homme, une fois vieux, ne meurt pas, il blâme encore les dieux, parce que, bien qu’il soit depuis longtemps pour lui le moment de se reposer, il reste dans l’inquiétude ; néanmoins, lorsque la mort est proche, il désire vivre ; il envoie chercher le médecin et l’implore de ne pas épargner sa peine. Les hommes sont fort étranges qui ne veulent ni vivre ni mourir49.
Épictète et Sénèque sont convaincus que la contradiction d’un tel exemple doit ramener à chacun à plus de sens et de cohérence. Seulement, dans leur confiance en la raison, il nie le caractère intrinsèquement fragile de la condition humaine. C’est avec ces mots que, dès 1580, Montaigne commence, pour ainsi dire, son chapitre : « Il y aurait un grand point gagné pour le soulagement de notre misérable condition humaine ». Épictète s’aveugle en comptant sur une puissance de la raison toute imaginaire : la raison nous convainc un temps que la mort soulage nos maux et un autre, qu’elle nous fait quitter une vie qui nous est, malgré tout, chère.
Dans ce dernier ajout, Montaigne montre avec acuité l’inanité de la pensée stoïcienne qui ne s’adresse pas à l’homme tel qu’il est, tel qu’il vit, c’est-à-dire balloté entre les tourments de la vie et la crainte de la mort. Un discours qui nie la « condition humaine » ne peut faire pour Montaigne.
Ainsi, si dans les marges de l’exemplaire de Bordeaux, il réaffirme à première vue la thèse stoïcienne, il faut sans doute entendre autrement qu’à la façon des stoïciens cette ressaisie de leur formule :
Chacun est bien ou mal selon qu’il s’en trouve. Non de qui on le croit, mais qui le croit de soi, est content. Et en cela seul la créance se donne essence et vérité. La fortune ne nous fait ni bien ni mal ; elle nous en offre seulement la matière et la semence, laquelle nostre ame, plus puissante qu’elle, tourne et applique comme il lui plait, seule cause et maîtresse de sa condition heureuse ou malheureuse50.
Cet ajout dans l’exemplaire de Bordeaux paraît accablant pour l’homme désespéré évoqué à la fin du chapitre. Le voilà, tout puissant et par conséquent pleinement responsable de son malheur. Pourtant, il nous semble falloir comprendre cet extrait avec les restrictions faites plus haut. « La créance se donne essence et vérité » ; cette phrase invite à lire autrement que dans la perspective stoïcienne, la maxime qui était initialement la leur. Dans la suite des réflexions sur le rapport à l’argent, l’accent est désormais mis sur la liberté de l’homme qui fait à la fois sa
grandeur et sa fragilité. Nous avons chacun la liberté de nous prononcer sur ce que nous sommes et par conséquent de nous créer, de nous achever selon ce que nous croyons bon d’être. Chacun est ce qu’il veut être. L’homme qui émane de ce chapitre n’est pas le sage tout-puissant qu’exalte Sénèque. Montaigne n’affirme pas la possibilité d’échapper à la souffrance qui fait partie de nous, mais de choisir ce qui est vraiment un malheur pour soi. Nous sommes responsables de notre condition heureuse ou malheureuse, en tant que nous la définissons en fonction de notre croyance, de notre intime conviction, qui émane d’une juste connaissance de soi et non de l’avis des autres. L’homme a la liberté de choisir ses valeurs, en fonction non de ce qu’il sait juste (sa raison ne lui permet de prétendre à aucun savoir), mais de ce qu’il croit juste.
Un autre ajout de l’exemplaire de Bordeaux, l’épisode emprunté à Plutarque et commenté avec précision par Dominique Bertrand permet de poursuivre la réflexion sur le rapport à l’argent, dont on a déjà vu le fonctionnement métaphorique. Feraulez se confie entièrement à son jeune ami ; en remettant ses biens, il lui remet aussi sa vie : « La fiance de la bonté d’autrui est un non léger témoignage de la bonté propre : partant Dieu la favorise volontiers51 ». Cette confiance en la bonté d’autrui trouve son origine dans la bonté propre de la personne qui imagine l’autre à son image. Il y a quelque chose de religieux dans cet abandon que Dieu ne peut qu’approuver. Mais néanmoins, dans cet exemple largement réécrit par Montaigne, il faut bien admettre que l’auteur des Essais se cherche des garanties : il circonscrit sa confiance à un arrangement réglé : « Heureux qui ait réglé à si juste mesure son besoin, que ses richesses y puissent suffire sans son soin et empêchement52 ». Cette conclusion peut paraître contradictoire avec l’idéal d’abandon exprimé juste avant. Montaigne paraît prendre des précautions face aux risques de la confiance, comme s’il hésitait entre le souhait de s’abandonner ou celui de se protéger. Cette tension entre le désir d’abandon et le souhait de régler soi-même son besoin se prolonge dans le chapitre « De la solitude ».
Abandon et « creance », ces deux notions semblaient un peu nous mener tout naturellement à la voie « fidéiste » qui est le pendant attendu du scepticisme de Montaigne. Sans savoir, mais juste en ayant la foi,
Montaigne se remettrait à la bonté de Dieu, dispensateur du temps qui lui reste, comme, jeune, il se remettait à la bonté des proches qui lui prêtaient de l’argent. Cette issue religieuse est évoquée dans « De la solitude » qui se situe dans la suite du chapitre « Que le goût des biens et des maux … », comme l’a déjà montré à juste titre Gérard Defaux53. Nous donnons seulement un extrait de l’ajout inscrit dans l’exemplaire de Bordeaux consacré au choix de la confiance en Dieu :
L’imagination de ceux qui par dévotion recherchent la solitude, remplissant leur courage de la certitude des promesses divines en l’autre vie, est bien plus sainement assortie [que la vie de ceux qui, par une « ridicule contradiction », se retirent du monde pour connaître la gloire littéraire]. […] Cette seule fin d’une autre vie heureusement immortelle, mérite loyalement que nous abandonnions les commodités et douceurs de cette vie nôtre. Et qui peut embraser son âme de l’ardeur d’une vive foi et espérance, réellement et constamment, il se bâtit en la solitude une vie voluptueuse et délicate au delà de toute autre forme de vie54.
Le discours du croyant est un discours, une « imagination » qui a une grande cohérence et une grande force aux yeux de Montaigne. Il fait pour « celui qui peut embraser son âme de l’ardeur d’une vive foi et espérance, réellement et constamment ». Montaigne ne signifie pas que c’est son choix. Dans une modification de l’exemplaire de Bordeaux encore, il évoque aussi la retraite recommandée par Sénèque :
Il est temps de nous dénouer de la société puisque nous n’y pouvons rien apporter. Et qui ne peut prêter, qu’il se défende d’emprunter. Nos forces nous faillent : retirons-les et resserrons en nous. Qui peut renverser et confondre en soi les offices de l’amitié et de la compagnie qu’il le fasse. En cette chute qui le
rend inutile, pesant et importun aux autres, qu’il se garde d’être importun à soi-même et pesant, et inutile. Qu’il se flatte et caresse et surtout se régente55.
Montaigne s’approprie l’idée de Sénèque et concilie le projet de retraite et sa nostalgie de l’amitié parfaite qu’il évoque indirectement dans le chapitre « Que le goût des biens et des maux… » Prêter et recevoir, donner de soi pour s’appuyer sur l’autre ; l’échange d’argent est confirmé comme une image de la relation à l’autre. Ce don comporte un risque que Montaigne a bien connu celui de perdre celui à qui on donne et qui donne en retour. Il s’en protège, en intériorisant cette relation d’amitié. Il ne s’abandonne cependant pas qu’à lui-même. Sénèque semble bien prendre sa part dans les « offices de l’amitié et de la compagnie » que Montaigne retrouve en lui-même.
La maxime stoïcienne que Montaigne s’est donnée pour titre ne passe pas l’épreuve de la souffrance et de la douleur. Cette imagination, opinion entre tant d’autres, ne fait pas pour lui et sans doute pour aucun homme. L’idée de s’abstraire de la douleur, de s’en libérer définitivement consiste à nier ce qu’est l’homme. Il n’y a pas de contradiction dans le désir contradictoire de ne vouloir ni souffrir, ni mourir. Il y a l’exercice difficile de la liberté qui comporte le risque de perdre ce qu’on mise et c’est toujours une partie de soi qu’on perd, qu’il s’agisse d’argent, d’amitié ou de santé.
Le sage stoïcien est par conséquent disqualifié, comme invention illusoire du stoïcisme. Sénèque, lui, n’est pas pour autant évincé. Si Montaigne rejette l’apport doctrinal, contenu dans les lettres, il n’est pas sourd aux conseils de Sénèque et continue d’être à l’écoute de ses avis. Dans l’édition de 1588 du chapitre « De la solitude », il condamne la « philosophie ostentatrice et parlière » de Pline et Cicéron et loue la « philosophie vraie et naïve » d’Épicure et Sénèque. Il ne me semble pas du tout anodin que les deux œuvres qui trouvent grâce aux yeux de Montaigne soient des lettres. Elles délivrent par conséquent une parole incarnée, parce qu’elle est soucieuse de son destinataire et de ses effets sur lui. En d’autres mots, la parole de Sénèque est sauvée comme parole d’ami, mais en aucun cas comme parole de philosophe56.
Montaigne reprend alors à son compte et dans une toute autre perspective les préceptes stoïciens. Il les asservit à une seule fin « bien vivre et se réjouir ». Il s’agit alors de jouir et de souffrir en homme libre, plutôt que de vouloir échapper à sa condition. Il est hors de question de nier sa nature en prétendant dépasser la crainte de la mort et de surmonter les assauts de la douleur. Si notre liberté nous permet de nous prononcer sur ce qu’est un bien ou un mal et d’être ce que nous voulons être, elle ne nous permet en aucun cas d’échapper à la souffrance. Il faut seulement apprendre à vivre le mieux possible avec. La voie d’acceptation souriante ouverte par la paraphrase des Nouvelles récréations trouve des prolongements jusque dans le dernier chapitre du livre III qui use lui aussi des vertus divertissantes des illusions engendrées par le langage qui peuvent faire de la mort ou de la gravelle un bien. On y lit plus explicitement la condamnation des prétentions du sage stoïcien qui voulant s’élever au-dessus de la condition humaine prend le risque de n’en être plus digne, on y lit encore qu’il faut accepter de souffrir :
Il faut apprendre à souffrir ce qu’on ne peut éviter. Notre vie est composée, comme l’harmonie du monde, de choses contraires, aussi de divers tons, doux et âpres, aigus et plats, mols et graves. Le musicien qui n’en aimerait que les uns, que voudrait il dire ? Il faut qu’il s’en sache servir en commun : et les mêler. Et nous aussi les biens et les maux, qui sont consubstantiels à notre vie. Notre être ne peut sans ce mélange57.
Montaigne chahute à son tour le vieil homme qui refuse de vieillir et de mourir et s’en moque un peu. Mais Montaigne le fait sans le mépris stoïcien qui condamne avec hauteur les incohérences du plus grand nombre :
Voyez un vieillard qui demande à Dieu qu’il lui maintienne sa santé entière et vigoureuse. C’est à dire qu’il se remette en sa jeunesse,
Stulte quid haec frustra votis puerilibus optas :
N’est ce pas folie ? Sa condition ne le porte pas. Mon bonhomme, c’est fait : on ne saurait vous redresser : on vous plâtera58.
Il ne donne pas de préceptes et ne fait pas confiance en la toute puissance de la raison. Il rit seulement de ses propres contradictions pour s’affranchir un peu de ses peurs. Il accepte sa fragilité pour pouvoir jouir de son être.
Blandine Perona
Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
1 « D’une utopie hospitalière chez Montaigne : Feraulès et son fidèle ami », dans Mythes et représentations de l’hospitalité, études rassemblées par Alain Montandon, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 1999, p. 125-137.
2 Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1982, p. 148-152.
3 La lecture proposée par Dominique Bertrand de l’anecdote du don de Féraulès au jeune Sace, empruntée à Xénophon, apporte, par une étude fine des déplacements opérés par Montaigne, une démonstration concrète d’une analyse plus abstraite et conceptuelle de Starobinski.
4 « “Nul n’est mal long temps qu’à sa faulte” : Montaigne, La Boétie, Les Essais », Montaigne Studies, La Boétie, volume XI, octobre 1999, p. 169-196.
5 André Tournon, La Glose et l’essai, édition revue et corrigée, précédée d’un réexamen, Paris, Champion, 2000, p. 223. Cette analyse du chapitre I, 14 a été proposée lors d’une journée d’agrégation en janvier 2011, et s’appuie donc sur l’édition de référence donnée pour ce concours : Essais, I, Folio-Gallimard, 2009.
6 Montaigne, Essais, reproduction photographique de l’édition originale de 1580 avec une introduction et des notes sur les modifications apportées, par Daniel Martin, Genève, Slatkine, 1976, p. 53 (paginé 35 par erreur). Pour permettre aux agrégatifs de suivre plus facilement notre propos, nous donnons également la page correspondante dans l’édition de référence au concours (Montaigne, Essais I, édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig et Alexandre Tarrête, Paris, Gallimard, 2009) : p. 177-178.
7 Montaigne, Essais (1582), texte présenté par Philippe Desan, Paris, Société des Textes Français Modernes, 2005, p. 33. En gras, nous indiquons les mots qu’a ajoutés Montaigne en 1582 et l’étoile indique la suppression de la négation « ne » présente en 1580.
8 Nous faisons cette remarque pour indiquer que notre lecture diffère de celle de Villey et des éditeurs du texte au programme de l’agrégation cette année. Dans la version de 1588, la modification que fait subir Montaigne à cette phrase ne change pas selon nous la nature de la troisième occurrence de « si » qui n’est pas « adverbe », mais reste un subordonnant. Que la fortune fournit une matière à modeler reste une hypothèse à évaluer dans le texte de 1588.
9 Dans le passage d’où est tirée la sentence, Épictète donne lui aussi l’exemple de la mort. Nous citons le début du fragment : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n’a rien de redoutable, car, alors, elle serait apparue comme telle à Socrate. Mais c’est le jugement que nous portons sur la mort, à savoir qu’elle est redoutable, c’est cela qui est redoutable dans la mort ». (Arrien, Manuel d’Épictète, introduction, traduction et notes par Pierre Hadot, Paris, Livre de Poche, 2000, p. 167).
10 Édition de 1580, p. 55 (édition de référence, p. 178).
11 Ibid., p. 62 (édition de référence, p. 184).
12 Le premier livre répond à la question : « La mort est-elle un mal ? » ; le deuxième à cette autre interrogation : « La douleur est-elle le plus grand des maux ? »
13 En effet, dans le développement consacré à la crainte de la mort, la démonstration de Montaigne est différente de celle de Cicéron qui procède en deux temps montrant qu’il ne faut pas avoir peur de la mort, que l’âme soit immortelle ou non.
14 Les Tusculanes, texte établi par G. Fohlen et traduit par J. Humbert, Paris, Belles Lettres, 1970, II, 25, 61, p. 112.
15 Édition de 1580, p. 63 (édition de référence, p. 184).
16 Ibid.
17 Tusculanes, II, vi, 15, p. 14.
18 Édition 1580, p. 65 (édition de référence, p. 185).
19 Ibid.
20 Édition 1580, p. 66. Édition de référence, p. 186-187. Montaigne ajoute en effet dans l’exemplaire de Bordeaux la citation latine « Si gravis brevis, si longus levis » qu’il a seulement traduite en 1580 et qu’il emprunte au De finibus.
21 Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, introduction, traduction et commentaires par Pierre Pellegrin, Paris, Seuil, 1997, Introduction, p. 43.
22 Lettres à Lucilius, texte établi par François Préchac et traduit par Henri Noblot, Paris, Belles lettres, 1989, Lettre 70, 22, p. 15.
23 Édition 1580, p. 55.
24 Ce travail d’actualisation de la parole de Sénèque se poursuit dans les ajouts du manuscrit de Bordeaux, où Montaigne cite également les œuvres de Jérôme Osorio.
25 « Pour un qui a sentiment de sa faute au partir de ce monde, et en demande pardon à Dieu, on en voit dix qui meurent n’ayans d’appréhension ni de sa justice, ni de sa miséricorde, que bestes brutes », Apologie pour Hérodote : satire de la société au xvie siècle, nouvelle édition faite sur la première et augmentée de remarques par P. Ristelhuber, Genève, Slatkine, 1969, p. 251-252. Montaigne emprunte cette série de bons mots au quinzième chapitre, « Des larrecins de nostre temps ».
26 Montaigne reprend la totalité du passage concernant le « plaisantin » : « On lui avoit mis son lict au long du feu, sus le plastre du foyer, pour estre plus chaudement : Et quand on lui demandoit, “Or ça mon amy ou vous tient il ?” Il respondoit tout foiblement, n’ayant plus que le cueur et la langue, “il me tient, dit il, entre le banc et le feu”, qui estoit à dire qu’il se portoit mal de toute la personne » (Nouvelles récréations et joyeux devis, édition critique par Krystina Kasprzyk, Paris, Champion, 1980, p. 18). Montaigne dans ce premier temps de l’épisode ôte le passage didactique qui explicite la plaisanterie et laisse à son lecteur le soin de la comprendre et de l’apprécier. Le moment de l’extrême onction est de la même façon largement repris par Montaigne : le plaisantin indique en effet que le prêtre trouvera ses pieds au bout de ses jambes et termine ainsi la conversation quand on lui demande de se recommander à Dieu : « Et bien disoit il, mais que j’y soys, je feray mes recommandacions moy mesmes » (ibid., p. 19).
27 Nouvelles récréations et…, p. 14.
28 Ibid.
29 Édition 1580, p. 60 (édition de référence, p. 183). Sénèque pose le problème en ces termes : Non putas virtutem hoc effecturam, quod efficit nimia formido ? (« Penses-tu que la vertu n’accomplira pas ce qu’accomplit l’excès de peur ? », Lettres à Lucilius, Lettre 4, 4, p. 11).
30 Édition 1580, p. 67 (édition de référence, p. 188). Chez Sénèque déjà, l’image de l’effondrement s’oppose à celle de la résistance : Istud quod premit, quod impendet, quod urguet, si subducere te coeperis, sequetur et gravius incumbet : si contra steteris et obniti volueris, repelletur (« Cette masse avance, menace ruine, pèse sur toi : si tu te dérobes, elles suivra et fera pression plus lourdement ; mais si tu tiens ferme, si tu es décidé à la résistance, tu la refouleras », Lettres à Lucilius, Lettre 78, 15, p. 76).
31 Édition 1580, p. 70 : « Quoy celuy qui ne d’aigna interrompre la lecture de son livre pendant qu’on l’incisoit. Et celluy, qui s’obstina à se mocquer et à rire a l’envy des maux, qu’on lui faisoit, de façon que la cruauté irritée des bourreaux qui le tenaient en mai, et toutes les inventions des tourmens redoublés les uns sur les autres luy donarent gaigné ». Chez Sénèque : Ille, qui cum varices exsecandas praeberet, legere librum perseveravit ; ille, qui non desiit ridere, cum hoc ipsum irati tortores omnia instrumenta crudelitatis suae experirentur : non vincetur dolor ratione, qui victus est risu ? (Lettre 78, 18, p. 77). Marius dont on opère les varices est mentionné deux fois déjà dans les Tusculanes (II, 35, p. 34 et II, 53, p. 96). Montaigne s’inspire aussi de la lettre 76 (Lettre 76, 20, p. 61). Une autre série d’exemples s’y trouve ; Sénèque y évoque Mucius Scévola, de nouveau, l’esclave meurtrier d’Hasdrubal (gendre d’Hamilcar) qui rit sous la torture ou encore Démocrite qui jette ses richesses à l’eau (cas que Montaigne évoque plus tard).
32 « Pour le voluptueux, c’est une punition que de vivre frugalement ; le paresseux voit dans le travail un supplice ; l’homme de plaisir prend en pitié l’homme de labeur ; l’étude met un fainéant à la torture ; de même, ces épreuves en face desquelles nous sommes tous sans force, nous les imaginons rudes, intolérables, sans nous rappeler le nombre de ceux qui regardent comme un tourment d’être privés de vin ou de se lever à la pointe du jour. Ces épreuves ne sont pas rebutantes de leur nature ; c’est nous qui sommes mous et énervés. Il faut juger avec grande âme des grandes choses ; autrement, nous nous figurerons voir en elles le vice qui est en nous. Ainsi, tel objet parfaitement droit produit, plongé dans l’eau, l’illusion visuelle d’une ligne courbe et brisée. Ce que nous voyons n’est pas la seule chose qui importe ; il y a la façon dont nous le voyons » (Lettre 71, 23-24, p. 24-25).
33 Édition de 1580, p. 73-74 (édition de référence, p. 201).
34 Dans ce cas, « que est l’équivalent d’une préposition suivie de quoi en fonction de circonstant (pourquoi) ». (Sabine Lardon et Marie-Claire Thomine, Grammaire du français de la Renaissance, étude morphosyntaxique, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2009, 12, p. 155).
35 Édition de 1580, p. 74 (édition de référence, p. 202).
36 Édition de 1580, p. 74-75 (édition de référence, p. 202).
37 Essais, reproduction en fac-similé de l’Exemplaire de Bordeaux 1588 annoté de la main de Montaigne, édition établie par René Bernoulli avec une préface de Claude Pichois, Genève, Slatkine, 1987, t. 1, pl. 49 (édition de référence, p. 193-194).
38 Édition de référence, p. 498.
39 Édition de 1588, pl. 49 (édition de référence, p. 195).
40 Édition de 1588, pl. 50 (édition de référence, p. 196). Sur la conception sceptique de la Fortune très présente aussi à la fin du chapitre « De l’incertitude de notre jugement », on peut lire en particulier les pages 159 à 161 du livre de Sylvia Giocanti : « les sceptiques qui se réfèrent à la Fortune avouent leur ignorance, l’incapacité de la raison à savoir dans telle ou telle circonstance, s’il y a un ordre caché ou du désordre, si l’on a affaire à la Providence ou au hasard. […] le concept de Fortune est plus sceptique que celui de hasard. Il serait bien hasardeux (présomptueux) et dogmatique pour un sceptique d’affirmer la toute puissance du hasard » (Penser l’irrésolution – Montaigne, Pascal, La Mothe le Vayer, trois itinéraires sceptiques, Paris, Champion, 2001).
41 Édition de 1588, pl. 51.
42 Édition de 1588, pl. 52.
43 Le dictionnaire Huguet montre qu’au seizième siècle, temerité a toujours son sens étymologique. Temeritas en latin signifie « hasard aveugle, absence de calcul », « caractère irréfléchi ». Montaigne dans les caprices de Fortune lit surtout l’aveuglement des hommes.
44 Édition de 1588, pl. 52.
45 On peut remarquer aussi que les coups et les caprices de la fortune ne se font pas toujours aux dépens de l’homme. C’est un caprice heureux qui fait passer Montaigne du deuxième au troisième état. Ce changement relève pour lui d’un mystère : « Je ne say quelle bonne fortune m’en jetta hors tres-utilement » (Édition de 1588, pl. 52). Montaigne semble ignorer comment il se défit de l’opinion selon laquelle l’épargne est indispensable pour une autre opinion. Il ne doit pas ce changement à son scepticisme, mais à l’inconstance qui fait changer souvent un attachement opiniâtre pour un autre. Dans l’exemplaire de Bordeaux, la « bonne fortune » devient « bon démon » ; cela reste par conséquent une transformation qui échappe complètement à l’entendement de Montaigne.
46 « Nul n’est mal long temps qu’à sa faulte… », art. cité, p. 192.
47 Villey, tout en voyant l’influence de Sénèque dans ce passage, ne donne pas de références précises pour cette phrase.
48 « L’humanité en général flotte misérablement entre la crainte de la mort et les afflictions de la vie : ils répugnent à vivre et ne savent pas mourir » (Lettre 4, 5, p. 11).
49 Nous avons traduit le fragment 24 à partir de l’édition anglaise de W. A. Oldfather : If a man dies young, he blames the gods because he is carried off before his time. But if a man fails to die when he is old, he too blames the gods, because, when it was long since time for him to rest, he has trouble ; yet none the less, when death draws nigh, he wishes to live, and sends for the doctor, and implores him to spare no zeal and pain. People are very strange, he used to say, wishing neither to live nor to die (Epictetus, The discourses as reported by Arrian, the Manual, and Fragments, with an english translation by W. A. Oldfather, Volume II, [Discourses, books III and IV, the manual and fragments], Cambridge, Mass., Harvard university press – London, W. Heinemann, 1928, p. 469).
50 Édition de référence, p. 200-201.
51 Édition de référence, p. 200.
52 Ibid.
53 Il montre en particulier de quelle façon la citation de l’Institution oratoire permet d’articuler I, 14 et I, 39 : « L’allusion que, dans son “Prohemium”, Quintilien fait au “jugement des sages”, de ces sages qui pensent que, “dans l’épreuve, les lettres sont la seule consolation”, a provoqué dans son esprit un rapprochement, une association d’idées à vrai dire inévitable avec I, 39 et I, 40. Car non seulement ce couple de chapitre est lui aussi très personnels, mais il rappelle étrangement, par son esprit et par les thèmes qu’il traite, l’essai I, 14 » (« Nul n’est mal longtemps qu’à sa faute… », art. cité, p. 193-194). I, 14 et I, 39 sont tous deux une méditation des lettres de Sénèque. Dans l’édition de référence, la page 448 est aussi très révélatrice des liens entre ces deux chapitres. Montaigne y reprend une série d’exemples traités dans I, 14 : entre autres, Démocrite qui se crève les yeux et Aristippe qui jette ses écus à la mer.
54 Édition de référence, p. 451.
55 Édition de référence, p. 447.
56 C’est une des conclusions que nous tirions d’une précédente étude : « “Que philosopher c’est apprendre à mourir” – Un exercice de réception » dans Le Nouveau Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, no 5, Premier semestre 2009, p. 7-32. Les analyses de cet article ont été partiellement reprises dans Blandine Perona, Prosopopée et persona à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 276-286.
57 Essais III, édition de référence, p. 441.
58 Essais III, p. 440 (nous donnons le texte sans l’ajout qui y est inséré dans l’Exemplaire de Bordeaux et donc tel qu’il apparaissait dans l’édition de 1588).