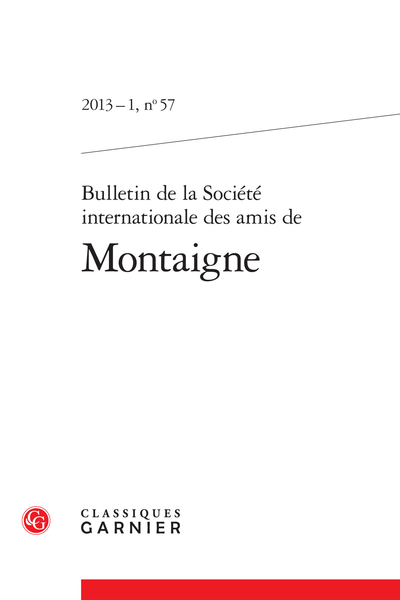
Puissances et faiblesses de l’opinion commune chez Montaigne
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2013 – 1, n° 57. varia - Author: Berns (Thomas)
- Pages: 23 to 38
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812420368
- ISBN: 978-2-8124-2036-8
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-2036-8.p.0023
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-16-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Puissances et faiblesses
de l’opinion commune
chez Montaigne
« Opinion » est employé plus de 300 fois, par Montaigne dans les Essais, souvent dans son sens traditionnel de Doxa ou d’opinio, d’idée sans fondement, ou d’idée fondée sur la seule vraisemblance, conjecture, croyance, etc. Ainsi, on trouve des expressions comme « Non par opinion mais en verité… » (Essais, III, 9, p. 9341). L’opinion est très classiquement opposée à la réalité des choses : « les hommes […] sont tourmentez par les opinions qu’ils ont des choses, non par les choses mesmes » (Essais, I, 14, p. 49). À première vue, on s’en doute, la particularité de Montaigne ne résiderait pas tant dans sa définition de l’opinion, que dans le peu de marge qu’il laisse à tout jugement d’être autre chose que de l’opinion.
Cependant, on doit noter que l’idée d’opinion, en croisant celles de « coutume » et de « renommée », renvoie de façon assez régulière à quelque chose de collectif : ainsi, il semblerait que Montaigne est un des premiers à proposer en français l’expression d’opinion publique, et on trouve très fréquemment dans son texte des expressions comme opinion commune, mais aussi opinion vulgaire, opinion du peuple, ou encore, dans un registre proche : voix du peuple, voix commune…
J’entends proposer ici une « trajectoire » cohérente sur la question de l’opinion, en suivant les remarques multiples développées par Montaigne à son sujet, et en les confrontant à la toile de fond que serait le constat de la présence, tout au long de la pensée politique, de considérations sur une réflexivité du commun, sur un regard du commun sur lui-même, même si ce regard ne donne lieu qu’à un jugement relevant du vraisemblable, et ce, plus particulièrement pour ce qui concerne les questions de moralité, et donc nécessairement de moralité collective. Ce qui m’intéresse
est donc l’histoire, souterraine, de la prise en considération de la capacité du commun, dont l’opinion est ni plus ni moins que la voix, à se contrôler lui-même, à intégrer ou même à développer ses propres normes, et ce par opposition à la prise en considération de l’action extérieure, verticale, momentanée, exceptionnelle, mais pleinement légitime de la loi, c’est-à-dire par opposition à la relation d’autorité, qui serait l’objet privilégié du questionnement philosophique : cette relation privilégiée de la philosophie à la loi (et plus généralement, une certaine congruence entre l’ordre philosophique et l’ordre juridique) éclaire ou répète le fait que l’opinion n’est pas la matière de la philosophie. Bref, il s’agit de répéter l’opposition traditionnelle de la philosophie entre opinion versus vérité, en la croisant avec celle qui mettrait aux prises le contrôle versus la loi, mais en se donnant la possibilité, par la sensibilité nominaliste, voire empiriste, de Montaigne, de ne pas donner à ces oppositions une quelconque teneur normative.
Si la renommée ou la gloire ont fréquemment été évoquées positivement, surtout dans la longue tradition républicaine et en particulier dans la tradition humaniste de la Renaissance, l’opinion commune, qui pourtant les meut, reste étrangement absente, voire décriée. Nous verrons, en nous reportant à un texte cité par Montaigne, que même Platon ne nie pas l’importance du rôle de l’opinion commune, mais uniquement quand il s’agit de veiller au contrôle de la moralité collective. Non seulement l’opinion commune serait un outil adéquat, mais elle serait même le seul outil adéquat au vu de l’impuissance de la loi face à un certain type de problèmes liés à la moralité collective. Les balises les plus nettes qui nous permettent d’appréhender cette histoire longue mais souterraine2 de l’opinion commune sont, premièrement, la figure antique du censeur, dont le regard « intégré » fait seulement rougir3 et permet ainsi de contrôler même ce qui échappe à la loi4 ; deuxièmement, l’idée d’opinion publique, telle qu’elle se forge aux xviie-xviiie siècles,
mais en supposant toutefois une prise de distance critique radicale par rapport à l’opinion commune ou opinion du peuple. Ces deux modèles majeurs (entre lesquels il convient de glisser certaines considérations plus isolées, comme celles de Locke que nous reprenons plus loin) confirment toutefois la difficulté d’une approche à la fois philosophique et « positive » de l’opinion commune, c’est-à-dire d’une approche de l’opinion commune pour elle-même, pour le jugement qu’elle produit, puisqu’ils supposent, dans un cas la médiation d’une institution, le censeur, fût-il là pour seulement donner un nom au regard que le commun porte sur lui-même, et dans l’autre cas celle d’une prise de distance critique.
Dans cette histoire souterraine, la place de Montaigne apparaîtra alors comme tout à fait surprenante. De même qu’il ne cesse d’affirmer à la fois la force et la vanité du souci de la renommée, on remarquera d’une part qu’il objective fortement l’idée d’opinion commune, en développant de véritables analyses de la question de l’opinion, en envisageant cette question en relation étroite avec celle du commun et peut-être même celle de la communauté politique (dont on sait qu’elle ne se fonde pas dans la justice) ; d’autre part qu’il dénie le peu de réflexivité attribué auparavant, même si de manière sporadique, au commun. Donc à la fois l’opinion commune acquiert une véritable consistance, mais en même temps elle se révèle essentiellement passive. Je vais parcourir les différentes considérations de Montaigne sur l’opinion commune, sans chercher à les harmoniser ou à dépasser les tensions dont elles témoigneront entre elles, mais en tentant de dessiner quelques lignes de cohérence dont résulteront une philosophie de l’opinion.
Négativité de l’opinion commune
Avant tout, l’opinion commune se définit très banalement de manière négative, comme n’étant pas « juger librement des choses » (Essais, I, 23, p. 117), comme n’étant pas « l’ordre du cours de nature » (Essais, I, 27, p. 179). Elle se mêle intimement à la coutume dont on croit
« desraisonnablement » qu’elle est la raison, car elle forge les « loix de la conscience » (Essais, I, 23, p. 114). La question des cannibales ou des barbares doit être jugée « par la voye de la raison, non par la voix commune » ou en s’attachant « aux opinions vulgaires » (Essais, I, 31, p. 200)5. Ou encore, juger par « la voix du peuple » (au même titre que « par la race, les richesses, la doctrine ») s’oppose à « juger par justice, et […] par raison », et est considéré comme hasardeux et comme ne permettant pas d’établir « une parfaite forme de police » (Essais, III, 8, p. 911). À première vue, nous ne serions donc pas loin du projet cartésien d’une politique de la raison, qui se méfie plus de l’opinion que de l’erreur. Cependant, et ce projet ne peut dès lors que s’effriter, toutes les lois semblent se réduire à « cette mer flotante des opinions d’un peuple ou d’un prince » et appartiennent dès lors au registre changeant de la « passion » (Essais, II, 12, p. 563) : comme annoncé, si le registre de l’opinion se définit donc négativement, il semble néanmoins difficile de lui échapper.
Vanité de l’opinion commune
L’opinion commune doit aussi s’entendre comme réputation, comme renommée, comme fama. Au moins trois chapitres sont consacrés explicitement à la vanité qu’il y a de régler sa vie et ses actions sur la renommée ou sur le souci de l’opinion commune, trois essais qui s’élaborent selon un même mouvement, et sur la base d’une même source.
De ne communiquer sa gloire (Essais, I, 41) définit « le soing de la reputation et de la gloire » comme la « plus universelle » des « resveries du monde », qui nous fait oublier « les richesses, le repos, la vie et la santé,
qui sont biens effectuels et substantiaux, pour suyvre cette vaine image et cette simple voix qui n’a ny corps ny prise » (p. 248) : l’opposition qui se dessine ici permettrait d’écarter le souci de l’opinion commune, au nom du caractère absolument vide de cette dernière, et ce au profit de biens effectivement plus substantiels. La gloire ou la renommée ne sont qu’une « voix », c’est-à-dire un mot, vox étant le terme communément employé par exemple dans le cadre de la querelle des universaux pour désigner les mots, qui comme les genres, les espèces ou les noms, sont des entités purement mentales.
Dans De la vanité (Essais, III, 9), Montaigne affirme que « vivre par la relation à autruy, nous faict beaucoup plus de mal que de bien. Nous nous defraudons [trompons, frustrons] de nos propres utilitez pour former les apparences à l’opinion commune. Il ne nous chaut pas tant quel soit nostre estre en nous et en effaict, comme quel il soit en la cognoissance publique » (p. 932). La « cognoissance publique », vis-à-vis de laquelle on ne peut entretenir qu’une relation d’apparence, s’oppose cette fois à la réalité de « nostre estre », une réalité qui supposerait au contraire un retour en nous.
Surtout, dans De la gloire (Essais, II, 16, p. 601), Montaigne poursuit et développe cette opposition entre le vide de l’opinion commune et la réalité de notre être propre : il dit suivre les philosophes cyniques en affirmant son « mespris de la gloire » et des « voluptez » liées à « l’approbation d’autruy » : la gloire ne justifie « pour elle seule » pas la moindre action. Et au même titre que la réalité de l’être réclamait plus haut un retour vers le soi, le souci du regard d’autrui doit être écarté dans la mesure où il serait en tant que tel l’objet du souci. Cependant, nuance Montaigne, en recréant ainsi de l’extériorité, la gloire « tire souvent à sa suite plusieurs commoditez pour lesquelles elle se peut rendre desirable » (p. 602) ; si on ne peut la désirer pour elle-même, elle n’en est pas moins désirable. Il ne faut, comme le conseille Epicure « regler aucunement ses actions par l’opinion ou reputation commune, si ce n’est pour éviter les autres incommoditez accidentales que le mespris des hommes luy pourroit apporter » (p. 603). Outre le fait que le souci de la gloire signifierait logiquement qu’il ne « faudroit estre vertueux qu’en public » (p. 604), il s’agit surtout d’un but bien trop hasardeux, « car qu’est-il plus fortuite que la reputation ». Seule la fortune peut décider « que les actions soient connuës et veuës » (p. 605). C’est « une fin si flotante et vagabonde »
(p. 608). Ensuite, « la vanité des jugemens humains » ne peut servir de « loyer » pour « les actions de la vertu » (p. 612).
Mais ce n’est pas là seulement pour Montaigne une question pratique (le caractère aléatoire du regard de l’opinion commune), ni une question morale (la juste mesure de la vertu) : à un niveau plus ontologique, « agrandir nostre nom » (p. 609) ne se conçoit pas, parce que, nous dit Montaigne « je n’ay point de nom qui soit assez mien » (p. 610). Le chapitre débute par ces mots : « Il y a le nom et la chose ; le nom, c’est une voix qui remerque et signifie la chose ; le nom, ce n’est pas une partie de la chose ny de la substance, c’est une piece estrangere joincte à la chose, et hors d’elle » (p. 601)6.
La source des considérations de Montaigne sur la gloire et sur le nom est évidemment La Théologie naturelle de Raymond Sebon, qu’il « déthéologise » cependant sans scrupule pour s’en servir dans une perspective strictement nominaliste : chez Sebon (chap. 189-199), seul Dieu, comme premier principe, mérite la gloire. Alors que l’homme, vu son imperfection, ne peut augmenter qu’au dedans et doit chercher cette augmentation, Dieu, comme perfection, ne peut augmenter qu’au dehors. Et la gloire, ou l’agrandissement du nom, pour reprendre les mots de Montaigne, n’entrent pas au dedans de la chose ; il s’agit seulement d’un accident extérieur aux choses, puisque l’homme peut faire croître Dieu, extérieurement, par ses louanges et opinions. Glorifier Dieu est une obligation pour l’homme (il y a une sorte d’échange entre l’agrandissement extérieur de Dieu et l’agrandissement intérieur de l’homme), tandis que chercher la gloire est à la fois une inanité (elle est qualifiée de « vide », etc.) et une offense à Dieu.
Ce qui subsiste de ce raisonnement théologique chez Montaigne est le fait que le souci de la renommée publique, la recherche de la « gloire pour elle seule » nous enferme dans le registre déraciné de la « simple voix », de la « vaine image », de la « piece estrangere »… un registre purement mental, ou verbal, langagier qui débouchera en d’autres lieux, c’est-à-dire dans la critique par Montaigne de la glose juridique7,
sur ce qu’il considère comme un pur « entregloser » sans fin, sur une « contestation » purement « verbale » (Essais, III, 13, p. 1045-1046), un « entregloser » aussi vain et infini que dangereux (derrière lequel se profile le spectre de la guerre civile), auquel Montaigne répond frontalement en nous enjoignant d’« effacer la trace de cette diversité innumérable d’opinions, non poinct s’en parer et en entester la posterité » (Essais, III, 13, p. 1044, nous soulignons).
Positivité et simplicité des intuitions communes
Cependant, on sait que quand Montaigne critique un questionnement qui ne serait que « de parolle », ou encore cet échange d’ « un mot pour un autre mot », cette critique qui se situe dans une perspective clairement nominaliste s’accompagne non seulement de l’exigence d’une nécessaire « économie » de concept (le rasoir d’Ockham) mais aussi d’une certaine conviction « intuitionniste ». Les explications les plus simples reproduisent le mieux le cours des choses : « je sçay mieux que c’est qu’homme que je ne sçay que c’est animal, ou mortel, ou raisonnable » (Essais, III, 13, p. 1046). Parallèlement, si l’opinion commune, élevée au rang de finalité suffisante par le souci de la renommée, nous fait errer dans un vide hasardeux, elle n’est donc pas pour autant dépourvue de toute vérité ou de tout ordre : « les meurs et les propos des paysans, je les trouve communéement plus ordonnez selon la prescription de la vraie philosophie, que ne sont ceux de nos philosophes » (Essais, II, 17, p. 644). Montaigne entend lui-même suivre « le langage commun, qui faict difference entre les choses utiles et les honnestes » (Essais, III, 1, p. 774) ; le langage commun (que Montaigne ne cesse d’opposer par exemple au langage du droit) ne se trompe pas quant à la réalité de cette distinction, même s’il est par ailleurs impossible pour Montaigne de définir en quoi elle consiste. Le « premier passant », quelqu’un d’élu « le jour du marché » pourrait même bien être le meilleur juge (Essais, III, 13, p. 1043), parce que justement il échapperait à tout « entreglosage ». Parallèlement à la critique du « vide » de l’opinion commune, il y a donc aussi une confiance de Montaigne dans la simplicité du « commun ».
D’autre part, pour poursuivre dans le sens d’une réhabilitation de l’opinion commune, si la gloire « pour elle seule » ne peut justifier aucune action, elle n’est pas pour autant, comme on l’a vu, dépourvue de « commoditez », ou encore, elle permet d’éviter des « incommoditez accidentales » produites par le mépris des hommes. Le vide absolu d’une pure « voix » apparaît lui-même comme évidemment inconcevable ou simplement théorique : une extériorité est toujours produite, d’où l’épaisseur politique qui découle de ce point de départ théorique portant sur le refus d’un discours, d’une verbalité qui seraient entièrement tournés vers eux-mêmes : des commodités comme des dangers peuvent en découler.
Éloge de l’illusion
Avant tout, l’illusion de l’opinion commune s’affirme comme telle dans ce qu’elle peut avoir d’utile pour l’ordre public. Ainsi, le chapitre sur la gloire se termine en montrant que « cette fauce opinion sert au public à contenir les hommes en leur devoir » (Essais, II, 16, p. 612) ; et nous assistons dès lors au retour du raisonnement antique sur la bonne réputation : « Platon, employant toutes choses à rendre ses citoyens vertueus, leur conseille aussi de ne mespriser la bonne reputation et estimation des peuples ; et dict que, par quelque divine inspiration, il advient que les meschans mesmes sçavent souvent, tant de parole que d’opinion, justement distinguer les bons des mauvais » (Essais, II, 16, p. 613)8.
L’ambiguïté reste forte : y a-t-il là une capacité naturelle à distinguer les bons des mauvais, et à créer dès lors une juste opinion commune ? La suite du texte fait plutôt de Platon un « forgeur de miracle », et surtout, Montaigne passe sans transition à l’affirmation que « la bonne monnoye » est insuffisante et doit toujours être complétée par « la fauce », dont les exemples sont les « origines et commencemens fabuleux », les « mysteres supernaturels », la « vanité ceremonieuse », ou encore l’« opinion mensongere » qui offrent la « bride » permettant de « tenir le peuple en office » (Essais, II, 16, p. 612). La métaphore de la
fausse monnaie est évidemment particulièrement efficace : il ne peut s’agir d’une fraude apparente, mais seulement d’une « vraie » illusion ; il n’y a de fausse monnaie que quand on la prend pour de la vraie, que dans la mesure où rien ne la distingue de la vraie ! L’opinion commune s’affirme ainsi très précisément comme relevant de l’ordre du purement vraisemblable, c’est-à-dire de ce qui pourrait à juste titre sembler vrai, de ce qui fonctionne comme tel9.
C’est au travers d’un renvoi comparable à Platon10, que surgit dans Essais, I, 23, la première utilisation de l’expression d’opinion publique, et ce immédiatement, et ce ne peut être un hasard, après avoir fait remarquer que lorsqu’on se penche sur l’origine d’une coutume, on lui découvre un fondement si faible qu’on ne peut qu’en être dégoûté : or « c’est cette recepte, de quoy Platon entreprend de chasser les amours desnaturées de son temps, qu’il estime souveraine et principale : assavoir que l’opinion publique les condamne » (p. 115). Malgré et avec son absence de fondement, que démontre la ténuité de l’origine de toute coutume, l’opinion commune, devenue publique dans la mesure où elle est considérée comme agissante, offre des recettes efficaces et même souveraines.
Être ou vraisemblance de ce dont l’origine s’oublie
Paradoxalement, l’objectivation de l’opinion commune entendue dans son sens collectif est produite par Montaigne à travers l’aveu ou la reconnaissance, toujours par Montaigne, de sa « fauceté », de son absence de tout fondement : l’opinion commune est précisément et seulement ce qui semble vrai. Et une telle reconnaissance de la « fauceté » de l’opinion, s’exprime positivement par le biais d’une mise en retrait, voire d’un effacement, de la question de son origine.
Le fait que « les loix prennent leur authorité de la possession et de l’usage » signifie pour Montaigne qu’il est dès lors « dangereux de les ramener à leur naissance », qui n’est « qu’un petit surjon d’eau à peine reconnoissable ». Dès lors, ceux qui « poisent tout et le ramenent à la raison » et qui donc affrontent cette naissance dépourvue de toute possible reconnaissance, « ont leurs jugements souvent très-esloignez des jugemens publiques » et « gauchissent la voye commune » (Essais, II, 12, p. 567). Si l’opposition de l’opinion, ou de la « voye commune », et de la raison reste frontale, c’est la seconde qui est accusée de gauchir la première, lorsqu’elle s’empare d’une naissance qui ne peut, en tant que telle et à proprement parler, produire aucune reconnaissance.
On assiste ici à la construction d’une véritable opposition entre naissance et reconnaissance. L’opinion commune est donc précisément ce dont la naissance est et peut ou doit être oubliée : elle est à la fois ce qui ne questionne pas l’origine des choses et qui ne se questionne pas par son origine : si « en toutes choses, sauf simplement aux mauvaises, la mutation est à craindre », cela veut dire pour Montaigne que « nulles loix ne sont en leur vray credit, que celles ausquelles Dieu a donné quelque ancienne durée ; de mode que personne ne sçache leur naissance, ny qu’elles ayent jamais esté autres » (Essais, I, 43, p. 261).
Or on connaît aussi l’opposition que dresse l’Apologie de Raymond Sebond entre l’existence et la naissance : ce « qui est véritablement » est ce « qui n’a jamais eu de naissance », et c’est pourquoi « nous n’avons aucune communication à l’estre » (Essais, II, 12, p. 586-588). L’illusion, la confusion entre être et non-être, est donc totale : l’opinion commune est ce qui s’affirme et peut s’affirmer dans l’oubli même de sa naissance, et qui se définit comme ce à quoi on s’oppose lorsqu’on en traque indûment la naissance, bref ce qui peut ainsi participer à l’être, fût-ce sur le mode de l’illusion.
C’est en effet un « conte » qui exprime pour Montaigne la force de la coutume : « Celuy me semble avoir très-bien conceu la force de la coustume, qui premier forgea ce conte, qu’une femme de village, ayant apris de caresser et porter entre ses bras un veau dès l’heure de sa naissance, et continuant tousjours à ce faire, gaigna cela par l’accoustumance, que tout grand beuf qu’il estoit, elle le portoit encore. Car c’est à la verité une violente et traistresse maistresse d’escole que la coustume. Elle establit en nous, peu à peu, à la desrobée, le pied de son authorité » (Essais, I, 23, p. 106).
Et c’est donc ainsi, à partir d’un « doux et humble commencement » qui n’a plus rien à voir avec le « furieux et tyrannique visage » que la coutume prend ensuite, sur la base d’une origine absolument illégitime sinon pour la contingence de tout ordre qu’elle démontre, bref sur la base de ce qui ne peut s’exprimer que par un conte tellement il met en avant des temporalités hétérogènes, que se forgent « les loix de la conscience » (Essais, I, 23, p. 114). Certes, celui qui affronte la précarité de l’origine de la coutume « sentira son jugement […] remis […] en bien plus seur estat », c’est-à-dire connaîtra la contingence de tout ordre, là où ceux qui s’en remettent entièrement à la coutume « triomphent à bon compte ». Mais « ceux qui ne se veulent laisser tirer hors de cette originelle source faillent encore plus et s’obligent à des opinions sauvages » (Essais, I, 23, p. 116), même si, à l’opposé, on ne peut comprendre le sauvage, cannibale ou barbare, qu’en se détachant de la « voix commune » ou des « opinions vulgaires » (Essais, I, 31, p. 200). La mesure de l’opinion s’exprime donc par le refus d’en rester à son « originelle source », et l’ordre repose sur un tel refus.
Si Montaigne reconnaît que « estonné de la grandeur de l’affaire », il ne trouve à son origine « que des advis vulgaires », cela lui fait conclure que « les plus vulgaires et usitez sont aussi peut estre les plus seurs et plus commodes » (Essais, III, 8, p. 912). C’est la « raison » elle-même qui conseille comme étant le « plus vraysemblable » (et le vraisemblable est le registre de l’opinion) « à chacun d’obeir aux loix de son pays », et non pas en tirant « de nous » « le reglement de nos meurs » (Essais, I, 23, p. 1). Si opinion et raison ou vérité continuent de s’opposer par la genèse qu’elles supposent, elles se confondent désormais quant à leur effet sur l’ordre des choses. Quand Montaigne avance que la « meilleure police est à chacune nation celle soubs laquelle elle s’est maintenuë », et que « sa forme et commodité essentielle despend de l’usage », il l’affirme « non par opinion, mais en verité » (Essais, III, 9, p. 934). Le fait que l’opinion soit la meilleure police est donc une vérité.
Cent ans plus tard, dans son Essai sur l’entendement humain11, John Locke distinguera trois « lois auxquelles les hommes rapportent en général leurs actions pour juger de leur rectitude ou de leur défaut » (livre II, chap. 28, § 7, p. 548), à savoir, la loi divine, la loi civile et « la loi de
l’opinion ou de la réputation » (appelée aussi « la loi philosophique, loi de la vertu et du vice », § 10, p. 550). Une telle loi est au plus proche de l’homme et ne relève vraiment que de lui, puisque, alors même que les hommes, « unis en sociétés politiques, […] ont résigné auprès de la république la jouissance de toute leur force », « ils conservent le pouvoir de penser le bien ou le mal » (§ 10, p. 551), et d’établir ainsi ce que sont la vertu et le vice12. La sanction de cette loi de l’opinion est « la louange et le blâme », et « personne ne lui échappe » (§ 12, p. 555-556). Or « on ignore pourtant plus souvent comment elle acquiert une telle autorité pour distinguer et dénommer les actions des gens, et quels sont ses véritables critères » (§ 10, p. 550, 1re édition). Pour Locke comme pour Montaigne, la loi de l’opinion s’affirme pleinement, sans en souffrir, comme ce dont on ignore l’origine, comme ce qui fonctionne alors même qu’on en ignore les critères et comment son autorité fut acquise.
Construction de l’opinion commune
Cependant, Montaigne entrevoit aussi la nécessité de « construire » l’opinion commune, c’est-à-dire de l’appréhender dans sa passivité pour développer une distance critique vis-à-vis d’elle. La figure de l’historien est centrale pour ce nouvel aspect contribuant à une objectivation de l’opinion commune, puisque l’historien se doit en effet d’être au plus près de cette dernière. Ainsi, lorsque Montaigne loue les historiens « fort simples » qui se contentent de « r’amasser tout ce qui vient à leur notice, et d’enregistrer à la bonne foy toutes choses sans chois et sans triage », ils les remercie de nous représenter « la diversité mesme des bruits qui courroyent et les differens rapports qu’on [en] faisoit. C’est la matiere de l’Histoire, nue et informe » (Essais, II, 10, p. 396-397). Le devoir des historiens est de savoir que « parmy les accidens publics sont aussi les bruits et opinions populaires. C’est leur rolle de reciter les communes creances, non pas de les regler » (Essais, III, 8, p. 921). La matière même de l’histoire, dans sa diversité, est composée non pas
tant des faits que d’opinions : les « bruits », et les rapports qui sont faits de ces « bruits ». Plus généralement, on doit noter que pour Montaigne, l’histoire se présente plus comme une histoire des histoires (celles-ci pouvant être lues sans fin, parfois même pour y découvrir un sens qui dépasse celui qui était visé par l’historien lui-même13) que comme une histoire des faits, l’historien étant lui-même toujours pris dans cette histoire, et donc dans l’opinion14.
Ensuite, l’histoire, et donc la réputation qu’elle crée, permettent justement de répondre à la question de la justice, là où, comme on le sait, la loi ne le peut (il faut obéir aux lois « non par ce qu’elles sont justes, mais par ce qu’elles sont loix », Essais, III, 13, p. 1049). Lisons avec précision ce fantastique passage de Essais, I, 3, dans lequel Montaigne s’arrête sur la question de la réputation post-mortem : « entre les loix qui regardent les trespassez, celle icy me semble autant solide, qui oblige les actions des Princes à estre examinées après leur mort. Ils sont compaignons, si non maistres des loix ; ce que la Justice n’a peu sur leurs testes, c’est raison qu’elle l’ayt sur leur reputation » : la justice peut donc agir à travers la réputation. Il s’agit là d’une « usance qui apporte des commoditez singulieres aux nations où elle est observée » : en plus d’être juste, cette action de la réputation est aussi utile, puisqu’elle agit préventivement sur le Prince. « Nous devons la subjection et l’obeissance egalement à tous Rois, car elle regarde leur office : mais l’estimation, non plus que l’affection, nous ne la devons qu’à leur vertu. Donnons à l’ordre politique de les souffrir patiemment indignes […]. Mais nostre commerce finy, ce n’est pas raison de refuser à la Justice et à nostre liberté l’expression de nos vrays ressentiments […]. Et ceux qui, par respect de quelque obligation privée, espousent iniquement la memoire d’un prince meslouable, font justice particuliere aux despends de la justice publique » (Essais, I, 3, p. 18-19). Il s’agit là certainement de la page des Essais où il est le
plus question de justice, une justice d’autant plus impérative qu’elle est poussée dans ses derniers retranchements, là où plus aucun argument relevant de la conservation de l’ordre public ne peut la contrarier. Or cette justice peut donc agir et être prise en considération par le biais de la « reputation », de l’estime et de l’affection, dans leur différence par rapport à l’office, c’est-à-dire par rapport à l’ordre de la loi et de l’autorité. Et se pose donc ici la question de la vertu.
Enfin, Montaigne lui-même s’imagine ainsi dans le rôle de conseiller du Prince : « j’eusse dict ses veritez à mon maistre, et eusse contrerrolé ses meurs, s’il eust voulu. Non en gros, par leçons scholastiques […], mais en les observant pas à pas, à toute opportunité, et en jugeant à l’œil pièce à pièce, simplement et naturellementr, luy faisant voyr quel il est en l’opinion commune, m’opposant à ses flateurs » (Essais, III, 13, p. 1055). La perspective d’un « contrôle des mœurs » du Prince semble évidemment surprenante : commençons donc par la ramener à de justes proportions. Le « contrerolle » n’a bien sûr pas un sens policier : il s’agit seulement de l’idée d’un examen, bien souvent de l’idée de s’examiner soi-même, puisque c’est précisément ce que Montaigne fait sur lui-même (Essais, II, 6, p. 358 ou Essais, II, 17, p. 641, où Montaigne dit aussi replier sa vue au dedans, se goûter, etc.) ; « contreroller les actions humaines » dans leur ensemble est une chose impossible (Essais, II, 1, p. 315, voir aussi Essais, II, 12, 523) : Montaigne, après avoir affirmé peindre le passage plutôt que l’être, précise que cela réclame un « contrerolle de divers et muables accidens… » (Essais, III, 2, p. 782) ; obéir ne se conçoit pas après contrôle (Essais, II, 34, p. 714), de même que dans le passage ci-dessus, Montaigne n’imagine contrôler les mœurs du Prince que si celui-ci « eust voulu ». Mais ces restrictions étant faites, ne s’agit-il pas justement là précisément d’un « contrôle », tel celui auquel donnerait par exemple lieu le regard du censeur, ou l’action de l’opinion : attaché aux détails et au particulier, avant tout réflexif et intérieur (même si le regard du censeur, du public ou de Montaigne accompagne nécessairement tout contrôle de soi), non concurrent de l’autorité, mais opposé à toute forme de flatterie. Revenons donc à notre passage des Essais, III, 13 : ce rôle de transmetteur de l’opinion commune qui s’oppose à la flatterie du courtisan et à toute relation d’autorité, demanderait « fidelité », « jugement » et « liberté ». Ce serait « un office sans nom ; autrement il perdroit son effect et sa grace » : la question de l’opinion commune se
trouve donc à nouveau hors de la sphère de l’autorité au point qu’elle ne peut être assignée à aucun « office ». Mais un tel rôle ne peut être tenu par n’importe qui, et la vérité qu’il permet de dévoiler ne peut « estre employée à toute heure » (nous sommes loin du registre du principe de publicité). Ce rôle, précise en effet Montaigne avec lucidité, devrait échoir à une homme « nay de moyenne fortune », qui d’une part ne doit donc pas craindre de perdre toute sa richesse du fait de sa critique, et qui d’autre part soit aussi de condition suffisamment « moyenne » pour avoir « communication15 à toute sorte de gens ». Car les princes ont besoin « de vrays et libres advertissemens. Ils soutiennent une vie publique, et ont à agréer à l’opinion de tant de spectateurs » (Essais, III, 13, p. 1055-1056). Le devoir d’agréer à l’opinion des spectateurs, correspond précisément à l’ébauche de l’idée d’opinion publique. Mais celle-ci réclame donc pour Montaigne, comme plus tard pour les Physiocrates, l’action intermédiaire d’une personne éclairée et ouverte à une communication universelle des formes spécifiques ; ainsi, elle témoigne du caractère définitivement passif de l’opinion commune. Surtout, l’action de cette opinion publique émergente se situe hors de toute relation d’autorité, et ce, de manière à la fois à préserver non seulement l’autorité du Prince, mais aussi la liberté de Montaigne. Enfin, en plus de la justice, on doit remarquer que c’est aussi dans cette sphère essentiellement cadrée de l’opinion, que surgit la question de la liberté : Montaigne, comme ses « advertissements », sont libres, et la sortie de la sphère de l’autorité permet à la liberté de donner lieu à l’expression de la vérité.
En conclusion (mais sans proposer une synthèse qui écraserait les tensions entre les différents arguments mis en avant), l’opinion commune se présente donc à la fois comme capable d’intuition simple et comme une pure voix vide ou comme vecteur d’illusion, comme un possible outil de justice exigeant certaines formes de liberté (dans ce cadre précis et « éclairé » que je viens de décrire) et comme un outil de l’ordre, et enfin, dans tous les cas, comme la matière même de l’histoire ou comme une de ses composantes essentielles, puisque « les hommes […] sont tourmentez par les opinions qu’ils ont des choses, non par les choses mesmes ». Aussi illusoire soit-elle, l’opinion commune permet de gérer
efficacement les hommes, le commun comme le prince, même s’il doit s’agir là d’un « triomphe à bon compte ». Si les Essais, au même titre qu’ils démystifient la loi pour mieux affirmer le fondement mystique de son autorité, n’ont de cesse de mettre l’opinion commune face à la précarité de son origine et face à son absence de fondement, de telle sorte que le jugement se trouve remis « en bien plus seur estat », il s’agit avant tout là d’affirmer la radicale contingence de tout ordre16, tout en le définissant précisément comme ce qui ne s’établit, ne se développe, ne se maintient, bref ne fait ordre que par l’effacement de la question de son origine qui témoignerait de sa contingence… mais tout ordre étant contingent, même celui de l’autorité suprême du prince, rien n’empêche alors, en revanche, à l’ordre de l’opinion d’agir, fût-ce post-mortem et fût-ce filtré par le sage, sur l’ordre du prince.
Thomas Berns
Université libre de Bruxelles
1 Cité sur base de Montaigne, Œuvres complètes, Éditions Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1962.
2 Pour laquelle je me permets de renvoyer à mon livre Gouverner sans gouverner. Une archéologie politique de la statistique, PUF, 2009.
3 Cicéron définit le jugement du censeur par la seule « rougeur » [ruborem] qu’elle provoque : ce jugement n’agissant que sur le « (re)nom » [in nomine], son verdict est l’ignominia (Rep. IV, vii). À l’époque de Montaigne, Jean Bodin (Les six livres de la République, VI, 1) et Juste Lipse (Les Politiques, IV, 11) reprendront cette idée.
4 Et qui sera de surcroît chargé non seulement à Rome, mais plus clairement encore lors de sa revivification « théorique » à la fin de la Renaissance (Bodin, Lipse, Althussius, Montchrétien), de la première tentative explicite de quantification du politique (dénombrer les biens et les personnes) donnant ainsi une assise très morale à notre statistique moderne.
5 Nous soulignons pour marquer l’opposition entre le chemin de la raison, et une voix, qui s’apparente, dans la tradition nominaliste à une pure construction mentale. Les analyses qui suivent poursuivent une réflexion globalement sensible aux inflexions nominalistes de la pensée de Montaigne, en soulignant les références à cette tradition, références que nous dont la portée nous semble plus instrumentale que systématique. Nos sources, sur cette question du nominalisme de Montaigne, sont avant tout : d’U. Langer, dans : Divine and poetic Freedom in the Renaissance, Princeton, 1990 ; P. Magnard, « La justice selon Montaigne », in : Philosophie, no 46, 1995, p. 86 et svtes ; A. Compagnon, Nous Michel de Montaigne, Paris, 1980, p. 23-24.
6 Des noms (Essais, I, 46) et De la vanité des paroles (Essais, I, 51) confirment bien sûr cette perspective nominaliste.
7 À ce sujet, et pour tout ce qui a trait à la question de la loi et de l’autorité chez Montaigne, je me permets de renvoyer à mon livre Violence de la loi à la Renaissance. L’originaire du politique chez Machiavel et Montaigne, Kimé, Paris, 2000.
8 Lois, XII, 950.
9 Cette question a été superbement développée par Jacques Derrida, La Fausse Monnaie, vol. I de Donner le temps, Paris, 1991 (par exemple p. 82, 164, 194-195).
10 Lois, VIII, 838, dans lequel Platon, qui au sujet de l’opinion n’est certes pas aussi confiant que les historiens grecs, Aristote, ou la pensée romaine, affirme ici clairement la puissance de la « voix publique », pour ce qui relève du contrôle de la moralité collective, et en particulier d’une surveillance de la sexualité vis-à-vis de laquelle il confirme, à la fin du livre VI, vouloir éviter la contrainte légale.
11 John Locke, Essai sur l’entendement humain (livre I et II), Paris, Vrin, 2001.
12 On perçoit ici toute l’opposition de Locke à Hobbes, pour lequel la souveraineté s’exprime comme rupture définitive par rapport au registre de l’opinion.
13 « Un suffisant lecteur descouvre souvant ès escrits d’autruy des perfections autres que celles que l’autheur y a mises et apperceües, et y preste des sens et des visages plus riches » (Essais, I, 24, p. 126) ; « J’ay leu en Tite-Live cent choses que tel n’y a pas leu, Plutarque en y a leu cent, outre ce que j’y ay seu lire, et, à l’adventure, outre ce que l’autheur y avoit mis » (Essais, I, 26, p. 155-156) ; « L’ouvrage, de sa propre force et fortune, peut seconder l’ouvrier outre son invention et connoissance et le devancer » (Essais, III, 8, p. 918)
14 Voir à ce sujet mon livre Violence de la loi…, op. cit., p. 358-365 et mon article « Philosophie de la bibliothèque de Montaigne : le difficile trajet des mots aux choses », in : R. De Smet (éd.), Les Humanistes et leur Bibliothèque, Éditions Peeters, Leuven-Paris-Sterling, 2002, p. 193-209.
15 Sur la communication, voir les remarques fondamentales de Pierre Magnard, « La justice selon Montaigne », in Philosophie, 46, 1995, p. 88.
16 Une contingence de tout ordre qui s’exprime peut-être par la reprise du raisonnement en terme de « puissance absolue » et « puissance ordinaire », la première, « occupée » théoriquement par Montaigne lorsqu’il démystifie l’ordre de la loi, de la coutume ou de l’opinion, excédant toujours la seconde, et offrant « hypothétiquement » la possibilité de mettre le jugement en « bien plus seur estat ».