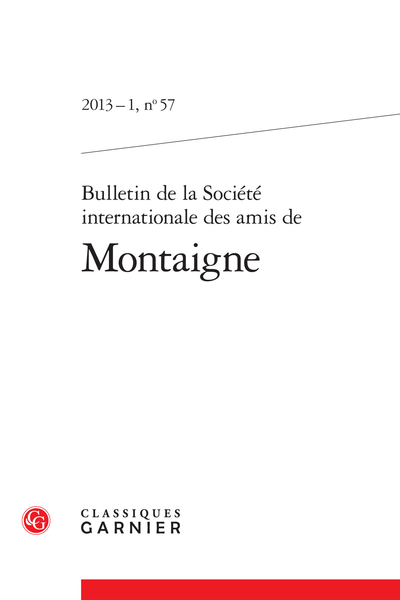
Prémices chatoyantes Mireille Habert déchiffre la traduction par Montaigne des « sainctes imaginations » sebondiennes
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2013 – 1, n° 57. varia - Auteur : Tilson (Edward)
- Pages : 105 à 119
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812420368
- ISBN : 978-2-8124-2036-8
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2036-8.p.0105
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/12/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Prémices chatoyantes
Mireille Habert déchiffre la traduction par Montaigne
des « sainctes imaginations » sebondiennes
Au centre de toute interprétation des Essais, l’« Apologie de Raimond Sebond » ; au cœur de cet essai-matrice, l’attitude de l’essayiste envers l’ouvrage du théologien qu’il traduit en 1569 sous le titre de Théologie naturelle et, partant, son attitude envers le Christianisme ; à la clef de la compréhension de cette attitude, les variations entre le texte latin de Sebond et le français de la Théologie naturelle. L’étude de Mireille Habert, Montaigne traducteur de la Théologie naturelle1, offre un apport précieux pour nous rapprocher de la conception qui préside à la traduction et pour nous ouvrir par extension la perspective d’une meilleure compréhension des textes de l’essayiste. En même temps, l’horizon d’une telle compréhension est inévitablement ébauché d’avance, ne serait-ce que par quelques traits. Pour discrète qu’elle se fasse, la lecture par Habert de l’« Apologie de Raimond Sebond » exerce à cet égard un effet en retour distinct, qui encadre l’interprétation des « gauchissements » de la traduction montaignienne.
Comme on le sait, Sebond rédige à Toulouse en 1436 une sorte de somme à l’adresse des laïcs, intitulée à l’origine le Liber creaturarum et dans certaines versions ultérieures la Theologia naturalis, dans laquelle il illustre toutes les vérités nécessaires au salut à partir d’une « lecture » du monde compris comme le reflet analogique, la grâce aidant à la lecture, des vérités Révélées. Le problème pour les études de la traduction, de taille, est l’incertitude concernant l’édition latine à partir de laquelle Montaigne aurait travaillé. L’essayiste ne faisant mention que d’un « livre rencontré de fortune » sous « un tas d’autres papiers2 », il n’est pas clair
s’il s’agit d’une copie manuscrite ou d’une édition imprimée, et toutes présentent des divergences qui deviennent vite significatives dès qu’il est question de se fonder sur les écarts de la version française pour y asseoir des conclusions sur l’attitude du traducteur envers sa source.
Habert reprend la répartition établie des manuscrits et des incunables du Liber creaturarum en trois groupes, ou états du texte, selon les rapports de filiation indiqués par l’évidence textuelle, le premier groupe étant composé du manuscrit notarié et des premières copies manuscrites, le deuxième se limitant pour l’essentiel à l’édition donnée à Lyon par Guillaume Balsarin, et le troisième étant représenté par l’édition donnée à Daventer par Richard Paffroed et celles qui en découlent ou qui s’en rapprochent manifestement. À cela s’ajoute l’intérêt présenté par une première traduction française chez Claude Daulphin en 1519, par la Viola animae, une version raccourcie et dialoguée produite par Pierre Dorland dans le milieu de la devotio moderna, et par la traduction française de celle-ci due à Jean Martin, traduction qui parut chez Vascosan en 1555 et qui fut sans doute connue de l’essayiste. La première partie du livre, philologique, vise à cerner l’édition latine utilisée par Montaigne à travers la recension des différences entre le manuscrit et les éditions Balsarin et Paffroed ; sont ensuite analysées la traduction de 1519, la Viola animae, sa traduction par Martin, et la traduction de Montaigne. Habert étudie la dimension polémique des différentes versions et les discours véhiculés par les variantes, et compare la facture des textes de Paffroed et de Montaigne. La deuxième partie, analytique et interprétative, présente d’abord les linéaments et le contexte de l’argumentation sebondienne. Des analyses stylistiques détaillées de certains chapitres de Sebond sont ensuite groupées sous quatre chefs : les rapports entre l’intelligence et la volonté, le traitement réservé à la foi, les rapports entre la doctrine, la certitude et la foi, et enfin le rôle joué par l’imagination. Quatre annexes sont également fournies : 1) le texte de la dédicace de la Theologie naturelle de Montaigne ; 2) celui du chapitre 208 de la Théologie naturelle ; 3) une présentation de la Theologie naturele [sic] de Martin avec un examen de la répartition de la matière de Sebond entre les six dialogues du format raccourci, une analyse de ses divergences par rapport au Sebond, et une étude de son influence sur Montaigne ; et 4) un recensement des soins apportés par Montaigne à la réédition (1581) de sa traduction qui conclut au « désintérêt relatif du traducteur à l’égard de l’auteur » (290).
L’idée directrice de l’étude d’Habert est que
L’examen des écarts prouve l’existence, dans la Théologie naturelle, d’au moins deux systèmes de gauchissements, l’un d’orientation critique, l’autre d’orientation édifiante. Le premier invite le lecteur à une distance et une prise de conscience. L’autre privilégie des traits déjà édifiants pour en amplifier les effets, en sollicitant l’adhésion de la foi. (249)
Son analyse de la dimension polémique de la tradition éditoriale souligne que le rationalisme du Liber creaturarum avait inspiré des atténuations chez tous ses éditeurs afin de situer les divergences de la Théologie naturelle comme le prolongement d’une humilité partagée, d’un désir commun « de dépasser le discours d’argumentation par le recours à l’émotion » (50), mais la tentative d’équilibrer la lecture, inéluctablement teinte d’anticipations sur l’« Apologie », d’un commentaire implicite mais hautement critique par une lecture qui tire des comparaisons avec les versions du troisième état et du Dorland un sous-texte de piété accrue ne convainc pas toujours.
En repérant les erreurs dans la transmission du texte du manuscrit, Habert montre que dans la grande majorité des cas, la Théologie naturelle reproduit les variantes présentes dans l’édition de Paffroed, et elle parvient ainsi à exclure l’hypothèse selon laquelle Montaigne aurait pu se servir du Liber creaturarum de chez Balsarin. Par exemple, là où le manuscrit et Balsarin portent la phrase « gradus… imobiles et finiti », le même passage devient « degrés… immobiles et infinis » dans la traduction de Daulphin, « gradus… immobiles et firmi » dans l’édition Paffroed, et enfin « fermes et immobiles » chez Montaigne (82-83).
Il existe cependant d’autres variantes qui indiquent que Montaigne semble suivre une version parfois plus proche du premier ou du deuxième état du texte. Pour ne donner qu’un exemple, en segmentant une partie de la traduction du prologue que commente Habert, « [Cette doctrine] luy donne grand accès à l’intelligence de ce qui est prescrit et commandé aux Sainctes escritures, et fait que l’entendement humain est délivré de plusieurs doutes… », on accordera que Montaigne rabat des revendications méthodologiques du prologue quelle que soit la version du départ, comme on sera d’accord que ces restrictions anticipent sur la présentation du programme sebondien dans l’« Apologie » (48). En même temps, à comparer le texte du Paffroed donné par Habert,
Et quidquid in sacra Scriptura dicitur et praecipitur, per hanc scientiam cognoscitur infallibiliter cum magna certitudine, it [sic] quod intellectus humanus adhaeret et credit absque omni dubitatione toti sacrae Scripturae, quoniam removet hominem ab omni errore et ab omni dubitatione, et certificat infallibiliter, ut nullus possit dubitare,
avec le texte du Balsarin,
Et praecipue par hanc scientiam cum magna certitudine intellectus humanus adheret et credit absque dubitatione toti scripture sacre quoniam removet hominem ab omni errore et dubitatione,
la traduction semble mieux s’expliquer en regard de cette dernière version, dans laquelle le dernier membre portant que tout lecteur de la doctrine certifie infailliblement l’Écriture et que nul ne puisse en douter est déjà absent. En somme, la majeure partie des changements pouvant s’autoriser des textes de troisième état et d’autres de la tradition manuscrite représentée par l’édition Balsarin, le texte utilisé par Montaigne semble provenir d’un état non encore recensé. Comme le remarque Habert : « On peut seulement affirmer que Montaigne n’a pas traduit le texte originel de Sebond, celui que présente la copie authentifiée de Toulouse. » (p. 86 en note)
L’étude de la facture des éditions différentes établit néanmoins, et cela est déjà fort utile, que le texte de départ partageait l’essentiel des caractéristiques des éditions du troisième état. Au-delà de l’identité du titre (non plus Liber creaturarum mais Theologia naturalis) et des similarités des informations données sur Sebond, Habert constate que l’ouvrage de Montaigne comporte comme celui de Paffroed 330 chapitres numérotés là où l’édition Balsarin comme la traduction chez Daulphin reproduisent les 348 divisions du manuscrit. En outre, la traduction de Montaigne comporte comme le Paffroed des manchettes et une table thématique alphabétisée là où ces versions de deuxième état ne proposent qu’une table chronologique.
Au-delà des similarités formelles cependant, les manchettes et les entrées de la table de la Théologie ne correspondent ni en nombre ni en contenu à celles de la Theologia (92-93). Les entrées de la table alphabétique de Montaigne multiplient par plus de trois fois celles du latin de chez Paffroed et s’en affranchissent largement en diminuant des entrées théologiques, en recensant des notions scientifiques et en incluant
des réflexions morales. Par ailleurs, les similarités entre le français du corps du texte et les tournures des manchettes permettent « d’attribuer pleinement à Montaigne la responsabilité du paratexte » (96). Comme le remarque Habert à l’endroit d’une des manchettes du chapitre 3, « Exhortation à l’homme de recognoistre son createur » (fo 10vo), le fait que les arguments du texte ne sont pas simplement résumés mais sont saisis par le métatexte des manchettes dans leur fonction rhétorique permet au lecteur d’y déceler en filigrane un commentaire du traducteur sur l’ouvrage qu’il entreprend.
De montrer que « la table du français et les manchettes sont d’authentiques créations » (107) est un des grands mérites de l’étude d’Habert, et on regrette qu’elle n’ait creusée plus avant les causes et les effets de l’« adéquation » parfois douteuse remarquée entre le discours théologique et le paratexte, comme de l’impression de désinvolture qui en résulte. Habert se demande « dans quelle mesure les multiples entrées [de la table] du français se justifient, étant donné le faible intérêt d’entrées trop proches entre elles comme : “Tout ce qui est au monde est faict pour l’homme”, 97, et : “l’Univers est basti pour l’homme”, 98. » (105). Ces traces d’un intérêt excentrique au discours théologique se remarquent dans les manchettes également, par exemple au ch. 6, où la manchette, « Pluralité de dieux refusée » (fo 13vo), correspond au passage, « Nous avons donc prouvé que la nature qui est au-dessus de l’humaine, et l’individu qui nous a engendrez, est un seul en nombre, et en effet infiny. Ainsi nous tenons un seul Dieu, et maistre de toutes choses. » (92). Le texte du théologien avait bien proposé de confondre les païens, mais cela se fait de soi comme une conséquence de l’induction « rationnelle » des dogmes, et la référence explicite aux arguments antiques à côté des « preuves » sebondiennes relève de la seule main de Montaigne. En effet, on y décèle les thématiques centrales du futur essayiste telles qu’elles se dégagent par exemple de ses notes de lecture contemporaines3.
La deuxième partie de l’étude analyse les gauchissements du texte lui-même. Ceux-ci sont considérés principalement par rapport à l’édition de Paffroed mais aussi à la lumière de la tradition éditoriale du Liber creaturarum. Habert rattache ainsi certaines tendances de la traduction au courant de la devotio moderna (133), en particulier par le biais de la condamnation érasmienne des ratiocinations tant réalistes que nominalistes. Central à l’argument sebondien, la place d’empereur que s’attribue l’homme par et au regard de sa raison apparaît plutôt comme la preuve de sa vanité pour Montaigne :
… d’un bout à l’autre, la traduction semble inviter le lecteur à considérer la démarche de la théologie naturelle moins comme suspecte que comme vaine. […] Par la transformation de l’énonciation, l’amplification des images et, de façon générale, le recours aux procédés rhétoriques du movere, Montaigne semble inviter le lecteur à contrebalancer les insuffisances de la démonstration rationnelle par une soumission authentique à la doctrine. (134-135)
Une des caractéristiques saillantes de cette transformation, la reformulation du discours à la première personne, mine la prétention aléthique des arguments pour les convertir en « énoncés qui ne reposent plus que sur la garantie de l’énonciateur » (146). La traduction met en scène le théologien, à la fois « le personnage du sophiste qui outrepasse les bornes assignées à la raison, et “l’orateur chrétien” habilité, en sa qualité de clerc, à tenir sur les vérités révélées le discours autorisé par l’Église. » (164). Ce « “je”, tantôt autorité exigeant l’obéissance et tantôt dogmatisme éveillant la suspicion, relève du double mouvement de critique et d’adhésion qui caractérise la traduction » (181). L’abbé Coppin déjà avait remarqué la « belle assurance » de cette voix4 ; Habert souligne la filiation avec l’ouvrage de Dorland tout en mettant l’accent sur la distanciation instaurée par ces procédés. Ainsi, les écarts de la traduction « varient selon que l’intention du traducteur est d’exhiber la présomption et de faire ressortir le ridicule des arguments, ou de corriger ces derniers » (149).
De façon systématique, les articulations logiques sont remplacées par des constructions impliquant le lecteur : « L’énoncé des conclusions du raisonnement, qui s’effectue en latin à travers des formules logiques impersonnelles comme “concluditur”, laisse place en français à des tournures familières dont certaines semblent un appel à la connivence du
lecteur. » (151) Prenons l’analyse d’une phrase du premier chapitre, « … et per hominem imus et ascendimus in Deum sicuti per veram scalam per quam debemus ascendere in cognoscendo » dont la traduction, souvent commentée, aura des répercussions dans l’Apologie : « … et tout d’un fil il enjambera de l’homme jusques à Dieu ». Habert y devine « le regard sceptique » derrière un langage qu’elle voudrait simultanément plus pieux : « L’image rend comique la prétention à vouloir humainement “enjamber” ce dernier barreau sans le secours de la grâce, tandis que l’idée “d’enjambement” rend plus sensible le gouffre qui sépare l’homme de Dieu. » (152) Mais on voit mal comment on séparerait l’idée de l’image. Ici comme ailleurs, l’observation sur la distance prise par la traduction sonne plus juste que sa contrepartie pieuse. À proposer que la suppression des conclusions logiques permet de « renforcer la dimension spirituelle » (154) on risque de ramener toute la rhétorique du texte à des attitudes peu nuancées prêtées au traducteur à l’égard de son énonciateur (Sebond : dépourvu de spiritualité) et de son énonciataire (les dames : dévotes).
Habert signale avec finesse les modulations, telles l’introduction systématique du verbe « accomoder » ou la transformation des formules du théologien dans le style sequitur ergo en formules du style croyons donc, voire, pourquoy donc ne croyons nous, qui infléchissent les inductions de Sebond vers des esquisses, des essais imagées nécessairement sans proportion avec l’objet visé. Les analyses suggèrent que certaines « modifications apportées par Montaigne [montrent] que sans la Révélation, la connaissance présentée par le discours n’est pas la vérité divine, mais une construction humaine » (205), alors que d’autres concourent en parallèle à rehausser la primauté de la foi. Pour Habert, qui suit ici Hendrick5, la traduction témoigne « du désir de Montaigne de faire prendre conscience au destinataire de la responsabilité qui est la sienne dans l’élaboration de ses convictions. » (206). Au plan lexical, l’un des mécanismes les plus voyants par où des arguments qui relevaient chez Sebond de la pensée ou de l’intellect (cogitatio) se métamorphosent en « plaisantes imaginations » est l’introduction du mot « fantaisie » aux côtés d’« imaginations » pour rendre « imago ». Habert souligne que la valeur de « fantaisie » chez Montaigne semble se rattacher aux « conceptions antiques associant les “phantasmata” aux visions, fantômes et autres spectres produits à l’intérieur des songes » (193) et donc à une
dévalorisation des facultés humaines. Ces sur-traductions évoquent en effet les passages sur les fantômes annotés à la même époque sur le Lucrèce de Montaigne, et cela porte évidemment préjudice à la solidité des démonstrations sebondiennes quand le mot est utilisé pour en désigner les conclusions. Mais la valeur négative de « fantaisie » peut également servir l’apologétique, par exemple dans le fameux passage où l’homme se « fourre en la fantaisie la forcenee opinion de se faire Dieu… » (196). Pour Habert, de telles envolées rappellent « la condamnation morale portée par l’Église contre le consentement intérieur au péché, en-dehors même de tout passage à l’acte » (197). D’un côté, la « disqualification des facultés mentales » discernée dans ces chapitres de la Théologie naturelle préfigure « l’attitude adoptée plus tard par Montaigne, renvoyant dos à dos les “preuves” de Sebond et celles de ses accusateurs, comme également dépourvues de fondement rationnel » (199), et de l’autre, l’imagination apparaît comme une faculté dont le danger potentiel exige de « la soumettre à un contrôle vigilant et d’apprendre à la diriger correctement pour échapper aux suggestions fantasques » (200). Sur ce point, il semble difficile cependant de passer sans danger de contresens des arguments sur les gauchissements de la traduction à l’intention de Montaigne. L’ironie des confidences par lesquelles l’essai liminaire nous apprend que faute d’avoir bridé ses imaginations Montaigne a dû les mettre en rolle dans l’espoir de « [s]’en faire honte à [luy]-mesmes » (« De l’oisiveté », 33) paraît incompatible avec la thèse avancée ici par Habert, à moins de prêter à Montaigne une jeunesse dévote et qui n’aurait évolué vers le scepticisme que plus tard, ou bien de rapprocher la traduction aux Essais sur la base d’une rhétorique commune de dissimulatio.
Le retour de tels lieux de la critique marque d’ailleurs les commentaires d’Habert au sujet de certains passages sur « L’obéissance envers la Révélation et la tradition […] qu’il y a tout lieu de considérer comme des développements autonomes… » (206). Habert commente la fameuse sur-traduction au chapitre 208 où Montaigne compare le « repos et l’asseurance » des Chrétiens à la « turbulente inconstante et doubteuse erreur, qui tourmente et martyrise continuellement les entendemens devoyez de ceste saincte creance6 » , pour y lire le déploiement d’un « encouragement à
conserver la foi chrétienne selon une décision humaine, digne de respect dans un monde où, en l’absence d’autres signes, la présence de Dieu se manifeste surtout à la dignité de ses témoins et à l’espérance sereine que leur confère sa promesse. » (212.) Créditer de telles envolées à l’intention du traducteur en les liant aux critiques des arguments rationalistes
va dans le sens de l’enseignement que propose la traduction, par-delà le discours de Sebond, d’une attitude d’humilité et d’espérance fondée sur la foi et non sur la raison. Cette attitude pourrait également être celle qui caractérise le fidéiste, décidant librement de séparer foi et raison et de croire en Dieu, en Jésus-Christ, aux vérités révélées, sans se soucier des motifs de crédibilité, en les tenant pour dérisoires. (212)
Même à admettre que les ironies de la traduction jouent à l’intérieur d’une rhétorique fidéiste à l’intention de l’énonciataire, cependant, la suggestion esquissée ici que ce fidéisme pourrait être celui de Montaigne lui-même se heurte aux problèmes que l’on connaît7. S’agissant du chapitre 208 en particulier, et sans souligner que rien chez l’essayiste n’indique une croyance à l’enfer ni même à l’immortalité, on observera qu’il serait difficile de trouver un texte plus éloigné de la pensée d’un écrivain dont l’inconstance est le maître mot. Aussi, attribuer cet embellissement sur la fermeté de l’« assiete » du chrétien à l’intention et à la pensée du traducteur de 1569 reviendrait à placer l’essayiste de
1580 dans la situation d’énonciation de l’infidèle. À supposer qu’elle est bien de l’invention de Montaigne, et à tenter une hypothèse sur l’occasion d’une telle sur-traduction, l’opposition apparemment gratuite entre tourment (tarachè) et quiétude (ataraxia) pourrait relever moins de la piété que d’une complaisance à produire une apologie religieuse en reflet anamorphique de la protreptique pyrrhonienne et épicurienne.
Les rapports entre la doctrine, la certitude et la foi sont analysés plus avant au sujet des chapitres sur la Rédemption, à propos desquels Habert remarque de nouveau une tendance double de la traduction qui réinscrit « dans un contexte orthodoxe l’énoncé de la vérité du dogme en […] pointant du doigt le ridicule de l’acharnement à tout prouver et tout justifier » (225). Lorsqu’au folio 334vo l’argument extrapolé d’Anselme sur la nécessité d’une mort ignominieuse pour le rachat de l’humanité est rendu par l’observation que cette mort nous apporte « le proffit, la commodité, le salut et l’utilité telle que nostre besoing le demande » (217), Habert observe ainsi que l’« imagination du théologien se déploie […] sous le regard ironique du traducteur » (218), et elle remarque ailleurs que la formulation de telle manchette « frôle l’injure » (216). En effet, Habert a certainement raison de dire que telle tournure où Sebond s’amuse, comme le dira l’essayiste, à peloter les raisons divines, est « raillée » (283). Ainsi quand Montaigne rend avec un vocabulaire dégoulinant d’ironie, « Il nous faut chercher bien avant et jusques au sacré thresor des intentions de Dieu, pour voir si nous n’y trouverions pas un dessein qui vueille cela et quelque debonnaire et benigne deliberation de faire au genre humain un si riche present », le simple « Ideo investigare debemus si Deus ex sua bonitate voluit dare talem hominem humanae naturae » de Sebond (fo 353), on accordera certainement que : « La démarche de reconstitution des faits a posteriori se voit ici caricaturée, ainsi que la présomption de ceux qui osent se permettre de sonder les pensées de Dieu pour mieux y reconnaître ce qu’ils cherchent » (219). Mais on est moins sûr de suivre Habert lorsqu’elle soutient que ces amplifications ironiques rétablissent la signification spirituelle du sacrifice de la Passion ou qu’elle propose à nouveau le fidéisme comme explication suffisante du rapport entre les deux tendances : « Cette soumission de la raison et ce renforcement de l’attitude de confiance du croyant définissent, comme on l’a vu, l’attitude fidéiste. » (225). Il faudrait en tout cas se garder de suggérer que la rhétorique fidéiste – celle de la traduction ou celle de l’« Apologie » – explique
à elle seule le sens des gauchissements du traducteur ou des paradoxes de l’essayiste. Prenons un passage où Sebond demande comment le nom de Jésus aurait pu être tant honoré s’il n’était pas le fils de Dieu : « Quomodo post mortem obtinuit tantum nomen tantum honorem per universum mundum ? » (fo 230vo), dans la version de Montaigne, « comme fust-il advenu […], que le monde se fust si volontiers abreuvé d’une opinion si mystérieuse et si estrange ? ». Pour Habert, « Par des termes comme “mystérieuse”, “estrange”, “sanctifiee”, la traduction rappelle au chrétien la dimension religieuse du mystère… » (227), et cela se peut, s’agissant de la traduction. Mais sans nous attarder au mot « abreuvé », qui reviendra dans un passage clef de l’Apologie8, s’agissant du traducteur, il nous paraît que ce langage souligne plutôt son extériorité aux considérations religieuses.
La section « Contrôler l’imagination : l’oraison spirituelle » est la plus originale, la plus spéculative, la plus explicative du livre. Habert y remarque que la traduction ajoute aux termes latins « cogitatio » et « memoria » les mots (et les facultés) d’« imagination » et de « jugement », et discerne derrière les inflexions du français un programme de valorisation du pouvoir de l’imagination « de venir en aide au sentiment religieux » (237). Ces analyses nous rapprochent d’une manière importante de la pensée de Montaigne, mais elles rencontrent également quelques difficultés. Habert glose des amplifications au sujet de la Passion dans le chap. 269 (fo 340vo) :
Il la recevra [la mort] non en privé mais en public, non de nuict mais en plein midy, non commune mais tres-honteuse, non simple et prompte mais estendue en largeur, et diversifiée en cent façons de tourments incroyables et de mesme des autres circonstances que nous pouvons imaginer correspondantes en tout à la malicieuse et forcenee passion de ses ennemis mortels,
qui correspond chez Paffroed au passage :
Et ideo convenit quod fiat in loco publico et solemni et non in occulto de die et non de nocte et sic de aliis circumstantiis. Et oportebit quod genus mortis sit turpissimum et ignominiosissimum,
pour suggérer qu’il s’agit dans de telles amplifications de « suscit[er] une réaction de compassion profonde. » (241) Mais ces gloses demeurent sujettes à la caution philologique. L’explication par la tradition des incunables ne peut jamais être écartée et il nous semble improbable que des membres tels « non simple et prompte mais estendu en largeur » soit de l’invention de Montaigne plutôt que du fait d’un des copistes de la version dont il s’est servie.
D’ailleurs, à admettre qu’une sur-traduction donnée soit de Montaigne, son interprétation ne va pas encore de soi. Ainsi, la traduction rendant au sujet de la Passion la phrase « illi qui occident eum » par « les auteurs de cest horrible massacre », Habert entend qu’il s’agit pour Montaigne de « rend[re] d’autant plus admirable le sacrifice » (241), ce qui peut être vrai selon un certain code de lecture programmé par la rhétorique de la traduction. Mais cette lecture n’exclut pas que le même passage se lise également comme une exagération ludique qui ironise par lassitude sur le dolorisme de la piété sebondienne. Aussi, là où Habert affirme que « Le traitement accordé à ces passages confirme que la vérité du sentiment religieux s’inscrit davantage pour Montaigne dans une pratique que dans un raisonnement » (242), il eût peut-être mieux valu se borner à remarquer que la traduction des chapitres sur la Passion inscrit cette vérité davantage dans l’imaginaire que dans le raisonnement. Le travail archéologique de ces chapitres sur l’intériorisation de la Passion expose bien les fondements du rôle joué par le jugement et l’imagination dans l’assimilation de l’héritage religieux à l’exercice de la pensée critique chez Montaigne. Le regard anticipatoire sur l’« Apologie » est ici incontournable, et on ne souhaiterait pas une cécité feinte sur ce chef, mais le développement d’une lecture qui mettrait à profit les analyses de la traduction en les appliquant à la compréhension de l’« Apologie » exigerait une relecture parallèle des Essais qui n’est pas du ressort de ce livre9.
L’examen dans la troisième annexe des recoupements entre la traduction de Montaigne et celle de la Viola animae appuie fortement la thèse d’Habert. Il fournit des éléments parmi les plus intéressants de l’étude en même temps que de mettre en relief les questions méthodologiques qu’elle implique. Habert y montre que le ton de celle-ci « est plus proche du discours de la catéchèse et de l’enseignement que de la démonstration » et que ce « jeu sur les affects, qui distingue l’ouvrage de Dorland de son modèle, semble annoncer le ton et les procédés de la traduction de Montaigne. » (262). Les analyses qui identifient dans la Viola les points de départ de certaines des envolées dans lesquelles la Théologie naturelle semble le plus s’éloigner de son texte de départ, quel qu’il pût être, sont très utiles pour expliquer l’origine d’un versant « édifiant » qui semble destiné à plaire aux lectrices escomptées de l’ouvrage, et elles apportent une contribution majeure au débat sur la traduction. La conclusion d’Habert, « on peut légitimement présumer que Montaigne a connu les sérieux remaniements apportés au discours de Sebond par Dorland » (288-289), nous semble définitive. En même temps, d’avoir identifié les sources d’amplifications précédemment mises sur le compte de l’invention pure nous enjoint à encore plus de circonspection dans leur interprétation. Autant ces recoupements sont probants, autant ils nous avertissent de ne pas franchir le pas entre le fait de déceler la cohérence d’une stratégie rhétorique en diapason avec ce que nous pouvons reconstruire de la situation d’énonciation de la traduction, et celui d’attribuer ces sentiments au traducteur. Le contrat de lecture qui régit les Essais est évidemment très différent, mais il n’y a pas de raison a priori qu’on ne puisse chercher même dans la traduction des indices d’une pensée pour laquelle « trier […] un mot, qui semble ne porter pas : cela, c’est un discours » (I, 26, 157-158). Mais dans l’optique d’une telle recherche, il s’agirait moins d’identifier la stratégie rhétorique de la traduction avec les vues de Montaigne que de distinguer les gauchissements pouvant vraisemblablement entrer dans une telle stratégie d’avec ceux qui semblent plutôt la saper. Les deux lectures ne s’excluent d’ailleurs pas : dans ces développements dont la Viola fournit le point de départ, le traducteur peut très bien chercher
à plaire à des destinataires plutôt pieuses en même temps que de se complaire, par exemple dans l’esquisse de symétries avec les tableaux de la philosophie païenne.
Les analyses menées au fil de l’étude permettent d’établir incontestablement la présence dans la Théologie naturelle des deux « systèmes » délinés par Habert, mais la question demeure de savoir en quelle mesure les écarts générés par ces systèmes relèvent de la rhétorique du traducteur et en quelle mesure ils décèlent la pensée de l’auteur. Comme le souligne Habert, la tradition éditoriale tend à rabattre des revendications pour la raison et pourrait fournir l’explication de certains traits de la Théologie, de même que ses broderies édifiantes prolongent des amplifications déjà notoires dans les éditions dites de troisième famille. Mais l’idée que Dorland ou Martin jettent déjà du ridicule sur les analogies désuètes de Sebond (287-288) de la même façon que le font manifestement certains gauchissements de Montaigne semble douteuse. Au contraire, c’est précisément dans ces passages que percent le plus la verve et l’originalité de la traduction montaignienne. La théorie de l’imagination dont Habert montre les traces contribue certes au phénomène par lequel « la traduction fait apparaître la vérité du dogme, non plus comme le résultat d’une enquête “à but explicatif”, mais comme l’aliment vivifiant de la vie chrétienne » (251), mais il importe de se souvenir que si la traduction développe une tendance piétiste, celle-ci appartient à l’origine à la devotio moderna, et non à Montaigne10. On comprend qu’il ait voulu produire une traduction qui aille dans le sens des goûts de son jour pour rendre « utile en la saison » la traduction entreprise à la demande de son père, mais cela ne présume en rien du statut accordé au dogme catholique par Montaigne.
La conclusion nous propose de « revenir sur le respect et l’humilité qu’encourage la traduction, pour voir de quelle manière Montaigne
invite le lecteur à renoncer à “enjamber de l’homme jusqu’à Dieu” » (250). Pris ensemble, les gauchissements donnent à entendre au lecteur qu’il doit se contenter de ne connaître les vérités divines « “qu’en partie, d’une manière inadéquate, bien que vraie et certaine” » (250)11. En même temps qu’elle « ridiculise les arguments de la raison », la traduction propose ainsi « une solution pragmatique à la question du salut : […] faire confiance […] à l’autorité, se soumettre à la parole de Dieu comme à la seule parole qui ne peut mentir. » (251). Cette conclusion parvient à rendre compte d’une manière cohérente des tendances à première vue contradictoires de la version française, mais on se demande si tous les aspects du style français s’y réduisent, à quel point l’emploi du ridicule ressort d’une stratégie concertée de promotion du respect de la dévotion, et si les envolées lyriques elles-mêmes n’invitent pas à y lire une complaisance littéraire autant qu’un encouragement à l’enthousiasme. En effet, il semble malaisé d’enjamber les broderies autour des passages se prêtant à un certain lyrisme pieux à l’idée que Montaigne souscrirait personnellement à une vision dans laquelle la foi supplée les certitudes ébranlées par le retour de la raison sur elle-même. Si cela fut vrai, il faudrait accréditer une énorme évolution dans les idées de l’essayiste, vu le cynisme de l’« Apologie » au sujet de l’interprétation de la parole de Dieu. Mais en même temps, comme le suggère l’étude d’Habert, la conclusion de l’« Apologie » est là pour nous mettre en garde contre tout congédiement hâtif du rôle structurant du discours religieux dans les Essais. En nous rappelant le profond ancrage de ce discours et en renouvelant notre compréhension de la rhétorique théologique chez Montaigne, l’étude d’Habert permettra d’améliorer l’optique selon laquelle nous abordons l’œuvre montaignienne tout entière.
Edward Tilson
1 Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. « Études montaignistes », no 57, 2010.
2 Les références aux Essais, dans le texte désormais, renvoient à l’édition Villey-Saulnier, Paris, Quadrige/PUF, 1988.
3 Cf. à cet endroit les annotations 737 et 738 dans la numérotation d’Alain Legros sur le cinquième livre du De rerum natura : « Mudus nostra causa creatus non est a diis qui nos non tanti æstimant 385. 113 » (« Le monde n’a pas été créé à notre intention par les dieux, qui n’ont pas pour nous tant d’estime. », trad. Legros) ; « A quoi faire eussent les dieux faict le monde pour nous ». Sur les notes de lecture de Montaigne, on se reportera à l’ouvrage d’Alain Legros, Montaigne manuscrit, Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. « Études montaignistes », no 57, 2010.
4 Montaigne, traducteur de Raymond Sebon, Lille, H. Morel, 1925.
5 Philip Hendrick, Montaigne et Sebond. L’art de la traduction, Paris, Honoré Champion, 1996.
6 Terence McQueeny a le premier signalé cette apostrophe, à laquelle rien ne correspond dans le texte latin des éditions connues du Liber creaturarum. (« Montaigne et la Theologia naturalis », BSAM, Quatrième série, no 9, janvier-mars 1967, p. 41-45).
7 Sur le fidéisme de Montaigne, on se reportera au livre d’Herman Janssen, Montaigne fidéiste, Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1930. Dans le débat pérenne autour de l’« Apologie », les interprétations « fidéisantes » font l’objet d’objections de la part de critiques dont les présupposés sont eux-mêmes différents. À n’en prendre que deux exemples, rappelons la mise au point de Thierry Gontier au nom de la raison montaignienne : « Par ailleurs, la foi n’est pas appelée à remplacer la raison, mais seulement à la tempérer, à lui donner cette discipline qui lui permettra de produire du sens : car c’est bien finalement la raison elle-même qui sera appelée à régler ses propres problèmes dans les Essais. » (De l’homme à l’animal. Montaigne et Descartes ou les paradoxes de la philosophie moderne sur la nature des animaux, Paris, Vrin, 1998, p. 103), et celle de Sylvia Giocanti au nom du scepticisme de l’essayiste : « l’essentiel d’un scepticisme à la fois moderne et radical : une pratique discursive et une éthique qui use de la raison sceptiquement […] de telle sorte qu’elle apprenne à se contenter au sein d’un doute insurmontable. » (Penser l’irresolution. Montaigne, Pascal, La Mothe Le Vayer : Trois itinéraires sceptiques, Paris, Champion, 2001, p. 31). Cf. Emmanuel Naya, pour qui le « fidéisme » est incompatible avec un scepticisme authentique et suppose un dérive néo-académicien dans l’acception du scepticisme, dérive qui est fermement rejetée par Montaigne. Voir « Le doute libérateur : préambules à une étude du discours fidéiste dans les Essais », dans Demonet et Legros (dir.), L’Écriture du scepticisme chez Montaigne, Travaux d’humanisme et Renaissance no 385, Genève, Droz, 2004, p. 201-221.
8 Dans un des passages d’anthropologie comparative les plus osés des Essais, Montaigne commente la pratique, rapportée par Hérodote (III, xii), de certains peuples de l’Inde qui cherchent à honorer le père défunt par l’ingestion d’une partie de ses cendres. L’essayiste ne parle que du corps du père, apparemment pour rehausser les similarités avec le rite eucharistique : « Les peuples qui avoyent anciennement cette coustume la prenoyent toutesfois pour tesmoignage de pieté et de bonne affection, cherchant par là à donner à leurs progeniteurs la plus digne et honorable sepulture, logeant en eux mesmes et comme en leurs moelles les corps de leurs peres & leurs reliques, les vivifiant aucunement et regenerant par la transmutation en leur chair vive au moyen de la digestion et du nourrissement. Il est aysé à considerer quelle cruauté et abomination c’eust esté, à des hommes abreuvez et imbus de cette superstition, de jetter la despouille des parens à la corruption de la terre et nourriture des bestes et des vers. » (« Apologie pour Raimond Sebond », 581, nous soulignons)
9 L’on conçoit par exemple que la thèse avancée sur l’usage de l’imagination conçue comme un exercice pratique et dirigée sur la réactualisation de la présence de l’Autre à travers la remémoration de la Passion puisse anticiper et même contribuer à modeler la pratique de l’essai, à supposer toutefois que la place du Christ soit prise ou du moins redoublée par celle de La Boétie. Mais il ne s’agirait plus dès lors de fidéisme, sinon comme prétexte.
10 Par ailleurs, comme le souligne Olivier Millet, l’aspect orant, performative de la dévotion, est précisément ce qui est atténué dans la traduction de Montaigne. Non pas nécessairement parce qu’il entend en rabattre, mais peut-être bien parce que ni Montaigne ni son lectorat n’appréhendent plus cette esthétique du bas Moyen-âge, les canons de la stylistique ayant été bouleversés par les nouvelles conceptions humanistes. L’article de Millet encourage à soulever le défi monumental de remonter par-delà les habitudes de lecture modernes et les réceptions du Liber creaturarum, à commencer par celle de Montaigne, pour comprendre Sebond sur ses propres termes. Voir « Le langage de la théologie : latin médiéval et éloquence humaniste dans la traduction française de la Théologie naturelle », dans P. Desan (dir.), « Dieu à nostre commerce et société ». Montaigne et la théologie, Travaux d’Humanisme et Renaissance no CDXLIV, Genève, Droz, 2008, p. 139-155.
11 Habert renvoie ici au Dictionnaire de Théologie catholique, Mangenot et Vacant (dir.), Paris, Letouzey et Ané, 1920.