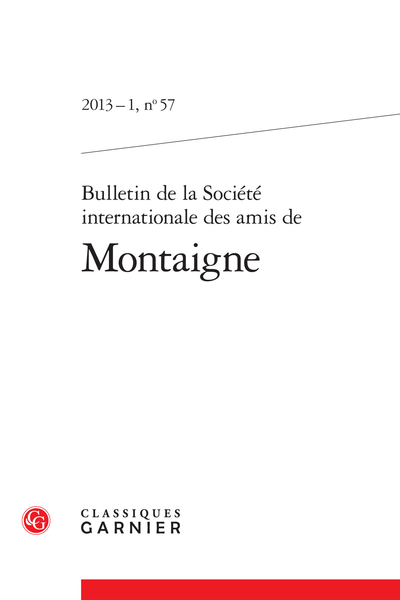
« … au premier que je rencontre » Remarques préliminaires sur le double texte de l’édition de référence (Bompiani, Milan 2012)
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2013 – 1, n° 57. varia - Author: Tournon (André)
- Pages: 81 to 99
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812420368
- ISBN: 978-2-8124-2036-8
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-2036-8.p.0081
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-16-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
« … au premier que je rencontre »
Remarques préliminaires
sur le double texte de l’édition de référence
(Bompiani, Milan 2012)
L’initiative peut sembler bizarre, mais elle a été patronnée, sans doute involontairement, par l’une des principales autorités universitaires et académiques de l’Hexagone. C’est en effet le Professeur Marc Fumaroli qui, affligé de constater que l’œuvre de Montaigne était souvent moins bien comprise par les étudiants français que par leurs condisciples étrangers, a proposé un jour de colloque de prendre pour base de lecture et d’étude non pas ces mystérieux Essais, à considérer comme une première phase de leur propre interprétation (la phase préalable, de production, restant à jamais ensevelie avec Montaigne), mais la phase suivante, une de leurs traductions en langues étrangères, par exemple les irréprochables Saggi de Fausta Garavini ; et enfin, pour dernière phase, retraduire en français cette traduction des Saggi, que l’on rebaptiserait Essais.
L’idée a été appliquée scrupuleusement dans l’édition Bompiani, à un détail près, déterminé par la paresse du préposé à la dernière phase : celui-ci a pensé à tort ou à raison que les Saggi avaient déjà été traduits en français, par un spécialiste incontestable, dès la période 1580-1592, et qu’il pouvait limiter son intervention d’anagnoste à quelques faciles retouches d’orthographe ; ce qui a donné les Saggi mis en français et adaptés par Montaigne à la conjoncture culturelle de notre Renaissance (séquelle honorable du Rinascimento), en « fausses pages », comme de juste, dans le présent volume.
Une plaisanterie ? Plutôt une heureuse surprise : on constate immédiatement que la qualité de l’original italien (un texte d’écrivain, avec ses subtilités propres et ses pouvoirs de suggestion) sollicite un vrai travail de lecture (plus que d’analyse grammaticale ou lexicale) au cours duquel les difficultés sont de prime abord atténuées par des réflexes
d’accommodation presque aussi aisés avec le français des Essais qu’avec l’italien des Saggi. Bref, on comprend.
En voici une épreuve sur échantillon :
Plutarco dice che a visto la lingua latina attraverso le cose. Qui è lo stesso : il senso chiarisce e produce le parole. Non più di vento, ma di carne e d’ossa. Esse significano più di quanto dicono (III, 5, p. 1619)
« Plutarque dit qu’ll vit le langage latin par les choses. Ici de même : le sens éclaire et produit les paroles : Non plus de vent, mais de chair et d’os. Elles signifient plus qu’elles ne disent ».
Il est vrai que le texte, ici, est limpide en français presque autant qu’en italien. Mais voici un autre passage, plus embarrassant, au sujet de la densité sémantique du livre :
Eppure, ch’io posse sbagliarmi se ce ne sone molti altri che ofrono di più come sostanza. E comunque sia, male o bene, se qualche scrittore l’ha trattata in modo più sostanziale o almeno più succoso nelle sue carte.
« Si suis-je trompé si guère d’autres donnent plus à prendre en la matière. Et comment que ce soit, mal ou bien, si nul écrivain l’a semée ni guère plus matérielle, ni au moins plus drue en son papier » (I, 40, p. 450)
Je ne me hasarderai pas à expliquer le tour français, qui introduit l’éventualité d’une erreur pour exploiter l’ambivalence de l’adverbe « guère », compliqué à sa seconde occurrence par la semi-négation « nul », de manière à accréditer indirectement l’hypothèse la plus flatteuse pour l’écrivain, sans la déclarer exacte ; le travail serait difficile, mais surtout superflu puisque la version italienne éclaire immédiatement le sens du texte, comme on le constatera au prix d’un simple effort d’attention. Quant à rendre compte des contorsions syntaxiques de l’autre version, c’est une question de style, pour amateurs de subtilités ; la version des Saggi permet de franchir le pas embarrassant sans trop s’y attarder.
Mais dès lors, que restait-il à faire devant la version française des Saggi ? En deux mots :
– donner à voir ce qui n’était pas clairement visible dans l’édition de 1998 ;
– surtout, faire entrevoir, de façon plus téméraire, une partie au moins de ce qui n’avait pas été entrevu dans cette même édition.
Il faudra insister sur la seconde étape, pour tenter de donner un sens aux réactions de strabisme plus ou moins volontaire enregistrées tout au long des siècles précédents.
Ce dont on détourne les yeux…
Une photocopie particulièrement révélatrice permettra d’apprécier à la fois l’évidence du « langage coupé » et les effets d’intimidation qui en ont procédé, jusqu’à bloquer les processus de lecture. C’est le cas du chapitre 10 du premier livre – cas extrême, mais loin d’être unique. Dès que le lecteur médusé au premier abord devant la profusion des graphèmes manuscrits de segmentation (dont 80%, pour ce chapitre, sont ignorés par les éditeurs posthumes) a vraiment ouvert les yeux, il constate sans difficulté qu’il a sous son regard une articulation surajoutée à la ponctuation imprimée en 1588. Et séparable : il existe aussi à la même époque un mode d’articulation sans ponctuation (au sens strict du terme : découpage du texte par des signes appropriés, virgule, point-virgule etc.) où le texte n’est subdivisé que par des majuscules de scansion placées en tête de certains syntagmes. Il se rencontre régulièrement, identifiable à l’état pur, dans deux types d’écrits codifiés : les écrits testimoniaux, dépositions ou testaments, et les sentences (dicta) de la Chambre des Enquêtes ; et il est attesté par les autographes de Montaigne. Notre propos s’inscrit dans ces limites : il ne s’agit pas ici d’inventorier les documents susceptibles de ce traitement, ni d’évaluer la régularité de son application, mais seulement de constater que Montaigne en respecte les règles tacites chaque fois que ses écrits prennent place dans la même catégorie de textes susceptibles d’être allégués. Il nous faudra revenir sur cet aspect de la question. Quoi qu’il en soit, Montaigne s’abstient de recourir aux signes de ponctuation pour les articuler. Négligence ? ce serait bizarre, compte tenu de l’importance légale de ces textes et du rang de leurs destinataires (le président de la Grand’Chambre pour les dicta, et le maréchal de Matignon pour les missives). Singularité aberrante ? Il ne faudrait pas se laisser fasciner par le modèle en question au point d’oublier que les Essais, eux, étaient
ponctués selon les règles grammaticales (par l’imprimeur), avant d’être aussi scandés par majuscules autographes. Il sera nécessaire de prendre en compte cette double donnée massivement attestée dans l’Exemplaire de Bordeaux (ci-après « EB »).
Enfin, pour compliquer un peu la question, on observera sur les photocopies d’EB que la ponctuation des additions manuscrites de quelque étendue est très souvent lacunaire : beaucoup de virgules et même de deux-points y sont omis. L’anomalie signalée ci-avant serait donc elle-même faussée par une anomalie en sens contraire ? Autrement dit, ce même Montaigne qui ajoute de sa propre main, minutieusement, entre 1588 et 1592, des milliers de segmentations par majuscules de scansion dans le texte de l’EB, aurait négligé de placer correctement des centaines de signes de ponctuation requis par la syntaxe de ses additions autographes dans le même texte. Bizarre…
Il s’agira ici de faire apparaître la cohérence et le sens de l’ensemble des pratiques adoptées par Montaigne, surtout là où l’on croit les prendre en défaut. C’est, pour le texte français, la gageure soutenue par l’édition Bompiani, nous verrons comment (p. 2277-2303, et voir ci-après).
Il faut bien l’avouer, une éminente grammairienne a déjà proposé une explication assez péremptoire pour couper court à nos embarras : Montaigne ne comprenait rien à la ponctuation1. La théorie est aussi claire qu’audacieuse, et nous éviterait bien des efforts. Mais elle reste conjecturale…
Notre propre explication sera nettement moins conjecturale, et surtout moins audacieuse : nous ne comprenons rien au système de segmentation autographe mis en œuvre par Montaigne ; et le premier travail, pour qui n’est pas historien patenté de la langue, est de l’élucider.
L’écrivain nous y aide, discrètement. Il utilise concurremment la ponctuation d’une part (dans la plupart des cas, celle de la version imprimée en 1588) qui régit les combinaisons de propositions à l’intérieur des phrases, et d’autre part les marques de ce qu’il appelle son « langage coupé » (de majuscules et accessoirement de points), régi par ce que j’appellerai ici la scansion, qui jalonne seulement la succession des énoncés, de quelque
nature qu’ils soient, en marquant le début de certains d’entre eux par des majuscules, à la première lettre du syntagme ainsi privilégié.
Quant à la ponctuation, il a déclaré dès 1588 qu’il s’en remettait volontiers aux imprimeurs, techniciens de l’écriture qu’il tient pour plus experts que lui :
Je ne me mêle ni d’orthographe : et ordonne seulement qu’ils suivent l’ancienne : Ny de la ponctuation : je suis peu expert en l’un et en l’autre. (III, 9, p. 1790)
On remarquera incidemment la retouche de scansion (ny surchargé en Ny) donnée pour étrangère à la ponctuation proprement dite, avec un aveu d’incompétence qui excuse galamment les propos de la grammairienne de l’avenir. La surcharge autographe n’en implique pas moins son droit d’écrivain, de mettre le syntagme en vedette en donnant forme de majuscule à sa lettre initiale2. Ce qui nous amène à la scansion proprement dite.
Montaigne use et abuse de ce droit, un peu partout, à sa convenance ; il n’hésite pas à bousculer les continuités syntaxiques – ainsi dans cette phrase risquée, sur l’éducation des jeunes gens :
… qu’on rende hardiment un jeune homme commode à toutes nations et compagnies. Voire au dérèglement et aux excès, si besoin est. (I, 26, p. 302)
En 1582 le propos avait été déclaré suspect par la censure romaine ; l’écrivain le maintient, en marquant sa fonction de surenchère par une majuscule de scansion accompagnée d’un point, comme pour le transformer en déclaration autonome. Élan polémique ? peut-être. Mais des aveux d’embarras et d’indécision, sans risque de censure ni incitation à regain d’audace, reçoivent un traitement tout aussi insistant. Il en est ainsi, au sujet de prétendus prodiges, de la découverte, par le penseur, de sa propre étrangeté, rehaussée d’une surprenante inflexion des effets de la connaissance de soi :
Je n’ai vu monstre et miracle au monde plus exprès que moi-même : On s’apprivoise à toute étrangeté par l’usage et le temps, Mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m’étonne. Moins je m’entends en moi (III, 11, p. 1914)
On trouvera aisément des cas de ce genre. Ils sont bien moins nombreux cependant que ceux qui ne manifestent pas la moindre trace de témérité ou de trouble, et même ne marquent aucune inflexion sensible des versions de 1580-1588. Reste donc à comprendre quelle exigence requiert la fréquence surprenante de ces marques de scansion sans signification apparente.
Ce que l’éditeur de 1998 n’avait pas compris
Sur ce point, pas de déclarations explicites ; mais une pratique régulière, dans un secteur bien visible : la segmentation des arrêts rédigés par le rapporteur Montaigne et proposés à titre de dictum de la Chambre des Enquêtes pour être « prononcés » et de ce fait validés par le président de la Grand Chambre. Nous disposons maintenant de dix de ces documents autographes, grâce aux recherches de Katherine Almquist, soit en tout une quinzaine de pages (d’autres s’y ajouteront, à brève échéance, issues également des dossiers de notre collègue, dont le regard amical s’est prématurément éteint en décembre 2012, non sans avoir orienté et jalonné les recherches à venir)3. Aucun de ces documents n’est ponctué, au sens strict du terme. Tous, en revanche, sont articulés sommairement par des majuscules de scansion en tête de chaque phase de l’écrit (identité des partenaires du procès, liste des actes enregistrés, formule de la future sentence (« Il sera dit… »), précisions sur ses conditions d’exécution, liste des signataires, « épices » dues au rapporteur). Pratique requise dans la procédure ? Simple routine en vigueur à la Chambre des Enquêtes de Bordeaux ? Quoi qu’il en soit, Montaigne n’y manque jamais. Son usage est analogue dans les 21 missives qu’il envoie à Matignon et aux jurats (sauf dans celle du 22/5/1585 : deux points, aux 20e et 21e lignes). En dépit de leur vivacité, à saisir comme expression de confiance partagée, ce sont aussi des documents officiels, qui engagent la parole du scripteur sur des informations capitales en
temps de troubles4. La ponctuation proprement dite en est absente, à deux exceptions près5.
Trait commun de ces documents : ils sont susceptibles de faire foi. L’expression mérite attention. Elle met en jeu l’assentiment aux propos d’un partenaire, et comme par réciproque l’assentiment qu’on attend de lui (la fides, confiance en ce qu’on me déclare et loyauté de mes propres déclarations) – tout cela en termes d’attitudes. Mais noter, dans l’appréciation des dires d’une personne en cause, que telle déclaration « fait foi », c’est joindre à l’assentiment personnel la reconnaissance de la fonction probatoire de l’indice qui en est donné. Je fais confiance à Pierre par estime personnelle, mais je suis aussi mis en demeure de le croire en vertu du document ou du cachet qui fait foi de son identité et de la fonction testimoniale de ses déclarations, qui lui est liée. C’est ainsi que la notion éthique de fides, sans que soit escamotée la contingence originelle des gestes et propos qu’elle accrédite, peut prendre, notamment par réitération solennelle de la profération ou confirmation expresse de sa trace écrite, une valeur juridique fondamentale dans le système de confiance et de conventions mutuelles qui devrait assurer la cohésion de la cité (voir La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Vrin 2002, p. 31 et 51).
Encore faut-il pour cela que l’exactitude et la portée des allégations soient reconnues officiellement, et entérinées enfin par l’ensemble de la procédure. Nous sommes au point de croisement de l’éthique et de la pratique légale, là où les paroles doivent être tenues pour définitives, sous la responsabilité de ceux qui les ont prononcées ou approuvées.
Reste à voir ce qui peut associer ce statut particulier des divers écrits considérés ici à la segmentation par scansion. Mais avant d’émettre une hypothèse sur ce point, il paraît nécessaire de reconsidérer les données
matérielles du phénomène qui nous intéresse. Pour quelque 75% des cas, ce sont des retouches qui ne modifient guère la signification des énoncés où elles s’inscrivent. L’acquis, répétons-le, n’est pas prometteur pour le lecteur en quête de surcroîts de sens. Mais qu’en est-il pour l’écrivain lui-même, et pour le « suffisant lecteur » dont il postule la coopération face à son travail, lorsqu’est examiné, et signalé à notre attention selon la formule de Gabriel-André Pérouse, « ce qui se dit dans le texte » ? Vient au premier plan, d’abord, le fait même de la retouche manuscrite, saisi comme événement scriptural, et il n’est pas négligeable : il signifie que les lignes écrites entre un et quatre ans auparavant, en 1588, sont réassumées maintenant par leur ancien signataire, comme contexte indissociable de la retouche matérialisée par quelques traits de plume ; il signifie également que le tracé typographique n’était pas définitif, puisque ces traits de plume l’ont modifié un jour, si peu que ce soit, entre 1588 et 1592, et prévalent désormais contre lui à titre de corrections. En somme, ce signe composite, imprimé et manuscrit, qui sera mentionné ici sous le nom générique de typographème, apparaît dans les retouches de scansion, soit en plus de quatre mille occurrences dans les Essais, pour y faire percevoir discrètement, à chaque fois, les effets contrastés d’une initiative en suspens : en l’inscrivant l’écrivain rappelle la souveraineté qu’il exerce sur son texte (il accuse et entérine l’énoncé primitif – assertion ou tout aussi bien doute) et la précarité de ce même texte, concrétisée par ses variantes graphiques et spécialement (mais pas seulement) en celle qu’il retouche ; et si son geste ne change presque rien à l’énoncé antérieur, il prend figure d’intervention à l’état pur, attestant la malléabilité de la parole souveraine, ou aussi bien la souveraineté de la parole malléable, postulée par la seule possibilité de la retouche.
Ce n’est pas négligeable. Réitéré tout au long des Essais, ce geste vaut pour réappropriation, au présent de l’écriture (à distinguer du présent de ce qui serait une biographie intellectuelle6), de déclarations que l’on pouvait croire en voie de péremption, d’hésitations que l’on aurait pu oublier comme si les conclusions les annulaient. Les questions en sont parfois éclairées ; elles gagnent parfois un surcroît de complexité lorsqu’elles sont marquées d’inflexions inattendues, parfois un surcroît de netteté ou de véhémence – à titre provisoire, puisque le choix confirmé
peut toujours être remis en cause par un autre trait de plume. Telle est, surplombant le message et déterminant le statut de celui-ci au seuil de sa profération, la double signification, contrastée, du typographème : il matérialise l’intervention du scripteur, la fait saisir comme instantanée et tend à la fixer. Reste en tout état de cause qu’une instance seconde s’est manifestée, et a ratifié ou critiqué l’opinion antérieure. Et c’est par ses interventions que se pose littéralement le problème de la véracité du livre, et de l’éthique qui peut en procéder. Jean-Yves Pouilloux a montré comment l’écriture telle que la pratique Montaigne, distanciée par le promptitude de la pensée, ménage à tout instant « un temps de battement par où peut naître la conscience, et se former la pensée […], battement de temps qui peut permettre une reprise, une intelligence d’attention, une ouverture d’accueil à ce qui vient […] et à prendre la mesure de l’écart qui s’est produit entre “moi” autrefois qui enregistra telle disposition ou pensée, et “moi” aujourd’hui qui me relis avec surprise […] ». Munis de concepts plus catégoriques, les juristes de la Renaissance savaient qu’une parole impromptue était révocable, mais que cette même parole, confirmée officiellement devant des tiers et après réflexion, ne l’était plus, sinon par rétractation solennelle et aveu de témérité. Est attendue une attestation réfléchie.
La conception même du typographème résume tout cela. Mieux, elle indique discrètement dans quel mode de pensée et d’expression se situe l’énoncé ainsi distingué. Privilégié par la majuscule inscrite en surcharge de sa première syllabe, donc à son début, il se donne comme profération, à l’initiative de qui le prononce : parole d’autorité ou de responsabilité, reconnaissable jusqu’en sa graphie, comme l’étaient les déclarations officielles des hauts personnages ou, tout simplement, des fonctionnaires accrédités ; mais aussi, dans le domaine privé, toutes les formes d’attestations, du certificat occasionnel jusqu’au testament.
C’est là que l’on entrevoit un rapport significatif entre le « langage coupé » et les types de documents où les scribes appliquent la règle la plus insolite à nos yeux – l’élimination des signes de ponctuation d’usage courant. Ce phénomène a été reconnu et décrit avec précision, notamment par Sandro Bianconi dans le domaine italien7, mais les explications proposées ne paraissent pas rendre compte de l’aspect systématique de
cette carence de segmentation, ni de l’exception elle-même systématique – le surcroît de segmentation dû aux majuscules de scansion – dont elle s’accommode. Quant à trouver des règles propres à expliquer ces deux phénomènes opposés ou complémentaires entre eux, ce n’est pas facile, et il est souvent admis que les caprices des scripteurs brouillent le jeu. (cf. p. 61). Compte tenu cependant des conditions concrètes d’enregistrement des décisions judiciaires et des données verbales sur lesquelles elles pouvaient se fonder, en une époque où la majeure partie des justiciables étaient illettrés, on peut accorder crédit, sous réserve de vérifications à plus grande échelle, à l’hypothèse explicative la plus simple qui soit, formulable en quatre mots : la ponctuation ne s’entend pas. Ce qui signifie seulement que le scribe qui rédige sous la dictée le procès-verbal d’une sentence, d’une déposition, d’un testament, bref de tout document susceptible de faire foi, doit bien noter tous les mots qu’il entend prononcer, mais n’a pas le droit de consigner dans son texte ce qui n’y est pas dit, ni par conséquent entendu : « virgule », « deux-points », etc. – apports étrangers à la chaîne d’énoncés, et dont la nomenclature et l’emploi, du reste, sont loin d’être fixés au xvie siècle. Une seule donnée autre que verbale peut et doit être notée, c’est la profération, qui rompt le silence d’attente dans le prétoire, répond à une sommation ou interrompt une parole tierce ; pour la distinguer dans l’écrit qui enregistre la déclaration de l’intéressé, il faut et il suffit qu’un indice visible en marque le début. On a reconnu le rôle d’une majuscule de segmentation. Il peut être accentué par un alinéa, ou par l’emploi de la graphie en capitales pour la désignation emphatique du scripteur, les débuts d’injonctions, la délimitation de leur champ d’application, l’identification des sceaux qui en attestent l’authenticité de parole royale, ou émanée du roi et confiée à ses officiers pour exécution. Tous ces procédés sont marques de pouvoir, jusqu’aux moins spectaculaires d’entre eux, ces traits de plume en surcharge qui suffisent à transformer une minuscule en majuscule. Tous portent les échos ou résonances d’un choix personnellement assumé.
Nous voici donc bien loin de Montaigne et de son ironique modestie ? – Non. Car tout en jalonnant ses pages des emblèmes visibles de cette
parole d’autorité, il s’inscrit en faux, à toute occasion, et spécialement dans les incipit du « troisième allongeail8 », contre le prestige qu’elle pourrait lui valoir ou dont il pourrait se réclamer, contre les « figures de fiction » auxquelles il risquerait de se laisser assimiler, contre le semblant de consistance dont il croirait bénéficier : de tels leurres sont dissipés par « le constat impitoyable du penseur » (J.-Y. Pouillloux, ibid. p. 6-7, citant II, 1, p. 594, « Non seulement le vent… » et 598, « Nous sommes tous de lopins… »). Si bien que l’énergie du « langage coupé » est mise au service de ce disinganno ravageur autant que libérateur dont Nicola Panichi a retracé les voies. Mais l’alternative, ici, ne se résout pas en un choix exclusif qui laisserait subsister un seul des deux termes, soit le sage censé édicter magistralement son éthique personnelle (III, 2, p. 1492, « J’ai mes lois et ma cour… »), soit le « badin », jouet des « circonstances extérieures, changeantes, variables et fugitives, écrit encore J.-Y. Pouilloux, qui me font ce que je suis bien obligé d’appeler “moi” ». Isolées et opposées, ces « déterminations imaginaires » se bloquent en vue d’un affrontement sans issue. Dans le réel, elles se composent en disparates difficiles à corréler, et pourtant vécues au jour le jour, à l’écart de la trompeuse cohérence des « figures de fiction » (J.-Y. Pouilloux, p. 6), leurres du savoir, du pouvoir ou des avantages qu’ils procurent, et dont Montaigne travaille à se détourner. Car le paradoxe majeur des Essais est d’investir dans la quête sans terme d’un pyrrhonisme régénéré toute l’énergie d’une dépossession qui se tourne en affranchissement : c’est précisément parce que Montaigne s’est détaché de tout ce qui pouvait définir les contours d’une place et d’une fonction assignée, qu’il peut parler vrai, être lui-même dans le flux des événements et des mots, avec à tout instant un éclair de conscience dont il puisse témoigner.
J’ai employé le verbe « témoigner », à escient. Car cette notion, avec le système dans lequel elle s’inscrit, atteint un point critique dans la pensée et le vocabulaire judiciaires, au cours de la carrière de Montaigne, plus précisément en l’année 1566, soit neuf ans après son entrée au Parlement de Bordeaux et cinq ans avant la résiliation de son office, lorsqu’est promulguée l’Ordonnance de Moulins. L’article 54 de celle-ci modifiait radicalement les conditions et la portée des « preuves par témoins » en matière civile. Jusqu’alors, le brocart « témoins passent lettre » tendait
à faire prévaloir la déposition testimoniale, parole vive, proférée sous serment devant le magistrat, parfois précisée à son instigation, contre les documents écrits (de donation, transaction, contrat…), signes figés, incapables d’adaptation. La nouvelle ordonnance stipule au contraire que désormais les témoignages ne seraient reçus par les tribunaux que si la valeur des biens en litige ne dépassait pas cent livres : au-delà, il faudrait un acte notarié ou un document écrit équivalent, certifié par l’instance d’accueil, pour leur donner valeur probante. Motif, selon l’explication des commentateurs du temps : les témoins et ceux qui les allèguent sont toujours suspects de subornation. Ce principe de défiance était contraire à ce qui pouvait subsister de l’éthique séculaire de la fides, du serment devant Dieu, de la « parole de gentilhomme » etc. : dans l’esprit de l’ordonnance, tout témoin était présumé corruptible, en vertu même de ce que sous-entendent les nouvelles règles de la procédure judiciaire qui interdisent aux juges de recourir aux témoignages dès que l’affaire a quelque importance.
Passons sur cette « nouvelleté », qui sur le moment a fait scandale, selon Boiceau qui rappelle les objections auxquelles elle se heurtait (Préface, § 1-7) – bien qu’il la défende autant qu’il le peut (§ 8-9) – mais est restée en vigueur, avec des clauses de plus en plus contraignantes jusqu’à la fin de l’ancien régime. Montaigne n’en a pas traité, mais il n’a pas pu l’ignorer : il fallait la prendre en compte, dès la fin de 1566, dans les litiges sur lesquels la Chambre des Enquêtes (cantonnée dans les affaires de droit civil) devait se prononcer, sinon même, pour les causes venues en appel, sur des dossiers enregistrés avant 1566 mais avec des données dont certaines n’étaient plus recevables. On entrevoit, dans ces conditions, les problèmes que pouvait poser à l’ancien conseiller des Enquêtes le statut de la parole d’autorité. Mais tenons-nous en aux Essais, et plus spécialement au chapitre où Montaigne paraît réfléchir sur ce qui peut légitimer ses monologues intérieurs, où il récuse tout autre garant que lui-même et son livre9. En vertu de l’esprit de suspicion qui caractérise la nouvelle procédure, une dernière difficulté, massive, fait obstacle à l’entreprise définie dès l’avis Au Lecteur, et à la « bonne foi » qu’elle requiert ; et c’est l’écrivain qui la formule : « Mais à qui croirons-nous parlant de soi, en une saison si gâtée ? vu qu’il en
est peu, ou point, à qui nous puissions croire parlant d’autrui, où il y a moins d’intérêt à mentir10 ? ». Ce n’est pas là une boutade incidente. Les chapitres xvi, xvii et xviii du livre II, syntaxiquement liés par deux de leurs incipit (p. 1168, « … une autre sorte de gloire » et 1228, « Voire mais on me dira… »), traitent méthodiquement des aspects fallacieux de la « gloire » ; en réplique, faisant l’essai du regard de l’écrivain face à sa propre image, ils conduisent à une éthique de l’estime de soi, sans complaisance comme sans dépréciation, sur des principes d’équité esquissés dans une longue addition au seuil du chapitre « De la présomption » (II, 17, p. 1172 : « Il me semble premièrement ces considérations devoir être mises en compte… »). Et voici que cet acquis est remis en question jusqu’en ses plus profondes assises : si l’image est fallacieuse, tout est leurre, la conception et la publication des Essais, le rapport à autrui qui s’y dessinait, tout cela n’est pas plus accrédité qu’une fiction de « badin ». Devant son propre témoignage l’écrivain partagerait ainsi la défiance requise, à moins que sa voix ne se perde dans un murmure collectif d’incrédulité ? Dans tous les cas, la présomption de mensonge paraît l’emporter.
Cela dit, il n’en sera guère question. Passé les réprobations attendues, le propos est réorienté, conformément au titre, vers les « divers usages de nos démentirs »… dont il ne sera pas davantage question : « je remets à une autre fois d’en dire ce que j’en sais » ; et tout se réduit à constater que les usages ont changé : jadis les hommes d’honneur échangeaient jusqu’à des invectives, et s’en tenaient là ; maintenant ils s’entretuent. Susceptibilité poussée à l’extrême, et aggravée par la codification des rôles liés au « point d’honneur » ? L’hypothèse proposée ici par Montaigne, pour expliquer l’acharnement dans les duels, est toute contraire, et en même temps très différente de celle que fait entrevoir plus loin le titre provocateur « Couardise mère de la cruauté » (II, 27), où tout est imputé à la lâcheté des duellistes censés tuer ou faire tuer prudemment leurs ennemis pour se soustraire à leur vengeance. Ici, rien de tel : derrière le trait de mœurs attesté par l’Histoire on voit
se profiler en paradoxe logique le recours au silence des épées pour répondre à un démenti : geste spectaculaire qui revient à masquer un usage de l’insincérité dont personne n’est dupe en l’élevant au second degré : j’accréditerai mon mensonge en défiant celui qui tente de rétablir la vérité. Et ce singulier critère est tenu pour conforme au code du champ clos puisque celui-ci stipule que le partenaire qui a proféré un outrage ou une calomnie est l’« offensé », et a le choix des armes, si son adversaire a déclaré « vous en avez menti », prononçant ainsi « l’extrême injure qu’on nous puisse faire de parole » (II, 18, p. 1234). Par de telles conventions les comportements réels sont métamorphosés en spectacle, exception faite de l’effusion de sang sur laquelle ils doivent s’achever ; et Montaigne n’en paraît pas surpris : « Sur cela je trouve qu’il est naturel11 de se défendre le plus des défauts dequoi nous sommes le plus entachés. Il semble qu’en nous ressentant de l’accusation, et nous en émouvant, nous nous déchargeons aucunement de la coulpe : si nous l’avons par effet, au moins nous nous la condamnons par apparence » (ibid.). Le duel même instaure la prédominance de ce faux-semblant, puisqu’il éclipse la seule question pertinente : les propos de Paul qui affirment la culpabilité ou l’indignité de Pierre, sont-ils fondés sur les faits ? Cette dernière formule est grossièrement simplifiée, sans doute, et les moindres rudiments d’éloquence suffiraient à la compliquer à plaisir, mais c’est bien sous cet aspect sommaire qu’elle devient lisible pour le commun des mortels, et pour les tribunaux chargés d’arbitrer les dissentiments afin que soit assurée la concorde civile.
L’interruption explicite des propos annoncés sur le « démentir » – et non pas sur le mensonge comme on pouvait s’y attendre – a pour effet de signaler comme étrange le brusque silence du philosophe, et de lui faire prendre l’aspect d’une réticence : quelque chose devait être déclaré, et n’a pas été prononcé, ni écrit, le greffier nous le fait savoir. Le procédé est connu des lecteurs des Essais : c’est ainsi que Montaigne mentionne avec insistance, à trois reprises12, l’absence du texte qu’il avait prévu d’enchâsser au centre du livre I, le Discours de la servitude volontaire, placé sous rature dès avant 1580, mais défini dans le chapitre « De l’amitié » par son titre, par son orientation générale indiquée d’un trait (il était écrit « en l’honneur de la liberté, contre les tyrans ») et par le rôle que
lui assignait l’ami de La Boétie dans la fraternité spirituelle et politique que ce Discours aurait inaugurée. Symétrique du silence, la prétérition marquée des propos annoncés au sujet des démentis donne à penser qu’on se trouve ici en présence d’une censure discrète, comme si l’accès au vrai comportait un malaise – mais quel malaise, et que signifie-t-il ?
« … au premier que je rencontre »
Un détour supplémentaire du côté de La Boétie pourrait nous mettre sur la voie, ou du moins nous aider à mieux cerner la part du silence, ombre portée du désir de « s’expliquer13 ». Dans le Discours de la servitude volontaire est évoquée comme incidemment la condition de ceux qui ont « gardé maugré le temps la dévotion à la franchise » (= liberté et franc-parler) même sous le régime tyrannique. Déception : leur « bon zèle […] demeure sans effet pour ne s’entreconnaître point : la liberté leur est toute ôtée, sous le tyran, de faire, de parler et quasi de penser : ils deviennent tous singuliers en leurs fantasies ». Il n’est pas question d’une persécution des justes, mais bien d’une incapacité collective à prendre conscience des valeurs civiques telles que les concevaient les humanistes du xvie siècle, d’après leurs modèles hérités de l’Antiquité ; et de son corollaire, le sentiment de mésentente et de méfiance dont la possibilité permanente risque de fausser les rapports humains. Rien de surprenant à voir Montaigne s’élever contre la mauvaise foi des intrigants et exprimer sa nostalgie de la sincérité dans les relations politiques, présumées gangrenées par la ruse ; reste que son chapitre « Des menteurs » expose deux cas de mensonges rendus obligatoires par la déontologie des diplomates chargés de plaider les causes de leurs princes – le second spécialement, taxé de trahison et encourant la mort pour n’avoir pas su dissimuler ses réticences devant les alliances qu’il devait faire conclure en vue des guerres d’Italie ; cela se voit encore plus clairement dans les versions de 1580 et 1582, puisque les considérations proprement morales n’apparaissent qu’ensuite (dans les strates de 1588 et 1592). Un exemple
plus complexe, de feinte assortie à la franchise, est présenté en détail dans le chapitre « De la physionomie ». Un voisin a projeté de s’emparer du château de Montaigne ; il y pénètre, sous prétexte de chercher refuge, et y fait entrer son escorte, par petits groupes ; Montaigne devine la manœuvre, trop tard pour avoir les moyens de s’y opposer, et se résout à tirer parti de son rôle de naïf : « Tant y a que, trouvant qu’il n’y avait point d’acquêt d’avoir commencé à faire plaisir, si je n’achevais, et ne pouvant me défaire sans tout rompre : je me laissai aller au parti le plus naturel et le plus simple – comme je fais toujours – commandant qu’ils entrassent. Aussi, à la vérité, je suis peu défiant et soupçonneux, de ma nature » (III, 12, p. 1974). Est-ce confiance spontanée, ou calcul ? La seconde hypothèse est dictée par le récit, la première, par le commentaire que cautionne surtout l’épilogue attribué à l’agresseur ; « Souvent depuis il a dit […] que mon visage et ma franchise lui avaient arraché la trahison des poings » (p. 1976). Montaigne juxtapose les deux lectures et résout l’alternative en imputant son salut à « la fortune » d’une mutation imprévisible. Quant à lui, sa « franchise » coïncide avec un choix propre à masquer l’hostilité mutuelle. Rien de choquant dans cette habileté, mais elle présuppose les rapports d’antagonisme qu’elle serait censée dissoudre s’il s’agissait d’un pacte14.
Or, justement, il ne s’agit pas d’un pacte, mais au mieux d’un instant de trêve dans les affrontements, tenus pour permanents sauf exceptions dues à l’intervention de « la fortune ». Ainsi est accréditée l’image d’une société bouleversée par une crise des valeurs, qui aux liens de solidarité substituerait des calculs d’« avantages » à obtenir, à l’occasion par traîtrise15. Dans ces conditions, on peut comprendre que Montaigne se soit acharné à confirmer ses propos, même encore indécis, surtout encore indécis, avec pour seule caution sa parole de personnage privé que rien ni personne n’accrédite, et qui pourtant doit être entendue. On ne s’étonnera pas de le voir s’inscrire en faux, avec une rare véhémence, contre tout ce qui déformerait ses pages passées et présentes, seules
trace de la véracité qui constitue, pour lui et pour ceux à qui il veut s’adresser, sa vérité d’homme « de la commune sorte16 ».
Tel est le motif qui a incité les responsables de l’édition Bompiani à placer entre l’apparat critique traditionnel (présenté sous le titre de « Varianti », p. 2089-2271) et les notes explicatives (« Note », p. 2307-2441), un Appendice (p. 2274-2303) où sont recensés tous les passages de la version imprimée en 1588 que Montaigne a retouchés (le plus souvent par typographèmes, sans additions notables) entre 1588 et 159217. Le but n’était pas de détailler l’histoire du texte, mais de faire apparaître les traces visibles de la confrontation du philosophe avec sa propre pensée, naguère fixée par les pages qu’il avait fait « mettre en moule » (III, 13, p. 2014), et maintenant tout à la fois remodelée et ratifiée par des signes muets, prêts à être ramenés en quelques traits de plume à la mobilité calligraphique. Cet extraordinaire document d’une pensée en perpétuel travail, novatrice jusqu’en ses hésitations, ferme dans la conduite de ses méditations et de leurs arborescences imprévisibles, voilà ce qui apparaît sur l’EB, par endroits de façon fulgurante, mais le plus souvent avec une telle discrétion qu’on hésite à l’interroger.
Et pourtant il faut l’interroger les difficultés à prévoir pourraient s’aplanir assez vite si l’on prend au sérieux, et surtout à la lettre, l’avis que donne Montaigne à l’orée de son troisième livre :
Personne n’est exempt de dire des fadaises. Nae iste magno conatu magnas nugas dixerit. Cela ne me touche pas. Les miennes m’échappent aussi nonchalamment qu’elles le valent. D’où bien leur prend. Je les quitterais soudain, à peu de coût qu’il y eût, Et ne les achète, ni les vends, que ce qu’elles pèsent. Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre. Qu’il soit vrai, voici dequoi (III, 1, p. 1458).
Le terme de « fadaises » paraît un peu vif. Pourtant, compte tenu de la critique de la connaissance exposée méthodiquement dans l’« Apologie de R. Sebond » et dans le dernier chapitre du livre II (autrement dit le
dernier des Essais, jusqu’en 1588), il est approprié à son objet : les propos du « philosophe imprémédité et fortuit » (II, 12, p. 998) n’ont rien qui puisse leur assurer le crédit qu’ils ont dénié à tous les autres. Sous cet aspect, la continuité est parfaite entre la fin du livre II et le début du livre III. Toutefois les déclarations de nonchalance et d’indifférence laissent la place à une affirmation toute nouvelle, qui forme exactement le point de suture entre ce qu’annonce le prologue et ce qu’est censée démontrer la suite du livre : « Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre. Qu’il soit vrai, voici dequoi ». Le lecteur confiant qui prendra au sérieux la suite du texte (et comment ne pas la prendre au sérieux ? surtout en cette fin du xvie siècle où le désarroi est total en France – voir III, 9, p. 1772-1784, ou III, 12, 1936-1940) est tenu par la logique de prendre aussi au sérieux la proposition dont cette suite est indissociable ; non les évaluations désinvoltes des « fadaises » (qui pourraient aussi bien être nommées « fantasies »), mais l’allusion à quelque partenaire anonyme à qui pourrait s’adresser Montaigne au hasard d’une « rencontre ».
Tout serait donc fortuit dans cet échange virtuel d’on ne sait quels propos, tout serait réductible à des « fadaises » peut-être dénuées de sens ?… – La conclusion serait hâtive, et finalement erronée. Car les propos, on est en droit de les identifier au chapitre ici commencé, ou au livre, ou à ce qu’on y découvrira, et c’est déjà beaucoup pour qui songe aux discussions entre Socrate et ceux qu’il rencontre, ou entre Diogène et ceux qu’il interpelle en pleine rue. Mais là n’est pas l’essentiel. Compte avant tout, comme condition de possibilité du dialogue, non le savoir à échanger, ou le sérieux des questions, mais le contact initial avec le premier venu, anonyme par définition, avec l’ébauche de confiance qu’il présuppose. Cela coïncide avec l’attitude définie par Montaigne dans son « art de conférer », trop brièvement « Mon humeur est de regarder autant à la forme qu’à la substance, autant à l’avocat qu’à la cause […] (C) Et tous les jours m’amuse à lire en des auteurs sans soin de leur science : y cherchant leur façon, non leur sujet. Tout ainsi que je poursuis la communication de quelque esprit fameux, non pour qu’il m’enseigne, mais pour que je le connaisse » (III, 8, p. 1722). À vrai dire, les exigences intellectuelles exposées dans le même chapitre rendent improbable l’entretien avec n’importe qui ; mais justement il fallait les négliger, comme il fallait appeler « fadaises » ce que mettrait en jeu
« quelque esprit fameux », comme il fallait savoir faire abstraction des prestiges et agréments de la conversation aristocratique, qui pouvaient intéresser le père spirituel de Marie de Gournay. Il fallait placer l’accent sur l’interpellation réitérée, avec signature anonyme marquée à chaque début d’énoncé, pour scander chaque rupture et reprise du discours, afin que soit rendue perceptible par agencement textuel l’aventure d’une parole adressée à chacun et à personne, où doit transparaître la volonté de liberté et de solidarité civique. Celle qu’avait évoquée La Boétie bien avant que son « frère », en mémoire de lui, en eût disséminé les traces dans ses propres Essais – jusqu’à y faire prévaloir, contre les cérémonies et comédies des tréteaux, le simple échange de regard et de paroles qui rapproche par instants les hommes, et restitue sa vérité à ce qui peut transparaître dans leur rencontre, « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui18 ».
1 Voir Éditer Montaigne, rec. Cl. Blum, Champion 1997, les p. 159-161 de l’article de Nina Catach, « L’orthographe de Montaigne et sa ponctuation ». Sous le titre Que deviendraient les textes de Montaigne remaniés selon ses instructions ? est insérée p. 172 une citation censée horrifier le lecteur ; on trouvera ce début de III, 1 transcrit plus loin (p. 10), comme inflexion significative propre à éclairer l’orientation générale du livre III des Essais.
2 Dans les citations ci-après, les majuscules autographes en début de syntagme sont inscrites en caractères gras.
3 Voir BSAM 1998-1 – Exemple exceptionnel de générosité intellectuelle : les données de l’enquête étaient mentionnées intégralement dans cet article, pour 340 dossiers alors inexploités.
4 Sur les Lettres missives de Montaigne on consultera la récente étude d’Alberto Frigo, « Montaigne e le “carte messaggiere” », introduction de son édition de l’ensemble des lettres, accompagnées de leur traduction en italien (Michel de Montaigne, Lettere / Con testo originale e traduzione a fronte/ a cura di AlbertoFrigo/ Centro interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, Le Monnier Università, Firenze, 2010). Une seule réserve, mais capitale quant à l’objet du présent article : toutes les lettres transcrites en français sont munies par l’éditeur moderne d’une ponctuation conforme aux normes typographiques actuelles, sans que ce parti soit justifié ni expliqué. Il convient donc de se reporter plutôt au Montaigne manuscrit d’Alain Legros (Paris, Garnier 2010) pour trouver une transcription entièrement fidèle des lettres à Matignon et au roi, p. 667-725.
5 Il n’est pas tenu compte ici des missives dont l’original, disparu, a été remplacé par une copie du xixe ou du xxe siècle, segmentée à la fantaisie du transcripteur
6 Dans une biographie intellectuelle la durée est prise en compte, à l’échelle de la vie ; le temps de l’écriture ne connaît que des successions d’énoncés.
7 Sandro Bianconi, « L’interpunzione in scritture pratiche fra la metà del Cinquecento e la metà del Settecento », in Storia e teoria dell’interpunzione – Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze 19-21 maggio 1988, a cura di E. Cresti, N. Maraschio, L. Toschi, Ed. Bulzoni, Roma 1992, p. 231-243
8 Voir ceux des chapitres 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12.
9 Voir II, 6, p. 668-674 (addition manuscrite), spécialement p. 670-672
10 II, 18, p. 1234, avec variante double : « Mais à dire vrai à qui croirions nous… » – l’incise raturée pouvait passer pour une confirmation, abusive puisqu’il s’agit précisément des difficultés du locuteur à garantir sa propre parole ; le conditionnel qui suivait accentuait l’aspect hypothétique de la croyance. La version finale durcit les traits, et paraît orienter la pseudo-délibération vers l’incrédulité.
11 La première version, de1580, portait ici « … qu’il est un peu naturel… »
12 I, 28, p. 332, 352.
13 III, 5, p. 1616 – Leçon correcte, à substituer au « s’exprimer » des éditions de 1998 et de 2012.
14 Pour une étude plus approfondie, consulter Y. Delègue, Montaigne et la mauvaise foi. L’écriture de la vérité, Champion, 1998, Théologie et poésie, ou la parole de vérité, Champion, 2008, Imitation et vérité en littérature, Presses universitaires de Strasbourg, 2008.
15 La dernière phrase de l’anecdote interdit de la travestir en récit édifiant : au moment où l’agresseur change de projet, ses hommes ont « continuellement les yeux sur lui, pour voir quel signe il leur donnerait : bien étonnés de le voir sortir et abandonner son avantage » (p. 1976) ; ils incarnent le comportement approprié à la conjoncture : sommation ou assaut.
16 II, 17, p. 1174, « Je me tiens de la commune sorte, sauf en ce que je m’en tiens » : le dédoublement réflexif, volontiers critique, problématise la conscience de soi. Sur l’attachement de Montaigne à cette forme d’identité, voir III, 5, V. p. 847, B. p. 1564, et III, 9, V. p. 983, B p. 1826.
17 Ce recensement, présenté sous la forme très succincte adoptée pour repérer les variantes (ici, du dernier mot imprimé qui précède la retouche, jusqu’au premier mot qui la suit), suit la pagination Bompiani (imprimée en caractères gras en tête de chaque série de retouches, que l’on identifiera en se reportant dans le livre à la page indiquée).
18 J.-P. Sartre, Les Mots, dernière ligne.