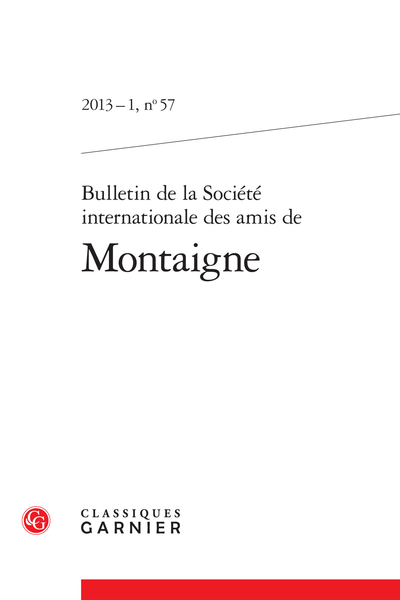
Apophtegme et « ordre du discours » dans les Essais de Montaigne L’apophtegme entre pertinence et contingence
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2013 – 1, n° 57. varia - Author: Basset (Bérengère)
- Pages: 39 to 68
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812420368
- ISBN: 978-2-8124-2036-8
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-2036-8.p.0039
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-16-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Apophtegme et « ordre du discours » dans les Essais de Montaigne
L’apophtegme entre pertinence et contingence
On ne saurait parler de véritable « poétique » de l’apophtegme, ni dans l’Antiquité, ni au xvie siècle. La forme est répertoriée dès l’Antiquité, elle relève des procédés rhétoriques mais sa définition reste assez succincte. Le xvie siècle recueille cette vacance et s’efforce, non sans peine, de la combler. Les traductions du terme grec et les éléments de définition qu’on en propose révèlent l’embarras des humanistes à l’égard de ce type d’énoncés, notamment dans son lien au hasard.
L’apophtegme semble d’abord arracher l’homme au hasard. Plutarque, dans l’épître dédicatoire de son premier recueil d’apophtegmes, oppose ces énoncés aux actes accomplis par les grands hommes. Si ces derniers sont soumis à la fortune (τύχη), il n’en va pas de mêmes des paroles prononcées, qui, dans une sorte d’idéal de transparence, se font miroir de leur âme :
Je vous supplie de recevoir en gré avec ma bonne affection, l’utilité de ces beaux dicts notables que je vous ai recueuillis, pour ce qu’ils peuvent servir à cognoistre quelles ont esté la nature et les meurs de ces grands personnages du temps passé, attendu qu’elles apparoissent mieulx bien souvent, et se decouvrent plus clairement en leurs dicts que non pas en leurs faicts. Il est bien vrai que nous avons en une autre œuvre, compilé les vies des plus illustres personnages, tant en armes qu’en conseils, comme capitaines, legislateurs, Roys et Empereurs, qui aient oncques esté entre les Romains et entre les Grecs : mais en la plus part de leurs faicts et gestes la fortune y est ordinairement meslée : là où és paroles qu’ils ont dittes et aux propos qu’ils ont tenus, sur l’heure mesme de leurs faicts, de leurs passions et de leurs accidents, on apparçoit plus clairement et plus nettement, comme dedans des miroirs, quel estoit le cœur et la pensée de chascun d’eulx1.
Face aux vicissitudes d’une existence soumise à la Fortune et à ses caprices, les paroles que sont les apophtegmes offrent comme un îlot de stabilité. Le xvie siècle reconduit et, d’une certaine manière, accentue cette approche de l’apophtegme par la définition qu’il en donne et les usages auxquels il le soumet. La pensée humaniste reprend ainsi la métaphore du miroir pour donner les apophtegmes comme des « signes » de l’âme. On la retrouve dans l’épître liminaire dont Macault fait précéder sa traduction en français des Apophtegmes d’Érasme, où elle est associée, comme chez Plutarque, à une opposition entre les dits et les faits, les premiers se soustrayant à la Fortune qui régit les seconds :
… veu que d’iceulx faictz (tant soient ils vaillamment entrepris, et heureusement executez) la fortune en retient à soy une bonne portion de la gloire, et les capitaines bien souvent (si c’est en acte de guerre) voire et les souldartz privez mesmes, une autre. Ce qui n’advient pas ainsi du dire : d’autant qu’il n’est riens qui ne descouvre plus la qualité des hommes, que la parolle : ne qui tant les face estimer ou blasmer. Car comme disoit Socrates, le parler est le plus certain et moins menteur myrouer de l’esprit de l’homme2.
Du fait de ses contours mal définis, l’apophtegme vient rejoindre, dans la pensée des humanistes, les sentences et mots dorés dont on constitue des recueils pour les livrer à la méditation en ce qu’ils constitueraient une sagesse universelle. Il intègre ainsi les arts de la mémoire. Appris et retenus, les apophtegmes offrent des ressources où puiser pour composer des discours, soutenir des controverses, ou encore entrer « en conférence ». Ils jugulent le hasard et s’opposent à lui, permettant à qui les maîtrise de disposer de ressources pour pallier les imprévus auxquels nous soumet la contingence de notre existence. Pourtant cette préméditation ne va pas sans improvisation. Si les recueils d’apophtegmes ressortissent bien aux arts de la mémoire, ils y font entrer une saisie du temps qui relève de l’instant. Ce n’est pas sans raison que l’on donne, à la Renaissance, pour équivalent français au grec apophthegma le substantif « rencontre3 ».
Polysémique dans la langue du xvie siècle, « rencontre » est un vocable qui a partie liée avec le hasard comme en témoigne la définition de Jean Nicot :
Rencontre, est proprement ce que sans estre preveu, et inespérement s’offre à nous. Car rencontre presuppose adventure4.
Comme phénomène langagier, la rencontre relèverait donc d’un parler improvisé5. Il y aurait rencontre dans les cas où coïncideraient, au sens étymologique du verbe, une situation et un propos. Cette coïncidence heureuse explique que l’apophtegme soit apparenté au bon mot, mais dans le même temps elle fait de ce bon mot le fruit du hasard et inscrit la parole humaine dans la contingence : le sens et la portée du propos sont entièrement dépendants des circonstances. Et de fait, les recueils d’apophtegmes qui donnent ces derniers comme des fragments d’une sagesse universelle, les présentent le plus souvent dans les circonstances qui les ont fait naître ; ce sont elles qui donnent sens et valeur à ces dits occasionnels. Et pourtant, on invite à les apprendre et à les retenir pour les réutiliser dans des circonstances autres. On voit là l’ambivalence de ce type d’énoncés et l’embarras dans lequel il place les humanistes. La transformation de l’apophtegme en « mot doré » – la fossilisation que l’on s’efforce de lui faire subir6 – pourrait dès lors se lire comme une volonté de réguler le hasard, d’arracher le discours humain aux aléas de la fortune.
La résolution de cette ambivalence de l’apophtegme se trouve peut-être dans la notion d’« à propos ». Au xviie siècle, c’est à travers cette notion que Nicolas Perrot d’Ablancourt distinguera l’apophtegme d’autres formes d’énoncés plus « stables » :
L’Apophtegme n’est donc proprement ni sentence, ni proverbe, ni exemple ou action memorable, ni fable ou enigme, et telle autre chose ; dont on fait pourtant quelquefois des apophtegmes en les disant à propos7.
La coïncidence est réintroduite dans l’emploi que l’on fait des énoncés appris et gravés dans la mémoire. Cette notion d’« à-propos » nous semble adaptée pour traiter des emplois de l’apophtegme au xvie siècle, et plus particulièrement dans les Essais de Montaigne : elle témoigne d’une parole partagée entre hasard et nécessité, entre contingence et préméditation.
Apophtegme et à-propos dans les Essais
Montaigne revendique une parole spontanée et essaie de retrouver à l’écrit la vivacité et l’ouverture à la contingence qui caractérisent l’oral8. Daniel Ménager a montré cependant la tension qui s’opère dans le discours des Essais entre improvisation et préméditation : adepte du « parler prompt » contre le « parler tardif », Montaigne ne récuse pas la mémoire et ne livre pas son discours au hasard9. Cette tension nous
semble se refléter dans l’apophtegme et dans les usages qu’il en fait : forme de breviloquentia, marqué par le piquant et la subtilité, l’apophtegme est un « discours de circonstances » qui naît de l’occasion. En cela c’est un discours contingent, fruit d’une aubaine moins « entre la pensée et les mots », qu’entre l’événement et les mots. Pour que l’apophtegme puisse avoir toute sa saveur, il faut que l’ouverture au hasard s’allie à l’« à-propos ». Contingence et pertinence doivent aller de pair dans la « pratique » de l’apophtegme. Or cette notion d’ « à-propos » est au cœur des Essais et de la parole que définit Montaigne. Elle trouve une application supplémentaire dans l’utilisation à faire du matériau emprunté. L’enjeu est d’importance pour les apophtegmes puisés chez autrui : comment retrouver le caractère « hasardeux » qui fait toute la saveur de l’apophtegme quand ce dernier s’est « fossilisé » en discours à apprendre et à retenir ? La réponse de Montaigne serait la suivante : en retrouvant la contingence initiale de l’apophtegme dans la pertinence de son réemploi.
Pertinence et à-propos dans l’art de conférer montainien :
de la rhétorique à l’éthique de la conversation
Gérard Milhe Poutingon, dans son travail sur la digression, place Montaigne au nombre des auteurs sur qui pèse le poids de la pertinence en dépit de leur tendance à digresser :
La pertinence pèse un tel poids sur les conscientes renaissantes que, même s’ils semblent digresser sans vergogne, les écrivains – comme Budé, Henri Estienne, Brantôme, Montaigne, Vigenère… parmi les plus libres – éprouvent malgré tout, à un moment ou un autre, le besoin de souligner l’à-propos de leur détour10.
Soit. Il convient toutefois d’examiner les termes dans lesquels Montaigne conçoit et définit la pertinence, la manière dont il la met en œuvre. L’« à-propos » tel que le pense et le pratique l’auteur des Essais est une notion moins rhétorique qu’éthique, elle prend assurément des distances avec l’aptum des traités des rhéteurs.
Un examen du chapitre « De l’art de conférer » (Essais, III, 8) permettra de saisir en quoi consiste pour Montaigne la pertinence. La notion est en effet au cœur des règles de « conversation » qu’il définit, lesquelles sont inédites et sans rapport avec les modèles répertoriés11. Deux conceptions des prises de distance avec le sujet semblent s’affronter :
On ne faict poinct tort au sujet, quand on le quicte pour voir du moyen de le traicter ; je ne dis pas moyen scholastique et artiste, je dis moyen naturel, d’un sain entendement. Que sera-ce en fin ? L’un va en orient, l’autre en occident ; ils perdent le principal, et l’escartent dans la presse des incidens. Au bout d’une heure de tempeste, ils ne sçavent ce qu’ils cerchent ; l’un est bas, l’autre haut, l’autre costié. Qui se prend à un mot et une similitude ; qui ne sent plus ce qu’on luy oppose, tant il est engagé en sa course ; et pense à se suyvre, non pas à vous. Qui, se trouvant foible de reins, craint tout, refuse tout, mesle des l’entrée et confond le propos ; [C] ou, sur l’effort du debat, se mutine à se faire tout plat : par une ignorance despite, affectant un orgueilleux mespris, ou une sottement modeste fuite de contention. [B] Pourveu que cettuy-cy frappe, il ne luy chaut combien il se descouvre. L’autre compte ses mots, et les poise pour raisons. Celuy-là n’y emploie que l’advantage de sa voix et de ses poulmons. En voilà qui conclud contre soy-mesme. Et cettuy-cy, qui vous assourdit de prefaces et digressions inutiles. [C] Cet autre s’arme de pures injures et cherche une querelle d’Aleimagne, pour se deffaire de la societé et conference d’un esprit qui presse le sien. [C] Ce dernier ne voit rien en la raison, mais il vous tient assiegé sur la closture dialectique de ses clauses et sur les formules de son art12.
Si Montaigne commence par admettre et justifier les « escapades » hors du sujet, il rejette en revanche les « digressions inutiles ». C’est que ces dernières relèvent, comme les autres défauts que dénonce Montaigne et
dont il se moque, de procédés rhétoriques : elles sont étalage de science, marque de pédantisme ; elles sont sans rapport à la quête, sincère et authentique, de vérité qui devrait animer l’échange. Ces digressions, à l’instar des autres pratiques tournées en dérision, manquent de pertinence en ce qu’elles sont oubli du ou des partenaires de la communication. Elles manifestent une forme de philautie qui conduit à perdre de vue le sujet traité : peu importe ce dernier pour de tels « conférenciers », leur seul souci est de se mettre en valeur. Montaigne ne cesse, en effet, de blâmer avec virulence la bêtise des pédants qui ont appris l’art de conférer aux « escholes de parlerie13 » et qui le pratiquent pour « servir de spectacle aux grands et faire à l’envy parade de son esprit et de son caquet14 ». La chose est bien connue, mais nous nous permettons d’attirer l’attention sur les termes dans lesquels Montaigne formule de manière récurrente ses griefs : cette bêtise des « discutants » prend le plus souvent nom sous sa plume d’« ineptie » ou d’ « impertinence15 ». L’étymologie latine, aptus dans un cas, pertineo dans l’autre, indique que c’est bien d’à-propos qu’il est question. Mais la notion est envisagée par Montaigne dans le cadre d’une éthique de la parole. L’« ordre du discours » que réclame Montaigne16 suppose une prise en compte du sujet sur laquelle s’entendent
ceux qui débattent ainsi qu’une attention à la parole de l’autre. Cet ordre ne saurait se confondre avec la politesse qui régit la conversation civile. Il autorise un discours suivi quand bien même on se coupe la parole, on anticipe sur le propos de l’interlocuteur, on parle avant son tour. C’est l’ordre qui régit « les altercations des bergers et des enfans de boutique », pourtant agitées et tumulteuses – agitation et tumulte qui sont sans doute le gage d’un véritable engagement dans la conversation :
Tout un jour je contesteray paisiblement, si la conduicte du débat se suit avec ordre. [C] Ce n’est pas tant la force et la subtilité que je demande, comme l’ordre. L’ordre qui se voit tous les jours aux altercations des bergers et des enfans de boutique, jamais entre nous. S’ils se detraquent, c’est en incivilité ; si faisons nous bien. Mais leur tumulte et impatiance ne les devoye pas de leur theme : leur propos suit son cours. S’ils se previennent l’un l’autre, s’ils ne s’attendent pas, aumoins ils s’entendent. On respond toujours trop bien pour moy, si on respond à propos17.
Une telle éthique de la parole permet aux escapades de ne pas dévoyer la conversation. Errances et écarts restent « à-propos » dès lors qu’ils sont au service du sujet traité, qu’ils ne cherchent à perdre l’autre ni à se faire valoir. Cet ordre est la condition d’un véritable échange, car il permet de se fier à la parole de l’interlocuteur :
Tout ainsi comme je debats contre un homme vigoureux je me plais d’anticiper ses conclusions, je lui oste la peine de s’interpreter, j’essaye de prevenir son imagination imparfaicte encores et naissante (l’ordre et la pertinence de son entendement m’advertit et menace de loing), de ces autres [il s’agit des « hommes riches d’une suffisance étrangère », comme le précise la note de Villey] je faicts tout le rebours : il ne faut rien entendre que par eux, ny rien presupposer. S’ils jugent en paroles universelles : Cecy est bon, cela ne l’est pas, et qu’ils rencontrent, voyez si c’est la fortune qui rencontre pour eux18.
Cette « rencontre » qui est de fortune plus que de l’initiative du locuteur concerne aussi l’emploi du matériau étranger, celui que mettent à disposition les recueils de lieux communs et autres florilèges :
Ils disent une bonne chose ; sçachons jusques où ils la cognoissent, voyons par où ils la tiennent. Nous les aydons à employer ce beau mot et cette belle raison qu’ils ne possedent pas ; ils ne l’ont qu’en garde : ils l’auront produicte à l’avanture et à tastons19.
Cela ne veut pas dire, toutefois, que Montaigne récuse toute improvisation, tout propos lancé « à l’aventure », le chapitre « Du parler prompt ou tardif » (Essais, I, 10) est là pour en témoigner. Mais il est nécessaire, pour une improvisation « pertinente », que le matériau légué par les arts de la mémoire ait auparavant été digéré, qu’on ait su le faire sien :
La plus part des hommes sont riches d’une suffisance estrangere. Il peut advenir à tel de dire un beau traict, une bonne responce et sentence, et la mettre en avant sans en cognoistre la force20.
L’« à-propos » de son utilisation suppose ainsi une appropriation. On pourrait jouer sur les mots et dire que Montaigne condamne tout à la fois un défaut d’« appropriation » du matériau utilisé et d’« à-propriation » de son emploi. Dès lors, une réintroduction du hasard est possible : contingence et pertinence s’associent dans l’utilisation de cette matière étrangère que l’on a su faire sienne. L’« à-propos » est alors à chercher du côté du kairos, cette capacité à savoir saisir l’occasion dont les Grecs faisaient une qualité. L’ineptie, au sens étymologique, que Montaigne reproche aux pédants, c’est l’incapacité à savoir adapter le discours mémorisé, le matériau emprunté aux circonstances fortuites dans lesquelles nous place la pratique de la conférence, de ne pas savoir faire « se rencontrer » ce « discours emprunté » et les hasards de la conversation21. Cette « à-propriation » que réclame Montaigne ne va pas
sans « appropriation » : déplacé dans un nouveau contexte, surgi dans des circonstances nouvelles, le matériau emprunté est susceptible de voir son sens déformé, du moins étroitement circonscrit aux circonstances dans lesquelles il est replacé.
Usage des apophtegmes dans les Essais :
appropriation et « à-propriation »
Les « dispositifs en miroir » que met en place pour Montaigne pour se livrer, à partir des dits et faits qu’il recueille, à des « exercices spirituels » relèvent sans nul doute de cette « appropriation » dont nous traitons. Nous voudrions étudier plus précisément la manière dont s’opère cette appropriation dans le tissu textuel, les emplois « à-propos » que fait Montaigne des « pièces » qu’il emprunte. Le chapitre « De l’art de conférer » offre des exemples de ce travail accompli par l’essayiste : les règles définies par Montaigne dans l’usage de la conversation se trouvent en effet mises en pratique dans l’écriture du chapitre, quand bien même ce dernier ne relève pas de la « conférence ». Nous observerons ainsi le traitement qu’il fait des apophtegmes qu’il utilise pour saisir la pertinence qu’il leur donne. Ainsi dans la critique qu’il mène des erreurs de jugement que l’on commet, abusés que nous sommes par les « grandeurs d’établissement » et les apparences :
Ouy, mais il a mené à point ce grand affaire. C’est dire quelque chose, mais ce n’est pas assez dire : car cette sentence est justement receuë, qu’il ne faut pas juger les conseils par les evenemens. […] On s’aperçoit ordinairement aux actions du monde que la fortune peut nous apprendre combien elle peut en toutes choses, et qui prent plaisir à rabatre nostre presomption, n’aiant peu faire les malhabiles sages, elle les fait heureux, à l’envy de la vertu. Et se mesle volontiers à favoriser les executions où la trame est plus purement sienne. D’où il se voit tous les jours que les plus simples d’entre nous mettent fin de tresgrandes besongnes, et publiques et privées. Et comme Sirannez le Persien respondit à ceux qui s’estonnoient comment ses affaires succedoient si mal, veu que ses propos estoient si sages, qu’il estoit seul maistre de ses propos, mais du succez de ses affaires c’estoit la fortune, ceux-cy peuvent
respondre de mesme, mais d’un contraire biais. La plus part des choses du monde se font par elles mesmes, // Fata viam inveniunt. // L’issuë authorise souvent une tresinepte conduite. Nostre entremise n’est quasi qu’une routine, et plus communement consideration d’usage et d’exemple que de raison22.
Le dit du Perse, circonstancié, est bien un apophtegme quand bien même Plutarque ne l’intègre au corps de son recueil23. Dans le texte de Montaigne, il fait suite à une « sentence », à laquelle il fait écho tout en la mettant en situation. Il prend place dans un système comparatif qui participe précisément à l’appropriation opérée par Montaigne : les situations se ressemblent sans être identiques. De là la nécessité de prendre l’apophtegme « d’un contraire biais » : il doit être adapté à la situation pour laquelle il est employé, la critique des malhabiles et des sots que leur succès fait passer pour sages et prudents. Dans le cas de ces derniers, il faut s’étonner que leurs affaires succèdent si bien, vu que leurs propos sont si sots. Montaigne fait ainsi de l’apophtegme un énoncé labile, dont le sens varie en fonction des circonstances, susceptible d’être envisagé selon plusieurs biais, de recevoir plusieurs visages. Il n’a pas la fixité de la sentence. L’adaptation-déformation du propos a encore le mérite, du reste, de servir la charge critique, en conférant à l’ensemble une dimension ironique. L’appropriation se poursuit dans la suite du passage : Montaigne ne s’en tient pas au sens véhiculé par l’apophtegme. Il va au-delà, en étendant, dans la suite, le rôle et le pouvoir du hasard :
Je dis plus, que nostre sagesse mesme et consultation suit pour la plus part la conduicte du hazard. Ma volonté et mon discours se remue tantost d’un air, tantost d’un autre, et y a plusieurs de ces mouvemens qui se gouvernent sans moy. Mais raison a des impulsions et agitations journallieres [C] et casuelles24.
Dans un propos qu’il prend en charge et qu’il applique à lui-même, Montaigne défait, en dépit de quelques atténuations, le partage qu’établissait le dit de Siramnès, entre les conseils qui seraient en notre maîtrise d’une part, de l’autre les événements qui nous échapperaient et seraient entre les mains de la fortune. « Couchant sur lui » le propos recueilli, Montaigne le dément, découvrant, à l’intérieur comme à l’extérieur de lui, le règne du hasard. Nous reviendrons sur ce point qui affecte l’appréhension de l’apophtegme.
Quelques lignes plus bas, Montaigne use à nouveau d’un apophtegme dont l’à-propos passe également par l’appropriation dont il fait l’objet. Il prend place dans un développement qui poursuit la critique des abus qu’entraînent les marques de la grandeur, après la « digression » en quoi a consisté la réflexion sur la fortune25 :
Melanthius interrogé ce qu’il luy sembloit de la tragedie de Dionysius : Je ne l’ay, dict-il, point veuë, tant elle est offusquée de langage. Aussi la pluspart de ceux qui jugent les discours des grands debvroient dire : Je n’ay point entendu son propos, tant il estoit offusqué de gravité, de grandeur, de majesté26.
Bien que le propos figure dans le traité Comment il faut ouïr27, il y a bien apophtegme, ce que confirme la présence de ce dit dans les Apophthegmatum libri constitués par Érasme28. À nouveau, Montaigne lie ce dit à ce propos au moyen d’un adverbe de comparaison, « aussi » en l’occurrence. Ici encore, les situations se rapprochent sans être identiques et Montaigne adapte le dit à son propos, il l’envisage sous un autre biais en en proposant une reformulation qui le met en adéquation avec le nouveau contexte. Les parallélismes que créent les reprises lexicales font mieux
apparaître encore l’appropriation à l’œuvre. Le piquant du propos de Mélanthius rejaillit ainsi sur l’adaptation qu’en fait Montaigne. Dans cette dernière, un déplacement s’opère, quant à ceux qui pipent notre jugement à l’égard des discours tenus, de l’emphase et de la grandiloquence29 vers les grandeurs d’apparat. Par cette appropriation dont il fait l’objet, l’apophtegme renoue le fil d’un propos amorcé quelques pages plus haut et quelque peu « noyé » dans les ondoiements du chapitre :
Comme en la conference : la gravité, la robbe et la fortune de celuy qui parle donne souvent credit à des propos vains et ineptes ; il n’est pas à presumer qu’un monsieur si suivy, si redouté, n’aye au-dedans quelque suffisance autre que populaire, et qu’un homme à qui on donne tant de commissions et de charges, si desdaigneux et si morguant, ne soit plus habile que cet autre qui le salue de si loing et que personne n’employe30.
Bien que situé à plusieurs pages d’intervalle, ce développement influe sur la lecture que Montaigne propose de l’apophtegme de Mélanthius. Mais ce dernier fait aussi signe vers ce développement qui l’a précédé. En somme, il crée des liens au sein des développements du chapitre, mais il le fait « en coin » ou encore « de manière oblique ».
Déplaçons-nous au chapitre « De la vanité » (Essais, III, 9) pour retrouver un apophtegme – ou ce qui s’apparente à un apophtegme – qui, en coin, établit des liens dans le texte et participe à sa cohérence. Au début du chapitre, Montaigne rend compte du goût qu’il nourrit pour les voyages et du peu d’intérêt qu’il a « pour le gouvernement de [sa] maison », le premier étant la conséquence du second. Il justifie cette disposition qui est la sienne :
Il y a quelque commodité à commander, fut ce dans une grange, et à estre obey des siens ; mais c’est un plaisir trop uniforme et languissant. Et puis il est par necessité meslé de plusieurs pensements fascheux : tantost l’indigence et oppression de vostre peuple, tantost la querelle de vos voisins, tantost l’usurpation qu’ils font sur vous, vous afflige ; […] et que à peine en six mois envoiera Dieu une saison dequoy vostre receveur se contente bien à plain, et que, si elle sert aux vignes, elle ne nuise de prez […]. Joinct le soulier neuf et bien formé de cet homme du temps passé, qui vous blesse le pied ; et que l’estranger n’entend pas combien il vous couste et combien vous prestez à
maintenir l’apparence et de cet ordre qu’on voit en vostre famille, et qu’à l’avanture l’achetez vous trop cher31.
Le soulier auquel il est fait référence à la fin de ce passage fait écho à la réplique d’un Romain que rapporte Plutarque dans la Vie de Paul-Émile et que l’on peut, à bon droit, considérer comme un apophtegme :
mais il me semble bien qu’un propos que lon compte en matiere de separation de mariage ets veritable : c’est à sçavoir que quelquefois un Romain ayant repudié sa femme, ses amis l’en tenserent en luy demandant, « Que trouves tu à redire en elle ? n’est-elle pas femme de bien de son corps ? n’est-elle pas belle ? ne porte elle pas de beaux enfans ? » Et luy estendant son pied leur monstra son soulier et leur respondit : « Ce soulier n’est il pas beau ? n’est il pas bien fait ? n’est il pas tout neuf ? toutefois il n’y a personne de vous qui sache où il me blece le pied32.
Montaigne condense l’anecdote et, par une sorte de syllepse, tend à effacer la dimension métaphorique de ce soulier. L’emploi de cette référence en appelle à la complicité du lecteur, nécessite une culture partagée. L’usage que fait Montaigne du pronom de la deuxième personne du pluriel témoigne de la manière dont il s’approprie ce dit : le « vous » permet de fondre la référence dans les autres raisons invoquées par Montaigne. Ce « vous » interpelle le lecteur en même temps qu’il est peut-être une manière pour l’écrivain de s’adresser à lui-même, pour essayer précisément ses dispositions, exercer son jugement sur elles. Il invite en tous les cas à « coucher sur soi » le propos emprunté. Mais ce n’est pas tout, on verra encore dans ce soulier un motif qui fait écho à un propos de Montaigne situé en amont, propos dans lequel il faisait part de sa négligence, de sa propension à s’abandonner au mal, en usant de métaphores vestimentaires :
[B] Quant à moy, j’ay cette autre pire coustume, que si j’ay un escarpin de travers, je laisse encores de travers et ma chemise et ma cappe. Je desdaigne de m’amender à demy. Quand je suis en mauvais estat, je m’acharne au mal ;
je m’adandonne par desespoir et me laisse aller vers la cheute [C] et jette, comme on dict, le manche apres la coignée ; [B] je m’obstine à l’empirement et ne m’estime plus digne de mon soing : ou tout bien ou tout mal33.
Cette image personnelle trouve son pendant dans celle de l’apophtegme du Romain, l’escarpin de Montaigne semble comme appeler le soulier du Romain, à moins que ce ne soit celui-ci qui rappelle celui-là. Une cohérence s’établit en tous les cas dans la conduite de Montaigne : un lien est posé, par le réseau des images, entre son acharnement au mal et son désintérêt pour le soin du ménage. Il faut l’attention du lecteur, et sa mémoire, pour percevoir ces liens obliques, que Montaigne n’a peut-être pas pensés, n’a peut-être pas prémédités. C’est la « leçon » que Daniel Ménager dégage de sa réflexion sur l’improvisation dans les Essais :
Ce que Montaigne aura « eslancé », sans peut-être y penser vraiment, le lecteur le recueillera pour le rattacher au reste et son écoute attentive découvrira un sens au discours qui s’invente. C’est la mémoire et l’attention qui abolissent le hasard. Montaigne a compté sur la nôtre [sic], comme il compte sur celle d’un bon partenaire dans la conférence34.
Ces liens sont, peut-être, en effet, plus de notre fait que de celui de Montaigne. Peut-être sont-ils contingents, mais cette contingence s’allie à la pertinence. C’est ici que les Essais font renouer l’apophtegme avec le hasard.
Les risques de l’appropriation : penser contre soi
L’appropriation dont les apophtegmes font l’objet de la part de Montaigne vient rejoindre son usage des sentences, ainsi qu’il le définit au chapitre « De l’institution des enfants » (Essais, I, 26) :
Je tors bien plus volontiers une bonne sentence pour la coudre sur moy, que je ne tors le fil pour l’aller querir35.
La métaphore du fil indique que la « sentence » ne saurait rompre sinon la continuité, du moins la cohérence du propos, qu’elle ne saurait porter atteinte à sa pertinence. La déformation (tordre la sentence) qui procède à l’appropriation (la coudre sur soi) rend possible l’à-propos (ne pas
tordre le fil). Mais cela ne va pas sans risque pour qui entend penser avec justesse et droiture. Montaigne, dans « De l’art de conférer », ne s’exempte pas des reproches qu’il adresse à ceux qui empruntent un matériau qu’ils ne maîtrisent pas ou qu’ils maîtrisent mal :
La plus part des hommes sont riches d’une suffisance estrangere. Il peut advenir à tel de dire un beau traict, une bonne responce et sentence, et la mettre en avant sans en cognoistre la force. [C] Qu’on ne tient pas tout ce qu’on emprunte, à l’adventure se pourra il vérifier par moy mesme36.
L’ajout sur l’Exemplaire de Bordeaux (en strate [C] de l’édition Villey) manifeste une méfiance de Montaigne à l’égard de son propre usage des « pièces rapportées ». Il est ici question de ne pas « en connaître la force » et dès lors de les convoquer à mauvais escient. Les détourner pour se les approprier peut aussi conduire à ne pas les « entendre » ; la déformation peut participer d’un usage rhétorique, voire sophistique, consistant à faire dire au matériau qu’on emprunte ce qu’on a envie qu’il dise. Dotées d’une valeur argumentative, les citations et les allégations viennent appuyer une pensée déjà formée et dès lors la ferment sur elle-même. Montaigne semble conscient de ce risque : s’il use des apophtegmes au service de ses thèses, il exploite encore leur nature circonstanciée qui leur donne une valeur toute relative pour déplacer sa pensée, pour penser contre lui-même, bref pour exercer son jugement37.
Ainsi, le chapitre « De la cruauté » (Essais, II, 11) s’ouvre sur des considérations sur la vertu, Montaigne plaidant pour une distinction entre la vertu et « les inclinations à la bonté », la première supposant de véritables efforts. Après avoir exposé cette thèse, il l’appuie d’exemples dont nous retiendrons le dernier :
Metellus, ayant, seul de tous les Senateurs Romains, entrepris, par l’effort de sa vertu, de soustenir la violence de Saturninus, Tribun du peuple à Rome, qui vouloit à toute force faire passer une loy injuste en faveur de la commune, et ayant encouru par là les peines capitales que Saturninus avoit establies contre les refusans, entretenoit ceux qui, en cette extremité, le conduisoient en la place de tels propos : Que c’estoit chose trop facile et trop láche que de mal faire, et que de faire bien où il n’y eust point de dangier, c’estoit chose vulgaire ; mais de faire bien où il n’y eust dangier, c’estoit le propre office d’un homme de vertu. Ces paroles de Metellus nous representent bien clairement ce que je vouloy verifier, que la vertu refuse la facilité pour compaigne38.
Le propos de Metellus dont Montaigne fait mention figure dans la Vie de Marius39 mais eût pu être retenu dans le premier recueil d’apophtegmes constitués par Plutarque. Il vient ici illustrer, au sens premier du terme, la thèse développée. En quelque sorte, il la met en scène. Cette illustration est aussi une mise à l’épreuve de la thèse : elle la vérifie. La démarche est presque d’ordre expérimentale : la thèse de Montaigne prend l’allure d’une hypothèse que le propos cité, à l’instar d’une expérience, viendrait valider. Mais l’essayiste sait sans doute qu’on eût pu trouver aussi bien un apophtegme qui aurait invalidé sa thèse. Comme s’il se laissait entraîner sur une pente, il a sélectionné, dans le magasin de sa mémoire, un propos qui prouve ce qu’il veut démontrer. Il y a une sorte de facilité à raisonner ainsi, une sorte d’assoupissement de notre jugement aussi. Cela n’est pas réfléchir. L’apophtegme n’a pas été l’occasion d’une prise de distance avec sa propre voix, sa propre pensée, prise de distance qui crée précisément l’écart dans lequel on peut se ressaisir et s’approprier ce que l’on disait et pensait jusque-là en somnambule. Montaigne ne saurait donc en rester là. Ce que l’apophtegme vient de valider, une relance dans le développement va le défaire et poursuivre un examen qui s’est déployé trop aisément :
Je suis venu jusques icy bien à mon aise. Mais, au bout de ce discours, il me tombe en fantasie que l’ame de Socrates, qui est la plus parfaicte qui
soit venuë à ma connoissance, seroit, à mon compte, une ame de peu de recommandation40.
Cet effort, sinon pour penser contre soi, du moins pour exercer son jugement est encore manifeste dans la chapitre « Coutume de l’île de Céa » (Essais, II, 3) dans lequel Montaigne réfléchit à la question du suicide. Après des propos liminaires sur lesquels il nous faudra revenir, définissant un certain régime de parole, la réflexion s’engage à partir d’une série d’apophtegmes lacédémoniens :
Philippus estant entré à main armée au Peloponese, quelcun disoit à Damidas que les Lacedemoniens auroient beaucoup à souffrir, s’ils ne se remettoient en sa grace : Et, poltron, respondit-il, que peuvent souffrir ceux qui ne craignent point la mort ? On demandoit aussi à Agis comment un homme pourroit vivre libre : Mesprisant, dict-il, le mourir. Ces propositions et mille pareilles qui se rencontrent à ce propos, sonnent evidemment quelque chose au-delà d’attendre patiemment la mort quand elle nous vient41.
Les dits recueillis ne viennent pas illustrer une thèse mais permettent de définir une première attitude à l’égard de la mort : aller au-devant d’elle quand les conditions sont inacceptables. D’autres apophtegmes vont être ajoutés avant que Montaigne ne formule, dans un passage démarqué de Sénèque, la thèse qu’ils expriment :
[A] C’est ce qu’on dit, que le sage vit tant qu’il doit, non pas tant qu’il peut ; et que le present que nature nous ait fait le plus favorables, et qui nous oste tout moyen de nous pleindre de nostre condition, c’est de nous avoir laissé la clef des champs. Elle n’a ordonné qu’une entrée à la vie, et celle mille yssuës42.
La position à l’égard de la mort, que Montaigne se garde bien de prendre en charge, émane sans doute des apophtegmes rassemblés : leur « rencontre », au gré des lectures ou d’un parcours dans le magasin de la mémoire, rend cette première option évidente, elle l’assoit. Et Montaigne de souligner qu’on pourrait ajouter bien d’autres dits allant dans le même sens (« mille pareilles »). Cette rencontre fait apparaître un accord
harmonieux qui permet au discours de « filer droit ». Mais, selon un procédé qui lui est courant, Montaigne opère rapidement un revirement qui relance la réflexion :
[A] Cecy ne va pas sans contraste. Car plusieurs tiennent que nous ne pouvons abandonner cette garnison du monde sans le commandement expres de celuy qui nous a mis ; et que c’est à Dieu, qui nous a icy envoyez non pour nous seulement, ains pour sa gloire et service d’autruy, de nous donner congé quand il lui plaira, non à nous de le prendre43.
Après la position des Stoïciens exprimée par la voix de Sénèque et corroborée par les dits des Lacédémoniens, celle de la religion catholique que viennent illustrer, non des apophtegmes, mais des citations poétiques décontextualisées empruntées à la littérature antique. Montaigne revient ensuite à la thèse partisane du suicide et la manière dont il la développe nous intéresse :
Entre ceux du premier advis, il y a eu grand doute sur ce : Quelles occasions sont assez justes pour faire entrer un homme en ce party de se tuer ? […] Quand Threicion presche Cleomenes de se tuer pour le mauvais estat de ses affaires, et ayant fuy la mort la plus honorable en la bataille qu’il venoit de perdre, d’accepter cette autre qui luy est feconde en honneur, et ne donner poinct loisir au victorieux de luy faire souffrir ou une mort ou une vie honteuse, Cleomenes, d’un courage Lacedemonien et Stoique, refuse ce conseil comme láche et effeminé : C’est une recepte, dit-il, qui ne me peut jamais manquer, et de laquelle il ne faut se servir tant qu’il y a un doigt d’esperance de reste ; que le vivre est quelquefois constance et vaillance ; qu’il veut que sa mort mesme serve à son pays et en veut faire un acte d’honneur et de vertu. Threicion se creut dès lors et se tua. Cleomenes en fit aussi autant depuis ; mais ce fut apres avoir essayé le dernier point de fortune. Tous les inconvenients ne valent pas qu’on veuille mourir pour les eviter44.
L’exemple est emprunté à la Vie d’Agis et Cléomène ; la réplique du personnage y est plus largement développée, Montaigne la condense et la reformule, lui donnant la taille d’un apophtegme45. Elle fait, en tous les
cas, très directement écho aux dits des Lacédémoniens qui ont ouvert le chapitre et lancé la réflexion. Montaigne choisit, à dessein sans doute, le propos d’un roi de Sparte et souligne, par le complément de manière dont il qualifie la réponse du personnage – « d’un courage Lacedemonien et Stoique » –, la manière dont elle entre en résonance avec les apophtegmes initiaux. Mais alors que ces derniers s’accordaient, le dit de Cleomenes fait entendre une note discordante. Il complexifie la position « lacédémonienne et stoïcienne » en faisant émerger la question des « occasions ». Les thèses qu’accompagnent les apophtegmes apparaissent dès lors comme des options singulières, dépendantes des circonstances et relatives à la personne qui les exprime. Ce à quoi conduit le chapitre, et il nous semble que les « paroles occasionnelles » que sont les apophtegmes y participent, ce n’est pas à la formulation d’une position clairement établie sur la question du suicide, mais à une option, toute relative, qui tient compte des situations : « [B] La douleur [C] insupportable [B] et une pire mort me semblent les plus excusables incitations46 ». Contingents et inscrits dans la trame des événements, les apophtegmes donnent lieu à des opinions tout aussi contingentes et précaires, des opinions qui se font elles-mêmes purs événements.
De l’à-propos à l’aventure :
une parole démonique
L’emploi des apophtegmes est ainsi soumis, dans les Essais, au principe de pertinence que réclame Montaigne dans l’utilisation des matériaux empruntés. Toutefois, cette pertinence ne saurait abolir la contingence de ce dit qu’est l’apophtegme, contingence sur laquelle Montaigne insiste, a contrario sans doute des définitions de ses contemporains. Le hasard s’instille, chez lui, jusque dans l’ordre de la parole et de la volonté – et dès lors dans l’ordre de l’écriture –, transformant l’usage des apophtegmes et la valeur méditative qu’on leur prête47.
Lecture « hasardeuse » des apophtegmes plutarquiens :
la fortune comme thème des dits recueillis
C’est d’abord sur le plan thématique, ou référentiel, que s’introduit le hasard, le plus souvent sous la forme de la fortune, dans nombre de dits recueillis à l’intérieur des Essais ; et Montaigne de les infléchir en ce sens pour tirer de leur lecture une confiance dans les événements qui nous échoient, pour inviter à se soumettre au sort et surtout à l’accueillir.
Le dit de Cléomène et son attitude envers la mort sont certes reconnus par Montaigne comme une manifestation de courage ; mais après lui la réflexion s’infléchit vers l’espérance que doit nous inspirer l’incertitude dans laquelle nous sommes concernant notre avenir :
Et puis, y ayant tant de soudains changements aux choses humaines, il est malaisé de juger à quel point nous sommes justement au bout de nostre esperance48.
De César, Montaigne va aussi retenir un apophtegme qui en fait, comme Alexandre, un « souverain patron des actes hasardeux49 » :
Et quant aux entreprises qu’il a faites à main armée, il y en a plusieurs qui surpassent en hazard tout discours de raison militaire : car avec combien de foibles moyens entreprint-il de subjuguer le Royaume d’Ægypte, et, depuis, d’aller attquer les forces de Scipion et de Juba, de dix parts plus grandes que les siennes ? Ces gens là ont eu je ne sçay quelle plus qu’humaine confiance de leur fortune.
[B] Et disoit-il qu’il failloit executer, non pas consulter, les hautes entreprises50.
L’ajout pratiqué sur ce que Villey identifie comme la strate [B] est un apophtegme que Plutarque avait recueilli51. Le contexte qui l’inspire témoigne de la lecture qu’en fait Montaigne, il appuie ainsi l’ouverture au hasard dont témoigne le propos de César. On dira sans doute, et à juste titre, que cette confiance envers la fortune s’explique par le fait qu’il est question ici d’entreprises militaires, or on sait que la guerre est un domaine dans lequel le hasard règne en maître. Il est pourtant des cas où cet accueil du hasard se manifeste dans des situations privées, des situations où la certitude, des décisions réfléchies devraient primer. En témoigne la lecture proposée d’un apophtegme de Dion dont Montaigne fait usage au chapitre « Divers événements d’un même conseil » :
[B] Pourtant Dion, estant adverty que Callipus espioit les moyens de le faire mourir, n’eust jamais le cœur d’en informer, disant qu’il aymoit mieux mourir que vivre en cette misere, d’avoir à se garder non de ses ennemys seulement, mais aussi de ses amis52.
L’apophtegme de Dion est emprunté au recueil de Plutarque53. Certes, comme dans le recueil d’apophtegmes d’Érasme, il manifeste le prix accordé à l’amitié54. Mais, Montaigne l’infléchit dans le sens d’une
ouverture au hasard en l’associant à l’exemple d’Alexandre qui lui fait suite immédiatement :
Ce que Alexandre representa bien plus vivement par effect, et plus roidement, quand ayant eu advis par une lettre de Parmenion, que Philippus, son plus cher medecin, estoit corrompu par l’argent de Darius pour l’empoisonner, en mesme temps qu’il donnoit à lire sa lettre à Philippus, il avala le bruvage qu’il luy avoit presenté. Fut ce pas exprimer cette resolution, que, si ses amys le vouloient tuer, il consentoit qu’ils le peussent faire ? Ce prince est le souverain patron des actes hazardeux ; mais je ne sçay s’il y a traict en sa vie, qui ayt plus de fermeté que cestuy-cy, ny une beauté illustre par tant de visages. Ceux qui preschent aux princes le deffiance si attentive, soubs couleur de leur precsher leur seurté, leur preschent leur ruyne et leur honte. Rien de noble ne se faict sans hazard55.
La confiance est préférée à la sécurité. Cette ouverture au hasard, l’accueil qui lui est fait relèvent de l’éthique, ils s’opèrent sur le fondement de la bonne foi56. Et il faut, en effet, une audace et une confiance naïves pour, comme le fait Montaigne, « [parler] au papier comme [on] parle au premier que [l’on] rencontre57 ». On a souvent relevé le propos pour noter la spontanéité et le naturel qui caractérisent l’écriture de Montaigne ; on n’a peut-être pas suffisamment souligné l’extrême confiance qu’il manifeste envers l’inconnu et l’imprévu. Le propos laisse entendre une absence totale de retenue et de dissimulation, même envers ceux dont on ignore tout. C’est là faire preuve d’un extraordinaire parrhésia58.
C’est sans doute l’utilisation faite du dit du Perse Siramnès, au chapitre « De l’art de conférer » qui marque le mieux l’inflexion en direction de l’emprise de la fortune que Montaigne fait subir aux apophtegmes. Nous avions commencé à le noter, il convient d’y revenir59. Si le dit relevé établit un partage entre ce qui dépend de nous, « ce qui part du dedans », et ce qui nous échappe et appartient à la fortune, « ce qui part du dehors », Montaigne abolit cette partition. Il étend, en effet, le domaine de la fortune, constatant que « la plus part des choses du monde se font par elles mesmes, // Fatam viam inveniunt60 ». Il lui abandonne encore ce que l’apophtegme ôtait à son emprise, « nostre sagesse mesme et consultation61 ». C’est toute une redéfinition de l’apophtegme qui se profile dans cette lecture que propose Montaigne.
Reconnaître le hasard dans « ce qui part du dedans »
De fait, le dit de Siramnès vient, dans l’épître à Trajan qui en fait mention, définir l’apophtegme en l’opposant aux faits qui sont sous la dépendance de la fortune :
Il est bien vray que nous avons en une autre œuvre, compilé les vies des plus illustres personnages, tant en armes qu’en conseil, comme capitaines, legislateurs, Roys et Empereurs, qui aient oncques esté entre les Romains et entre les Grecs : mais en la plupart de leurs faicts et gestes la fortune y est ordinairement meslee : là où és paroles qu’ils ont dittes et aux propos qu’ils ont tenus, sur l’heure mesme de leurs faicts, de leurs passions et de leurs accidents, on apparçoit plus clairement et plus nettement, comme dedans des miroirs, quel estoit le cœur et la pensée de chascun d’eulx : au moien dequoy Siramnes gentilhomme Persien respondit à quelques uns qui s’esmerveilloient comme ses entreprises ne succedoient heureusement, veu
que ses propos estoient si sages : c’est, dit il, pource que je suis seul maistre de mes propos, mais des effects, c’est la Fortune et le Roy62.
Amyot reprend ce dit dans l’avis « Aux lecteurs » de sa traduction des Vies pour établir, sur les mêmes fondements, un partage entre la matière des histoires et celle des vies :
Or est il, que selon la diversité de la matiere qu’elle [l’histoire] traitte, ou de l’ordre et manière d’escrire dont elle use, on luy donne noms differents : mais il y en a entre autres deux principales especes : l’une qui expose au long les faicts et adventures des hommes, et s’appelle du nom commune d’histoire : l’autre qui declare leur nature, leurs dicts et leurs mœurs, qui proprement se nomme Vie. Et combien que leurs subjects soient fort conjoincts, si est-ce que l’une regarde plus les choses, l’autre les personnes : l’une est plus publique, l’autre plus domestique : l’une concerne plus ce qui est au dehors de l’homme, l’autre ce qui procede du dedans : l’une les evenemens et l’autre les conseils : entre lesquels il y a bien souvent grande difference, suivant ce que Sirammes Persien respondit à ceulx qui s’esbahissoient dont venoit que ses devis estoient si sages, et ses effects si peu heureux : « C’est pour autant, dit il, que les devis sont en ma pleine disposition, et les effects en celle de la fortune et du roy63.
Face aux vicissitudes d’une existence soumise à la Fortune et à ses caprices, les paroles que sont les apophtegmes offrent comme un îlot de stabilité. Cette conception qui prévaut encore au xvie siècle est ainsi mise à mal par Montaigne. En découvrant dans sa propre parole, ses propres mouvements internes, toute une part immaîtrisée, il marque du sceau de l’instabilité et de l’inconnu ce qui semblait y échapper. L’apophtegme perd les qualités dont il se dotait chez Plutarque et ses continuateurs. S’il est encore un « signe de l’âme », c’est une âme qu’on ne saurait connaître dans la transparence, une âme animée de mouvements qui échappent à notre contrôle.
L’écriture des Essais est en effet soumise au règne du hasard qui fait perdre au locuteur la maîtrise de ce qu’il dit :
[C] J’aurai eslancé quelque subtilité en escrivant. […] ; je l’ay si bien perdue que je ne scay ce que j’ay voulu dire : et l’a l’estranger descouverte par fois avant moy. Si je portoy le rasoir par tout où cela m’advient, je me desferoy
tout. Le rencontre m’en offrira le jour quelque autre fois plus apparent que celuy du midy : et me fera estonner de mon hesitation64.
Une distance s’instaure entre Montaigne (le « je ») et le discours qu’il tient : la mention de « l’étranger » qui découvre le sens du discours avant celui qui l’a produit témoigne de manière explicite de l’aliénation consécutive à l’intrusion du hasard dans la parole. Il s’ajoute à cela une instabilité du sens65. Cette parole que découvre l’essayiste et qu’il laisse s’épandre nous la qualifierons volontiers de « démonique » parce que Montaigne la situe dans le droit fil du démon de Socrate :
[B] Le demon de Socrates estout à l’advanture certaine impulsion de volonté, qui se presentoit à luy, sans attendre le conseil de son discours. En un ame bien espurée, comme la sienne, et preparée par continuel exercice de sagesse et de vertu, il est vray semblable que ces inclinations, quoy que temeraires et indigestes, estoyent toujours importantes et dignes d’estre suyvies. Chacun sent en soy quelque image de telles agitations [C] d’une opinion prompte, véhemente et fortuite. C’est à moy de leur donner quelque authorité, qui en donne si peu à nostre prudence. [B] Et en ay eu [C] de pareillement foibles en raison et violentes en persuasion : ou en dissuasion, qui estoient plus ordinaires en Socrates, [B] ausquelles je me laissay emporter si utilement et heureusement qu’elles pourroyent estre jugées tenir quelque chose d’inspiration divine66.
Généralisant cette parole démonique et se l’appropriant – même si, pour « précariser » sa propre parole, il prend soin de se situer en deçà de Socrate – Montaigne définit un discours proprement humain partagé entre un hasard dénué de sens et une providence. De fait, les démons, si l’on en croit Plutarque67 régissent la sphère où s’accomplissent les événements terrestres et les actes accomplis par les hommes. Ils appartiennent
à une zone qui est celle de la Fortune, située entre celles soumises à la Providence d’une part, au hasard d’autre part. Avec cette parole démonique, c’est la parole humaine, dans sa force et dans ses faiblesses, que Montaigne accueille.
Avec un peu d’audace, nous nous risquerions à dire que l’apophtegme, en sa qualité d’énoncé contingent, en sa nature laconique qui le rend parfois énigmatique et le plus souvent incomplet, serait une forme d’archétype de cette parole démonique, à mi-chemin entre l’inspiration divine et une part infra-humaine de notre être qui échapperait au contrôle de la raison68. La valeur de cette parole serait alors dans les potentialités qu’elle offre : précaire, instable et incertaine, elle ouvre une « route par ailleurs », notamment parce que, placée sous le sceau de l’incertain, elle est dépourvue de toute autorité dogmatique. Revenons au chapitre « Coutume de l’île de Céa » et à son ouverture. Avant la série d’apophtegmes qui va lancer la réflexion, Montaigne définit le statut de sa parole :
[A] Si philosopher c’est douter, comme ils disent, à plus forte raison niaiser et fantastiquer, comme je fais, doit estre doubter. Car c’est aux apprentifs à enquerir et à debatre, et au cathedrant de resoudre. Mon cathedrant, c’est l’autorité de la volonté divine, qui nous reigle sans contredit et qui a son rang au dessus de ces humaines et vaines contestations69.
Ces propos nous semblent affectés aussi les apophtegmes qui suivent et qui, par leur dimension circonstanciée, s’offrent comme soumis à une précarité. Ils sont, pourrait-on dire, des paroles prononcés « à l’aventure ». L’expression indiquerait un abandon au hasard quelque peu incontrôlé. On sait qu’elle fait partie des expressions qu’aime Montaigne parce qu’elles marquent une parole « enquesteuse et non resolutive » :
On me faict hayr les choses vray-semblables quand on me les plante pour infaillibles. J’ayme ces mots, qui amollissent et moderent la temerité de nos propositions : A l’avanture, Aucunement, Quelque, On dict, Je pense, et semblables. Et si j’eusse eu à dresser des enfans, je leur eusse tant mis en la bouche cette façon de respondre, [C] enquesteuse et non resolutive : [B]
Qu’est-ce à dire ? Je ne l’entends pas, Il pourroit estre, Est-il vray ? qu’ils eussent plustost gardé la forme d’apprentis à soixante ans que de representer les docteurs à dix ans comme ils font70.
La locution s’inscrit dans une série de modalisateurs dubitatifs qui renvoient la parole humaine à sa précarité et par-là en affirme la contingence. Montaigne semble soucieux de maintenir cette part de hasard dans la parole humaine : l’enjeu est à nouveau éthique, il s’agit de ne pas usurper les droits de la parole divine. Ce discours, contingent et incomplet, douteux en sa nature proprement humaine qu’affirme l’exorde du chapitre, il pourra être contredit, repris, prolongé, bref il pourra donner matière à d’ « infinis essais ». Le matériau emprunté ouvre alors la voie à un discours « hors de propos », celui de Montaigne, celui du « suffisant lecteur » :
Et combien y ay-je espandu d’histoires qui ne disent mot, lesquelles qui voudra esplucher un peu ingenieusement, en produira infinis Essais. Ny elles, ni mes allegations ne servent pas toujours simplement d’exemple, d’authorité ou d’ornement. Je ne les regarde pas seulement par l’usage que j’en tire. Elles portent souvent, hors de mon propos, la semence d’une matiere plus riche et plus hardie, et sonnent à gauche un ton plus delicat, et pour moy qui n’en veux exprimer davantage et pour ceux qui rencontreront mon air71.
Il n’y a pas de contradiction, selon nous, entre ce « hors de propos » autorisé et les exigences de pertinence que l’on a vu Montaigne formuler ; les deux étant intimement liés. L’usage « hors de propos » du matériau emprunté est autorisé par l’« à-propos » avec lequel il est employé dans le contexte où il est transplanté. Aux circonstances contingentes dans lesquelles surgit l’apophtegme se substitue la contingence de la lecture. Est-ce hasard en effet si le texte que nous citons a été ajouté après relecture d’un passage où fleurissent des apophtegmes empruntés à Plutarque ? L’ « allongeail » nous semble plutôt fait « à-propos ».
Toutefois, cette découverte d’une part incontrôlée, soumise à des puissances qui nous échappent, n’est pas toujours vécue sur le monde euphorique. Derrière la confiance et la sérénité de Montaigne, nous semble poindre, tapie et latente, une « inquiétante étrangeté », celle que feraient naître les forces occultes qui nous habitent, celle qui nous dépossèderait de nous-mêmes, et notamment de ce qui semble nous
être le plus propre, notre discours. L’écriture des Essais est née comme l’indique le court chapitre « De l’oisiveté » (Essais, I, 8) de ce sentiment :
faisant le cheval eschappé, il [il s’agit de son esprit] se donne cent fois plus d’affaire à soy mesmes, qu’il n’en prenoit pour autruy ; et m’enfant tant de chimeres et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l’ineptie et l’estrangeté, j’ay commencé de les mettre en rolle, esperant avec le temps lui en faire honte à luy mesmes72.
L’exposé du projet débouche ainsi sur l’évocation des productions inattendues de l’esprit qui revêtent les caractéristiques que l’on vu Montaigne réprouver dans la manière de conférer des pédants ; à quoi s’ajoute ici l’étrangeté, une forme d’aliénation. Une distance s’inscrit en effet entre Montaigne et son discours – ici les productions de son esprit mises par écrit – mais encore entre lui et son esprit, partie de lui-même dont il se désolidarise. Livré à l’improvisation, au hasard, le discours semble lui échapper, ce qui n’est pas sans le troubler ni l’effrayer (en témoignent les images des « chimères et monstres fantasques »)73.
L’expérience se répète, nous semble-t-il, dans les « exercices spirituels » auxquels Montaigne se livre. Le miroir que lui tendent les apophtegmes et les exemples sur lesquels il s’essaie lui font faire l’expérience de l’étrangeté. Le passage par autrui est proprement aliénant dans la mesure où Montaigne s’éprouve à travers lui comme un « monstre » :
Jusques à cette heure, tous ces miracles et evenemens estranges se cachent devant moy. Je n’ay veu monstre et miracle au monde plus expres que moy-mesme. On s’apprivoise à toute estrangeté par l’usage et le temps ; mais plus je me hante et me connois, plus ma difformité m’estonne, moins je m’entens en moy74.
L’étrange, l’insolite, l’incontrôlable ne sont plus hors de nous, mais en nous. Plus on se connaît, plus on s’aliène. L’introspection et l’exercice spirituel qui devaient permettre une meilleure maîtrise de soi nous plongent dans des profondeurs occultes où l’on constate que l’on ne s’appartient pas.
Bérengère Basset
Université Toulouse 2 – Le Mirail
1 Plutraque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, Paris, Vascosan, 1572, 188b-c.
2 Les Apophtegmes d’Érasme, traduit par A. Macault, Paris, L’Angelier, 1547, non paginé. Simon Goulart ouvre le sommaire qu’il consacre aux Dits notables des Anciens rois dans la traduction proposée par Amyot en définissant la parole comme « une marque et vive painture de l’ame ».
3 C’est en effet l’une des traductions que propose Amyot. Ainsi, par exemples, dans la Vie de Thémistocle : « Telles étaient doncques les responses et rencontres de Thémistocle » (Plutarque, Vies de hommes illustres, trad. Jacques Amyot, Paris, Le Club français du livre, 1953, [Paris, Vascosan, 1559], t. 1, p. 242, nous soulignons. Nous donnons le texte grec : « ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀποφθέγμασι τοιοῦτος τις ἦν ») ; voir encore dans la Vie de Caton le censeur : « et trouve lon plusieurs de ses sentences et dicts moraux, rencontres et responses aigues, qui en sont translatées de mot à mot » (ibid., p. 687, nous soulignons et donnons le texte grec : « καὶ μεθηρμηνευμένα πολλὰ κατὰ λέξιν ἐν τοῖς ἀποφθέγμασι καὶ τοῖς γνωμολογίαις τέτακται »). La treizième serée de Guillaume Bouchet intitulée « Des responses et rencontres des seigneurs à leurs subjects, et des subjects à leurs signeurs » recueillent des apophtegmes.
4 Jean Nicot, Thresor de la langue française.
5 Sur la rencontre au xvie siècle, voir les travaux d’Olivier Guerrier : « “Rencontres” de mots et de pensées de Montaigne à Richelet », in Jean-Yves Laurichesse (dir.), L’ombre du souvenir, Paris, Classique Garnier, 2012, p. 35-51 ; « Rencontre et apophtegme », in Bérengère Basset, Olivier Guerrier et Fanny Népote (dir.), Usages et enjeux de l’apophtegme aux xvie et xviie siècles (à paraître).
6 Voir la métaphore de la pierre précieuse qu’utilise Érasme dans l’épître liminaire de son recueil : il les qualifie de « selectas ac repurgatas gemmae auro inclusas » (Apophtegmatum libri, Bâle, Froben, 1545, non paginé).
7 Nicolas Perrot, Sieur d’Ablancourt préface à son recueil, traduit du grec et du latin, Les Apophtegmes des anciens tirez de Plutarque, de Diogene Laerce, d’Elien, d’Athénée, de Stobée, de Macrobe, et de quelques autres, Paris, Thomas Jolly, 1664.
8 Voir sa formule, « Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre » (Essais, III, 1, éd. P. Villey, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1999, p. 790).
9 Daniel Ménager, « Improvisation et mémoire dans les Essais » in Frank Lestingant (dir.), Rhétorique de Montaigne – Actes du colloque de la Société des amis de Montaigne (Paris, 14 et 15 décembre 1974), Paris, Champion, 1985, p. 101-110. Et le critique d’écrire : « Montaigne est l’un des premiers à donner une certaine autonomie à la notion de “parler prompt” qui ne s’inscrit pas seulement dans les anecdotes concernant la mémoire mais dans une réflexion sur l’occasion et son rôle, sur les rapports entre les aubaines de la pensée et celles des mots. Enfin l’éloge de l’occasion ne signifie pas chez Montaigne l’abandon du discours à la puissance du hasard » (p. 102). Les termes de « parler prompt » et de « parler tardif » sont empruntés à Montaigne, plus particulièrement au chapitre 10 du livre I des Essais, « Du parler prompt ou tardif ».
10 Poétique du digressif. La digression dans la littérature de la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, p. 43.
11 Voir les remarques d’André Tournon sur ce point. Soulignant « l’aspect agonistique, de joute intellectuelle, sur lequel Montaigne met l’accent », il poursuit : « Il n’est rien qui distingue autant ce chapitre des modèles antiques ou contemporaines qu’on a pu lui trouver. De Platon à Cicéron et Plutarque, d’Érasme à Castiglione, tout le monde donne pour fin à l’échange verbal la découverte d’une vérité sur laquelle on pourra s’accorder. Dans le chapitre “De l’art de conférer”, cette image paisible des discussions philosophiques ou mondaines est délibérément écartée, pour laisser place aux aspects éritisques soulignés d’emblée » (Essais de Montaigne livre III, Neuilly, Atlande, 2002, p. 103) ; voir encore quelques lignes bas : « la “conférence” telle que l’entend Montaigne ne se conforme à aucun des modèles répertoriés : ni au dialogue platonicien dominé par un maître de sagesse autant de d’ignorance, Socrate ; ni à la disputatio pro et contra des universités, arbitrée par le “cathédrant” (= titulaire de la chaire) qui détient la vérité ; ni aux conversations de cour selon Castiglione, où la complaisance mutuelle et le désir de séduction, requis par le regard du prince, priment sur le besoin de rigueur » (ibid., p. 105).
12 Montaigne, Essais, III, 8, op. cit., p. 926, nous soulignons.
13 Ibid. p. 927 B.
14 Ibid. p. 923 B.
15 En voici quelques exemples, tous empruntés au chapitre huit du troisième livre des Essais (c’est nous qui soulignons, en gras, à chaque fois) : « Ainsi Platon, en sa republique, prohibe cet exercice aux esprits ineptes et mal nays » (p. 926 C) ; « Pour estre plus sçavans, ils n’en sont pas moins ineptes » (p. 927 B) ; « Socrates dispute plus en faveur des disputants qu’en faveur de la dispute ; et, pour instruire Euthydemus et Protagoras de la connoissance de leur impertinence plus que de l’impertinence de leur art » (p. 927 C) ; « L’agitation et la chasse est proprement de nostre gibier : nous ne sommes pas excusables de la conduire mal et impertinemment ; de faillir à la prise, c’est autre chose » (p. 928 B) ; « Par ainsi, la fauceté qui vient d’ignorance ne m’offence point, c’est l’ineptie. J’ay rompu plusieurs marchez qui m’estoyent utiles, par l’impertinence de la contestation de ceux avec qui je marchandois » (p. 928 B) ; « C’est pourquoy on voit tant d’ineptes ames entre les sçavantes, et plus que d’autres » (p. 931 B) ; « Ils ne vous en sçavent nul gré et en deviennent plus ineptes » (p. 937 B) ; « mais d’aller prescher le premier passant et regenter l’ignorance ou ineptie du premier rencontré, c’est un usage auquel je veux grand mal » (p. 938 B).
16 « Tout un jour je contesteray paisiblement, si la conduicte du debat se suit avec ordre. [C] Ce n’est pas tant la force et la subtilité que je demande, comme l’ordre » (ibid., p. 925, nous soulignons). Voir les remarques de Bernard Sève sur cette importance donnée à l’ordre : « L’insistance de Montaigne sur l’ordre est spectaculaire, le mot (ou ses dérivés) est employé sept fois en quelques pages ; les mots exprimant des idées voisines (forme, règle, à propos, façon de débattre, conduite, manière de dire, allure) sont aussi extrêmement nombreux. L’art de conférer c’est d’abord l’art de respecter l’ordre dans le discours, l’art de savoir écouter, de répondre à propos, d’avoir de la suite dans les idées sans “préfaces et digressions inutiles” […], d’être ordonné dans le jeu des arguments, répliques et réponses aux objections » (Bernard Sève, Montaigne des règles pour l’esprit¸ Paris, PUF, coll. « Philosophie d’aujourd’hui », 2009, p. 238).
17 Ibid., p. 925.
18 Ibid. p. 936. On se souviendra que pour Montaigne « la parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l’escoute » (ibid., III, 13, p. 1088 B). Et la remarque est précédée d’une citation empruntée à Quintilien, ajoutée sur l’Exemplaire de Bordeaux, qui fait intervenir la notion d’« à-propos » : « Est quaedam vox ad auditum accommodata, non magnitudine, sed proprietate » (nous soulignons).
19 Ibid. p. 937 B.
20 Ibid. p. 936 B. Sur cette appropriation de la matière étrangère, voir aussi les remarques bien connues du chapitre « De l’institution des enfants » (I, 26).
21 Voir les remarques de Bernard Sève sur l’improvisation chez Montaigne : « Ce qui est remarquable ici est que, dans l’improvisation, le fortuit répond au fortuit. La présence d’esprit, comme on dit si bien, consiste à répliquer au fortuit sur le mode du fortuit » (Bernard Sève, « Ménager le fortuit », BSIAM, 2012-1, no 55, p. 275-287, le propos cité figure à la page 281). Cette capacité d’improvisation est, pour Bernard Sève, le fait non du jugement mais de l’esprit. Sur la distinction entre « jugement » et « esprit », voir son ouvrage, Montaigne des règles pour l’esprit, op. cit. Concernant l’improvisation dans l’utilisation de la matière « étrangère », nous dirions que l’esprit suppose en amont le jugement : il faut que le jugement se soit exercé sur la matière mémorisée, l’ait faite sienne pour que l’esprit puisse en disposer dans l’improvisation.
22 Montaigne, Essais, III, 8, op. cit., p. 933.
23 Il figure dans l’épître liminaire adressée à Trajan. Voir dans la traduction d’Amyot : « au moien dequoy Siramnes gentilhomme Persien respondit à quelques uns qui s’esmerveilloient comment ses entreprises ne succedoient heureusement, veu que ses propos estoient si sages : c’est, dit il, pource que je suis seul maistre de mes propos, mais des effects, c’est la Fortune et le Roy » (Plutarque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, op. cit., 188c-d). Amyot réutilise ce dit dans l’avis « Aux lecteurs » qu’il place au seuil de sa traduction des Vies : « … suivant ce que Siramnes Persien respondit à ceulx qui s’esbahissoient dont venoient que ses devis estoient si sages, et ses effects si peu heureux : “C’est pour autant, dit il, que les devis sont en pleine disposition, et les effects en celle de fortune et du roy” » (Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, Paris, Le Club français du livre, 1953, t. 1, non paginé).
24 Montaigne, Essais, III, 8, op. cit., p. 934.
25 Voir la formule par laquelle Montaigne renoue le fil de son propos : « Or j’estois sur ce point, qu’il ne faut que voir un homme eslevé en dignité… » (ibid., p. 935B).
26 Ibid.
27 Voir dans la traduction d’Amyot : « Car ainsi comme ceulx qui chantent soubs une fluste, font beaucoup de faultes dont les escoutans ne s’apperçoivent point : aussi un langage elegant et brave esblouit les aureilles de l’escoutant, qu’il ne puisse sainement juger de ce qu’il signifie, comme dit Melanthius interrogué qu’il luy sembloit de la Tragedie de Dionysius : Je ne l’ay, dit il, peu veoir, tant elle estoit offusquee de langage » (Plutarque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, op. cit., 26h).
28 Voir Érasme, Apophthegmatum libri…, op. cit., p. 572-573 : « Interrogatus quid sentiret de tragoedia Diogenis, negavit se vidisse, quod esset obtecta verborum involucris. Notans ambitiosa verborum copia rem obscurari. Refert Plutarchus περὶ τῷ ἀκούειν » (« Comme on lui demandait ce qu’il pensait de la tragédie de Diogène, il répondit qu’il ne l’avait pas vue, dans la mesure où elle est recouverte d’une enveloppe de mots », nous traduisons).
29 Dans le recueil d’Érasme, l’apophtegme est accompagné de la manchette suivante : « verborum ampullae ».
30 Montaigne, Essais, III, 8, op. cit., p. 930B.
31 Ibid., III, 9, p. 948B.
32 Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, op. cit., t. 1, p. 519. Si le propos ne figure pas dans les recueils d’apophtegmes, c’est sans doute parce qu’il est le fait d’un anonyme qui n’est pas un Lacédémonien. Les apophtegmes recueillis sont toujours des propos prononcés par des personnes connues, à l’exception des apophtegmes des Lacédémoniens, le recueil rassemblant ces derniers contient, en effet, une section consacrée aux anonymes.
33 Montaigne, Essais, III, 9, op. cit., p. 947.
34 Daniel Ménager, « Improvisation et mémoire dans les Essais », art. cit., p. 110.
35 Montaigne, Essais, I, 26, op. cit., p. 171C.
36 Ibid., III, 8, p. 936.
37 Il nous semble ainsi que Louis Lobbes simplifie quelque peu les choses lorsqu’il traite de l’utilisation des apophtegmes dans les Essais : « Montaigne de son côté fait de l’argumentation. Celle-ci repose sur deux piliers, le premier étant constitué des données de l’expérience personnelle et vécue, le second étant fourni par tout ce que les Anciens ont pu faire et dire de sage (ou non !) qui puisse servir encore à l’usage du lecteur moderne : l’on aura reconnu les facta memorabilia, autre genre très en vogue sur les brisées de Valère Maxime, et l’apophtegme. Or, une différence fondamentale sépare ici Montaigne d’Érasme. C’est que celui-ci part du propos mémorable pour se livrer à un commentaire, si bref soit-il, alors que l’auteur des Essais suit un cheminement intellectuel strictement inverse, l’apophtegme venant seulement confirmer l’assertion » (Louis Lobbes, Des Apophtegmes à la Polyanthée – Érasme et le genre des dits mémorables, Paris, Champion, 2013, p. 152).
38 Montaigne, Essais, II, 11, op. cit., p. 423A.
39 Montaigne résume les circonstances dans lesquelles le propos a été tenu, mais il suit assez fidèlement Amyot dans la restitution des paroles du personnage : « et à tant s’en alla de l’assemblée devisant avec ceulx qui l’accompagnoient ; “Que c’estoit chose trop facile et trop lasche, que de mal faire : et que de faire bien là où il n’y eust point de danger, c’estoit chose commune : mais que faire bien là où il eust danger, c’estoit le propre office d’un homme d’honneur et de vertu” » (Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, op. cit., t. 1, p. 867).
40 Montaigne, Essais, II, 11, op. cit., p. 423A.
41 Montaigne, Essais, II, 3, op. cit., p. 350A.
42 Ibid. On voit, à travers cet exemple, que, contrairement à ce qu’écrit Louis Lobbes, le cheminement intellectuel accompli par Montaigne n’inverse pas, en l’occurrence, celui que met en place Érasme dans ses Apophthegmatum libri (voir notre note supra).
43 Ibid.
44 Ibid., p. 354A, nous soulignons.
45 Voir dans la traduction d’Amyot : « Therycion ayant dit de semblables paroles, Cleomenes luy respondit, “Tu penses, doncques que ce soit à toy magnanimité que de chercher la mort, qui est l’une des plus faciles et plus aisées choses qui puisse advenir à l’homme, et celle qu’il a plus à commandement et à main toutes les fois qu’il luy plaist : et ce pendant, meschant que tu es, tu fuis d’une fuitte plus lasche et plus honteuse que la premiere. Car plusieurs vaillans hommes, autres que nous ne sommes, ont bien autrefois cedé à leurs ennemis, ou pour quelque accident de fortune qui leur a esté contraire, ou ayans esté forcez par plus grand nombre de gens : mais celuy qui se laisse aller et qui succumbe aux travaux et labeurs, ou aux blasmes et louanges des hommes, il fault qu’il confesse qu’il est vaincu par sa propre lascheté : car il ne fault pas que la mort que lon se donne vouluntairement soit pour fouir à faire des actes laborieux, ains fault que celle mort mesme soit un acte louable, pource que c’est honte de vouloir vivre ou mourir pour l’amour de soy mesme, comme tu m’enhortes que je face maintenant, pour me tirer hors des travaux où nous sommes de present, sans faire autre chose quelconque, ny utile ny honorable : là où au contraire je suis d’advis que toy ne moy ne devons jamais abandonner l’esperance de servir encore quelque jour à nostre païs : car là où toute esperance nous defaudra, alors nous sera il tousjours assez aisé de mourir toutes et quantes fois que nous vouldrons” » (Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, t. 2, p. 684-685).
46 Montaigne, Essais, II, 3, op. cit., p. 362.
47 Sur la part de hasard qui entre dans l’écriture de Montaigne, on consultera l’article d’Olivier Guerrier : « “La plume au vent” : L’errance réfléchie » in BSIAM, 2012-1, no 55, p. 91-104. Voir aussi, dans le même volume, l’article de Bernard Sève déjà cité.
48 Montaigne, Essais, II, 3, op. cit., p. 354A.
49 L’expression vient qualifier Alexandre dans le chapitre « Divers événements d’un même conseil » (Essais, I, 24, op. cit., p. 129). Nous allons revenir sur ce passage.
50 Ibid., II, 34, op. cit., p. 740A-B.
51 Voir, dans la traduction de Jacques Amyot : « Les haultes et hazardeuses entreprises, il disoit qu’il fallait les executer, et non pas en consulter » (Plutarque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, op. cit., 208D.
52 Montaigne, Essais, I, 24, op. cit., p. 129.
53 Voir la traduction qu’en propose Jacques Amyot : « Dion, celuy qui chassa Dionysius hors de sa tyrannie, estant adverty que Callipus, auquel il se fioit plus qu’à nul autre de ses hostes ny amis, espoit les moyens de le faire mourir, n’eut jamais le cœur d’en informer pour le convaincre, disant, qu’il amoit mieulx mourir que vivre en ceste peine, d’avoir à se garder non de ses ennemys seulement, mais aussi de ses amys » (Plutarque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, op. cit., 190h).
54 Voir Érasme, Apophthegmatum libri…, op. cit., p. 377 : « Dion, qui Dionysium regno expulit, quum accepisset Calippum, cui et inter hospites et amicos suos fidebat maxime, sibi moliri insidias, non potuit inducere animum ut illum convinceret, dicens, Mori satius esse quam vivere, si non ab hiostibus tantum, verumetiam ab amicis cavendum esset. Dignus erat optimis amicis, qui mori prius habuerit, quam amico diffidere » (voir la traduction de Macault : « Dion qui chassa Dionysius du Royaume, quand on luy dit que Callipus, auquel entre tous ceulx de sa maison et autres estrangers il avoit grande confidence, luy estoit traistre, ne se peult mettre en l’esprit qu’il fut tel, disant qu’il estoit meilleur de mourir que de vivre, s’il se falloit garder, non seulement de ses ennemys, mais aussi de ses amys. Certes il estoit homme digne d’avoir de tresbons amys, qui aymoit mieulx mourir, que de se meffier d’eulx », op. cit., 281a-b).
55 Montaigne, Essais, I, 24, op. cit., p. 129C.
56 Voir l’exemple de Scipion, ajouté dans le même passage sur l’Exemplaire de Bordeaux : « Scipion sceut, pour pratiquer la volonté de Syphax, quittant son armée, et abandonnant l’Espaigne, douteuse encore sous sa nouvelle conqueste, passer en Afrique, dans deux simples vaisseaux, pour se commettre en terre ennemie, à la puissance d’un Roy barbare, à une foy inconnue, sans obligation, sans hostage, sous la seule seureté de la grandeur de son propre courage, de son bonheur, et de la promesse de ses hautes esperances : “habita fides ipsam plerumque fidem obligat” » (ibid., p. 129C).
57 Ibid., III, 1, p. 790B.
58 On comparera avec la liberté de parole à laquelle invite Érasme dans son commentaire de l’adage Quicquid in buccam venerit (I, v, 72) : « Quicquid in buccam venerit. Quoties libere quospiam ac tuto loqui significamus, incircumspecte et quicquid forte fortuna in animum inciderit. Quemadmodum apud fidos amiculos facere solemus, apud quos impune quidvis nugamur atque effutimus » (« Tout ce qui vient à la bouche. Chaque fois que nous signifions à des interlocuteurs de parler librement et en confiance, sans retenue, et de dire ce qui d’aventure se présente à leur esprit. Comme nous avons coutume de faire auprès d’amis sûrs, avec qui nous plaisantons et bavardons sans risque de tout sujet », Érasme, Les Adages, Paris, Les Belles Lettres, 2011, vol. 1, p. 382, nous soulignons). La liberté de parole ne se déploie, comme on voit, que dans un cercle restreint d’amis en qui l’on a confiance.
59 Voir nos remarques supra.
60 Montaigne, Essais, III, 8, op. cit., p. 933B.
61 « Je dis plus que nostre sagesse mesme et consultation suit pour la plus part la conduite du hazard » (ibid., p. 934B).
62 Plutarque, Œuvres morales et mêlées, trad. Jacques Amyot, op. cit., 188c-d.
63 Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, op. cit., t. 1, non paginé.
64 Montaigne, Essais, I, 10, op. cit., p. 40. Un peu plus haut, dans la 2e édition (strate [B] de l’édition Villey), Montaigne écrit : « Je ne me tiens pas bien en ma possession et disposition. Le hasard y a plus de droit que moi ».
65 C’est tout à la fois la production du discours et la redécouverte du sens qui sont placées sous la dépendance du hasard. C’est ce qu’indiquent l’emploi du verbe « advient » pour la première et celui du terme « rencontre » pour la seconde.
66 Montaigne, Essais, I, 11, op. cit., p. 44.
67 Il en traite dans le traité Sur la fatale destinée ou encore dans Le Démon de Socrate et De la cessation des oracles. Sans nul doute, la pensée de Plutarque en la matière a influencé Montaigne. Il n’est qu’à voir l’importance qu’accorde l’humaniste au traité sur le démon de Socrate. Sur les théories de Plutarque en ce qui concerne, nous renvoyons à l’article d’André Tournon « Le philosophe et ses démons », in O. Guerrier (dir.), Moralia et œuvres morales à la Renaissance, Paris, Champion, 2005, p. 309-327.
68 On aura pu noter que dans le passage du chapitre I, 10 que nous citions, Montaigne identifie sa parole hasardeuse à « quelques subtilités ». Or, les apophtegmes sont définis précisément comme des paroles subtiles.
69 Montaigne, Essais, II, 3, op. cit., p. 350.
70 Ibid., III, 13, p. 1030.
71 Ibid., I, 40, p. 251C.
72 Essais, I, 8, p. 33 [A]. Nous soulignons.
73 Nous renvoyons à l’analyse qu’Olivier Guerrier propose de ce passage dans son article : « “La plume au vent” : l’errance réfléchie », art. cit., p. 98-99.
74 Montaigne, Essais, III, 11, op. cit., p. 1029. Nous renvoyons à ce sujet au texte que Merleau-Ponty a consacré à Montaigne : « Lecture de Montaigne », art. cit. On peut lire les remarques suivantes : « La connaissance de soi chez Montaigne est dialogue avec soi, c’est une interrogation adressée à cet être opaque qu’il est et de qui il attend réponse » (p. 325) et quelques lignes bas : « Le mot d’“étrange” ets celui qui revient le plus souvent quand Montaigne parle de l’homme. Ou “absurde”. Ou “monstre”. Ou “miracle” » (p. 327). Voir encore le texte de Jean-Yves Pouilloux, « “Connais-toi toi-même” : un commandement paradoxe » in Montaigne, une vérité singulière, Paris, NRF Gallimard, coll. « L’infini », 2012, p. 41-69.