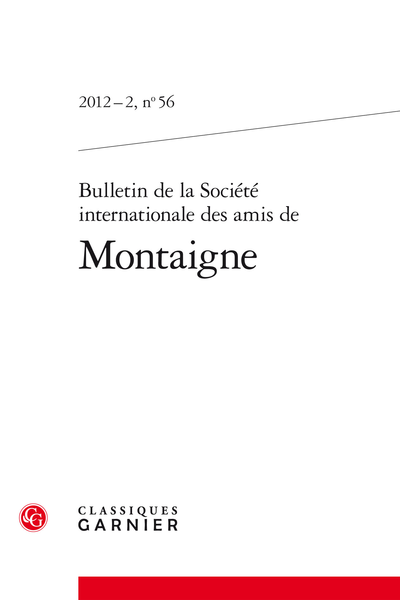
Une lecture straussienne des Essais, ou le Montaigne du docteur Armaingaud
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Author: Desan (Philippe)
- Pages: 55 to 68
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439773
- ISBN: 978-2-8124-3977-3
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0055
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-21-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Une lecture straussienne des Essais,
ou le Montaigne
du docteur Armaingaud
Le livre le plus célèbre du politologue, philosophe et spécialiste de littérature classique, Leo Strauss (1899-1973) est sans aucun doute Persecution and the Art of Writing, ouvrage publié en 1952 par les presses de l’Université de Chicago1. Le premier chapitre de ce livre fut écrit en 1941, durant la Seconde Guerre mondiale. Cette étude porte sur les procédés de dissimulation dans la littérature et comporte trois études qui accompagnent l’introduction : un premier texte sur le caractère littéraire du « Guide des égarés » de Moïse Maïmonide (xiie siècle), une seconde étude sur la loi et la raison dans l’œuvre de Judah Halévi, le Kusari (xie-xiie siècle), et finalement une étude plus connue et assez emblématique intitulée « Comment étudier le “Traité théologico-politique” de Spinoza ». Rappelons que le texte de Leo Strauss n’a été traduit en langue française qu’en 1989 (de façon relativement confidentielle) et a été assez mal interprété en France. Il faut en fait posséder quelques rudiments de « straussisme » pour comprendre la façon dont cette étude a été appliquée et a servi de modèle pour toutes sortes de plateformes politiques et idéologiques aux États-Unis depuis plus d’un demi-siècle.
Les prémisses de l’ouvrage sont pourtant assez simples. Dans la crainte d’être persécutés pour leurs idées, la plupart des grands auteurs avant le xviiie siècle auraient développé des façons détournées pour exprimer leurs idées. Ce langage caché aurait même profondément influencé et même défini leur style tout en permettant aux « lecteurs suffisants » d’y déceler des critiques voilées des systèmes de pouvoir en
place. Nous aurions aujourd’hui perdu cette manière de lire entre les lignes et ces messages nous apparaissent pour cette raison indéchiffrables et donc incompréhensibles. Les grands auteurs du Moyen Âge, de la Renaissance et la plupart des auteurs du xviie siècle se seraient donc mis à écrire entre les lignes (texte au premier abord invisible pour ceux qui ne sont pas suffisamment éclairés). Leo Strauss soutient que le message de presque tous les « grands auteurs » avant le xviiie siècle est souvent dissimulé, mais il est néanmoins possible de le restituer grâce à une lecture herméneutique éclairée par une prise en compte des circonstances historiques immédiates au moment de la rédaction de leur ouvrage. La thèse de Strauss est fondée sur des principes « objectifs » qui permettent de déceler si un auteur a pu cacher sa pensée : 1) le désordre apparent avec des idées importantes dissimulées et entremêlées au sein de réflexions insignifiantes ou très personnelles ; 2) les répétitions avec des variantes ; 3) les allusions non précisées, ou les obscurités volontaires ; 4) les contradictions délibérées avec de nombreux ajouts ; 5) les silences ou omissions, plus particulièrement sur les événements contemporains.
On comprend que ces cinq signes qui annoncent la dissimulation conviennent parfaitement à une lecture des Essais. Et pourtant Strauss n’a rien écrit sur Montaigne, à part un cours fait à l’Université de Chicago au tout début des années 1970. C’est pourtant entre 1960 et 1973 qu’il forma un groupe redoutable de jeunes penseurs américains que l’on appelait à l’époque les néo-straussiens – formés à l’université de Chicago dans le département de « Social Thought » –, et qui sont pour la plupart devenus néo-conservateurs aujourd’hui. Le travail du critique straussien est celui d’un détective. Il s’agit de mettre à jour l’écriture cachée de l’auteur qui n’avait pas d’autre choix pour exprimer ses vues devant la persécution toujours possible. Pour les straussiens l’écriture des auteurs étudiés correspond presque toujours à une recherche de la liberté, c’est-à-dire une forme de libéralisme dans le sens américain du terme. L’objet de son discours est la liberté dans toute son abstraction, à savoir la liberté de penser et de s’exprimer ; l’action n’est quant à elle jamais essentielle et est pour cette raison reléguée à l’arrière-plan des motivations individuelles. Au fil des ans, dans le milieu universitaire américain, lire le sens caché d’un texte devint un véritable art qui permit de créer une confrérie de straussiens. David Schaeffer compte parmi les plus connus parmi eux, du moins pour le sujet retenu. C’est le seul
nom que je donnerai ici car c’est celui qui a le plus écrit sur Montaigne à partir d’une approche straussienne2.
Mais commençons pas quelques rudiments de straussisme. Leo Strauss argue que la pensée indépendante a toujours été réprimée dans l’histoire des civilisations et que la persécution a donné naissance à une technique particulière d’écriture où la vérité se présente uniquement de façon cachée, c’est-à-dire diffuse entre les lignes. Il remarque que « les hommes irréfléchis sont des lecteurs inattentifs, et seuls des hommes réfléchis sont des lecteurs attentifs. C’est pourquoi il suffit pour un auteur qui ne veut s’adresser qu’à des hommes réfléchis d’écrire d’une manière telle que seul un lecteur très attentif pourra déceler la signification de son livre3 ». On se rend compte de l’argument circulaire ici : à une écriture dissimulée correspond donc une lecture tout aussi dissimulée pour ceux qui ne seraient pas suffisamment « réfléchis » ou attentifs (les deux mots utilisés par Strauss comme un leitmotiv). Certes, Strauss remarque que les preuves avancées à partir de sa méthode herméneutique qui consiste à lire entre les lignes « n’aboutissent pas à un accord complet entre tous les spécialistes », mais il conclut néanmoins que « Si l’on estime que cela constitue une objection à la lecture entre les lignes en tant que telle, on peut rétorquer que les méthodes généralement utilisées aujourd’hui n’aboutissent pas, elles non plus, à un accord universel, ni même à un consensus assez large sur les questions les plus importantes4 ». Donc aucun problème pour l’interprète puisque l’expertise est toujours de son côté. Il devient en quelque sorte le « suffisant lecteur » dont parle Montaigne dans ses Essais.
J’ai toujours été surpris par la réception largement positive faite à Strauss en France. Cette réception est purement théorique et n’a jamais pris en compte la façon dont la méthode straussienne a été utilisée par le pouvoir en place pour faire dire aux textes ce que l’expertise d’un petit nombre d’individus voulait bien dévoiler sur ces textes. C’est peut-être parce que j’ai vu d’assez près – à l’université de Chicago où j’enseigne depuis presque trente années, mais surtout à la Maison Blanche dans
les années 1980 et 1990 – les ravages de cette méthode straussienne qu’il me semble bon de mettre en garde contre une telle approche de la littérature et de tout texte en général. Et j’en arrive à Montaigne et au docteur Armaingaud. L’application des principes straussiens sur la dissimulation de l’écriture permet en effet de faire dire au texte absolument tout ce que l’on veut. Rappelons que les straussiens furent d’importants conseillers de Ronald Reagan quand ce président voulut faire vérifier par des experts en écriture dissimulée ce qu’il voulait personnellement lire dans la constitution américaine, notamment un pouvoir plus fort pour l’exécutif que n’auraient pas voulu exprimer de front les pères fondateurs de la constitution. Les signataires de la constitution américaine n’auraient eux-mêmes pas pu tout dire et se seraient exprimés de façon voilée. Cette lecture straussienne fut de nouveau à la mode durant l’administration de George Bush, plus particulièrement pour les nouvelles lois éthiques – par exemple le doit des embryons – mises en place à partir du principe que ces positions morales étaient déjà présentes « entre les lignes » dans la pensée des dirigeants du pays au xviiie siècle. Une fois de plus on fit appel à des néo-straussiens de l’université de Chicago pour trouver la bonne interprétation des textes invoqués.
Retour en arrière. Transportons-nous un demi-siècle avant Léo Strauss et venons-en au docteur Arthur Armaingaud (1842-1935), le fondateur de la Société des Amis de Montaigne. Successivement secrétaire de Sainte-Beuve et de Littré durant sa jeunesse, Armaingaud reçut le grade de docteur en médecine de la faculté de Paris en 1867. Il fut ensuite professeur à la faculté de Bordeaux, au cours municipal d’hygiène, membre du Conseil de surveillance des enfants du premier âge, puis rapporteur auprès du comité international de Genève pour les hospices et sanatoriums maritimes. Le Dr Armaingaud connut en fait deux carrières bien distinctes. D’abord médecin, il combattit la tuberculose et les maladies infantiles, puis, après sa retraite à l’âge de 65 ans, il entama une seconde carrière de montaigniste au début du xxe siècle.
C’est comme on le sait le Dr Armaingaud qui, en 1912, créa la Société des Amis de Montaigne avec pour premier président Anatole France. Il passa plus de dix ans à préparer une édition des œuvres complètes de Montaigne et son édition des Œuvres complètes de Montaigne, en douze volumes fut publiée entre 1924 et 1927, c’est-à-dire pratiquement en
même temps que l’édition des Essais par Pierre Villey (1923). Ces deux éditions s’imposèrent d’emblée et furent en concurrence avec la fameuse édition municipale imprimée à Bordeaux. Il aura en effet fallu presque trente années pour voir paraître le dernier tome de l’édition municipale en 1933. Le projet s’essoufflait et l’on commençait à douter de cette entreprise bordelaise. Quand le projet fut enfin terminé, on s’étonna que ce monument restât inaccessible au grand public. Vint alors le docteur Armaingaud !
Son édition des œuvres complètes de Montaigne représente un véritable monument. Armaingaud dédia son travail « Au Vainqueur de la Marne, le Maréchal Joffre » et présenta sous forme d’une très longue introduction ses vues sur Montaigne et les Essais. Partisan convaincu de la supériorité de l’Exemplaire de Bordeaux sur le texte de 1595, il pensait que Gournay avait considérablement modifié le texte de Montaigne et parla même d’une « profanation ». Il contribua largement à dévaluer le travail éditorial de Marie de Gournay, une position que l’on retrouve encore aujourd’hui parmi de nombreux montaignistes. Comme Pierre Villey, il s’intéressait à l’évolution de la pensée de Montaigne et émit l’idée alors à la mode d’une représentation des différentes couches des Essais par des lettres (A pour l’édition de 1580, B pour 1588) au sein d’un même texte. Son édition des Essais est en fait la première – avant l’édition de Pierre Villey – qui donne les variantes de 1580, 1582, 1588 et 1595 au bas de chaque page.
Le texte manuscrit de Montaigne permit à Armaingaud de vérifier matériellement (ou du moins de donner l’illusion d’une vérification) les thèses qu’il soutenait. Il rendit hommage à Dezeimeris pour avoir publié ce document précieux, « avec raison que l’exemplaire de Bordeaux est bien l’exemplaire, le seul exemplaire authentique des Essais, celui que Montaigne destinait à l’impression5 ». Le Docteur se méfiait pourtant de Dezeimeris dont il n’aimait pas les états d’âme. Il n’était pour lui pas question de mettre l’Exemplaire de Bordeaux sur le même plan que l’édition Gournay de 1595 : « Mais il [Dezeimeris] émit une conclusion étrange en accordant que l’on doit introduire dans le texte d’une édition authentique des Essais les additions qui ne sont pas représentées dans
l’exemplaire de Bordeaux6 ». Cette position de Dezeimeris lui parut intolérable et il décida de se lancer dans une nouvelle bataille pour établir la précellence de l’Exemplaire de Bordeaux. Le Docteur Armaingaud réussit finalement à convaincre Dezeimeris de ne pas se compromettre avec l’édition de 1595. Il n’est pas peu fier de sa victoire : « en 1904 il [Dezeimeris] approuvait complètement l’opinion que j’avais fait partager à Paris, dès 1901, à nos amis de la Société Montaigne, opinion exprimée dans la lettre adressée le 22 mars 1905 à M. le Directeur de l’Imprimerie nationale, et qui fut aussi celle des éditeurs de l’édition municipale7 ». La victoire de l’Exemplaire de Bordeaux était désormais évidente, après cette ultime récupération de Dezeimeris par le Docteur Armaingaud.
Fort des possibilités que permettait selon lui la représentation physique des différentes couches des Essais, il avait émis l’hypothèse d’une édition parfaite qui reproduirait toutes les variantes par des lettres (A pour l’édition de 1580, B pour 1588) au sein d’un même texte. Le Docteur s’embarqua alors dans une politique éditoriale des plus étranges. Il émit le principe fantaisiste selon lequel seul le premier livre des Essais avait besoin de toutes les variantes de 1595 – les second et troisième livres ne réclamaient selon lui que les « variantes vraiment capitales » : « Nous avons donné pour le premier livre, à peu près toutes les variantes de 1595, même celles qui ne présentent aucun intérêt, afin que le lecteur puisse en juger. Pour les deux autres livres, au contraire, nous nous sommes borné aux seules variantes vraiment capitales de cette même édition de 15958 ». Jamais il ne s’expliqua sur les « à peu près » du premier livre et sur la sélection subjective des autres livres9. Armaingaud éprouvait un malin plaisir à choquer les universitaires qui ne l’avaient jamais accepté en leur profession.
Après le docteur Payen, le docteur Armaingaud s’intéressa à son tour aux portraits de Montaigne et émit l’intention de publier une étude iconographique qui devait accompagner son édition des Œuvres de Montaigne publiée entre 1924 et 1927. Mort à l’âge de 93 ans, il ne compléta jamais cette étude et ses papiers ne laissent aujourd’hui
aucune trace de ce travail10. Il faut dire qu’il en était encore à chercher le modèle des gravures d’Étienne Ficquet et de Pierre Michel Alix : « Sur quel portrait de Dumonstier Fiquet (et aussi Alix, graveur de la même époque) ont-ils copié le portrait ? Nous n’avons sur ce point trouvé aucun renseignement, et notre étude aussi complète que prolongée pendant de longues années, sur les portraits de Montaigne, n’a pu nous faire obtenir aucune indication11 ». Sa documentation est aujourd’hui perdue, contrairement à celle de Payen.
Rappelons aussi le fait que c’est le docteur Armaingaud qui offrit à la ville de Paris la statue de Montaigne par Landowski que l’on peut aujourd’hui voir devant la Sorbonne. En effet, en septembre 1931 le docteur Armaingaud, montaignophile et montaignologue reconnu à cette époque par la société des Amis de Montaigne qui comprenait à l’époque une minorité d’universitaires, passa commande d’une statue de Montaigne à Landowski. Pour le quatrième centenaire de la naissance de Montaigne, le plâtre original fut installé à la Sorbonne. Un article publié dans Le Temps, daté de juin 1933, annonce que le docteur Armaingaud, « Commandeur de la Légion d’honneur, secrétaire général de la Société des Amis de Montaigne, auteur d’une importante édition critique des œuvres de Montaigne », a décidé d’offrir une statue de Montaigne à la ville de Paris. En attendant l’achèvement de cette statue par le célèbre sculpteur Landowski, une réplique en plâtre fut placée dans la salle des pas perdus, au pied de l’escalier conduisant au grand amphithéâtre de la Sorbonne. De nombreuses personnalités assistèrent à la cérémonie de remise officielle, parmi lesquels M. de Fontenay, président du Conseil municipal, Louis Barthou, de l’Académie française et président de la Société des Amis de Montaigne, M. Charléty, recteur de l’Université de Paris, et M. Brandon, député du 5e arrondissement de la ville de Paris12. L’inauguration de la statue en marbre, haute de 2 mètres, eut lieu le 24 avril 1934. Cassée au pied droit, cette statue fut enlevée et placée au dépôt des œuvres d’art d’Ivry et remplacée par une fonte en
bronze (de Blanchet) érigée devant la Sorbonne en 1989. C’est cette reproduction que l’on peut voir aujourd’hui et qui est devenue une attraction touristique. Le plâtre original est aujourd’hui conservé au Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt13. Le buste en plâtre de 1932 est quant à lui dans le hall d’entrée du Lycée Montaigne à Paris. Le plâtre en très mauvais état – avec la jambe droite cassée – est signé « Paul Landowski, Boulogne/Seine 1933 ». L’exposition Montaigne de 1965 à Paris présenta le plâtre original de cette statue sous le no 78 du catalogue14. Le socle de cette statue comporte un bloc de pierre sur lequel on lit l’inscription suivante : « Je ne suis Français que par cette grande Cité, grande en peuples, grande et incomparable en variété et diversité de commodité, la gloire de la France et l’un des plus nobles ornements du monde. Tant qu’elle durera, je n’aurai faute de retraite où rendre mes abboies, suffisante à me faire perdre le regret de toute autre retraite ». En pleine montée du nazisme et du fascisme en Europe, et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces mots peuvent aujourd’hui paraître ironiques. Ils avaient été choisis par Armaingaud lui-même qui pensait que la Société des Nations permettrait d’éviter un second conflit en Europe.
Allons de l’avant pour retrouver Leo Strauss par le biais du docteur Armaingaud. Le savant montaigniste, qui s’était investi dans la vie de la société des Amis de Montaigne et contribua largement à la diffusion de la pensée de Montaigne entre les deux guerres, eut une grande idée, peut-être la seule ! Cette idée lui permit de développer une grille de lecture pour les Essais ; de façon étonnante, c’est en fait la même idée que reprendra (sans apparemment avoir eu connaissance du docteur Armaingaud) un peu plus tard par Leo Strauss. Voici comment ces deux esprits se croisèrent intellectuellement sans s’être pour autant connus.
C’est en 1910, alors qu’il avait presque 70 ans, que le docteur Armaingaud débuta sa carrière de montaigniste. Il lança un pavé dans la marre tranquille des montaignistes de l’époque. Son Montaigne pamphlétaire fut très mal reçu, peut-être pour de mauvaises raisons – Armaingaud était arrivé très tard sur la scène Montaigne ; il n’avait
aucune formation en sciences humaines et n’était qu’un « ami » de l’auteur qu’il admirait. Sa thèse était pourtant simple : La Boétie (du moins comme auteur) était une invention de Montaigne qui ne pouvait pas exprimer directement ses propres vues politiques sous peine de persécution et aurait alors « inventé » La Boétie pour mettre dans ses textes (inventés) – principalement le Discours de la servitude volontaire – ses propres idées sur la tyrannie et la démocratie. Car Montaigne fut forcément un auteur « moderne », épris de liberté, et donc un des pères fondateurs du libéralisme. Le sous-titre de son livre donnait en quelque sorte la réponse à la question qu’il s’était posée en lisant La Boétie : « L’énigme du Contr’Un ». Armaingaud était convaincu que le texte du Discours de la servitude volontaire n’était pas entièrement de la main de La Boétie et que les passages les plus saillants étaient par contre bien de l’auteur des Essais. Pour lui le Discours de la servitude volontaire était un pamphlet contre Henri III devenu tyran. C’est même Montaigne qui aurait lui-même communiqué le Discours aux protestants pour l’utiliser contre Henri III. Les Essais seraient ainsi un livre engagé, un livre de combat déguisé, un traité contre l’intolérance. Il faut pourtant être « lecteur suffisant » pour comprendre le message voilé de Montaigne. C’est donc entre les lignes qu’Armaingaud proposait de lire les Essais et de découvrir le message profond du révolutionnaire masqué.
Les Montaignistes ne manquèrent pas de porter en dérision son livre. Mais le docteur savait ce qu’il voulait et avait l’énorme avantage de toujours faire en sorte que les choses avancent selon ses projets. C’était un homme qui ne s’en laissait pas conter et il avait jusqu’à présent réussi à mener ses responsabilités au bout de leur chemin. Il était aussi du genre querelleur et les échanges de noms d’oiseau n’étaient pas pour lui déplaire. Nous ne donnerons qu’un seul exemple.
Dans un compte rendu assassin du livre de Fleury Vindry sur les Parlementaires français au xvie siècle, Armaingaud nous permet de cerner ses motivations à la veille de la création de la SAM. Vindry, grand spécialiste des parlements et des milieux d’ambassade à la Renaissance vit se déchaîner contre lui cet inconnu de la profession universitaire qui savait tourner ses phrases comme des armes blanches. Dans le tome XII de la Revue de la Renaissance, sous la direction de Léon Séché, Vindry tenta de montrer l’importance de son livre face aux invectives et autres fulminations d’Armaingaud. Vindry passe sur le ton ironique
d’Armaingaud qui lui avait reproché d’avoir écrit un livre « triste comme un cimetière ». Assez étonné de cette langue pleine de fiel, il se défendit de connaître suffisamment le xvie siècle et de travailler sur cette période historique depuis vingt ans pour savoir de quoi il parlait, alors que « le bon Docteur écrasât mon insuffisance présumée sous une tartine qui semble extraite du Dictionnaire Larousse, article “Tolérance”15 ». Il continue ainsi sa réplique au docteur : « M. Armaingaud devrait savoir que je n’en suis pas à mon premier livre et que mon activité ne s’est pas limitée, comme la sienne, à un point minuscule de l’Histoire » (faisant ici référence au Discours de la servitude volontaire qui ne jouissait pas encore d’une renommée suffisante pour être considéré comme un texte important). Le directeur de la revue, de façon assez extraordinaire, publia également à la suite du compte rendu une lettre privée envoyée par Vindry au docteur Armaingaud où il déplorait « de voir des esprits distingués comme le vôtre ou celui de M. Léon Séché, s’extasier devant cette longue puérilité qu’est le Contr’Un, se pâmer devant des enfantillages délayés gravement en une prose emphatique, boursouflée et gauche, ou se rencontre tout juste, une expression heureuse (sucrer la servitude)16 ». Il concluait sans appel possible : « À force d’admirer un écrivain uniquement parce que le temps a passé sur sa mémoire, nous en arriverons à trouver de la profondeur à un Claude Fauchet ou du génie aux laborieux calembours d’un Barthélemy Aneau. Et ce serait grand dommage, vraiment, car le bon sens en pâtirait17 ». Cette dernière remarque est intéressante car elle se réfère à un important débat de l’époque, à savoir la distinction établie entre auteurs majeurs et auteurs mineurs. On concédait alors que La Boétie pouvait être lu grâce à son amitié avec Montaigne, mais jamais en tant qu’auteur à part entière. Pour ces défenseurs d’une « haute littérature » (ce que Allan Bloom, le successeur de Leo Strauss à l’Université de Chicago, appellera plus tard le canon littéraire), La Boétie appartenait évidemment à la catégorie des auteurs mineurs. Pour Vindry et consorts de l’université française, la preuve que Montaigne n’était pas l’auteur du Discours tenait précisément à la médiocre qualité et à la naïveté du texte. N’étant pas lui-même universitaire, Armaingaud n’avait pu faire cette distinction ! Il faut
pourtant lui reconnaître d’avoir réussi à bouleverser sans scrupules l’ordre établi des penseurs et mis en cause le canon littéraire de l’époque. Vindry relègue La Boétie aux auteurs de « quatrième ordre » (oui, pas moins de quatrième) : « C’est un pauvre petit humaniste de quatrième ordre, qui eut la chance d’avoir un ami illustre et qui aurait pu clamer – avant la lettre – le vers célèbre : “L’amitié d’un grand homme est un bienfait des Dieux” car il en a bénéficié jusqu’à l’impertinence ».
La réponse d’Armaingaud, datée du 14 juin 1911, également publiée dans ce numéro de la Revue de la Renaissance, ne se fit pas attendre. Nous atteignons ici le niveau des insultes. Armaingaud constate la verve « toute méridionale » de son adversaire et lui reproche d’être à peine français. Il accuse Vindry de ne pas toujours savoir ce qu’il veut dire : « Il faut donc vous interpréter », lire entre les lignes lui répond-il. Et sur ce point le bon docteur est effectivement très bon ; c’est même sa spécialité. On retrouve ici la méthode straussienne si chère à Armaingaud. Le débat n’était pas pour autant clos et la polémique fut relancée par Vindry dans une nouvelle réponse au docteur Armaingaud datée du 5 juillet 1911. Il se défend sur son style et sa « langue maternelle » et reproche au docteur d’être puéril et « chimérique ». Pour lui Paul de Foix est un « Huguenot honteux » et La Boétie, sans être pour autant « un faible d’esprit », manque pourtant de maturité. Il condamne Armaingaud pour son extravagance et son ingéniosité extrême pour défendre sa thèse et lui reproche de lire entre les lignes et de sur-interpréter Montaigne. Et sur ce point il n’a effectivement pas tort. Ce jugement renvoie, un demi-siècle avant Leo Strauss, à un courant de la pensée libérale qui a tendance à voir une recherche d’affranchissement chez tous les auteurs canoniques. Montaigne dut forcément se montrer critique de la politique de son temps, sinon il n’aurait pu devenir un grand auteur. S’il ne l’avait pas fait il n’aurait pas été Montaigne. Cet argument circulaire se rencontre encore fréquemment parmi ceux qui défendent leur auteur préféré à tout prix.
Comme tout grand intellectuel, Montaigne se devait de laisser des traces de ses critiques. Il dut donc le faire entre les lignes ou par l’intermédiaire d’un autre inventé, en l’occurrence La Boétie. Nous sommes confrontés à une prophétie auto-réalisatrice. La querelle entre Vindry et Armaingaud se prolongea avec une nouvelle réponse du docteur Armaingaud. Il remarqua que les lecteurs de la revue, après
toutes ces calomnies, commençaient probablement à « bailler » d’ennui. Il ne s’en laissa pourtant pas compter et s’étonnait que Vindry ait pu qualifier de « nigauds » les éditeurs de Montaigne et La Boétie comme Villemain, Nodier, de Sacy et de Lamenais18 ». Rappelons que, tout au long du xixe siècle, la tendance était d’imprimer ensemble les œuvres de Montaigne et de La Boétie. Mais le débat entre Vindry et Armaingaud, de façon tout à fait inconsciente, portait en fait sur l’idée d’un Montaigne premier penseur libéral. Armaingaud fut suffisamment clair sur ce point : Montaigne ne pouvait que faire partie de ceux qui, parmi les hommes éminents, « défendaient la tolérance religieuse. Vous mettez en doute la sincérité de leur libéralisme parce qu’ils étaient, plus ou moins entachés de protestantisme inavoué19 ». Ce n’était plus une question de foi ou de religion pour Armaingaud, mais bien la marque du choix de la liberté. Douter de Montaigne, c’était être réactionnaire : « En résumé – conclut Armaingaud – ce que Montaigne a écrit dans les essais étant identique, pour une part, et absolument équivalent pour l’autre part, à ce que vous reprochez à l’auteur du Contre Un d’avoir dit, c’est donc aussi Montaigne en personne que vous avez taxé de “sottise” et “d’ânerie”. Je ne veux pas abuser contre vous de cette simple constatation, et je laisserai le lecteur tirer la conclusion20 ». En fin de compte Vindry aurait donc insulté Montaigne lui-même – et à travers Montaigne la progression implacable de la modernité et de la liberté qui lui est associée –, un acte évidemment impardonnable pour Armaingaud.
Depuis une vingtaine d’années, la réception du travail du docteur Armaingaud a connu un certain succès aux États-Unis, notamment parmi les straussiens. Armaingaud nous apprend qu’à l’époque de Montaigne il fallait « se taire ou mourir ». Et il ajoute pour donner le ton à sa thèse : « Montaigne s’est résigné ni à l’un ni à l’autre21 ». Selon Armaingaud, Montaigne fut un penseur libéral épris d’une conception universelle de la liberté. Il présentait en fait la thèse straussienne
– avant Leo Strauss – selon laquelle Montaigne ne pouvait abandonner extérieurement les pratiques religieuses – sous peine de dangereuses conséquences – tout en présentant des vues assurément matérialistes et irréligieuses (mais toujours suffisamment voilées) dans ses Essais. Armaingaud transforma ainsi Montaigne en écrivain politique « courageux » et « libre », tolérant et indépendant. Cette vision d’un Montaigne premier penseur libéral a fait fureur et trop fréquemment été reprise par les Montaignistes. À sa façon – par ce qu’Armaingaud appelle « la constante préoccupation » de Montaigne pour Henri de Navarre –, Montaigne aurait « pour sa part contribué à préparer dans les esprits l’édit de Nantes22 ».
Encore en 1939, juste avant la guerre, à l’occasion de la publication du dernier volume de l’édition des œuvres de Montaigne par le docteur Armaingaud, on s’interrogeait encore sur la crédibilité de cette démonstration. La Revue historique de Bordeaux, par l’intermédiaire de Camille Aymonier, revenait une fois de plus sur la thèse d’Armaingaud : « Est-il vraisemblable qu’un artiste aussi scrupuleux, aussi soucieux de la pureté, de l’originalité de la forme, aussi convaincu que le style c’est l’homme, au moins autant que la pensée, ait porté une main, qu’on hésiterait à peine à dire sacrilège, sur l’œuvre de son ami23 ». Et l’article de conclure : « On serait fort empêché, je veux dire, incapable de soutenir que Montaigne eût approuvé les nouvelletés religieuses, les remuements des Protestants24 ». Montaigne n’aurait jamais pu être un collaborateur, un dissimulateur, un hypocrite. Il fallait qu’il soit droit dans ses bottes : « Parlons net. Cette dissimulation, cette hypocrisie, disons cette couardise, sont-elles dans la nature loyale, ennemie jurée du mensonge, de l’auteur des Essais25 ? ». L’auteur des Essais ne pouvait pas jouer double jeu car la politique n’avait jamais vraiment été sa chose à lui. On ne pouvait pas douter si aisément de sa sincérité. C’est là je crois tout l’apport des batailles à la don Quichote du docteur Armaingaud. Il a su révéler et questionner tout un pan bien pensant des montaignistes qui avaient bon an mal an transformé l’auteur des Essais en sage, qui ne se serait intéressé qu’accessoirement à la politique. Ce Montaigne
profondément politique du docteur Armaingaud, même s’il est assez extravagant, donna pourtant une bouffée d’air aux études montaignistes durant la première moitié du xxe siècle et permit au moins de relire La Boétie dans son contexte politique immédiat.
Philippe Desan
The University of Chicago
1 La Persécution et l’Art d’écrire fut pour la première fois traduit en français par Olivier Berrichon-Sedeyn en 1989 et publié chez Agora Presses pocket. Le livre fut repris en 2003 par les Éditions de l’éclat à Tel-Aviv, avant que Gallimard ne le réédite en 2009 dans sa collection « Tel » (traduction revue par Olivier Sedeyn).
2 Voir ses livres sur Montaigne et La Boétie : The Political Philosophy of Montaigne, Ithaca, Cornell University Press, 1990 ; Freedom over Servitude : Montaigne, La Boétie, and On Voluntary Servitude, Westport, Greenwood Press, 1998.
3 La Persécution et l’Art d’écrire, Tel-Aviv, Éditions de l’éclat, 2003, p. 27.
4 Ibid., p. 34.
5 Œuvres complètes de Michel de Montaigne, 12 vol., t. I, Les Essais. Texte du manuscrit de Bordeaux, étude, commentaires et notes par le Dr. Armaingaud, Paris, Louis Conard, 1924-1927, p. v.
6 Ibid., p. vi.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 260.
9 [Armaingaud], Bibliothèque du Dr A. Armaingaud. Catalogue annoté de toutes les éditions des Essais de Montaigne (1580-1927), Paris, Conard, 1927. La bibliographie du Docteur Armaingaud s’arrête en 1927 et comporte 75 numéros.
10 Le docteur Armaingaud comptait publier son étude sur les portraits de Montaigne dans le onzième volume de son édition des Œuvres complètes de Montaigne.
11 Bibliothèque du Dr Arthur Armaingaud, op. cit., p. 24.
12 « Remise d’une statue à la ville de Paris », Le Temps, 25 juin 1933, p. 8 ; « Statue offerte à la ville de Paris par le Dr. Armaingaud », Journal de Médecine de Bordeaux, vol. LXIV, 1934, p. 370-393 ; A. P., « Montaigne à Paris », Le Périgourdin de Bordeaux, juillet 1933, p. 6-7.
13 Numéro d’inventaire 91.2.87.
14 Montaigne et son temps à travers « les Essais », Le voyage en Italie de 1580. Exposition du ll au 20 Juin 1965, Lycée Montaigne, Paris, Institut Pédagogique National, 1965.
15 Revue de la Renaissance, t. XII, 1911, p. 106.
16 Ibid., p. 111.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 172.
19 Ibid., p. 173-174.
20 Ibid., p. 175.
21 Arthur Armaingaud, Montaigne pamphlétaire. L’énigme du Contr’Un, Paris, Hachette, 1910, p. xv.
22 Œuvres complètes de Michel de Montaigne, Paris, Louis Conard, 1924, t. I, p. 257.
23 Revue historique de Bordeaux, t. XXXII, 1939, p. 147.
24 Ibid., p. 150.
25 Ibid., p. 152.