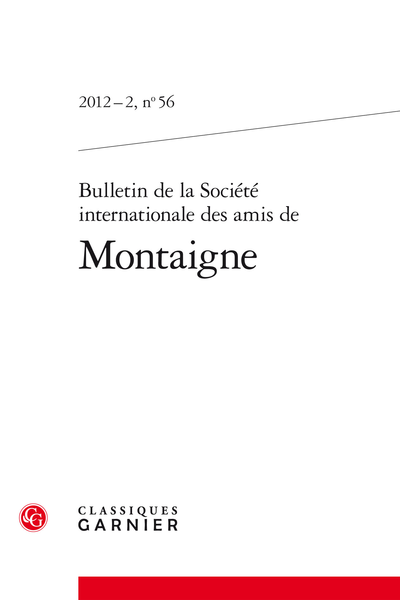
Trois points de repère et trois « avis au lecteur » du III, 1
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Auteur : Cardoso (Sérgio)
- Pages : 207 à 225
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439773
- ISBN : 978-2-8124-3977-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0207
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Trois points de repère
et trois « avis au lecteur » du III, 1
De Pierre Villey à Hugo Friedrich, de Richard Sayce à Géralde Nakam, les commentaires les plus remarquables à propos des réflexions politiques de Montaigne en ce siècle d’existence de la SIAM considèrent qu’elles doivent être inscrites sur le terrain du « réalisme » – le « réalisme politique » que les Italiens, à partir de Machiavel et Guicciardini, ont opposé à la littérature des « specula principis ». Ces lectures, c’est sûr, ont suscité controverses et contestations (nous pouvons citer les articles de Pierre J. Goumarre, Contre un faux Montaigne de 1971, ou celui de Robert J. Collins, Montaigne’s rejection of reason of state in De l’Utile et de l’honneste, 1992 – pour ne rappeler que des titres concordants) ; néanmoins, il nous suffit de considérer les contributions acceuillies par le BSAM pour attester une ample adhésion à cette thèse du réalisme. Il y a, certainement, parmi ces textes, des différences de perspective et de tonalité ; il y a des propos plus tranchés (Alexandre Nicolaï, Le machiavélisme de Montaigne, 1957-59, ou Sylvia Sanders, Montaigne et les idées politiques de Machiavel, 1976) et d’autres plus nuancés (Pierre Michel, La Boétie, Montaigne et Machiavel, 1962, ou Nicole Trèves, Beyond L’Utile et L’Honneste, 1983), mais, d’une manière générale, le champ du commentaire paraît s’encliner à la thèse du réalisme.
Mais, prenons comme points de repère trois interprétations paradigmatiques – « exemplaires » – du réalisme politique de Montaigne, en commençant par rappeler brièvement l’interprétation bien connue proposée par Pierre Villey.
Villey : le réalisme assumé
Villey est direct dans son propos : « Montaigne – dit-il – a compris que la politique est une chose et la morale en est une autre (…) une distinction qu’on ne faisait pas communément autour de lui1 ». L’activité politique, visant nécessairement une cible, un but, est commandée par l’utile. La morale, orientée par principes et valeurs, par contre, quête l’honnête – dont les préceptes, chez le Montaigne passé par la crise du scepticisme, ne sont plus déduits des inclinations naturelles des hommes, comme l’entendait le rationalisme stoïcien, mais découlent, selon Villey, d’un autre « naturalisme moral », « essentiellement référé à la conscience de soi », étayé par l’affirmation de l’autonomie de la conscience. Que l’on se rappelle des passages comme ceux du III, 2 : « J’ay mes loix et ma court pour juger de moy, et m’y adresse plus qu’ailleurs2 ».
Sont donc inévitables les conflits entre les impositions de la conscience individuelle et les contraintes de la politique, la trame, toujours ondoyante et diverse, des intérêts qui s’assemblent et s’ajustent dans les associations des hommes. « L’action politique – dit Villey – ne peut pas se soumettre aux principes de la morale3 », qui, pourtant, « sont sacrés4 ». « Comment le sage pourra-t-il se tirer d’embarras ? » demande-t-il. Un passage connu du III,1 lui paraît répondre directement à cette question : « Le bien public requiert qu’on trahisse et qu’on mente et qu’on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissans et plus soupples5 ». Devant les conflits inévitables entre les intérêts en jeu dans le domaine de la politique et les impératifs de sa conscience, il ne reste à l’homme moral que l’abstention de l’activité publique : se soumettre aux lois et pouvoirs de la cité, mais agir et vivre de la manière la plus privée possible, « en la forme que je puis la plus privée6 », dit l’essayiste.
Mais, ce qu’il y a de plus intéressant dans le commentaire de Villey c’est la concentration du sens fondamental du III,1 dans la question de la participation politique. Il comprend très bien que Montaigne reviens là à « un problème d’actualité7 » : « le problème des devoirs de l’individu envers le public, et plus particulièrement en temps de troubles civils8 ». Vers 1586, quand cet essai est écrit, la reprise violente de la guerre, l’intensification des passions, rendent pressante pour beaucoup de citoyens modérés la question de la participation et de l’engagement dans les partis en conflit. L’immense succès du De Constantia de Justus Lipsius, publié en 1584, témoigne bien les afflictions, l’accablement et aussi les dilemmes qui se posent alors aux hommes de bien, désireux d’atteindre la concorde. On peut se rappeler la scène initiale de ce livre, dans laquelle le jeune Lipsius, inconsolable, fuit sa Flandres natale dilacérée par la guerre. Son maître et directeur de conscience, Langius, l’exhorte à supporter les adversités du temps avec constance, à ne pas s’évader. Si la nef de la patrie submerge, il ne faut pas, les bras croisés, la voir sombrer. Il faut « combattre pour elle et la défendre (…) mettre la main aux rames et larguer les voiles9 » ; il faut assumer son rôle solidaire aux autres hommes dans la trame du destin. Quelques années plus tard, pendant le calamiteux siège de Paris de 1590, on écoutera de Guillaume Du Vair le même précepte : « il faut que le bon citoyen porte lors patiemment ses afflictions… qu’il reconnoisse que son infortune est sa part et portion contingente de la société humaine, au mal commun de laquelle il doit participer volontairement, comme il a fait et feroit au bien, s’il arrivait10 ». Pour ces contemporains, avec lesquels Montaigne dialogue, la constance n’est ni résignation, ni passivité ; elle invite plutôt à la vie active.
Or, selon la compréhension de Villey, Montaigne, en reprenant, dans l’ouverture du livre III, cette question – lors si controversée – de la participation, l’implication et l’engagement, des particuliers dans les divisions civiles, et même, plus amplement, dans les affaires de la
politique, lui donne une réponse radicalement diverse de celle des néostoïciens : il pointe vers la voie de l’abstention politique. Les compromis moraux de l’homme de bien l’obligent à s’éloigner des impositions de la vie politique, étant donné que leur conflit est incontournable. Montaigne ne censure pas Machiavel, dit-il, d’avoir séparé politique et morale11 : le mal existe et contraint l’homme politique, à certaines occasions, à des actions malhonnêtes, à l’usage d’expédients moralement condamnables.
Toutefois, nous le savons, il n’est pas si facile de soutenir une telle lecture et d’identifier dans le III,1 un clair appel à l’abstention politique. Dans le passage le plus directement consacré à la question de l’engagement dans les conflits civils, Montaigne assume, avec les néostoïciens, l’ainsi-nommée « loi de Solon » (évoquée par Du Vair12 et Lipsius13) : « Il faut prendre parti ». Ceux qui n’ont pas de charges publiques, les hommes privés, n’ont certainement pas besoin de s’offrir pour les besognes et n’ont pas le devoir de les accepter ; mais, il tient à le préciser : « de se tenir chancellant et metis, de tenir son affection immobile et sans inclination aux troubles de son pays, je ne trouve ny beau ny honneste14 » – « ce serait une espèce de trahison », dit-il. Et il avertit encore : « nécessairement il faut prendre parti par application de dessein15 ». S’il reconnaît « à l’homme qui n’a ny charges ny commandements exprès qui le presse » la possibilité « de ne s’embesogner », une telle attitude est designée à peine comme « plus excusable », et il dit ne pas se valoir lui-même de cette excuse. Même au moment où son mandat à la mairie de Bordeaux était déjà terminé, il continue, comme nous le savons, de « s’embesogner » des affaires de la guerre, ce qu’il mentionne avec modestie au début de
l’essai : « en ce peu que j’ay eu à negocier entre nos Princes, en ses divisions et subdivisions qui nous déchirent aujourd’hui16. ». L’impératif de l’engagement s’impose clairement. Et il concerne aussi l’homme privé : les perils et souffrances de la patrie exigent l’intervention de tous. De cette manière nous pouvons certainement voir comme très redoutable d’aligner et lier à cette question de la participation le fameux passage de ce texte : « résignons cette commision à gens plus obeissans et plus soupples », comme l’entendent Villey et plusieurs autres.
Friedrich : le réalisme élargi
Pour Hugo Friedrich aussi, la réflexion politique de Montaigne s’inscrit dans la sphère du réalisme politique. Cependant, il s’agit cette fois d’un réalisme politique élargi, qui nous permet de remettre l’homme de bien sur le terrain de l’activité politique. Ici, il n’y a plus proprement de séparation et d’incompatibilité entre la morale et la politique, mais plutôt entre la théorie et la pratique, entre les préceptes théoriques d’une moralité idéale et l’ordre des faits, le domaine pratique, avec ses déterminations de circonstance et ses nécessaires motivations d’utilité : « en théorie, certes, la pureté morale peut se concevoir et s’enseigner (…) mais la pratique s’oriente suivant (…) ses nécessités propres, selon le cas17 ». Montaigne, en matière de politique, assumerait, comme Machiavel, « la notion d’une humanité – dit-il – qui irait à sa perte si elle imposait des normes inflexibles à la réalité18 ». Il s’agirait pour ces humanistes de rompre avec la tradition cicéronienne du rationnalisme moral stoïcien et son intransigeante association de l’utile et de l’honnête (« il ne faut pas douter que jamais l’utilité ne puisse entrer en lutte avec l’honnêteté19 »). Montaigne, de son côté, inviterait donc l’homme honnête à prendre en compte la « structure mixte », composée de raison et passion, de sa condition humaine, ouverte à la vertu et au
vice, « simenté de qualitez maladives (…) qui logent en nous d’une si naturelle possession20 » et qui ne peuvent pas être extirpées sans porter préjudice à notre vie. Ainsi que Plutarque et Augustin, Montaigne, dit Friedrich, est un critique sevère de la prétension stoïcienne d’extirper les passions21 ; son réalisme politique n’est « qu’un indice de la fêlure de notre condition humaine22 », « de l’enchevêtrement du bien et du mal dans notre existence23 » ; il répond directement à ce caractère mixte de la condition humaine.
La pratique politique, donc, ne peut pas se régler par des principes moraux abstraits, par une moralité théorique. « L’infirmité foncière de l’humanité rend les hommes incapables de se conduire idéalement24 ». Elle exige le passage continu entre le précepte et le fait, entre l’honnête et l’utile. Et c’est ce refus de réduire le comportement humain soit au bien soit au mal qui, justement, selon Friedrich, rend la pensée politique de Montaigne plus nuancée et même plus réaliste que celle des adeptes de Machiavel, qui voient partout « force, immoralité, fautes de conscience25 », falsifiant les leçons de l’expérience.
On ne peut pas, donc, dans le domaine de la politique, abandonner les exigences de l’honnêteté et tout réduire à la trame de l’intérêt, à l’astuce et au cynisme. « Montaigne n’est pas machiavélique – dit Friedrich –, il ne prêche ni politique de force, ni immoralité. Mais il est assez avisé pour savoir que l’homme qui pénètre dans la zone profane de la politique doit faire fi de beaucoup de ses nobles scrupules (…). Il est ouvert aux faits, même au fait que l’homme est en certains cas obligé d’agir amoralement26 ». Ni machiavélisme, ni anti-machiavélisme, donc. L’important pour Montaigne, en matière politique, serait de « cerner la complexité de la chose (…) et de montrer qu’aucune solution générale n’est possible, pas même celle qui attribuerait la prééminence absolue à la sphère de l’utile27 ». « Solution occasionaliste28 », dit Friedrich : on peut
agir en conformité à des maximes de moralité ou « être obligé d’agir injustement et mal29 ». De cette manière l’action politique demande un type de justification toute particulière, toujours relative à un cas déterminé (« l’homme concret ne peut se décider que dans tel cas donné30 »).
Friedrich nous avertit que « Montaigne, quant à lui, prend bien ses distances par rapport à ce genre de mauvaise conduite politiquement nécessaire31 ». Il ne peut pas oublier le « resignons cette commission à gens plus obeissans et plus soupples ». Mais, que doit-on comprendre ? Serait-ce une question de sensibilité personnelle ? Et doit-on revenir à la division de l’humanité entre ceux qui refusent toujours l’immoralité et ceux qui sont prêts à y entrer de bonne grâce, entre l’intrinsigeante moralité et la souplesse « occasionaliste » (toujours suspecte) ? Le commentateur lui-même pose cette question gênante : « la morale aura donc le dernier mot32 ? ». Pas exactement. Dès les premières pages de l’essai, dit-il, « Montaigne semble pris d’hésitation33 ». L’alternance de perspectives et d’éclairages qui traverse le texte (« le jeu de contradictions, dont cet essai est un exemple particulièrement instructif34 ») aurait, justement, l’intention de montrer la complexité du sujet, de montrer l’impossibilité de lui donner une réponse générale et, finalement, de mettre « simplement côte à côte deux manières possibles d’agir, selon la morale et selon l’utilité35 », laissant à l’agent de décider laquelle est l’adéquate au cas concret envisagé.
On ne peut pas sûrement oublier que cette lecture du III,1 procède d’une considération plus large sur la nature de la réflexion morale des Essais. Friedrich voit en Montaigne, comme nous le savons, le premier classique de la littérature des « moralistes », de ce genre de science morale qui, du xve siècle au xviiie, se dédie à l’investigation empirique et détaillée des mœurs36, un savoir qui se veut purement positif, « exempte de tout jugement de valeur37 », de toute acception normative, qui habilite
l’homme à donner des réponses variables à l’infinie diversité des situations auxquelles il doit faire face (lui permet de « s’adapter aux conditions variables par des réponses variables38 »). C’est cette perspective positive du moraliste Montaigne devant le comportement humain, fouré d’égoïsmes et d’altruismes, que Friedrich identifie dans sa réflexion politique.
Nous pouvons objecter à cette lecture la difficulté de constater dans cet essai une démarche qui ne serait que positive et descriptive des mœurs et réalités politiques, exempte de prétentions proprement normatives – justement en cet essai dans lequel, par des moments, une rare indignation exhale des mots (« ils nomment zèle leur propension vers la malignité et la violence. Ce n’est pas la cause que les eschauffe, c’est leur interest39 ») et qui surtout ne laisse pas d’y prendre parti (prescriptif) sur des questions controversées, plus d’une fois. Mais, à cette objection, on pourrait répondre, d’autre part, qu’elle prend le réalisme (moral et politique) que Friedrich assigne à Montaigne dans un sens trop étroit. Il fallait prendre en compte que sa « science morale », l’inspection de la condition humaine, n’implique pas une neutralisation des normes et valeurs, mais réalise simplement la conversion de la moralité au monde du relatif, des « variations » des temps et lieux, l’affranchissement des principes universels, de la théologie et de la metaphysique. Cela est certain. Toutefois, il est possible de penser que ce qui est en cause dans le III, 1 n’est pas précisement l’acceptation réaliste de « deux manières d’agir possibles40 », morale et « politique », mises côte à côte, que l’agent devra choisir, selon l’occasion ou les impératifs de la nécessité. On peut sûrement penser que, pour la « sagesse de la compréhension » de Montaigne, la condition mixte de l’homme, à maintes reprises, rend grises et troubles les exigences de la moralité elle-même, ne permettant plus de séparer nettement vertu et vice (« vice, n’est-ce pas », dit-il de la perfidie du Prince, un acte qui n’est pas non plus vertueux), imposant fréquemment aux hommes de se contenter à peine de la médiocrité de « l’excusable ». L’action politique est certainement justiciable d’une legitimité particulière, relative aux cas concrets envisagés, oui ; mais la condition mixte de l’humanité paraît devoir se satisfaire aussi d’une « vertu mixte » (une vertu qui n’est pas sans une certaine parenté avec la
« prudence mixte » des néostoïciens ou avec la nouvelle virtù du prince de Machiavel). Qu’il nous suffise ici de rappeler un passage de l’essai « De la Vanité » (III, 9) : « La vertu assignée aux affaires du monde41 est une vertu à plusieurs plis, encoignures et couddes, pour s’appliquer et joindre à l’humaine foiblesse, meslée et artificielle, non droitte, nette, constante ny purement innocente (…). Celuy qui va en la presse il faut qu’il gauchisse42 ».
Nakam : le réalisme renversé
Nakam met en valeur et la transforme dans le ressort de sa lecture du III, 1, une considération qui, en général, que ce soit en passant, ne reste pas inaperçue de presque tous les intéressés aux réflexions politiques de Montaigne : sa remarque sur l’utilité et le profit de l’honnêteté.
Comme nous le savons, c’est dans « De la présomption » (II, 17) – un essai dans lequel plusieurs éléments du III, 1 sont anticipés – que cette remarque est développée le plus directement et le plus clairement. « Je ne sçay – dit l’essayiste de ceux qui font profession de malhonnêteté – quelle commodité ils attendent de se feindre et contrefaire sans cesse, si ce n’est de n’estre pas crus lors mesme qu’ils disent verité ; cela peut tromper une fois ou deux les hommes43… » ; or, observe-t-il ensuite, dans une phrase devenue très connue : « on faict plus d’une paix, plus d’un traitté en sa vie44 ».
Cette observation – en différentes facettes – est reprise dans le III, 1 et devient, selon Nakam, l’épine dorsale de l’argumentation de cette pièce de « dénonciation de l’ignominie en politique45 ». Montaigne y témoigne du succès de son propre parler franc et véridique dans l’espace public (conférant certainement à cette observation une portée générale) : « la naïfveté et la verité pure, en quelque siècle que soit, trouvent encore leur
opportunité et leur mise46 ». Son intention serait, finalement, de montrer contre les « machiavelistes », l’inefficacité à long terme de la ruse, de la rouerie, de la perfidie, et l’avantage de la probité, l’utilité de l’honnête. « La ruse tranformée en habitude n’a plus d’effet47 », attesterait-il. Il veut montrer, dit Nakam, « que c’est le bien qui est utile, que c’est le souci et l’honneur, la confiance, la bienfaisance, qui sont réalistes et profitables. Voilà – continue-t-elle – ce que son livre-conseiller expliquera au prince, à travers, en particulier, De l’Utile et de l’Honneste48 ».
Ce que Montaigne ferait donc, c’était d’affirmer l’honnêteté (la moralité) en tant que principe politique. Si l’on accepte, dans la droite ligne de Machiavel, que la politique vise l’efficacité et l’utilité, on doit accorder, en conséquence, qu’elle doit être commandée par l’honnêteté. La loi fondamentale de l’efficacité en politique est donc l’honnête. En bref : si la politique n’est pas directement question de morale, mais d’utilité et de stratégie, l’affirmation de « l’utilité du bien » élève la politique de Montaigne à un réalisme tout à fait original, un « machiavélisme du bien49 », dit Nakam. Et elle associe à cette expression d’autres analogues – « idéalisme réaliste », « machiavélisme érasmien » – pour les condenser toutes, comme l’on sait, dans la rubrique de « réalisme moral », le réalisme qui constituerait la réponse de l’auteur aux tenants de la « raison d’état », aux docteurs de ruse et de tromperie qui conduisent la France à la catastrophe50.
Chez le Montaigne de Nakam tout se passe, finalement, comme si au lieu de fonder – comme font les stoïciens – l’identité de l’utile et de l’honnête par le principe de l’entière rationalité des événements du monde (par une garantie metaphysique, donc), il l’aurait établie expérimentalement et pragmatiquement : il l’établit, sur le territoire de Machiavel, par la voie de la verità effetuale. En partant de la séparation, promue par Machiavel, de la morale (l’honnête) et de la politique (l’utile), il reviendrait à leur association, cette fois-ci dans le pôle de l’utilité, par la visée de l’utilité et non pas de l’honnêteté, comme le prétendaient les anciens.
Cependant, il faut bien remarquer que, pour Nakam, cette affirmation de l’utilité de la probité, erigée en principe ou loi générale de la politique, parvient à Montaigne dans un contexte polémique : l’un de ces « tours d’escrime » dans lesquels, comme il dit dans l’Apologie, « il faut abandonner vos armes pour faire perdre à vostre adversaire les siennes51 ». Montaigne, ayant pour cible les « nouveaux conseillers » en ruse et perfidie52, « leur renvoie la balle sur leur propre terrain – dit Nakam – (…) renverse leurs propositions, retourne contre eux leurs propres exemples53 ». Mais, de sa part, ce Montaigne de Nakam semble effectivement compter sur un autre secours, sur un bastion plus ferme, pour soutenir son inexpugnable adhésion au principe de l’honnêteté en politique : la référence à une « grande justice » – « la justice en soy, naturelle et universelle » indiquée dans cet essai, – « l’idéal des humains » et objet de sa plus profonde aspiration54, dit Nakam. C’est au nom de cette idée (idéale) de justice que, selon elle, Montaigne peut rappeler « les droits de l’individu et les crimes de la légalité55 », qu’il peut dénoncer les lois civiles artificielles56, quand elles entament les « droits de l’individu » et deviennent oppressives et tyranniques57.
C’est, finalement, cette idée/idéale de justice qui, pense Nakam, procure à Montaigne la possibilité d’invoquer une « raison d’État supérieure », « un intérêt général à plus long terme et l’efficacité du bien, dont le désir – elle complète – est, selon Érasme, inhérent à la nature de l’homme58 ». Cet idéal de justice est donc le garant dernier de l’interdiction de l’usage de moyens malhonnêtes par l’homme de bien, même dans les cas extrêmes de salut public. « (…) par deux fois au cours de l’essai III, 1 – affirme Nakam – Montaigne paraît accepter, à contre cœur, la loi de la raison d’état comme remède exceptionnel59 » ; néanmoins, il met à nu l’infamie d’un tel expédient et « il engage les gens d’honneurs à ne s’y prêter60 », considérant que, elle continue, « l’intérêt supérieur d’une
nation ne réside pas dans la vilenie61 ». Cet « intérêt supérieur » déclasse tous les moyens vils en « fausse utilité », interdit toute concession aux allégations de « raison d’état ».
Il faut donc remarquer que cette lecture du III, 1 exclut toute ouverture de la réflexion de Montaigne à une perfidie qui serait nécessaire et acceptable, qui serait « excusable ». Son interprétation du fameux passage relatif aux « maladifves exceptions62 », qui seraient autorisées aux princes en situations de necessité urgente, remet entièrement son sens au paragraphe de l’ajout en couche C : l’intransigeante moralité politique de Montaigne ne pourrait souscrire que la décison de ce personnage « de si tendre conscience, à qui nulle guarison ne semblat digne d’un si poisant remède63 ». Même dans ces situations extrêmes, sa fidélité à l’honnêteté servirait à « un intérêt général plus certain et à plus long terme64 ».
Or, cette lecture, non seulement affaiblit la manifestation originelle du texte, des couches A et B, en suggérant une espèce de reprise ou même de correction du propos initial de l’auteur (thèse assumée par quelques interprètes), mais elle semble aussi ne pas conférer l’attention exigée par l’allusion directe de Montaigne à la doctrine traditionnelle de « l’état de nécessité », dont, pourtant, il accueille intégralement les premisses ; soit : la menace immédiate pour le salut public (l’imminence de la « mort publique », comme il dirait) qui obligerait un prince – responsable et intéressé au bien public – à agir en marge de la loi, ou contre la loi et contre les devoirs ordinaires de son état. Montaigne assume et la condition de la contrainte impérieuse de la circonstance (« s’il fut véritablement geiné entre ces extrèmes (…) il le falloit faire65 ») et l’hypothèse de la probité de ce personnage malheureux, qui serait témoignée par son regret.
Or, en réalité, on pourrait penser que ce que Montaigne ajoute en couche C à la première rédaction de l’essai est l’hypothèse d’un prince qui, dans une telle occasion, en fonction de sa « tendre conscience », s’abstient de l’action, croise les bras et remet à Dieu la conduite des événements – un personnage, donc, qui ne considère pas possible de sacrifier les impératifs de sa conscience et de sa fides publique aux mesures exceptionnelles et
extrêmes que les « accidens extraordinaires » (cf. I, 2366) imposent aux responsabilités de son état. Ce Prince, Montaigne le considère « excusable », et affirme « ne l’estimer moins » : « Il ne sçaurait perdre – dit-il – plus excusablement et decemment. Nous ne pouvons pas tout67 ». Il faut certainement espérer que Dieu vienne à l’aide d’une main si pure et si juste. De cette manière, si « le bien public requiert qu’on trahisse et qu’on mente et qu’on massacre68 », comme la nécessité paraît imposer dans les cas extraordinaires de menace du salut public, il vaudrait certainement mieux que les commissions destinées aux « ministres de l’intérêt public » – les « commis de la salus rei publicae », dans une expression de vieille tradition – soient réservées à gens pourvus d’une conscience moins sensible. Montaigne l’affirme : « il faut laisser jouer cette partie aux citoyens plus vigoureux et moins craintifs qui sacrifient leur honneur et leur conscience, comme ces autres antiens sacrifierent leur vie pour le salut de leur pays69 ».
Toutefois ces observations que nous venons de faire ne compromettent pas l’intérêt principal du commentaire de Nakam, qui reste certainement une des plus éclairantes exégèses du III, 1. Son mérite le plus saillant, à notre avis, c’est d’être la première à identifier nettement, et avec une remarquable compréhension de son contexte intellectuel et politique, les grands enjeux de la réflexion de Montaigne en cet essai. Nakam l’illumine définitivement au moment où elle nous fait vérifier que l’auteur y intervient d’une manière ferme et courageuse dans les deux questions les plus polémiques du débat juridico-politique de son temps : celle de la conversion de l’état de nécessité en politique ordinaire, et celle de la nature et des limites de l’obéissance des magistrats, qui était le noyau du débat sur le droit de résistance. Cette nette et fine identification des cibles critiques du texte et de ses adversaires plus proches représente un acquis définif pour la lecture du III, 1.
Et il nous faut finalement reconnaître encore au travail de Nakam un atout supplémentaire : celui d’avoir attesté, en examinant la réflexion politique de Montaigne, l’efficacité d’une certaine voie (française) du contextualisme – la contextualisation ancrée par les grands textes ; qui part des œuvres classiques pour cerner en elles, à partir d’elles, leur
contexte, la trame qui les contextualise – leurs interlocuteurs et le débat politique qu’elles promouent et qu’elles intègrent – et, ainsi, illuminer leur sens. Le travail de la pensée qui engendre ces œuvres s’enracine dans une histoire qui les habite, plus qu’elles ne l’habitent, de manière que leurs exégèses, comme celle de Montaigne, paraît se satisfaire plus d’un travail comme celui de Nakam que de l’effort de reconstruction des « matrices intellectuelles » et du « vocabulaire normatif » qui permettraient de les intérpreter.
Trois (brefs) avis au lecteur du III, 1
Première observation
Nous pouvons commencer par une observation simple, qui semblerait naïve si elle n’était ignorée par presque toutes les lectures de cet essai. Il est important qu’on se rappelle que dans l’univers politique dans lequel Montaigne se meut, un monde de structure et de culture monarchique, il n’est pas possible de penser à un sujet et à une action politiques génériques, à une seule configuration de l’agent et des activités qui se produisent dans le domaine public. Il nous faut prendre en compte qu’il y a dans ce contexte une distinction première, constitutive de l’ordre politique elle-même, entre le prince, le magistrat et le particulier. Cette distinction opère immédiatement en toutes les considérations politiques de l’époque (Bodin, par exemple, nous la rappelle, presque en passant, tellement elle lui semble évidente, dans l’introduction du chapitre iv de « La République » sur l’obéissance du magistrat70.
Nakam nous permet d’entrevoir l’importance, pour l’éxègese du III,1, de cette distinction – ignorée soit par Villey, soit par Friedrich – quand elle signale la critique de la doctrine de l’obéissance inconditionnelle des magistrats, proposée par Bodin, comme un des motifs principaux de l’essai. Toutefois, elle n’arrive pas à l’identifier comme un opérateur décisif de l’interprétation. Or, le lecteur avisé pourra observer que les
questions qui concernent spécifiquement ces diverses figures – le particulier, le magistrat, le Prince – ordonnent et scandent en grande partie la progression même du développement du texte : l’exigence de la participation politique pour les particuliers ; les limites de l’obéissance des magistrats ; les limites de la concession qui serait accordée à la violation, parfois nécessaire, de la fides des Princes.
Deuxième remarque
Un deuxième « avis » que l’on pourrait extraire de ces lectures que nous avons examinées ce serait peut-être de ne pas identifier immédiatement le réalisme montaignien à l’opposition qui associe la morale et l’honnêteté d’un côté et la politique et l’utilité de l’autre, comme s’il s’agissait de deux domaines nettement distincts. Si Montaigne se détache de la conviction stoïcienne (et cicéronienne) de l’entière coïncidence ou superposition de l’utile et de l’honnête (« Je suy le langage commun qui faict différence entre les choses utiles et les honnestes71 », comme il le dit), ce n’est pas pour distinguer et opposer l’agir par devoir et l’agir par intérêt (à l’épreuve, son observation : « Que Montaigne s’engouffre quant et la ruyne publique, si besoin est ; mais (…) autant que mon devoir me donne de corde, je l’employe à sa conservation72 »). Nous pouvons constater que l’activité politique, toujours mue par l’utile et les intérêts, ne se passe pas non plus des paramètres bien clairs d’intégrité et d’honnêteté : l’exigence justement du respect de la fides, de la parole véridique et toujours à honorer, dont l’expression majeure est le respect des lois civiles. À ces lois, dit l’essayiste, « toute autre supériorité doibt estre relative et retranchée73 ». Il n’importe que le sage stoïcien Dandamys (qui certainement croit obéir aux preceptes des lois naturelles) s’étonne de la révérence que Socrate consacre à ces lois74.
Dans le domaine public, l’Apologie de Raymond Sebond nous avertissait déjà, « ce que nostre raison nous y conseille de plus vray-semblable, c’est generalement à chacun d’obeir aux loix de son pays, comme est l’avis de Socrate, inspiré d’un conseil divin75 ». C’est exactement ce compromis et
cet attachement nécessaires des citoyens aux lois civiles qui, ici, fait de la fides (au lieu de la justice des stoïciens, de laquelle la fides n’est qu’une partie) la vertu de première instance de l’ordre politique. Étant donné que nous sommes éloignés de la connaissance d’un Droit procédé d’une loi naturelle et divine, c’est certainement la « parole donnée », ses engagements et limites (d’où la centralité du thème de la perfidie dans l’essai), le noyau de cette réflexion politique, comme l’a déjà attesté, en maintes circonstances et avec une grande perspicacité, Antoine Compagnon.
Troisième remarque
Pour finir, je dois venir, par une très briève allusion, à une question presque ignorée par la critique. Il s’agit d’un motif central du III, 1 : les multiples références de cet essai aux regrets des princes – puisqu’il y en a plusieurs et de divers ordres : soit les contrefaçons ou les masques des vrais regrets (les désaveux des trahisons, perfidies, et abus astucieux des lois, à travers la punition de leurs ministres, par ceux mêmes qui les ordonnent), soit les véritables (comme celui du prince intègre « jetté hors de son devoir ordinnaire76 » ou celui de Timoléon, dont les larmes ont acheté la liberté de Corinthe). Il est indispensable pour la lecture du III, 1 de considérer la nature et la portée politique des ces regrets, les vrais et les faux, leur vérité effective. Dans les cas extraordinaires de « salut public », où il ne reste au Prince que la voie de la violence (le mensonge, la trahison, le parjure ou le massacre), seules ses larmes et son regret peuvent rouvrir l’espace de la politique, relancer la voie de la fides, qui soutient les lois et les liens de société.
On ne peut pas oublier, finalement, la manifeste relation de ce thème du regret – et de l’action motivée par les contraintes du salut public – avec la question du silence de Montaigne relatif à la Saint-Barthélemy. Et, là-dessus, nous tenons à rappeler, entre toutes, les éclairantes considérations de Jean-Louis Bourgeon, Montaigne et la Saint-Barthélemy77, et celles de François Rigolot, Saint Barthélemy l’Indien : Montaigne, la Loy de l’Oubliance et la Légende Dorée78, publiées par le Bulletin de la SIAM.
Il n’est pas difficile de supposer (comme une grande partie du commentaire le fait) qu’il y a une allusion délibérée des réflexions du III, 1 concernant « l’état d’urgente necessité » aux événements traumatiques du 24 août. Une telle approximation paraît corroborée par l’essai De la Coustume (I,23)79, dont les observations finales dirigées contre « ceux qui donnent le branle à un estat80 » et l’amènent à la ruine l’auteur remet directement à « nostre presente querelle81 ». À cette occasion, l’essayiste utilise le même langage et les concepts relatifs à l’état de nécessité employés dans le texte d’ouverture du livre III. Ainsi nous pouvons sûrement penser que, là aussi, la réflexion de Montaigne n’est pas toute abstraite et théorique. Nous pouvons croire, avec Bourgeon, que, là, le « nul remede » « s’applique très exactement à la situation de Charles IX82 », confronté à une « urgente circonstance et quelque impétueux et inopiné accident » (« la triple prise d’armes simultanée de l’Espagne, des Guises et de la milice parisienne83 », insurrection imminente d’une ville « mobilisée pour la solution finale84 ») « du besoin de son estat » (« mettre la chancellante monarchie à l’abri de l’insurrection, couper court à une quatrième guerre civile et à un conflit ouvert avec l’Espagne85 »).
Voici, nous montre Bourgeon, le drame de Charles IX, « véritablement geiné entre deux extrèmes86 » : entre l’effondrement prévisible de la Monarchie (« le Roi aurait-il voulu s’interposer, qu’il aurait été lui aussi balayé87 ») et le déshonneur (« gauchir sa parole et sa foy88 », assumer le massacre, même s’il le fait sous l’allégation du « salut public »). La Saint-Barthélemy, continue Bourgeon, n’est pas d’origine royale, ni à l’initiative de la Reine – « le gouvernement royal a fini par laisser se dérouler la Saint-Barthélemy, qui, de toute façon, allait éclater : la seule
marge de manœuvre laissée à la royauté était de savoir si elle allait se ranger parmi les victimes ou les complices de l’imminente insurrection parisienne89 ». Et si le Roi regrette la perfidie et le massacre, il doit être lui aussi regretté. À le voir comparé à Néron, Montaigne ne laissera pas de le plaindre : « nostre pauvre feu Roy Charles neufiesme90 ».
Si les allusions aux massacres de 1572 dans les Essais sont indirectes, cela se doit, premièrement, en grande partie, à ce que l’essayiste ne peut ni défendre le roi (l’action est effectivement odieuse) ni le condamner (« vice, n’est-ce pas (…) mais certes c’est mal’heur91 »). Mais, il y a plus. Il faut considérer – Rigolot rappele la question en toute son ampleur – la politique officielle de l’oubli : « après le massacre de la Saint-Barthélemy les édits royaux se succédèrent pour imposer le silence aux Français de toutes confessions sur un sujet qui ne pouvait que les diviser92 », dit-il. Montaigne, avec son silence, respecte donc la loi, soit par sa conviction concernant le devoir de se soumettre aux lois établies, soit, suggère Rigolot, « pour contribuer à étouffer la haine qu’avait provoqué l’abominable carnage93 » – une raison, cette dernière, qui nous paraît moins probable, étant donné que l’essayiste évoque à plusieurs reprises la mémoire de l’événement et ne cesse de dénoncer les crimes de la guerre et de témoigner son horreur devant toutes les cruautés94.
Sergio Cardoso
Bibliographie
Bodin, Jean (1993), Les Six Livres de La République, Paris, Librairie Générale Française.
Bourgeon, Jean-Louis (1994), Montaigne et la Saint-Barthélemy, in BSAM, n.37-38, p. 101-109.
Cicéron (1970), Les Devoirs, texte établi et traduit par Maurice Testard, Paris Les Belles Lettres.
Du Vair, Guillaume (1614), Traité de la Constance et de la Consolation es Calamités Publiques, Hildesheim, Olms Reprint, 1973.
Friedrich, Hugo (1978), Montaigne, Paris, Presses Universitaires de Fance.
Lagrée, Jacqueline (1994), Juste Lipse, La Restauration du Stoïcisme, Paris, Vrin.
Lagrée, Jacqueline (2010), Le Néostoïcisme, Paris, Vrin.
Montaigne (1978), Les Essais de Montaigne, ed. Pierre Villey, Paris, Presses Universitaires de France.
Nakam, Géralde (1982), Montaigne et son Temps : les Événements et les Essais, Paris, Librairie A.-G. Nizet.
Nakam, Géralde (1984), Les Essais de Montaigne, Miroir et Procès de leur Temps, Paris, Librairie A.G. Nizet.
Rigolot, François (2005), Saint Barthélemy l’Indien, Montaigne, la « loy d’oubliance » et la Légende Dorée, BSAM, n.37-38, p. 51-65.
Villey, Pierre (1933), Les Sources et L’Évolution des Essais de Montaigne, Paris, Hachette.
1 Villey, Pierre, Les Sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Paris, Hachette, 1933, p. 371.
2 Montaigne, Michel de, Les Essais de Montaigne, éd. Pierre Villey, Paris, Presses Universitaires de France, 1978, p. 807.
3 Villey, Pierre, op. cit., p. 375.
4 Ibidem, p. 375.
5 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 791.
6 Ibidem, p. 795.
7 Villey, Pierre, op. cit., p. 789.
8 Ibidem, p. 789
9 Lipse, Juste, De Constantia libri duo, ch. 22 ; trad. Lagrée, Jacqueline, Juste Lipse, La Restauration du Stoïcisme, Paris, Vrin, 1994, p. 157.
10 Du Vair, Guillaume, Traité de la Constance et de la Consolation es Calamités Publiques, Hildesheim, Georg Olms reprint, 1973, p. 890-891.
11 Cf. Villey, Pierre, op. cit., p. 373.
12 « Je crois que la loi de Solon était pleine de prudence laquelle ordonnait qu’es divisions, chacun prît incontinent parti pour ce que de deux factions y en ayant ordinairement une injuste et qui entreprend injurieusement sur l’autre, le citoyen est inexcusable qui quitte le parti des lois et du salut public, pour se rendre spectateur de la ruine de son pays ». Du Vair, Guillaume, Traité de la Constance, in Lagrée, Jacqueline, Le Néostoïcisme, Paris, Vrin, p. 161.
13 « Le sage Solon, par loi expresse a banni et chassé ces tranquilles et qui ne sont ni d’um ni d’autre parti. En cas de guerre civile dit-il celui qui ne se joindra à aucun des partis, mais seul et separé s’éloignera du mal commun de la cité, soit privé de sa maison, de sa patrie et de toutes ses facultés et soit banni et chassé hors de son pays » Lipsius, Justus, Politicorum sive Civilis Doctrinae libri sex, in Lagrée, Jacqueline, Le Néostoïcisme, Paris, Vrin, p. 161.
14 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 793.
15 Ibidem, p. 793.
16 Ibidem, p. 791.
17 Friedrich, Hugo, Montaigne, Paris, Gallimard, 1968, p. 195.
18 Ibidem, p. 197.
19 Cicéron, De Officiis, III, 3, 11 ; trad. Maurice Testard, Paris, Belles Lettres, 1970, p. 75.
20 Montaigne, Michel de, op. cit. p. 790.
21 Cf. Friedrich, op. cit., p. 183-184.
22 Ibidem, p. 186.
23 Ibidem, p. 195.
24 Ibidem, p. 188.
25 Ibidem, p. 199.
26 Ibidem, p. 198.
27 Ibidem, p. 201.
28 Ibidem, p. 201.
29 Ibidem, p. 199.
30 Ibidem, p. 201.
31 Ibidem, p. 201.
32 Ibidem, p. 201.
33 Ibidem, p. 201.
34 Ibidem, p. 201.
35 Ibidem, p. 201.
36 Cf., ibidem, p. 190.
37 Ibidem, p. 190.
38 Cf., ibidem, p. 192.
39 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 793.
40 Friedrich, Hugo, op. cit., p. 201.
41 Les « cose del mondo », selon l’expression souvent répétée par Machiavel.
42 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 970.
43 Ibidem, p. 648.
44 Ibidem, p. 648.
45 Nakam, Géralde, Les Essais de Montaigne, Miroir et Procès de leur Temps, Paris, Libr. A.-G. Nizet, 1984, p. 257.
46 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 792.
47 Nakam, Gérald, op. cit., p. 253.
48 Ibidem, p. 254.
49 Ibidem, p. 251.
50 Cf. ibidem, p. 252.
51 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 558.
52 Cf. Nakam, Géralde, op. cit., p. 252.
53 Ibidem, p. 254.
54 Cf. ibidem, p. 263.
55 Ibidem, p. 264.
56 Cf. ibidem, p. 263.
57 Cf. ibidem, p. 264.
58 Ibidem, p. 265.
59 Ibidem, p. 259.
60 Ibidem, p. 259.
61 Ibidem, p. 259.
62 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 800.
63 Ibidem, p. 799.
64 Nakam, Géralde, op. cit., p. 265.
65 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 799.
66 Cf. ibidem, p. 122.
67 Ibidem, p. 799 – nous soulignons.
68 Ibidem, p. 791.
69 Ibidem, p. 791.
70 Cf. Bodin, Jean, Les Six Livres de la République, Paris, Librairie Générale Françaisse, 1933, p. 280.
71 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 796.
72 Ibidem, p. 792.
73 Ibidem, p. 794-95.
74 Cf. ibidem, p. 795.
75 Ibidem, p. 578.
76 Ibidem, p. 799.
77 Bourgeon, Jean-Louis, « Montaigne et la Saint-Barthélemy », in BSAM, n. 37-38, 1994, p. 101-109.
78 Rigolot, François, « Saint-Barthélemy l’Indien, Montaigne, La “Loy d’Oubliance” et la Légende Dorée» , in BSAM, n. 37-38, 2005, p. 51-65.
79 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 108-123.
80 Ibidem, p. 119.
81 Ibidem, p. 119.
82 Bourgeon, op. cit., p. 106.
83 Ibidem, op. cit., p. 106.
84 Ibidem, p. 104. Les acteurs de cette insurrection sont multiples : « un clergé hystérique, toute la bonne bourgeosie en armes, Hôtel-de-Ville et Parlement compris, assurés de l’appui des Guises, des courtisans avides de revanche, et des soldats que le roi ne payait plus depuis longtemps » Ibidem, p. 102.
85 Ibidem, p. 106.
86 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 799.
87 Bourgeon, op. cit., p. 104.
88 Montaigne, Michel de, op. cit., p. 799.
89 Bourgeon, op. cit., p. 102. Les considérations de M. Bourgeon sont certainement aptes à nous persuader soit au niveau de l’exégèse des textes, soit au niveau de sa compréhension de l’histoire. Néanmoins nous nous éloignons beaucoup de son interprétation du passage relatif à l’ajout en couche C qui suit le paragraphe où Montaigne reprend la doctrine de « l’état de necessité » (« Quand il se trouveroit qulqu’un de si tendre conscience (…) » – Montaigne, op. cit., p. 799).
90 Montaigne, Michel de, op. cit., I, 32, p. 721.
91 Ibidem, p. 799.
92 Rigolot, op. cit., p. 52. Nakam aussi nous rappelle cette politique : « Montaigne n’est pas le seul à censurer le nom de la Saint-Barthélemy. Ses amis Politiques, De Thou particulièrement, et plus tard Henri IV, feront de la politique d’“oubli” un des principes essentiels de la réconsiliation nationale ». Nakam, Géralde, Montaigne et son Temps. Les Événements et les Essais, Paris, A.-G. Nizet, 1982, p. 101.
93 Ibidem, p. 54.
94 Voir l’ample dossier de Nakam sur ce sujet dans le chapitre v (« Cruautés ») de son Les Essais de Montaigne, miroir et proccès de leur temps, op. cit., p. 311-351.