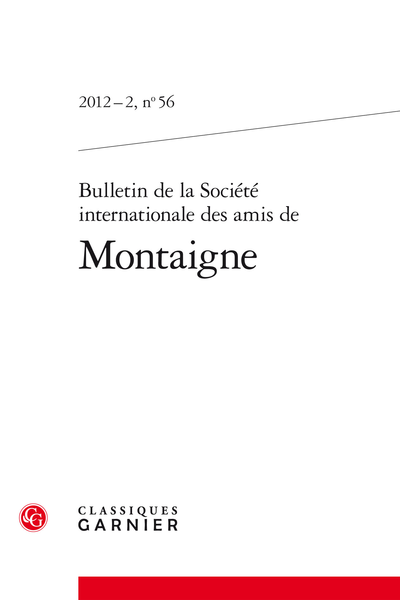
Retrouver les traces du droit Les écritures de Montaigne
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Author: Roussel (François)
- Pages: 177 to 206
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439773
- ISBN: 978-2-8124-3977-3
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0177
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-21-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Retrouver les traces du droit
Les écritures de Montaigne
Pour rassurer les esprits éventuellement inquiets devant certains tropismes philosophiques, il se sera pas proposé ici de variations plus ou moins subtiles sur la notion même de « traces » ; celle-ci est prise dans son sens courant, sans lui accorder une aura poético-philosophique par ailleurs légitime et susceptible de réflexions fécondes qu’on peut trouver chez Jacques Derrida ou Emmanuel Lévinas. S’il y avait cependant à invoquer une orientation intellectuelle stimulante, ce serait celle de Carlo Ginzburg dont il faut rappeler plusieurs choses : 1o outre son grand livre sur Mythes, emblèmes, traces, Montaigne est très présent et à plusieurs titres dans son travail, notamment dans ses réflexions sur la démarche historique et dans sa critique d’une orientation historiographique trop radicalement sceptique identifiant « histoire » et « fiction » ; 2o C. Ginzburg a par ailleurs constamment travaillé en historien et réfléchi en citoyen sur les formes et procédures de la justice instituée1 et sur la question du statut du « témoignage », objets d’analyses attentives qui le relient, au moins latéralement, à Montaigne ; 3o enfin il a rédigé une postface, « Preuves et possibilité », à la traduction italienne du livre de Natalie Zemon-Davis sur le procès de l’affaire « Martin Guerre » (texte récemment traduit en préface à une réédition du livre en français, et également repris dans le recueil Le fil et les traces) – écho lointain, là encore, d’un célèbre passage des Essais dans le chapitre Des boiteux.
Et à titre liminaire, on peut citer l’amorce du texte concernant expressément Montaigne dans ce récent recueil : « Il y a des figures du passé que le temps rapproche au lieu de les éloigner. Montaigne en fait partie. Nous sommes irrésistiblement attirés par son ouverture aux cultures lointaines, par sa curiosité pour la multiplicité et la diversité des
vies humaines, par le dialogue complice et impitoyable qu’il entretient avec lui-même. Ces traits apparemment contradictoires nous le rendent proche. Mais il s’agit d’une impression trompeuse : Montaigne nous échappe. Nous devons essayer de l’aborder en partant de ses catégories, non des nôtres. Ce qui ne signifie pas interpréter Montaigne à partir de Montaigne : perspective discutable et en dernière analyse stérile » (« Montaigne, les cannibales et les grottes », Le fil et les traces, p. 81).
Compte tenu de cette concise et salutaire mise en garde, l’entrecroisement des fils proposés par C. Ginzburg dans les itinéraires singuliers de sa « micro-histoire » suffirait à nourrir une réflexion substantielle dont la notion de « traces », à partir de ce qu’il a nommé « le paradigme indiciaire2 », serait la médiation dans une enquête détournée sur l’écriture des Essais. Mais le propos sera ici de portée beaucoup plus limitée : évoquer les traces du droit comme pratique et comme forme de pensée (ce dont témoignent les textes autographes rédigés par Montaigne dans sa fonction de conseiller et retrouvés dans les archives du Parlement de Bordeaux), traces dont la reprise explicite et la réflexion critique sont absentes ou éludées dans les Essais alors même que ceux-ci regorgent de vocabulaire et de références juridiques ainsi que d’innombrables exemples ou « cas » judiciaires (cas et situations, procès, jeux rhétoriques mimant la « chicane » c’est-à-dire les affrontements codifiés de discours dans un procès, références à des « arrêts » plus ou moins célèbres et répertoriés dans la littérature juridique).
Comme on le sait en effet de très longue date, parfois pour lui en faire grief (cf. notamment Guez de Balzac, ou Arnaud et Nicole), cet effacement ou ce silence concernent la « carrière » parlementaire de Montaigne à la Chambre des Enquêtes pendant treize ans, autrement dit son activité de conseiller sur laquelle les Essais ne disent rien à part quelques brèves allusions incidentes, notamment dans De la physionomie : « Un président se vantait, où j’étais, d’avoir amoncelé deux cents tant de lieux [citations] étrangers en un sien arrêt présidental » (III, 12, p. 413/1056)3 ; ou encore : « Aussi ne hais-je personne ; et suis si lâche à offenser que, pour le service
de la raison même, je ne puis le faire. Et lors que l’occasion m’a conviée aux condamnations criminelles, j’ai plutôt manqué à la justice » (ibid., p. 423/1063). De même les Essais restent silencieux concernant les raisons du retrait de cet « office » de conseiller ; il faut à cet égard se reporter à l’inscription latine que Montaigne fit peindre dans sa « librairie », telle qu’elle est reconstituée : « L’an du Christ 1571, âgé de trente huit ans, la veille des calendes de Mars, Michel de Montaigne, las depuis longtemps déjà de sa servitude du Parlement et des charges publiques, en pleines forces encore, se retira dans le sein des doctes vierges, où, en repos et en sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre. Puisse le destin lui permettre de parfaire cette habitation des douces retraites qu’il a consacrées à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs » (Montaigne, Œuvres complètes, Gallimard, « Pléiade », 1962, p. xvi). Or, comme on le sait également, tel n’est pas le cas de la magistrature politique de Montaigne comme maire de Bordeaux, sur laquelle il a expressément réfléchi et écrit, notamment dans des passages du chapitre De ménager sa volonté souvent et attentivement commentés.
Sur le silence des Essais maintes fois souligné concernant cette carrière parlementaire, l’éclairage ici choisi peut se rapporter à une formulation du chapitre De la solitude, moins connue ou moins sollicitée que d’autres mais peut-être plus significative, l’idée de traces effacées y étant associée à certains comportements animaux : « C’est une lâche ambition de vouloir tirer gloire de son oisiveté et de sa cachette. Il faut faire comme ces animaux qui effacent la trace, à la porte de leur tanière. Ce n’est plus ce qu’il vous faut chercher, que le monde parle de vous, mais comme il faut que vous parliez à vous-même » (I, 39, p. 402/247). Outre son inscription dans une réflexion continue sur le “commerce de soi” caractéristique de l’écriture des Essais4, cette remarque de Montaigne pointe indirectement la difficulté ici mise en lumière et interrogée : quel est le sens de la comparaison entre le « retrait » d’une “vie active” – thématisé notamment dans ce chapitre De la solitude – et la « cachette » de ces animaux qui effacent leurs traces à l’entrée de leur tanière ? Autrement
dit, pourquoi dans le cas de Montaigne, avoir effacé ces traces ? Qu’en reste-t-il concernant cette activité elle-même et concernant ses éventuelles répercutions dans l’écriture des Essais, au delà de développements thématiques qui attestent d’une familiarité évidente avec le champ du droit et des institutions de justice ? Car cette activité judiciaire a bien laissé des traces dont l’empreinte est nettement et fréquemment marquée, y compris lorsque s’agit de s’en déprendre ou de s’en démarquer (« Nous autres qui privons notre jugement du droit de faire des arrêts », III, 8, p. 218/923), et plus encore de se retourner contre elle, de la prendre à revers en soulignant à quel point ses cheminements sont loin d’avoir la rectitude que le nom de « droit » prétend contenir et soutenir (cf. de nombreux développements en I, 23, II, 5, II, 11, III, 13). Il s’agit donc de rappeler de quelles traces il s’agit et en quoi le geste d’effacement de Montaigne ne peut être compris comme une simple dénégation – à supposer trop naïvement qu’une dénégation puisse être simple.
Dans cette orientation de recherche de plus en plus nourrie au fil des ans, la SIAM et le BSAM ont bien évidemment pris toute leur part, notamment depuis les années 70 qui ont vu un regain d’attention portée à la « vie publique » de Montaigne et plus singulièrement à sa « carrière » parlementaire et aux traces que cette activité a pu laisser jusque dans l’écriture des Essais. À défaut de pouvoir en parcourir toutes les dimensions, on va en ponctuer certains traits plus nettement identifiables :
1. la thématisation de la notion même de « trace » dans les Essais, souvent liée à une référence aux « lois de nature » devenues indéchiffrables, « embrouillées » ou « confondues » et recouvertes par l’infinie diversité des lois et coutumes humaines dont Montaigne ne se lasse pas de faire l’inventaire tragi-comique.
2. l’attention progressivement portée par certaines recherches aux traces conservées de l’activité juridictionnelle de Montaigne et à sa remise en contexte : textes rédigés en préparation aux « arrêts » de justice et écrits selon un « style » et une scansion rhétorique spécifique, analyses des « formes » et « formules » de l’institution judiciaire, références aux « arrêts » ou « cas perplexes » qui nourrissent la littérature juridique.
3. les points plus spécifiques qui confrontent les traces de cette activité judiciaire à l’écriture des Essais (statut du témoignage et d’une parole attestant de sa « bonne foi ») et qui sollicitent la dimension juridique de certains termes ou expressions décisifs sans prétendre en livrer l’explication ultime ni exclusive – cf. à titre exemplaire la référence à « l’humaine condition5 ».
Traces effacées, embrouillées, recouvertes
Comme on peut facilement le vérifier via la Concordance des Essais de R.-E. Leake, le registre des « traces » (substantif et verbe) relève des significations ordinaires du terme et mobilise notamment l’image ancienne des « empreintes » laissée en l’âme comme sur de la cire (mémoire, expérience, opinions). Un exemple en est donné dans un passage de l’Apologie de Raymond Sebond évoquant le brusque renversement d’une accoutumance (notamment à la vertu) par l’effet d’une expérience déstabilisante qui vient renverser l’ordonnance apparente de l’âme : « On lui voyait étonner et renverser toutes ses facultés par la seule morsure d’un chien malade, et n’y avoir nulle si grande fermeté de discours, nulle suffisance, nulle vertu, nulle résolution philosophique, nulle contention de ses forces, qui la peut exempter de la sujétion de ces accidents : la salive d’un chétif matin, versée sur la main de Socrate, secouer toute sa sagesse et toutes ses grandes et si réglées imaginations, les anéantir de manière qu’il ne restât aucune trace de sa connaissance première (…) Et ce venin ne trouver non plus de résistance en cette âme qu’en celle d’un enfant de quatre ans – venin capable de faire
devenir toute la philosophie, si elle était incarnée, furieuse et insensée » (II, 12, p. 550/349-350). Cette analyse est ironiquement soulignée par l’exemple (par ailleurs tragique) de Caton le jeune, modèle d’une vertu inflexible et pourtant renversée par un simple accident : « si que Caton, qui tordait le col à la mort même et à la fortune, ne peut souffrir la vue d’un miroir, ou de l’eau, accablé d’épouvantement et d’effroi quand il serait tombé, par la contagion d’un chien enragé, en la maladie que les médecins nomment Hydrophobie ». On reconnait là une variation sur le thème du philosophe apparemment inflexible et pourtant pris de vertige sur une poutre suspendue, incapable de maîtriser les effets de son imagination ici perturbée par une contagion corporelle ou même par la simple idée de cette contagion qui suffit à briser ou “renverser” sa vertu la plus affirmée.
Une analyse de teneur analogue se trouve dans un passage ultérieur du même chapitre où l’insistance porte également sur la fragilité des traces toujours mouvantes qui s’impriment en l’âme comme sur une cire molle, dès lors qu’elle est confrontée à quelque chose de nouveau sinon d’imprémédité (il s’agit en l’occurrence d’idées nouvelles dans l’ordre du savoir cosmologique ou médical) : « Ainsi, quand il se présente à nous quelque doctrine nouvelle, nous avons grande occasion de nous en défier, et de considérer qu’avant qu’elle fut produite sa contraire était en vogue, et comme elle a été renversée par cette-ci, il pourra naître à l’avenir une tierce invention qui choquera de même la seconde. Avant que les principes qu’Aristote a introduits, fussent en crédit, d’autres principes contentaient la raison humaine, comme ceux-ci nous contentent à cette heure. Quelles lettres ont ceux-ci, quel privilège particulier, que le cours de notre invention s’arrête à eux, et qu’à eux appartient pour tout le temps à venir la possession de notre créance ? ils ne sont non plus exempts du boute-hors qu’étaient leurs devanciers. Quand on me presse d’un nouvel argument, c’est à moi à estimer, que ce à quoi je ne puis satisfaire, un autre y satisfera : car de croire toutes les apparences desquelles nous ne pouvons nous défaire, c’est une grande simplesse : il en adviendrait par là que tout le vulgaire, et nous sommes tous du vulgaire, aurait sa créance contournable comme une girouette : car leur âme, étant molle et sans résistance, serait forcée de recevoir sans cesse autres impressions, la dernière effaçant toujours la trace de la précédente. Celui qui se trouve faible, il doit répondre, suivant la pratique, qu’il
en parlera à son conseil, ou s’en rapporter aux plus sages, desquels il a reçu son apprentissage » (II, 12, p. 383-384/570-571).
Le contexte de ce passage est très clair : comment apprécier la portée de doctrines nouvelles dans divers domaines de savoir (astronomie, géométrie, médecine …) ? Quelle « créance » ou crédit leur accorder ? On peut en retenir ici le trait principal souligné par Montaigne : la succession des traces qui se superposent dans l’âme brouille et fragilise leur teneur de vérité en les « confondant » ; et ce mouvement incessant ne peut être corrigé que par la force du jugement qui est capable de reconnaître l’insuffisance de ses propres ressources eu égard à la « science » qui va au delà des « apparences ». Il s’agit alors de savoir bien mesurer sa « créance » en refusant par principe la symétrie convenue et confortable de l’opposition entre confiance aveugle et défiance systématique ; à ce propos, on peut considérer que la recherche et la détermination d’un « savoir mesurer sa créance » est l’objet même du chapitre De l’art de conférer, ce que Pascal n’a pas manqué de reconnaître, tout en lui donnant une tout autre orientation6.
Outre ces significations commune qui mobilisent le registre des « traces » et « empreintes » continuellement recouvertes en l’âme par de nouvelles traces tout aussi éphémères et soumises à contestation, un motif ou un lien plus spécifique est repérable dans nombre de passages des Essais (que les termes y soient expressément ou non) : celui des traces de la nature « empreintes » en nous (raison et lois) mais perdues, effacées, « brouillées ». Un passage significatif se trouve par exemple dans De la punition de la couardise à propos de la différence entre « faiblesse » et « malice » : « À la vérité c’est raison qu’on fasse grande différence entre les fautes qui viennent de notre faiblesse, et celles qui viennent de notre malice. Car en celle-ci nous sommes bandés à notre escient contre les règles de la raison, que nature a empreinte en nous : Et en celles-là, il semble que nous puissions appeler en garant cette même nature, pour nous avoir laissé une telle imperfection et défaillance : De manière
que prou de gens ont pensé qu’on ne se pouvait prendre à nous que de ce que nous faisons contre notre conscience : Et sur cette règle est en partie fondée l’opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales contre les hérétiques et les mécréants : Et celle qui établit qu’un avocat et un juge ne puissent être tenus de ce que par ignorance ils ont failli en leur charge » (I, 16, p. 70/141). Ce passage n’oppose pas, comme à l’ordinaire chez Montaigne, « nature » et « dénaturation » : la faiblesse est aussi du côté de la nature qui nous a laissé « une telle imperfection et défaillance ». Il est significatif que la réflexion morale et politique qui s’ensuit s’articule spontanément au registre des pratiques judiciaires à propos desquelles Montaigne risque ici quelques suggestions théologico-juridiques plus hardies, sans pour autant reprendre ces opinions en son nom propre ni se référer explicitement à son activité antérieure de magistrat.
De manière plus prévisible et attestée, les Essais établissent cependant un lien solide et moins équivoque entre le registre des « traces », souvent effacées ou recouvertes, et l’invocation de la nature comme principe d’évaluation morale. Sur ce registre, on peut se reporter à un ajout manuscrit inséré dans le chapitre De la modération : « Callicles, en Platon, dit l’extrémité de la philosophie être dommageable : et conseille de ne s’y enfoncer outre les bornes du profit : que, prise avec modération, elle est plaisante et commode, mais qu’en fin elle rend un homme sauvage et vicieux : dédaigneux des religions et lois communes : ennemi de la conversation civile : ennemi des voluptés humaines : incapable de toute administration politique et de secourir autrui et de se secourir à soi : propre à être impunément souffleté. Il dit vrai : car, en son excès, elle esclave notre naturelle franchise : et nous dévoie par une importune subtilité du beau et plain chemin que nature nous a tracé. » (I, 30, p. 198/332). Il y a là, comme à de nombreux moments des Essais, une réflexion critique sur l’excès de vertu ou sur la vertu irrépressiblement en excès d’elle même – et la « scène » du suicide de Caton le jeune est un exemple récurrent à cet égard. Il faut d’ailleurs souligner qu’ici, la mise en garde contre cette vertu ou « franchise » dénaturée revient à Calliclès dont Montaigne note laconiquement : « Il dit vrai », ce qui suggère implicitement une prise de distance par rapport à l’attitude socratique visée dans ce passage du Gorgias. Un autre écho de ces « traces de nature », plus favorable à Socrate, se trouve
dans De la physionomie à propos de la « prudhommie », sagesse pratique démarquée de sa version scolastique : « Je l’aime telle, que les lois et religions, non fassent mais parfassent et autorisent : qui se sente de quoi se soutenir sans aide : née en nous de ses propres racines, par la semence de la raison universelle empreinte en tout homme non dénaturé. Cette raison qui redresse Socrate de son vicieux pli, le rend obéissant aux hommes et aux Dieux qui commandent en sa ville, courageux en la mort, non parce que son âme est immortelle, mais parce qu’il est mortel. » (III, 12, p. 418/1059).
Concernant le droit, la justice et les lois, la référence s’entend plus nettement dans ce passage bien connu de l’Apologie de Raymond Sebon où, si le registre des « traces » et « empreintes » ne s’y trouve pas explicitement, l’indication y est bien présente sous la forme indirecte de la référence au brouillage et à la confusion : « Il est croyable qu’il y a des lois naturelles, comme il se voit ès autres créatures ; mais en nous elles sont perdues, cette belle raison humaine s’ingérant par tout de maîtriser et commander, brouillant et confondant le visage des choses selon sa vanité et inconstance » (II, 12, p. 400/580). Ici, nature et raison se présentent comme opposées, l’une comme intangible mais perdue ou entièrement recouverte et « brouillée », l’autre comme entièrement flexible, cet « instrument ployable à tous sens » comparé à une « règle de plomb », et non pas cette « semence de la raison universelle » dont il était question dans le passage précédent. On peut encore se rapporter au passage très souvent cité et commenté dans De l’expérience : « Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et juste (…) Je quête partout sa piste : nous l’avons confondue de traces artificielles. Et ce souverain bien académique et Péripatétique, qui est de vivre selon icelle, devient à cette cause difficile à borner et exprimer » (III, 13, p. 501/1113-1114). L’ensemble du développement dans lequel prennent place ces formules et formulations inscrit le motif des traces dans une réflexion sur le « mariage du plaisir avec la nécessité », la bienheureuse jointure du corps et de l’esprit (« Que l’esprit éveille et vivifie la pesanteur du corps, le corps arrête la légèreté de l’esprit, et la fixe ») et sur le fait de « savoir jouir loyalement de son être7 ».
Sur ce registre des « lois de nature », le développement le plus significatif se trouve dans De la physionomie où l’analyse est saturée de ces « traces » embrouillées et perdues : « Nous avons abandonné nature, et lui voulons apprendre sa leçon : elle qui nous menait si heureusement et si sûrement ! Et cependant les traces de son instruction et ce peu qui par le bénéfice de l’ignorance, reste de son image empreint en la vie de cette tourbe rustique d’hommes impolis, la science est contrainte de l’aller tous les jours empruntant pour en faire patron à ses disciples de constance, d’innocence et de tranquillité. Il fait beau voir : que ceux-ci, pleins de tant de belle connaissance, aient à imiter cette sotte simplicité, et à l’imiter aux premières actions de la vertu : Et que notre sapience apprenne des bêtes mêmes les plus utiles enseignements, aux plus grandes et nécessaires parties de notre vie : Comme il nous faut vivre et mourir, ménager nos biens, aimer et élever nos enfants, entretenir justice – singulier témoignage de l’humaine maladie. Et que cette raison qui se manie à notre poste, trouvant toujours quelque diversité et nouvelleté, ne laisse chez nous aucune trace apparente de la nature : Et en ont fait les hommes comme les parfumiers de l’huile : ils l’ont sophistiquée de tant d’argumentations et de discours appelée du dehors, qu’elle en est devenue variable, et particulière à chacun. Et a perdu son propre visage, constant et universel, Et nous faut en chercher témoignage des bêtes, non sujet à faveur, corruption, ni à diversité d’opinions. Car il est bien vrai qu’elles mêmes ne vont pas toujours exactement dans la route de nature, Mais ce qu’elles en dévient c’est si peu, que vous en apercevez toujours l’ornière. Tout ainsi que les chevaux qu’on mène en main font bien des bonds et des escapades, mais c’est la longueur de leurs longes, et suivent ce néanmoins toujours les pas de celui qui les guide : Et comme l’oiseau prend son vol, mais sous la bride de sa filière » (III, 12, p. 402-403/1049-1050). Ce tableau est familier pour tout lecteur ou lectrice des Essais : la comparaison des hommes aux bêtes tourne rarement sinon jamais en faveur des premiers, surtout sur ce terrain des « lois de nature » et de l’image qui en est malgré tout conservée ou à l’inverse irrémédiablement « corrompue », telle la statue de Glaucus évoquée par Platon au début de La République, rongée par l’eau qui la recouvre. C’est bien ce qui ressort de la confrontation proposée ici par Montaigne, les bêtes constituant le « témoignage » d’une empreinte naturelle effacée ou entièrement brouillée en l’homme.
Pour attester cette « sophistication » artificieuse des lois humaines, leur diversité et leur multiplication dans des « gloses » infinies dont les traces s’entassent les unes sur les autres et se brouillent irrémédiablement, on peut encore se reporter à ce passage très bref et très net dans De l’expérience évoquant quelques juristes célébrés pour leurs commentaires et devenus « autorité » jurisprudentielle : « Nous doutons sur Ulpien, redoutons encore sur Bartolus et Baldus. Il fallait effacer la trace de cette diversité innombrable : non point s’en parer, et en entêter la postérité » (III, 13, p. 428/1067). S’ensuit une analyse bien connue sur la propension à nous « entregloser » dont le champ du droit est le modèle négatif : « Qui ne dirait que les gloses augmentent les doutes et l’ignorance, puisqu’il ne se voit aucun livre, soit humain, soit divin, auquel le monde s’embesogne, duquel l’interprétation fasse tarir la difficulté » (ibid., p. 429/1068). Mais cette critique n’aboutit cependant pas à la conclusion qu’on pourrait effacer toutes ces « gloses » pour revenir à une simplicité première et retrouver une nature perdue.
Comme le précise un passage suivant qu’il faudrait reprendre dans son mouvement d’ensemble : « Il n’y a point de fin en nos inquisitions : Notre fin est en l’autre monde. C’est signe de raccourciment d’esprit quand il se contente, ou de lâcheté. Nul esprit généreux ne s’arrête en soi » (ibid., p. 430/1068). C’est pourquoi nous sommes voués à cette « glose » interminable, à condition de la prendre en un autre sens que son sens proprement juridique ; de ce point de vue, chacun des passages précédemment cités des Essais appellerait une analyse minutieuse qui irait au-delà d’un simple relevé de la thématique des « traces ». Que la « glose » ne se réduise pas à son sens strictement juridique ne dissuade en rien, bien au contraire, de mesurer l’écart entre les formes de discours en scrutant aussi attentivement que possible les « traces » laissées par cette pratique du droit dans les tournures d’esprit de Montaigne – du moins dans ce qui en est attesté comme écriture.
Du « droit de faire des arrêts » :
traces d’une autre écriture
On pourrait alléguer beaucoup d’autres passages concernant cette thématique de la « voix » ou des « lois » de nature dont les traces sont perdues, effacées, brouillées et recouvertes par la « sophistication » de la raison humaine, ce qui dessine par contrecoup un tableau très négatif des institutions de justice forcément « humaines, trop humaines8 ». Ce tableau est bien connu et parcouru de longue date ; on peut notamment se reporter au BSAM de janvier-juin 2001 entièrement consacré à « La justice », avec de nombreux angles d’analyse anticipées, prolongées, reprises, infléchies dans d’autres articles et numéros du BSAM qui portent sur la puissance de la coutume9, sur la question du témoignage et de l’attestation10, sur le statut des « fictions » juridiques11, sur les procès et procédures judiciaires évoqués au détour de tel ou tel développement12, et plus singulièrement sur la question de la cruauté qui incite Montaigne à une réflexion anthropologique constamment relancée sur les rapports complexes entre « nature » et « coutume13 ».
Le seul trait constant de toutes ces analyses a déjà été rappelé : les éléments n’en sont jamais repris et thématisés par Montaigne sous la forme d’une réflexion après-coup concernant son activité comme
conseiller à la Chambre des Enquêtes. Comme on l’a déjà rappelé, les traces identifiables de cette activité ne se trouvent pas dans les Essais, sinon de manière allusive et détournée. Mais elles n’en existent pas moins et un certain nombre de recherches et découvertes en ont progressivement rendu compte, même si les éléments les plus significatifs n’en ont vraiment été étudiés qu’assez récemment. Sur ce point, les choses sont clairement synthétisées dans un article de Katherine Almquist publié dans le BSAM de janvier-juin 1998 : « Quatre arrêts du Parlement de Bordeaux, autographes inédits de Montaigne (mai 1566-août 1567) », article qui a notamment le double mérite de retracer un tableau synthétique de ces textes successivement retrouvés dans les archives et de mettre en perspective les différents horizons de leur réception depuis la fin du xixe siècle.
K. Almquist amorce sa réflexion par une remarque ironique concernant le manque de recul ou de « scepticisme » des commentateurs de Montaigne à l’égard de ses rares allusions concernant son activité de magistrat. Elle critique notamment l’opinion d’Alphonse Grün, auteur de La vie publique de Michel de Montaigne (1855) qui soutient – et beaucoup d’autres après lui – l’idée d’un désintérêt et d’un désengagement de Montaigne eu égard à ses fonctions de Conseiller au Parlement. L’auteure rappelle que cette vision communément reçue et entérinée jusqu’à une date récente était déjà contestée au xixe siècle ; selon elle il faut la renverser définitivement car elle barre l’accès à une lecture attentive des écrits juridiques autographes de Montaigne (textes rédigés en vue d’un « arrêt », qu’on peut nommer plus exactement des dictum, autrement dit des « projets de sentences qui seront dites par la Grand’Chambre et dès lors prendront leur plein effet14 »).
L’article de K. Almquist analyse notamment la constitution d’une sorte d’« image-écran » paradoxalement confortée par P. Bonnefon, à la fin du xixe siècle, alors même qu’il fut le premier à publier des « arrêts » ou textes préparatoires rédigés par La Boétie et Montaigne et retrouvés dans les archives parlementaires. Car cette publication fut assortie d’un jugement comparatif défavorable au second – jugement souvent réitéré jusqu’à une date récente : « Pour être sobre et court, Montaigne est sec.
Son style juridique n’est pas formé comme celui de La Boétie (…) c’est le langage d’un homme qui essaie d’accommoder à sa propre nature des façons de penser et de dire étrangères à son tempérament » (article du BSAM, citation p. 18). Cette appréciation négative a notamment été relayée par G. Hubrecht dans son article sur « Montaigne juriste » publié en 1933 : « Les arrêts de La Boétie sont d’une logique serrée et précise ; ils attestent chez leur auteur un esprit juridique puissant. Ceux de Montaigne, en général beaucoup plus courts et plus vagues, trahissent à la fois l’indifférence et l’indécision du juge » (ibid., citation p. 19). Il y a là, comme l’analyse à juste titre K. Almquist, une propension longtemps partagée à lire ces textes autographes de Montaigne à la lumière rétroactive du cheminement des Essais et de leur « manière » singulière, irréductible à cette rhétorique ou « style » judiciaire des « arrêts » qui semble alors n’offrir aucun lien identifiable avec eux, aucune continuité ou influence d’écriture.
À l’appui de ce constat, on retrouve l’écho amplifié d’un tel jugement négatif dans un livre de Gustave Lanson qui résuma ultérieurement les choses de la manière suivante : « Des années qui suivirent sa sortie du collège, de ses études de droit, à Toulouse ou ailleurs, de ses honorables charges de conseiller à la Cour des aides de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux, l’auteur des Essais ne nous entretient guère. On a remarqué que s’il est fait mention de lui dans les registres de la compagnie, c’est surtout pour noter qu’il est absent, ou qu’il s’en va. Dans quelques endroits du livre où il parle du droit, de la justice et des juges, il paraît n’avoir pas beaucoup d’illusions sur le métier qu’il fait, ni de la joie ou de l’orgueil à le faire […] C’est sans doute dans l’exercice de sa profession qu’il prit en horreur l’atrocité de la justice de son temps […] Il eût voulu que la justice s’abstînt de tous moyens non conformes à la conscience. Mais le pis qu’il y vit, et qui fut un scandale de tous les jours pour son esprit clair et exigeant sur la preuve, fut la confusion, l’incohérence et l’incertitude de toute cette législation, procédures et arrêts qui semblent ne toucher le vrai que par accident […] Ce sont certainement les conclusions de son expérience de magistrat qu’il a consignées au dernier chapitre de son livre, lorsqu’il se plaint de la multitude des lois, des interprétations, des gloses et des commentaires, qui laissent encore place à la dispute des avocats et aux contradictions des tribunaux […] Il n’y a pas d’exagération à supposer que c’est dans
sa fonction de juge que Montaigne prit les premiers germes de son scepticisme » (Les Essais de Montaigne, éd. Mellottée, 1948, p. 25-28).
Même si cette analyse comporte quelques éléments éclairants, l’idée d’une absence répétée et d’une indifférence de Montaigne eu égard à ses fonctions de conseiller doit être battue en brèche. Cette rectification tient notamment à un travail d’inventaire des archives judiciaires et K. Almquist rappelle que le BSAM s’en est fait l’écho dans les années 70 via certaines remarques et indications de travail de R. Trinquet et P. Michel (cf. les BSAM de janvier-mars 1970 et de janvier-mars 1973). Elle rappelle surtout l’importance décisive des analyses développées par A. Tournon dans La glose et l’essai, initialement limitées aux cinq textes autographes publiés par P. Bonnefon, mais prolongées ultérieurement, avec correctifs, dans la réédition du livre et dans nombre d’autres articles publiés depuis. L’importance de ce travail dans la transformation des approches de l’activité judiciaire de Montaigne est marquée avec force : « En refusant de conditionner son évaluation de l’écriture du magistrat par l’écriture de l’essayiste, Tournon agit en bon sceptique : il renversa le point de vue communément adopté par la critique en demandant comment l’image de Montaigne juriste devrait conditionner l’interprétation des Essais (ibid., p. 20) ».
C’est ce travail critique qui a incité K. Almquist à poursuivre les recherches dans archives judiciaires et lui a permis de trouver d’autres textes autographes de Montaigne dont l’analyse est présentée dans la suite de l’article du BSAM. Mais elle s’interroge également sur le manque d’intérêt ordinaire pour de tels textes très codifiés dans leurs formules et structurations et qui, pour un auteur reconnu, vont à l’encontre de la « singularité de sa forme et de sa substance ». C’est bien la perception ordinaire du statut de ces textes qui dissuade alors de « parler du “style” de Montaigne magistrat » (ibid., p. 20). La suite de l’article confirme en grande partie ce constat, tout en s’interrogeant sur la possibilité de déceler malgré tout des « styles » de rédaction et même des formulations spécifiques attestant des différences internes à un mode d’analyse apparemment très codifié et relevant en partie d’une écriture ou réécriture collective. Etudiant le contenu précis de ces textes qui rapportent le détail d’un « cas » à juger, K. Almquist reconnaît cependant « qu’il est très difficile d’aborder les arrêts manuscrits de Montaigne sans les lire du point de vue de son œuvre littéraire » (ibid., p. 23). Et elle conclut son étude par une
hypothèse inscrivant le travail judiciaire de Montaigne dans le tableau d’un groupe restreint de conseillers dont les signatures se retrouvent fréquemment associées : « Si nous détachions notre interprétation de l’écriture juridique de Montaigne de l’influence des Essais, nous devrions la rattacher à ses collègues du Parlement. Représenter correctement la magistrature de Montaigne, c’est encadrer le conseiller au milieu de ses collègues de la 2e chambre des Enquêtes (…) Ce serait dépeindre un tableau de magistrats où la figure de Montaigne sort à peine de l’ombre. Un tableau qui fonctionne un peu comme un contrepoids à la force des Essais, une image qui s’intègre néanmoins à leur défi sceptique » (ibid., p. 33-34).
Mouvements d’écriture, des « arrêts » aux Essais
À la lecture des textes autographes ainsi retranscrits et analysés, il semble difficile de contester l’hypothèse avancée par K. Almquist ; ce qui ne signifie pas pour autant que l’examen doive s’en tenir là et se contenter d’entériner la pure et simple discontinuité entre deux formes d’écriture résolument incommensurables. Peut-on dire qu’il ne reste plus trace de cette écriture judiciaire dans celle des Essais ? Faut-il opposer le mouvement continuel de leurs cheminements à la logique des « arrêts » ou dictum, comme le suggère la formule déjà citée dans De l’art de conférer : « Nous autres qui privons notre jugement du droit de faire des arrêts » (III, 8, p. 218/923) – formule qui éclaire une remarque faite par Albert Thibaudet dans les notes publiées de son livre projeté sur Montaigne, lorsqu’il rappelle le sens de l’essai comme « apprentissage » et comme « épreuve » : « Voilà la vraie raison d’être du style et du titre des Essais. La vie qui se résout, c’est-à-dire qui s’arrête, qui prend une figure fixe et plastique, se tourne naturellement en dogmatique. C’est le mot : arrêt, dans tous les sens, y compris le sens parlementaire sur lequel Montaigne a bien dû s’égayer et méditer. Les arrêts sont le contraire des Essais qui impliquent le mouvement en même temps que l’apprentissage et l’épreuve15 ».
S’ouvrent ici plusieurs direction d’analyse dont on n’esquissera que quelques linéaments susceptibles d’éclairer la réflexion sur les traces persistantes du droit dans l’écriture de Montaigne : 1o quels échos donne-t-il dans les Essais à cette littérature d’« arrêts notables » ou « mémorables », au delà de la critique réitérée des « formes » et « formules » de la justice instituée ? ; 2o comment la scansion particulière des dictum judiciaires rejaillit malgré tout sur le singulier « langage coupé » que Montaigne a adopté ou indiqué dans ses retouches manuscrites aux Essais sur l’exemplaire de Bordeaux ?
Sur le premier point, on peut notamment renvoyer à l’étude récente et éclairante de Stéfan Geonget, « Montaigne et Jean Papon. L’“arrêt notable”, une tradition sabordée par Montaigne », paru dans le NBSIAM (no 50, 2e semestre 2009). L’analyse développée dans cet article confirme que toutes les références à des exemples d’arrêts dans les Essais (il y en a de nombreuses) visent à en défaire l’autorité juridique, alors même que cette autorité jurisprudentielle se voyait confirmée et amplifiée du fait de la compilations d’arrêts « notables » – dont le recueil publié à la même époque par Jean Papon et que Montaigne ne pouvait ignorer16. S. Geonget parle à cet égard d’un « contre-recueil » qu’on pourrait égrener au fil des Essais, faisant pièce à ces recueils d’arrêts « notables » ou « mémorables » qui nourrissent la littérature et la pratique juridique. Il conclut alors son analyse par une appréciation qu’il est difficile de ne pas partager : « Par un travail de sape systématique, Montaigne ruine donc la tradition qui se met en place à l’époque à laquelle il écrit17 ».
L’un des meilleurs exemples en est d’ailleurs la référence au célèbre procès dit de « Martin Guerre » et à « l’arrêt mémorable » rendu et publié ultérieurement par le juge Jean de Coras, tel qu’on le trouve évoqué dans le chapitre Des boiteux : « Je vis en mon enfance un procès, que Corras, conseiller de Toulouse, fit imprimer, d’un accident étrange : de deux hommes qui se présentaient l’un pour l’autre. Il me souvient
(et ne me souvient aussi d’autre chose) qu’il me sembla avoir rendu l’imposture de celui qu’il jugea coupable si merveilleuse et excédant de si loin notre connaissance, et la sienne qui était juge, que je trouvai beaucoup de hardiesse en l’arrêt qui l’avait condamné à être pendu. » (III, 11, p. 375/1030). C’est cet exemple « mémorable » qui amène Montaigne à suggérer ironiquement la forme paradoxale d’un « arrêt » qui se suspendrait lui-même, figure improbable et provocante d’une juridiction acceptant de différer indéfiniment sa décision du fait de l’incertitude des preuves.
La seconde interrogation peut apparaître plus formelle ou formaliste puisqu’elle porte sur la scansion marquée dans ces dictum autographes et son éventuelle persistance dans l’écriture les Essais, à travers le « langage coupé » indiqué et pratiqué par Montaigne dans ses retouches autographes sur l’exemplaire de Bordeaux18. Ce travail inlassablement poursuivi engage de fait bien autre chose qu’une simple question de ponctuation rhétorique, comme le même A. Tournon l’a amplement montré dans nombre de ses analyses dont certains articles publiés dans le BSAM. Cela a donné lieu à des discussions et confrontations dont le BSAM s’est également fait l’écho, même si la question des choix éditoriaux concernant les Essais n’est pas ici évoquée puisqu’on se limitera celle de la scansion ou « segmentation » des textes de Montaigne.
Y a-t-il sur ce point une continuité repérable, quoique implicite, entre les deux régimes d’écriture de « l’arrêt » et de « l’essai » ? Etudiant cette segmentation avec toute la rigueur et le scrupule nécessaire, A. Tournon met l’accent sur la dimension de « témoignage » et d’accréditation d’une parole qui en constitue l’enjeu essentiel. Outre le récent article « Ce que je discours selon moi » publié dans le NBSIAM (premier semestre 2009), il a précisé et accentué son interprétation dans un texte complémentaire, « La scansion dans les documents juridiques du xvie siècle19 », qui contient des éléments peut-être plus directement éclairants et incisifs ici. Il y est rappelé que dans les dictum préparant les « arrêts », la segmentation par usage de majuscules à l’intérieur d’une phrase donnée vise à indiquer
l’oral des paroles et des témoignages recueillis, attestés par l’autorité juridictionnelle ; elle a donc une fonction identifiable et répond à une exigence spécifique de véracité eu égard à un fonctionnement institutionnel où l’oral est nécessairement retranscrit, au risque d’être trahi ou « difformé ».
Montaigne retrouve-t-il cette pratique dans les retouches et indications autographes de ponctuation sur son exemplaire des Essais ? Pris à la lettre, le respect du « langage coupé » fait ressembler cette écriture segmentée à « une écriture de fou », comme une éminente montaigniste l’a suggéré avec un peu d’effroi à A. Tournon. La réponse conclusive de ce dernier semble ici très ajustée : « Le mode d’énonciation qu’il [Montaigne] élabore, ce “langage coupé”, tardivement inventé à partir de l’écriture juridique, est utilisé à contre-emploi et court le risque de paraître déconcertant dès que l’on cesse d’en masquer ou d’en estomper les traits les plus accusés : les marques linguistiques (segmentales) de conviction, d’option, de témoignages – mais de convictions tenues pour contingentes, d’options à haut risque d’inefficacité, de témoignages que rien ne viendra accréditer, si ce n’est la confiance précaire des inconnus qui le liront. Le contraste a bien quelque chose d’aberrant. Mais c’est nous qui lui conférons son incongruité, faute de le comprendre et de jouer correctement le jeu » (L’Écriture des juristes, p. 257-258). L’expression de « contre-emploi » appliquée à l’écriture de Montaigne est ici particulièrement judicieuse : elle indique le maintien d’une logique d’attestation de la parole dans les Essais, attestation dont la provenance est indiscutablement juridique mais coupée de toutes ses justifications et garanties institutionnelles : celle de la justice en l’occurrence, mais plus largement celle de toutes les formes d’institution qui prétendent enseigner, « former » et régenter plutôt que « réciter » c’est-à-dire raconter, interroger, enquêter inlassablement sur les pratiques humaines nourries par d’innombrables « imaginations » ou « fantaisies », sans pour autant prétendre fixer un « arrêt » qui aurait la forme d’un jugement. « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde ? » (III, 9, p. 249/945) : telle pourrait être la formulation la plus expressive de cette écriture à « contre-emploi ».
Persistance des traces : l’« humaine condition »
Alain Legros a relayé et poursuivi plus largement ce travail dans un livre précieux, Montaigne manuscrit (Garnier, 2010) qui recense et éclaire les divers et nombreux textes autographes de Montaigne. Il y reprend notamment l’analyse de ceux qui ont trait à son activité de conseiller à la Chambre des Enquêtes – même s’ils ne constituent pas les traces les plus nombreuses ni les plus significatives eu égard à la portée spéculative qu’on peut y chercher. Cela a permis de nourrir ou de relancer la discussion déjà engagée dans le BSAM autour de cette question de la « segmentation » de l’écriture de Montaigne qui, on vient de le rappeler, n’a rien de simplement formel puisqu’une dimension constitutive du cheminement des Essais y est engagée via cette pratique d’une parole attestant de sa « bonne foi », quoique ne prétendant à nulle autorité sinon peut-être, avec beaucoup de réticence, à celle d’auteur – bien que Montaigne se refuse à être assimilé à un « faiseur de livres ».
Outre la dimension de ce « langage coupé », les traces du droit sont encore perceptibles dans l’usage spécifique et parfois spécifié de certain termes qui ont par ailleurs d’autres significations : « fiction », « jouissance », « condition ». Puisqu’il faut choisir et que certaines indications ont déjà été suggérées ou rappelées concernant les deux premiers termes, on s’arrêtera sur le troisième qui permet de revenir sur l’analyse d’une formule parmi les plus citées et récitées des Essais, jusqu’à apparaître comme l’emblème de leur « sagesse » humaniste supposée : « Chaque homme porte la forme entière, de l’humaine condition » (III, 2, p. 44/805). Là encore le BSAM a pleinement joué son rôle de ponctuation de la recherche et de relance des interprétations qui s’affrontent à propos du sens et de la portée qu’on peut donner à cette célèbre formule.
Dans la continuité des analyses précédentes, c’est notamment A. Tournon qui revient avec force sur le sujet dans un article marquant publié dans le BSAM de juillet-décembre 1990 : « Le grammairien, le jurisconsulte et “l’humaine condition” » – article dont le contenu est repris, prolongé et précisé dans le recueil Route par ailleurs (Champion, 2006, p. 130-151). La démarche suivie est, comme toujours, attentive aux inflexions de sens qui viennent « dérouter » une acception trop vite
établie et accréditée de la formule, surtout lorsqu’elle est retouchée et commentée comme le fait M. Screech dans sa traduction anglaise : « The whole form of the human race is to be found in every single man or woman » (citation donnée dans l’article du BSAM et renvoyant à Montaigne and Melancoly, 1983, p. 106). Il y a là une interprétation « essentialiste » de provenance thomiste revendiquée, ou encore d’inspiration aristotélicienne si l’on se reporte à d’autres auteurs évoqués par A. Tournon pour en démarquer sa propre lecture. Ainsi P.-M. Schuhl qui soutient que « Forme a ici un sens philosophique, technique : chaque homme en est le sujet qui supporte l’essence de l’homme en général ; ce qui varie, ce sont les accidents, mais la forme, c’est-à-dire l’essence, est la même chez tous. C’est par la matière qu’on s’individualise » (Trois essais de Montaigne expliqués par P.-M. Schuhl et G. Guggenheim, Vrin, 1965, p. 67).
À l’inverse, rappelant la défiance de Montaigne à l’égard de tout discours essentialiste nourri de vocabulaire scolastique, E. Auerbach dans Mimesis (Tel-Gallimard) ou B. Croquette dans Études du livre III des Essais (Champion) insistent, quoique de manière différente, sur le lien entre « forme » et « condition », entendant par là des structures d’expérience décisives mais marqués par la contingence ou les aléas de la fortune : douleur, vieillissement, rapport à autrui, violence, mort. Il y a là un horizon de compréhension auquel une lecture ordinairement attentive des Essais ne devrait pas être insensible ; A. Tournon constate cependant sans grande surprise que ces remarques et analyses, relayées par la sienne, n’ont pas eu d’effet notable puisque dans un article ultérieur du BSAM de juillet-décembre 1994, « Le singulier universel », P. Magnard reprend l’acception traditionnelle de la formule sans autre forme d’examen. Il n’y a finalement rien d’étonnant à la persistance de cette interprétation convenue dès lors que l’accent est mis sur la seule notion de « forme », celle de « condition » restant dans l’ombre ou lui étant entièrement subordonnée alors qu’elle seule échappe à ce vocabulaire essentialiste et en perturbe « la routine doctrinale » (cf. Route par ailleurs, p. 132) trop souvent suivie pour en fixer le sens et le rabattre sur ce qui semble bien connu et donc “reconnu”, là où les cheminements de Montaigne visent précisément à défaire cette fausse reconnaissance.
C’est pourquoi l’analyse d’A. Tournon se focalise sur ce terme de « condition » pour en restituer les significations juridiques et en percevoir les échos dans la formulation de Montaigne. Sans entrer dans le détail
par ailleurs nécessaire de ce cheminement attentif, on peut en marquer les étapes en soulignant la distinction ancienne, au delà du simple écart de la graphie latine, entre condicio et conditio, ou plutôt le sens dérivé du second par rapport au premier. Celui-ci renvoie à la stipulation d’une condition entre deux parties (paroles échangées faisant foi), celui-là à la situation instaurée établissant un état (statut), une position morale ou sociale. La dimension théologique du terme, dans sa dérivation dominante de « condition », est marquée par l’idée que « le Dieu de justice a déterminé la “condition humaine” selon les sanctions méritées par le pêché originel » – ce qui nourrit le thème chrétien inépuisable de la « misère » de l’homme. A. Tournon souligne également que dans l’usage du terme « condition », persiste une oscillation continuelle et une superposition des significations : « en vertu de l’histoire du mot telle qu’elle s’inscrit dans ses deux formes concurrentes, la notion de “condition” renvoie indistinctement au résultat d’une convention, con-dicio, déterminée de façon contingente par l’accord occasionnel des contractants, et à l’ordre définitivement instauré, conditum, par le décret du législateur ou même du Créateur » (Route par ailleurs, p. 133).
La dimension plus philosophique du terme, notamment dans l’usage plus commun de l’expression « condition humaine » venu de la théologie, résulte de ces entrecroisements de sens hérités du registre juridique : entre la contingence d’une stipulation contractuelle et la fixité d’un statut posé, les aléas de la “conditionnalité” apparaissent dans le contenu des clauses sans pour autant affecter l’instauration de cette « condition » statutaire selon un geste souverain qui renvoie à une forme de toute-puissance qui surplombe les hommes et les rappellent à leur faiblesse. A. Tournon reformule ainsi les choses : « La “misère” de la condition humaine c’est d’abord d’être en butte aux coups de la fortune (…) La nécessité de supporter cela, uniforme et imposée à tous, n’est que la clôture infranchissable de la zone d’insécurité où l’homme devra faire face à toutes sortes d’événements avant la confrontation suprême avec la mort ; en-deçà rien n’est déterminé : ce qu’est l’homme, l’essence qui le définirait, reste sous-entendue » (Route par ailleurs, p. 135). Cette analyse conduit alors à différencier ce qui relèverait d’une conception de la « nature humaine » de provenance métaphysique explicite, postulant une « identité générique de l’Homme » détachable des vicissitudes de toute vie singulière, et ce
qui relève d’une affirmation de la « condition humaine » accentuant et reformulant l’horizon d’une contingence plus déterminante que toute « essence ».
Tout en corrigeant l’approche initiale de son article du BSAM qui lui avait fait présenter les deux orientations comme incompatibles alors même que les éléments de son analyse n’imposaient nullement cette conséquence et attestaient une effective oscillation de sens, A. Tournon note que la profusion du terme « condition » dans les Essais autorise à en dégager une signification dominante qui s’inscrit dans cet horizon de la contingence et de la fortune, bonne ou mauvaise. Et il cite à l’appui ce passage du dernier chapitre, De l’expérience : « Qui se souvient des maux qu’il a courus, de ceux qui l’ont menacé, des légères occasions qui l’ont remué d’un état à l’autre, se prépare par là aux mutations futures, et à la reconnaissance de sa condition » (III, 13, p. 438/1073). Au-delà de l’héritage complexe des significations juridiques du terme mises en avant par A. Tournon, on pourrait trouver une formulation convergente dans la métaphore de Pic de la Mirandole comparant l’homme à cet animal protéiforme qu’est le caméléon, ou dans la reformulation érasmienne d’une humanité qui se détermine et se constitue non par naissance/essence mais par formation. On en retrouve l’écho ironique dans un chapitre des Essais, De l’inconstance de nos actions : « Notre façon ordinaire, c’est d’aller après les inclinations de notre appétit, à gauche, à dextre, contre-mont, contre-bas, selon que le vent des occasions nous emporte. Nous ne pensons ce que nous voulons qu’au moment où nous le voulons, et changeons comme cet animal qui prend la couleur du lieu où on le couche (…) Nous n’allons pas, on nous emporte » (II, 1, p. 17/333).
Il ne s’agit pas d’imposer à toute force cette dimension exclusive mais d’y entendre une tonalité dominante qui vient incontestablement déjouer le registre d’une conception essentialiste de l’homme. Dans l’analyse d’A. Tournon, la mise au point de la compréhension de ce que peut vouloir dire « la forme entière », dans la phrase de Montaigne, va dans le même sens : la signification juridique de l’adjectif « entière » éclaire la précision apportée en rappelant que seule la présence complète des éléments requis légitime l’ensemble, c’est-à-dire la « forme » – ce qu’on entend a contrario dans l’expression « vice de forme ». Et l’on peut ironiquement relever que l’interprétation substantialiste se voit
obligée d’apparaître sur ce point purement tautologique ou pléonastique puisqu’en dans l’identification à une « essence », une forme qui ne serait pas « entière » serait déjà une autre forme, une autre « essence ».
Droit de réponse, après une lecture tordue
Les vertus d’une telle analyse résident précisément dans la mise en évidence d’une constellation de significations dans laquelle les sollicitations du registre juridique peuvent avoir un rôle très éclairant, d’autant que ce registre est reconnu dans sa complexité et ses oscillations de sens et ne délivre pas une compréhension exclusive des termes et des formulations choisies ou reprises et transformées par Montaigne. Il y a là un travail de lecture attentif et continu pour lequel le BSAM est une terre d’accueil qui suscite et relance la réflexion, à commencer par les contributeurs eux-mêmes. On s’arrêtera pour finir sur le prolongement de cette analyse de l’article du BSAM à propos de « l’humaine condition » dans Route par ailleurs, ce qui conduit A. Tournon à rectifier discrètement mais fermement certaines lectures biaisées, telle celle de J. L. Marion trop vite enclin à lui imputer une approche exclusivement juridique concernant la compréhension de la célèbre formule. Dans un texte intitulé « Qui suis-je pour ne pas dire Ego sum ego existo20 ? », ce fameux et prolixe philosophe, lecteur occasionnel du BSAM en la circonstance, conteste l’interprétation avancée par A. Tournon dans son article, du moins tel qu’il croit pouvoir la restituer : selon lui cette lecture « juridique » de l’expression serait recevable « à condition de comprendre cette “condition” dans un sens strictement et exclusivement juridique ». Et il ajoute : « Il faudrait aussi s’assurer que “condition” a souvent, voire toujours une acception juridique ; or bien des occurrences paraissent relever autant de la métaphysique que du droit21 ». Ces deux remarques critiques ou plutôt polémiques réduisent l’analyse proposée
par A. Tournon à une curieuse clôture sémantique qu’il est pourtant facile de rectifier et de battre en brèche dès lors qu’on ne tombe pas dans les habitudes de langage et de pensée dont l’article du BSAM avait précisément pour but de montrer la réelle et fâcheuse persistance, y compris dans les efforts méritoires pour s’en dégager en essayant d’être au plus près des cheminements de Montaigne.
Peut-être faut-il voir dans le caractère polémique des remarques de J. L. Marion l’effet d’une lecture forcée qui, outre la volonté expresse d’arrimer Montaigne à un héritage métaphysique et théologique très « orthodoxe », veut à tout prix introduire pour son propre compte la « réduction » phénoménologique comme manière de rendre compte du statut du « moi » selon Montaigne ? Sur quoi il y aurait beaucoup à dire, ou plutôt à dédire, comme l’ont fait d’autres lecteurs attentifs tels J. Y. Pouilloux ou T. Cave en marquant l’absence de substantification de ce terme dans les Essais. Dans la reprise de l’analyse qui prolonge l’article du BSAM et en précise certains points sensibles, A. Tournon a clairement et sobrement répondu qu’il faut entendre autrement l’éclairage ainsi apporté dans sa nouveauté : « On découvre ainsi qu’en introduisant la notion de “condition” qui modifie tout, la formule sollicite l’idée héritée dans le sens insolite que requiert l’ensemble du contexte, et signale, en retour, l’hétérodoxie de ce contexte, encore plus nettement que ne l’aurait fait une expression sans antécédents traditionnels. C’est dire que ces antécédents traditionnels restent présents à l’horizon du texte, précisément pour y être “difform[és]” à nouveau service » (III, 2, p. 413). On ne saurait donc affirmer que la notion de « condition », pour prendre son plein sens dans la page considérée, doit être entendue « dans un sens strictement et exclusivement juridique », et selon une détermination qui « s’affranchit de la métaphysique », étant supposé que « le droit reste franc, indemne et autonome envers la métaphysique » (…) Mais qui va prétendre qu’une notion juridique « s’affranchit de la métaphysique » ? Il s’agit au contraire de montrer qu’elle permet de « méditer sur des questions fondamentales – l’identité, le changement, la contingence… – sans rester exclusivement tributaire des doctrines accréditées par l’École ; autrement dit, de repenser la métaphysique, en ne s’affranchissant que des ornières qui la sclérosent » (Route par ailleurs, (p. 141). Dans la subtilité de cette réponse qui rectifie au passage les formulations qui lui avaient été imputées à tort, on ne saurait mieux dire dès lors qu’il
s’agit bien de montrer en quoi les traces du droit dans l’écriture et la pensée de Montaigne ne doivent pas être comprises comme assignation des termes, tels celui de « condition » ou de « forme », à une signification exclusivement juridique. Ces traces incitent bien davantage à une compréhension plus affinée et moins convenue qui suppose précisément de se dégager des significations héritées de l’empreinte scolastique et de ses habitudes de pensée à la fois formatées et déformantes hier comme aujourd’hui, comme le montre à ses dépens l’analyse de J. L. Marion.
On pourrait d’ailleurs poursuivre sinon affiner la critique de la critique, ce qu’A. Tournon ne fait pas, sensible peut-être à la devise de la grand-mère de Sartre telle qu’elle est rapportée dans Les Mots : « Glissez mortels, n’appuyez pas ». Au risque d’appuyer avec un peu plus d’insistance que nécessaire, et sur un registre polémique qui n’est cependant pas toujours injustifié mais que la générosité d’A. Tournon l’incite à ne pas emprunter en cette occasion, on se penchera pour achever cette passe d’armes à fleuret moucheté sur une remarque ultérieure de J. L. Marion. Celui-ci croit enfoncer le clou de sa “démonstration” critique à l’encontre d’une compréhension juridique – et donc au bénéfice d’une signification métaphysique – en citant un passage bien connu du chapitre De l’art de conférer : « Autant peut faire le sot celui qui dit vrai que celui qui dit faux : car nous sommes sur la manière, non sur la matière du dire. Mon humeur est de regarder autant à la forme qu’à la substance » (III, 8, p. 225/928). Cette citation, coupée de sa formule conclusive, est alors suivie de la lecture substantialiste proposée par J. L. Marion qui mobilise ici une terminologie directement empruntée à Aristote pour l’appliquer à un « moi » considéré comme sujet universel : « ici “matière” et “substance” s’identifient l’un à l’autre (…) mon “moi” offre le substrat (et la matière) sur lequel seulement la “forme” de l’humaine condition peut apparaître. Je suis la condition matérielle d’apparition de la “forme” universelle de l’homme en moi22 ».
Pour saisir le caractère biaisé de cette analyse qui appellerait par ailleurs bien d’autres remarques, il suffit de relire simplement l’ensemble de la phrase de Montaigne sans s’arrêter sur les seuls termes hérités d’une compréhension scolastique (même renouvelée sous couvert de réduction phénoménologique) : « Mon humeur est de regarder autant
à la forme qu’à la substance, autant à l’avocat qu’à la cause, comme Alcibiade ordonnait qu’on fît ». Par cette ultime référence à « l’avocat » et à la « cause » qui vient éclairer tout autrement le sens des rapports « manière »/« matière » et « forme »/« substance », on comprend et on entend mieux qu’il s’agit bien, là encore, d’un entrelacement de droit et de métaphysique caractéristique de la manière de Montaigne – ce que ne manquait pas de rappeler avec force A. Tournon en réponse aux thèses déformées que lui impute J. L. Marion. Coupant étrangement la phrase de Montaigne dont la formulation redoublée se tient pourtant dans le même mouvement d’analyse et d’écriture, ce dernier barre la saisie de l’articulation entre registre métaphysique et registre juridique, là où la lecture la plus féconde et la plus scrupuleuse consiste précisément à tendre l’oreille pour s’y rendre attentif. Et on pourrait multiplier les exemples de ces lectures “coupées” – au sens inverse du « langage coupé » caractéristique de la singulière scansion voulue et indiquée par Montaigne dans sa ponctuation des Essais.
L’intérêt de s’être un peu attardé sur cette passe d’arme ne réside pas dans une forme de jubilation polémique mettant en évidence de curieuses distorsions dans la lecture des textes. Il s’agit plutôt de souligner combien les ressources du droit ne sont pas là pour couper court à toute autre dimension de compréhension des termes et des formulations choisies par Montaigne mais bien, à l’inverse, pour montrer les liens multiples que ces ressources mettent en évidence dès lors qu’on ne pratique pas trop cavalièrement une « réduction » phénoménologique fort mal ajustée à son objet. Comme le dit laconiquement et ironiquement A. Tournon en ouvrant du même geste un redoutable programme de travail : il s’agit bien de « repenser la métaphysique, en ne s’affranchissant que des ornières qui la sclérosent ». Toute la difficulté est contenue dans cette petite négation d’une persistante cécité métaphysique ou plus exactement scolastique dont la levée est à coup sûr plus difficile à pratiquer qu’à formuler. La leçon plus générale d’un cheminement comme celui qu’on vient de parcourir est assez simple à tirer : entre articles du BSAM et publications autonomes, il y a une série d’allers-retours qui marquent aussi ce travail fécond de la recherche et de la « conférence » au sens de Montaigne, autrement dit une forme de disputatio singulière car non réglée d’avance, non protocolaire ni encore moins barrée d’emblée par un dispositif d’autorités ou de garants philosophico-théologiques.
Que l’enquête continue
Dans ces restitutions multiples des traces du droit, à la fois comme activité et comme forme de pensée, on est donc face à un chantier de mieux en mieux déblayé, sur le mode d’une fouille archéologique : retrouver la marque de ces traces dans l’écriture de Montaigne (y compris celle antérieure aux Essais, ou dans les marges de leur élaboration qui n’ont parfois rien de « marginal »), et les interpréter en tenant compte d’une stratégie de neutralisation sinon de dissimulation qui reste en partie énigmatique dès lors qu’on la confronte à la manière dont Montaigne réfléchit dans les Essais sur son expérience politique (maire, diplomate, intercesseur voire ambassadeur). Si son activité de magistrat, au sens strictement judiciaire, est quasi-entièrement passée sous silence, les traces négatives (comme on dit les « mains négatives ») y sont largement repérables et fort « instructives », au sens retors de la chute du chapitre De la conscience qui évoque une « condamnation instructive » à propos d’une instruction judiciaire expéditive où c’est la justice qui devient « témoin d’elle même » sur un mode accusatoire23.
Ce silence de Montaigne, comme d’autres plus politiques notamment sur le massacre de la Saint-Barthélemy, reste objet d’interprétations divergentes sinon incompatibles, au delà de celle d’une ambition de carrière déçue qui aurait alors été rejetée, ou de celle de la réaffirmation oblique d’un désir de distinction sociale privilégiant la noblesse d’épée plutôt que la noblesse de robe24. Si Montaigne, faisant comme ces animaux évoqués dans De la solitude, efface les traces d’une activité judiciaire qui n’est jamais assumée en nom propre, ce n’est pas pour brouiller les pistes et se mettre totalement à couvert dans une retraite visant à se protéger des menaces extérieures. Cet effacement renvoie plus expressément à la remarque rappelée plus haut dans De l’expérience : c’est une activité
donc l’effectivité souvent redoutable repose sur des paroles purement formalisées et « vitrifiées », « mécaniques » au sens où Montaigne parle des « mécaniques victoires » à propos des conquêtes coloniales et de la destruction du « nouveau monde » récemment découvert. Telle est du moins l’expérience judiciaire qui est obliquement restituée dans les pages introductives du dernier chapitre consacrées à l’interminable et répétitive glose juridique érigée en contre-modèle de toute parole un tant soit peu inventive.
On pourrait à l’inverse faire valoir l’inventivité de la jurisprudence comme ce qui est véritablement « créateur de droit » selon la suggestion de Gilles Deleuze25 ; mais à l’évidence ce n’est pas ce qu’en a retiré ou retenu Montaigne. Puisque la réflexion critique sur les formes et « formules » institutionnelles de la justice est par ailleurs constante, constamment nourrie et relancée dans les Essais, le silence de Montaigne à l’égard de ses fonctions de conseiller signifie avant tout l’impossibilité d’y reconnaître une parole qui pourrait être subjectivement assumée, revendiquée et explicitée dans ses modalités enquêteuses. Confronté aux réflexions sur sa magistrature politique comme maire de Bordeaux, ce silence incite à esquisser l’hypothèse suivante : si « Le maire et Montaigne, ont toujours été deux, d’une séparation bien claire » (III, 11, p. 347/1012), et si cette dualité relève d’une articulation conceptualisable et justifiable après-coup (entre « la peau » et la « chemise »), rien dans son activité de magistrat ne semble avoir pu faire l’objet d’une quelconque réappropriation en nom propre, d’une parole soutenue en fonction d’un « office », mais néanmoins assumée comme telle. Il y a dans cette activité menée pendant treize ans une pure extériorité que seule la rupture – et non le simple dédoublement sur le mode d’un « rôle » public à jouer – peut vraiment exprimer, même si cette rupture a pris une forme silencieuse et inévitablement équivoque.
En un sens, la parole « libérée » reste en partie conditionnée par cette rupture sourde (non explicitée ou reprise après-coup) que les Essais ne cessent cependant d’éprouver pour en tirer un certain nombre d’éclaircissements sur le travail qui les constitue comme tels : s’essayer « à fer émoulu », comme Montaigne le dit ironiquement à propos des relations de Socrate avec sa femme (II, 11). Tout incite à penser que
la pratique du droit fut, pour Montaigne, un « essai » de cet ordre et qu’il n’y entendit pas, même rétrospectivement, autre chose qu’une contre-épreuve du véritable exercice du jugement, « un jugement qui ne juge pas » selon M. Conche, ou encore « une écriture juridique (…) utilisée à contre-emploi » comme le redit fortement A. Tournon, n’accréditant alors rien d’autre qu’une parole singulière reposant sur la confiance de qui se met à son écoute. On peut inscrire toutes ces analyses dans une réflexion « à distance », en gardant à l’esprit la remarque de C. Ginzburg évoquée en amorce qui met en garde contre la tentation inévitable d’une façon anachronique de parler de Montaigne ou de le faire parler (y compris dans ses silences, esquives et effacements des « traces »). De cette réflexion à distance, la SIAM le BSAM ont été et restent un constant relais, comme le montrent nombre d’articles dont ceux évoqués au fil de ce petit périple sur les traces du droit. Le souhait conclusif ne sera donc guère risqué et n’a rien d’un vœu pieux : que l’enquête continue, et que d’autres y aillent (les Montaigne Studies par exemple), si d’aventure le BSAM n’y allait pas – ce qui n’est guère probable.
François Roussel
1 Cf. notamment Le juge et l’historien (Verdier, 1997) qui prolonge ses études sur les procès de sorcellerie.
2 Cf. Mythes, emblèmes, traces (Verdier, rééd. 2012)
3 Les références entre parenthèses renvoient à l’édition des Essais par A. Tournon en 3 volumes (Imprimerie nationale, 1998, livres I, II, III) ; pour faciliter les renvois de lecture, est également indiquée à la suite la pagination de l’édition Villey-Saulnier récemment regroupée en un seul volume (PUF, 2004).
4 Sur ce thème, je me permets de renvoyer à F. Roussel, « Le commerce de soi », BSAM, juillet-décembre 2002. Les sigles SIAM et BSAM désignent respectivement la Société internationale des amis de Montaigne (anciennement « Société des amis de Montaigne »), et le Bulletin de la Société des amis de Montaigne, devenu de manière éphémère NBSIAM (Nouveau Bulletin) puis BSIAM.
5 Il n’est probablement pas nécessaire – mais je le fais quand même – de rappeler toute la dette contractée à cet égard envers les analyses continues d’A. Tournon qui m’ont rendu, comme beaucoup d’autres, attentif au « travail » et aux « effets » souterrains de la pratique du droit (les remarques qui suivent en seront une nouvelle confirmation). À quoi il me faut ajouter la priorité, pas seulement chronologique, des analyses de J-Y. Pouilloux, toujours aussi vivantes et vivifiantes malgré la distance des années initiales de lecture. Cette orientation de recherche peut également être inscrite dans l’acclimatation et le développement en France du champ d’études « droit et littérature », et notamment dans le travail affiné sur L’écriture des juristes, titre d’un récent volume publié sous la direction de Laurence Giavarini (Garnier, 2010).
6 Cf. sa remarque pour une fois laudative concernant Montaigne dans De l’esprit géométrique et de l’art de persuader : « c’est pourquoi l’incomparable auteur de L’Art de conférer s’arrête avec tant de soin à faire entendre qu’il ne faut pas juger de la capacité d’un homme par l’excellence d’un bon mot qu’on lui entend dire (…) qu’on pénètre, dit-il, l’esprit d’où il sort ; qu’on tente s’il le tient de sa mémoire ou d’un heureux hasard (…) Il faut donc sonder comment cette pensée est logée dans son auteur » (Rivages-poche, p. 142-143).
7 Le registre du « jouir » et de la « jouissance », très insistant dans ces pages ultimes des Essais, contient d’ailleurs une articulation entre l’expérience subjective la plus corporelle et les catégories du droit, qu’il faudrait analyser plus avant.
8 Sur la critique des institutions de justice, outre certains articles du BSAM de janvier-juin 2001, cf. J.P. Dhomaux-Sauleau, « Montaigne et sa critique de la justice », BSAM, janvier-mars 1969.
9 Sur ce thème, cf. Trevor Peach, « De la coutume », BSAM, juillet-décembre 1994 ; Papa Gueye, « Les représentations ironiques de la coutume dans les Essais », BSAM, juillet-décembre 2000.
10 Sur la dimension du témoignage et de l’attestation, cf. notamment O. Guerrier, « “Ce que tu dis à feinte”. Fiction, reconnaissance, vérité », BSAM, juillet-décembre 2006 ; A. Tournon, « Ce que je discours selon moi », NBSIAM, premier semestre 2009.
11 Sur les divers sens du terme, notamment juridique, cf. O. Guerrier, « Des fictions légitimes aux feintes des poètes », BSAM, janvier-juin 2001.
12 Sur les procès de sorcellerie, cf. notamment R. Esclapez, « Deux magistrats humanistes du xvie siècle : Montaigne et Bodin », BSAM, janvier-juin 1987.
13 Sur la cruauté judiciaire et ses autres dimensions, cf. notamment les analyses de G. Nakam dans Le Dernier Montaigne (Champion, 2002), ainsi que son récent article à visée synthétique : « Enquête de Montaigne sur la cruauté », NBSIAM, no 49, 2009. Cf. également F. Roussel, « Désapprendre le mal », BSIAM, no 55, 2012.
14 Cf. A. Tournon, « La scansion dans les documents juridiques du xvie siècle », in L’écriture des juristes, Garnier, 2010, p. 244.
15 Cf. A. Thibaudet, Montaigne (Gallimard, 1963, p. 49-50). Je me permets de renvoyer également à Montaigne. Le magistrat sans juridiction (Michalon, 2006), où j’évoque cette opposition entre forme arrêtée et mouvement de l’enquête dans la 3ème partie, « Suspendre l’arrêt ».
16 Sur la figure de ce juriste, cf. également S. Geonget, « L’arrêt notable entre droit et littérature, les choix de Jean Papon », in L’écriture des juristes (Garnier, 2009, p. 205 sq.).
17 Cette analyse se situe dans le droit fil des recherches de S. Geonget, notamment La notion de perplexité à la Renaissance, Genève, Droz, 2006 ; Littérature et Droit, du Moyen Âge à la période baroque : le procès exemplaire, en collaboration avec B. Méniel, Champion, 2008 ; Droit et justice à la Renaissance, en collaboration avec J.-P. Pittion, Paris, Champion, 2009.
18 Langage coupé auquel A. Tournon a restitué toute son importance, notamment dans son édition des Essais. On peut signaler à cet égard l’intérêt de la nouvelle édition des Essais en Folio-Gallimard (3 volumes), héritière du travail d’A. Tournon, notamment dans cette attention portée à la singulière ponctuation pratiquée par Montaigne.
19 Cf. L’écriture des juristes, Garnier, 2010, p. 241-258.
20 Texte inclus dans le recueil collectif Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, PUF, 2004.
21 « Qui suis-je pour ne pas dire Ego sum ego existo ? », in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, PUF, p. 252.
22 Ibid., p. 253-254.
23 Cf. l’analyse attentive des remaniements importants de ce chapitre par A. Tournon, Route par ailleurs, p. 53-61. J’ai eu l’occasion de recouper les cheminement complexes de ce chapitre par un autre biais, à propos de l’affaire d’Outreau : cf. F. Roussel, « La justice témoin de soi : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne », Droit et culture, no 55, 2008.
24 Pour une critique de ces raisons alléguées par certains lecteurs des Essais, cf. l’article d’A. Tournon, « Justice oblige », BSAM, janvier-juin 2001.
25 Cf. notamment Pourparlers, éd. de Minuit, 1990, p. 209-210.