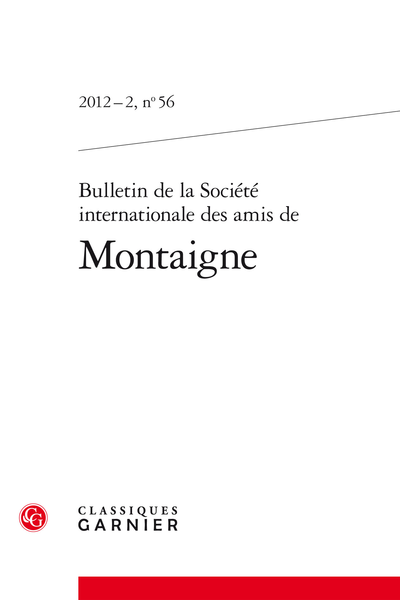
L’imagination entre scepticisme et éthique Imagination-passion, imagination philosophique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Auteur : Panichi (Nicola)
- Pages : 145 à 158
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439773
- ISBN : 978-2-8124-3977-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0145
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
L’imagination entre scepticisme
et éthique
Imagination-passion, imagination philosophique
Un article d’Alain Lagrange sur les passions, paru il y a trente ans dans le Bulletin1, nous aide à comprendre le sens radical de la perspective montaignienne concernant la puissance de l’imagination et sa fonction dans la nature des passions et des plaisirs sensiblement intellectuels, intellectuellement sensibles.
Tout semble se jouer sur la séparation et distinction lucrétienne entre anima et animus : « animus c’est l’esprit séparé, qui juge et qui dirige le corps, instrument docile et silencieux [mens] ; anima c’est l’esprit encore mais “disséminé par tout le corps” [per totum dissita corpus], l’esprit uni au corps, rivé au corps, à un corps qui sent, qui désire, qui souffre, à un corps “en première personne”. La passion n’est ni de l’esprit seul, ni du corps seul, elle est l’expérience fondamentale de l’union de l’esprit et du corps de l’âme2 ». En effet Lucrèce dans le troisième livre du De rerum natura (v. 141-143) avait notamment précisé : « Nunc animum atque animam dico coniuncta teneri/inter se atque unam naturam conficere ex se ».
Lagrange nous donne, via Montaigne, une sorte de phénoménologie imaginative : à côté d’une imagination « reglée » ou anticipation du réel, la « fantasie », imagination qui se détourne du monde extérieur et se laisse aller à interpréter les sensations internes comme dans la rêverie, ensuite l’imagination passionnée et enfin l’imagination poétique, synthèse des trois autres qui les surmonte et les intègre3. Puis il ajoute : « l’acte d’imaginer ou de s’imaginer a toujours aspect affectif : on n’anticipe pas,
on ne rêve pas, on ne s’imagine pas sans s’émouvoir ou se passionner ». Dans cette lecture « l’imagination [montaignienne] n’est que l’aspect intellectuel de la passion : erreur de jugement consécutive à un trouble corporel, tel est le contenu de l’imagination déréglée, c’est-à-dire livrée à elle-même […] Aussi l’imagination dépend-elle essentiellement du corps et de ses états4 ». Lorsque l’on imagine on ne crée pas d’images mais on subit les impressions qui nous viennent du corps : l’agitation du corps est la cause et l’effet de l’imagination, comme Montaigne évoque dans l’expérience de la chute du cheval en II, 6. Nous y revenons. La conclusion est en parfait style « philosophique » : « Le monde de l’imagination est […] un monde totalitaire, où tout se tient, et où tout nous tient ».
Nous sommes ici sur la définition de l’imagination philosophique telle qu’on la retrouve chez Montaigne, à laquelle Dumont dédiera un dense article5 résumant son objet en des termes problématiques : « Nous sommes au seuil d’une philosophie imaginative qui rencontre non pas l’imaginaire mais le réel, un réel cependant incertain et douteux où l’impossibilité de trancher entre l’être et le non-être maintient en équilibre, pour le sujet qui aime, les représentations de la vie et de la mort6 ». Le chapitre en question est De trois bonnes femmes, exemple de la force de l’amour, transmutation symbolique de la douleur en plaisir7. C’est l’imagination (ici la puissance de l’imagination amoureuse) qui permet la transmutation de la vie en mort, et de la mort en vie. La précision apporté dans ce chapitre (« Ce sont pourtant exemples en peu autres, et si pressans qu’ils tirent hardiment la vie en conséquence » [II, 35, 745 ; 649B]8), substitue vie à mort (là où dans Des destriers c’est la mort qui est tirée « en conséquence » (I, 48, 289 ; 458A). Dans le cas de la mort de Sénèque l’imagination philosophique va se mouvoir dans un
cadre élargi qui accueille les représentations conjointes de la vie et de la mort, la représentation amoureuse unique de la vie-mort : « Sénèque n’en finit pas de mourir, parce que Pauline n’en finit pas de vivre, et surtout parce que paradoxalement, avant de finir par mourir, le vieux philosophe lui-même n’en finissait de vivre9 ». Le trait commun entre le vivre et le mourir est fourni par l’amour et l’imagination amoureuse10. Dumont en conclut qu’il serait vain de vouloir établir une séparation entre la raison de Montaigne et son imagination.
Lycas, Apelle ou la Chimère sceptique
Mais notre Bulletin a donné d’autres visages, riches et féconds à cette perspective du discours montaignien sur l’imagination. Je me réfère en particulier aux implications littéraires, rhétoriques et philosophiques aussi des articles d’Olivier Guerrier (auteur notamment du volume Quand les poètes « feignent » : « fantasie » et fiction dans les Essais), d’Emmanuel Naya et de Marie-Luce Demonet qui ont jeté beaucoup de lumière pour la mise au jour de notre problématique. Leurs travaux ont rapporté la conception du fictionnel à une tradition textuelle et philosophique croisée, comprise et réinvestie par l’auteur des Essais dans une dynamique intellectuelle qui a trouvé ses expressions par exemple dans l’exercice judiciaire au long d’une tradition qui a abouti dans le champ de l’éthique, ou le traitement pyrrhonien de la notion de fiction, ou le statut du « chimérique» . Dans Des « fictions legitimes » aux feintes des poètes11, Guerrier explore le rapport que l’imagination entretient avec le droit, les « fictions légitimes », issues du droit romain, socles de la vérité du discours de justice, une confrontation entre un mode de raisonnement de légiste et la démarche des Essais, de ces « fantasies » soumises à une “interne jurisdiction” impliquant un certain rapport à la vérité12. Dans ce contexte Alciati en est un exemple important par
l’introduction des fictions poétiques dans l’armature de ses raisonnements de juriste.
Ces concepts, transposés dans un registre philosophico-moral, ont aidé à chercher à envisager ce qu’on donne pour « fiction » dans les Essais. Le commentaire d’un passage célèbre de Sur des vers de Virgile (III, V, 875 ; 147-48) est repris par Guerrier et approfondi dans l’article : « Ce que tu dis à feinte » : fiction, reconnaissance, vérité13. Le texte Sur des vers de Virgile revendique la parole « à feinte » comme une modalité de la peinture. Mais que fait la vérité en tout cela, se demande Guerrier ? L’expression indirecte (« ce que tu dis à feinte ») et les « tesmoignages fabuleux » de I, 21, deviennent le critère du possible14.
Guerrier avait déjà bien montré comment chez Montaigne, moyennant l’exemple de Lycas15, la « fantasie » devient l’instrument fondamental pour retrouver le bonheur dans quelques dérèglements du jugement, réconciliant la « fantasie » et le sensible, sur lequel porte l’illusion. L’exemple définit un bon sens paradoxal, qui fait d’un comportement insensé la voie de la sagesse. Imagination et folie deviennent source de « contentement ». La perspective eudémoniste l’emporte sur le souci heuristique16. Devenu spectacle, le réel est privé de sa valeur ontologique et va se transformer en apparence : « En cela l’attitude spectatrice peut être reliée à scepticisme, qui procède à une mise entre parenthèses de ce qui est, en le reduisant en état d’apparences17 ». Du reste, le monde imaginé comme un théâtre est l’expression métaphorique d’une forme de scepticisme qui trouve dans l’Apologie son développement philosophique. Le portrait et la conduite de Lycas s’apparentent à ceux de Pyrrhon. Comme Pyrrhon, qui avait renoncé aux « privilèges fantastiques, imaginaires et faux […] d’establir la verité », Lycas regarde le monde avec recul, et jette ainsi le doute sur la valeur ontologique du réel. L’attitude spectatrice préserve de toute implication excessive ; le recul critique est libérateur18.
Dans cette perspective « sceptique », qui délimite le traitement pyrrhonien de la notion de fiction chez Sextus Empiricus, en regardant le statut de la fiction chez les Pyrrhoniens et en la synthétisant par une série de remarques19, E. Naya a souligné comment l’anecdote paradoxale d’Apelle pose la question fondamentale de la relation qui unit ou sépare nos facultés de représentation de la réalité20, enfin le rapport entre fiction et réel. La fiction atteint pleinement son effet de réalité : l’éponge, et seule l’éponge, aurait une vertu mimétique. La skepsis est un processus, dynamique contradiction, expérience incertaine d’elle-même dont les effets intellectuels ont une incidence éthique.
Naya souligne en quelle mesure à la Renaissance la récupération de l’usage pyrrhonien de la fiction dépend du degré de la radicalité propre au pyrrhonisme et rend la pensée à son statut d’expérience – et comment la fiction, dans son extension considérablement modifiée par l’« essai » sextusien, se place au cœur de l’épistémologie montaignienne, permettant de définir le fonctionnement de l’esprit humain. À cet égard l’essai Des boyteux notamment est significatif, rêverie-réflexion théorique sur l’instrument libre et vague de l’humain, sur le rapport entre imagination, persuasion21 et manipulation de la croyance (in I, 21 aussi). L’imagination n’est alors pas seulement productrice d’éléments abstraits mais elle produit des effets sur le vivant, le soumettant à l’aliénation et à l’angoisse. Sous le signe de l’imagination naissent des phénomènes physiques et psychiques, des effets thérapeutiques et des maux, et même on devine en I, 21 qu’on peut prendre des effets naturels pour des stigmates, des phénomènes de lévitation, donc, des miracles. Obiter dicta, la première censure par le second consultor souligne le danger d’une telle assertion : « 122. Tribuit potentiae imaginationis praecipuum assensum, qui datur miraculis. Titulus capitis est : fortis imaginatio facit casum22 ». Dans l’essai Des boyteux, il parlera d’effets analogues dus à la « force de l’apprehension », à la force de l’autosuggestion (III, 11, 1028 ; 372B).
Mais à propos des chimères, Marie-Luce Demonet nous a donné un article paru en 2007, « La fiction comme “chimère” chez Montaigne et
Sanchez23 ». Si Montaigne nous parle de la « Chimera d’Arezzo » dans son Journal, l’image de la chimère désormais symbolise la science vaine dans un emploi du mot chimère au sens figuré (représentation vaine et imaginaire) – sens attesté dans le très célèbre Cortegiano où Castiglione nous indique « strani concetti e nove chimere ». En réalité l’attestation est plus ancienne : elle remonte à Leonardo24 et à Bembo25. Le concept de fiction est présenté dans un tableau très clair articulé en trois niveaux (nous suivons à la lettre Demonet) : les fictions intentionnelles, les fictions légitimes du droit, le mensonge, l’expression indirecte (Guerrier), la création utopique dans les descriptions de police, « feintes par art », fictions produites par jeu, par souci artistique (la poésie qui feint l’âge d’or, la tromperie politique des mythes utiles à la politique et les figmenta des religions païennes – le discours humain, parce qu’il est construit sur le principe de représentation et que toute représentation transforme le réel ; mais ce type de fiction est redoublé dans la création du discours sur le discours – la fiction historique, ce que Demonet a appelé le « possible passé » de l’historiographie qui comble les lacunes de l’histoire par le recours au vraisemblable, avec une modification importante en association à la fiction, l’hypothèse26.
Merci pour ces contributions si riches et si considérables, et leurs significatives implications théoriques.
Imagination voluptueuse, imagination « méthodique »
Maintenant je voudrais exploiter d’autres voies, d’autre routes par ailleurs, pour paraphraser Montaigne et le titre d’un important livre d’André Tournon.
Alors que disent-elles nos routes qui portent sur la religion, la théologie et la politique ? Que l’imagination est surtout une puissance. Dans un Fragment posthume de l’automne-hiver 1887 ([11]287), Nietzsche transcrit une note tirée de la lecture du bibliste et orientaliste Julius Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten)27 sur le concept de potestas. Le texte semble mettre en question les termes du dualisme herméneutique dont Montaigne (Nietzsche s’était montré suffisant lecteur)28 s’était servi pour attaquer le problème de la puissance divine (la toute-puissance de Dieu) considérée comme incommensurable par rapport à notre puissance, la puissance de l’imagination ou de la raison – imagination et raison pris dans les Essais comme des synonimes. Dans le concept de la puissance soit d’un Dieu soit d’un homme, écrit Nietzsche, sont toujours comprises la capacité de servir et la capacité de nuire. C’est une démarche fatale de séparer de façon dualistique la force de l’un de la force de l’autre. C’est ainsi que la morale empoisonne la vie…
Nietzsche dirigera son discours dans une direction paradoxale qui ne l’empêchera cependant pas de soustraire à un tel « destin » le concept de morale de Montaigne en l’associant à celui de puissance de la nature, au point (à juste titre) de définir Montaigne un « naturaliste de l’éthique ».
Au reste, dans un fragment précédent (9 [72]), les repères du discours nietzschéen semblent revenir clairement à leur point originel, même
si – en est témoin ad adiuvandum le paragraphe 48 de l’Antichrist29 – il s’agit encore d’une transcription/remaniement de la pensée du bibliste, tirée cette fois des Prolegomena zur Geschichte Israels30, texte abondamment annoté et souligné comme on le constate en examinant l’exemplaire présent dans la bibliothèque de Nietzsche. Les textes cités introduisent quelques éléments propédeutiques vis-à-vis de notre discours. Même si on ne trouve pas trace de « la panique » et de « l’envie » divines dans les Essais, Dieu – que l’homme appelle, sans pouvoir le connaître, le tout puissant (II, 8, 393 ; 102C : II, 12, 489 ; 250A)31 – est la limite négative de la puissance humaine. Pour Montaigne, la puissance divine reste incomprehensible à l’homme (II, 12, 513 ; 289A). Les promesses divines elles-mêmes « pour dignement les imaginer, il les faut imaginer inimaginables, indicibles, incomprehensibles » (Ibid., 518 ; 298A). Dans son incapacité à mesurer la puissance divine, la faiblesse des pouvoirs de l’imagination/raison admet toute son impuissance. En plusieurs occasions, le rien du tout de la puissance humaine, ipso facto, finit par se décliner en impuissance, defaillance, impossibilité… La connaissance humaine est foible en tout sens (III, 6, 907 ; 194B).
À bien voir, un tel résultat n’est pas définitif dans les Essais et le contraire est souvent vrai : l’impuissance est déclinée comme puissance sur la base du couple synonymique imagination et raison que Montaigne a peu à peu construit et qui deviendra le garant d’une dialectique subtile entre impuissance et puissance : l’impuissance ne l’est pas si elle est en mesure de s’exercer en tant que vis imaginandi. Si Fortis imaginatio generat casum (dans un cadre épistémologique, anthropologique, éthique et historique), si l’imagination est la faculté qui produit « l’échange de place avec l’autre », si elle permet de concevoir mille autres formes de vie et de se mettre dans une optique historique comme Mercure des événements (l’expression est de Hegel) en devenant la clef de voûte du
concept même de possibilité et de futur, l’ouverture anthropologique permet à la réflexion philosophique d’ouvrir d’autres espaces et d’autres temps en partant du présupposé de l’unité psychosomatique, âme et corps, de l’individu qui lui permet de se poser en tant qu’existant capable de cogitations, passions, plaisirs intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels (III, 13, 1107 ; 490C), en évitant ainsi la scission entre raison et passion ou leur affrontement. La raison ne doit pas refroidir la passion, elle doit la guider et l’alimenter…
La vis imaginandi est la véritable puissance de l’homme ; même si, parfois, elle est illusoire, dans ses utilisations épistémologiques, mais surtout éthiques et historiques, elle marque l’horizon d’attente de l’anthropologie humaine. C’est la raison pour laquelle le discours de Montaigne culminera dans le présupposé/résultat du concept total et par certains aspects dépassant le scepticisme de l’infinie puissance de nature, la puissance de nostre mere nature, qui est multiplication et vicissitudes de formes (II, 6, 908 ; 196B).
Mais l’imagination comme agent de la métamorphose, permettant le passage d’une forme à l’autre, est l’antidote contre l’inertie, l’identité, l’intolérance et favorise le continuel enrichissement de soi, de son estre, ce en quoi consiste la nobilitas, la « hauteur extreme de l’humaine nature » (II, 12, 502 ; 271A). On a vu une telle hauteur de la nature humaine chez ces individus qui ont su élever leur force naturelle « au plus haut point de sagesse. Ils ont manié leur ame à tout sens et à tout biais » (Ibid., 502 ; 270A). Comme d’habitude, Montaigne reformule sa pensée : « La plus contraire qualité à un honneste homme, c’est la delicatesse et obligation à certaine façon particulière de vie » (III, 13, 1083 ; 453B).
La « santé » de Montaigne si désirée consiste donc en l’exaltation d’une vie joyeuse qui exclue fixité et identité – et sache expérimenter la sensualité. À bien voir, l’aspiration à la pluralité des formes de vie ne peut exclure, et même elle s’y concentre, le concept même de plaisir, d’exaltation des sens et de leur sens (dans l’acception, donc, de signification), élément consubstantiel à cette santé même. Les mots eux-mêmes devraient être de chair et de sang… Et ici « sens » devient justement signification.
Si dans De vita triplici de Ficin, Vénus n’avait promis que deux plaisirs (voluptates) et Mercure cinq (« puras, perpetuas, salutares, quarum
infima est in olfactu, superior in auditu, sublimior in aspectu, eminentior in imaginatione, in ratione excelsior atque divinior32 » – odorat, ouïe, vue, imagination, raison – qui sont des voies de communication qui rendent l’homme pleinement humain), Montaigne rapporte aux cinq sens les voies de communication qui vont dessiner les confins d’une véritable anthropologie du sens en mesure de permettre la reconstruction d’une sorte de méta-narration, à l’intérieur des Essais, de l’union fondatrice entre « sensible » et « intellectuel » grâce à la puissance de l’imagination.
Notamment Montaigne consacrera un chapitre entier aux odeurs, alliées aux saveurs. Instrument sophistiqué de méditation, l’odorat devient un moyen de connaissance de son propre corps et du corps des autres, des relations interpersonnelles et sociales. Il assume une fonction analogue au goût : il nous parle des autres et de leur univers symbolique. Le goût aussi, sens primitif et archaïque, se prête à l’expérience fondamentale de la rencontre et devient une espèce de moyen de transport qui décentre et dépayse. Qui fait voyager. Il n’est rien de plus instructif que d’expérimenter des saveurs inconnues, étrangères et nouvelles. C’est la découverte à l’intérieur de la sensibilité individuelle de l’univers de l’autre, de nouveaux plaisirs qui poussent à ne pas rester « entre nous » mais d’aller à table comme à autant de rencontres humaines, tout à fait comme l’attente du banquet socratique. C’est la même fonction qu’a le voyage, fils de « cette humeur avide de choses nouvelles et inconnues » (III, 9, 948 ; 252B). Le banquet interculturel est le miroir du mode de sentir, à divers estages, avec la capacité de « se mettre à la place de l’autre ». En effet, il ajoute aussitôt qu’on dit avec raison qu’un homme de bien est un homme composite, un homme meslé.
Les saveurs sont donc un moyen de connaissance, des chemins de pensée, des chemins qui cheminent, des lieux de découverte et de civilisation. Signe d’humanitas, le goût nous révèle à l’autre et au monde, et nous révèle à nous l’autre et le monde, unique et multiple. Montaigne dessine aussi une sorte de synergie et de communication réciproque des sens ; si les odeurs participent du goût, la vue aussi. Et il précise que Pyrrhon le sceptique, au fond, jouissait « [B] de tous plaisirs et commoditez naturelles, embesoignant et se servant de toutes ses pieces
corporelles et spirituelles [C] en regle et droicture » (II, 12, 505 ; 276-267). Autrement dit, quand le scepticisme devient sensualisme33.
Tout en étant conscient que les sens sont trompeurs, il n’évite nullement la « force des sens » et considère la volupté, le plaisir, la vertu voluptueuse et le plaisir de la vertu comme le bien suprême ; il aimerait rebattre les oreilles des philosophes, si hostiles au plaisir, en répétant ce mot (I, 20, 82 ; 157C). La volupté est le critère d’une vie saine : « l’extreme fruit de ma santé ».
Mais ici encore la puissance de l’imagination joue un rôle essentiel. La contradiction comme pratique de la nature prélude à la rencontre de ces couples philosophiques « plaisir » et « vertu », sens et intellect, qui en dessinent la topographie. Il appartiendra justement à la première, apparent antonyme éthique, d’être recomposée et déclinée en forme nouvelle dans l’espace/temps médian du concept de « plaisir de la vertu » et à la second de se poser en conciliation de pulsions esthétiques et de pulsions intellectuelles. Le défi philosophique est de construire l’idée de plaisir intellectuellement sensible, sensiblement intellectuel.
Anatomie de la volupté
Le « plaisir de la vertu » dans sa configuration de « volupté » se compose d’une sorte de principe régulateur du désir : désir de l’être et du réel en une tension/conjonction entre plaisir physique et métaphysique, terre et ciel, sens et raison, Vénus terrestre et Vénus céleste.
Dès les premières phrases, Que philosopher c’est apprendre à mourir, chapitre aux forts accents épicuriens par son éloge appuyé de la volupté (dans les Essais, en tout 81 occurrences) rappelle le ton avec lequel Lorenzo Valla, en particulier dans le De voluptate, en avait desiné le concept. Il ne s’agissait pas seulement d’une adhésion conceptuelle (d’ailleurs partielle, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs)34, mais d’une reprise « philologique », une citation de l’œuvre de Valla, selon moi négligée par
l’historiographie. Mais, tout bien considéré, la cible est double – et elle apparaîtra clairement lorsque le Bordelais fera l’“anatomie” des concepts de volupté et de vertu dans leur subtile recomposition dialectique. Si le plaisir, susceptible de devenir divin et parfait dans sa source première d’humanitas, est procuré par une vertu toute humaine, c’est une erreur de penser que la vertu est « austere et inaccessible ». Dans De la cruauté, Montaigne mettra côte à côte stoïciens et épicuriens : « à la verité, en fermeté et rigueur d’opinions et de precepts, la secte Epicurienne ne cede aucunement à la Stoique » (II, 11, 876 ;149A).
Bien évidemment, l’ontologie rationaliste elle aussi est dans l’erreur (Valla semble être du même avis) elle pour qui le mépris du corps, le mépris des émotions et des affects prélude au mépris des passions politiques et sociales : « bête » ou ange. La déshumanisation de la philosophie s’accomplit sur la base du divorce renouvelé entre théorie et praxis, et Diogène peut devenir chez Valla35 l’emblème de la séparation entre ratio et pathos, affects et effets ; une fois théorisé l’hiatus entre raison et passion, on considérera la nature humaine telle quelle comme peccamineuse et le corps (comme la philosophie stoïque) maladie incurable.
Le refus de son propre corps (et de la vie commune) deviendrait ainsi le chemin obligé pour devenir philosophe et la méthode unique pour atteindre à cette sagesse parfaite qui est, en réalité, pure abstraction, sagesse totalement déshumanisée. La prétendue élévation morale stoïque (mais aussi dialectique, typique de la philosophie rationaliste) qui voudrait anoblir l’homme, en fait un dieu seulement en apparence, un dieu « vêtu » – ou même homme sans humanité, en dessous de l’humanité. Le fait que « omnis voluptas bona est36 » est pour Valla « une opinion commune acceptée » (recepta persuasio)37 : sur ce point, il y a plein accord – même si l’idée du plaisir, qui présuppose la prééminence de la communauté sur le particulier, est une sorte de pré-conception qu’on a ensuite mise en question38.
C’est surtout le chapitre Quod vita contemplativa est species voluptatis qui fournit une contribution décisive pour la formulation du chiasme montaignien référé à la volupté dans le dernier chapitre des Essais. Valla y trouve l’explication suivante : l’unité psychosomatique se compose d’un seul plaisir, du corps et de l’âme : « … quis dubitat, et voluptates corporis adiuvante animo, et voluptates animi subserviente corpore generari39 ? ». Alors, ce que nous pensons n’est presque pas corporel puisque vu, ouï, perçu par nos sens, mais n’est-ce pas ainsi que naît la contemplation ?
Les chapitres 14 et 15 du livre second de De vita de Ficin sont plutôt mordants dans leur tentative de fournir une solution au problème de la conciliation des pulsions esthétiques avec les pulsions intellectuelles, et il est vraisemblable que Montaigne, abeille laborieuse, a pu « digérer » ces textes aussi pour exprimer le concept en le condensant dans le chiasme plusieurs fois évoqué référé à la nature des plaisirs, véhiculé et renforcé par la puissance de l’imagination qui seconde et ne contrarie pas les plaisirs… Une façon de penser par images : Apollon toujours en compagnie de Dionysos, Saturne de Vénus.
Ficin expose sa théorie esthétique qu’on a dejà évoquée : s’il existe cinq voies pour la sensibilité (vue, ouïe, odorat, goût et toucher) il existe cinq voies pour la raison (« esse rursum quinque, ut ita dixerim, discite rationes »)40. Les textes de Ficin aident à bien saisir le point basique de Montaigne sur le plaisir qui établit une pleine correspondance entre le sensible et l’intellectuel. Cinq sens et autant de raisons, même si Ficin semble ensuite réduire en quelque sorte et décliner son intuition sur un plan « ontogénique ».
Pour ainsi dire, Montaigne arrache l’intuition de Ficin à son contexte pour la mettre en place marchande à l’intérieur de la sensualisation de la raison même. S’il faut se garder des chausse-trapes de Vénus, il faut se garder tout autant des plaisirs que provoque la contemplation : Saturne, dévore ses propres enfants41. Mais Vénus et Saturne ne peuvent rester séparés. Chacun participe en quelque sorte de l’autre.
À partir de tels présupposés, on comprend comment on ne peut pas avoir un Montaigne dualiste (raison vs passion). Et l’on revient au point de départ : si l’homme appelle raison la justification post festum de la passion, il n’est pas possible de séparer la raison de l’imagination et du mouvement même de la vie. Vu sous cet angle, Montaigne construit une éthique de l’estroite cousture de l’âme et du corps à la lumière de laquelle la dimension, toujours sensible, de la passion trouve sa pleine légitimation. Dans l’expérience de la demi-mort qu’il éprouva lors de son accident de cheval dans l’essai De l’exercitation, le sentiment de la mort est ressenti comme un acte consubstantiel à la vie, flux de pur affect détaché du mouvement réel, provoquant le plaisir qu’il faut seconder jusqu’à s’y perdre42 : « C’estoit une imagination qui ne faisoit que nager superficiellement en mon ame… » (II, 6, 374 ; 72A). Absence de déplaisir, langueur, douce suspension de l’existence. Ici, expérience de la vie et fantasme réalisé coïncident. Dans le pur mouvement du sentir en tant que matérialisation de l’événement, la vie/mort, simulation affective de la mort dans la vie, est plaisir doux, désiré et redoublé par la puissance de l’imagination, jusqu’à en devenir, par moments, volupté. « Quand je dance, je dance, quand je dors, je dors » (III, 13, 1107 ; 491B) écrivait le Bordelais dans le dernier chapitre des Essais – lui qui avant Nietzsche avait appris à danser sa danse.
« Il y a mille sentiers qui n’ont jamais été parcourus, mille santés et mille terres cachées de la vie. L’homme et la terre des hommes n’ont pas encore été découverts et épuisés43 », dit le Zarathoustra de Nietzsche, lecteur de Montaigne. Sommes-nous au rouet ? Si fortis imaginatio generat casum, l’homme demeurera pour toujours humain, trop humain.
Hic Rhodus, hic salta : ici c’est la rose, ici tu dois danser, à savoir sauter.
Nicola Panichi
Università degli Studi di Urbino « Carlo Bo »
1 « L’homme et le monde dans l’édition des Essais de 1580 – La Passion et les Passions », 3-4, Juillet-décembre 1980, p. 31-52. Dans le numéro 27, Juillet-septembre 1963, Ch. Sécheresse avait publié Montaigne et l’Imagination (p. 18-29).
2 Ibid., p. 32
3 Ibid., p. 37.
4 Ibid., p. 38.
5 J.-P. Dumont, « L’Imagination philosophique de Montaigne », Revue Internationale de Philosophie, 2, 1992, 181, p. 169-189. « Y a-t-il un lieu philosophique où seule l’imagination puisse se mouvoir, et, à défaut, où le concours de l’imagination soit indispensable… » (p. 172).
6 Ibid., p. 176.
7 Ibid., p. 177.
8 Éditions de référence, dans l’ordre : Villey-Saulnier, PUF, Paris 2004 (1965), avec une Préface de M. Conche ; A. Tournon, Présentation, établissement du texte, apparat critique et notes, Imprimerie Nationale, Paris 1998. L’indication de la citation est donnée dans le corps du texte.
9 J.-P. Dumont, L’Imagination philosophique de Montaigne, cit., p. 182.
10 Ibid., p. 186.
11 BSAM, « La Justice », Janv.-juin 2001, 21-22, p. 151-149.
12 Ibid., p. 141.
13 In « Contributions données lors de la journée du 1er avril 2006 à Aix-en-Provence, en l’honneur d’André Tournon, à l’initiative de Daniel Martin et Jean-Raymond Fanlo », BSAM, Juillet-Décembre, 2006, 43-44, p. 50-60.
14 Ibid., p. 58-59.
15 « La “Resverie” de Lycas : un exemple problématique », BSAM, Juillet-Décembre 1995, 41-42, p. 24-38.
16 Ibid., p. 27.
17 Ibid., p. 32-33.
18 Ibid., p. 34 et p. 35.
19 « Apelle peintre abstrait : scepticisme et fiction dans les Essais », [N]BSAM, 2e sémestre 2007, 46, p. 25-40.
20 Ibid., p. 26.
21 Ibid., p. 34.
22 Textes et commentaires in N. Panichi, Montaigne, Carocci, Roma 2010, p. 61-96.
23 [N]BSAM, 2e semestre 2007, cit., p. 7-24.
24 « Della fallace fisonomia e chiromanzia non mi estenderò, perché in esse non è verità ; e questo si manifesta perché tali chimere non hanno fondamenti scientifici » (Trattato della pittura […] tratto da un codice della Biblioteca Vaticana e dedicato alla Maestà di Luigi XVIII re di Francia e di Navarra, nella Stamperia de Romanis, Roma 1817 [Carabba Lanciano 1947, a cura di A. Borzelli], p. 159-160).
25 « Et poi dirà Perottino che ciechi sono gli amanti. Cieco è egli, che non vede le cose che da veder sono, et non so che sogni si va, non dico veggendo, ché veder non si può ciò che non è, anzi pure ciò che non può essere, ma dipingendo : un garzone ignudo, con l’ali, col fuoco, con le saette, quasi una nuova chimera fingendosi, non altramente che se egli mirasse per uno di quelli vetri che sogliono altrui le maraviglie far vedere » (Asolani, II, 22, in Prose della volgar lingua, Gli Asolani, Rime, Utet, Torino 1966, a cura di C. Dionisotti).
26 M.-L. Demonet, La fiction comme “chimère” chez Montaigne et Sanchez, cit., p. 10-11.
27 Drittes Heft, Reste arabischen Heidenthumes, Berlin 1887, p. 218. Aforisme 352 di Der Wille zur Macht, éd. 1911. Cf. Note dell’editore (NdE), à la traduction italienne, Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari Adelphi, Milano 1967-sgg, p. 470.
28 Cf. A. Tournon, Méprises et affinités, in Plures, Montaigne contemporaneo, a cura di N. Panichi, R. Ragghianti, A. Savorelli, Edizioni della Normale, Pisa 2011, p. 9-28. Pour la littérature critique, je renvoie à N. Panichi, Picta historia. Lettura di Montaigne e Nietzsche, QuattroVenti, Urbino 1995 ; Ead., Nietzsche et le « gai scepticisme » de Montaigne, in Nietzsche et l’Humanisme, Actes du Colloque international, Nice 20-22 octobre 2005, « Noesis », X, 2006, p. 93-114 ; cf. aussi Ead., Deus nudus est / Io temo che sia tutto vestito. Nietzsche legge Montaigne, « BSAM », 1, 2012, 55, p. 235-256.
29 L’Anthéchrist, traduit de l’allemand par H. Albert, tr. révisée par J. Lacoste, in F. Nietzsche, Œuvres, édition dirigée par J. Lacoste et J. Le Rider, Préface par Ph. Raynaud, Robert Laffond. Paris 1993, II, p. 1083-1084 (in KGW, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1967-sgg., hrsg. v.).
30 Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 1883, p. 310-336 (dernière rééd. anast. 1967).
31 Sur la toute-puissance de Dieu chez Montaigne voir au moins : Plures, Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, publié sous la direction de V. Carraud et J.-L. Marion, PUF, Paris 2004 ; Plures, Montaigne et la théologie. Dieu à nostre commerce et société, Études publiées sous la direction de Ph. Desan, Droz, Genève 2008.
32 Ficino, De vita triplici, Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 1992, p. 156.
33 Cf. N. Panichi, Montaigne, cit., p. 275-289.
34 J’analyse cette thématique (avec les notes bibliographiques afférentes) en relation avec le concept de sens commun dans l’essai : Sensus communis. La fortuna europea di un concetto di Valla, in Plures, Le radici umanistiche dell’Europa. La diffusione europea del pensiero del Valla, Centro di Studi sul Classicismo, Polistampa, Firenze 2012, p. 285-307.
35 L. Valla, De voluptate ac de vero bono, in Opera omnia, scripta in editione basilensi anno MDXL collecta, I, Bottega d’Erasmo, Torino 1962, avec une préface d’E. Garin, I, 9, p. 908 ; « De vero falsoque bono », critical edition by M. De Panizza Lorch, Adriatica, Bari 1970, 12, p. 16.
36 I, 42, p. 923 ; 42, p. 38.
37 I, 47, p. 926 ; 46, p. 41.
38 III, 1, 929-930 ; 1, 45-47. Si, avec Épicure, le De voluptate identifie le bien suprême avec le plaisir, dès le livre premier, Valla avait précisé qu’il ne tirait pas de la théorie épicurienne l’exclusion de la providence des affaires du monde : la « divina voluptas » l’inclue (III, [30], p. 997 ; 26, p. 136), en raison justement de la vis divinae voluptatis.
39 II, 36, 952 ; 28, p. 76.
40 Ficino, De vita triplici, cit., p. 152.
41 Ibid., p. 156.
42 Cf. F. Brahami, Affection, entrée du Dictionnaire de Michel de Montaigne, publié sous la direction de Ph. Desan, Champion, Paris 20072.
43 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, De la vertu qui donne, in Œuvres, cit., II, p. 342.